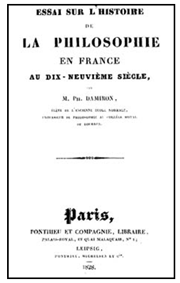 1828 – Philibert Damiron
1828 – Philibert Damiron
Essai sur l’histoire de la philosophie en France au dix-neuvième siècle
Article : Saint-Martin
Par M. Philibert Damiron (1794-1862), élève de l’ancienne École normale, Professeur de philosophie de l’Académie de Paris.
Seconde édition, revue et augmentée -Tome premier
Paris, Schubart et Heideloff, libraires, Quai Malaquais, n° 1. - Leipzig, Ponthieu, Michelsen et Cie - 1828
La première édition ne comportait pas d’article sur Saint-Martin.
Philibert Damiron publie cet article dans la deuxième édition et en explique les raisons.
Une troisième édition a été publiée en 1834 à Paris et une autre en 1835 à Bruxelles (5e édition)
Article : SAINT-MARTIN, (Le Philosophe inconnu)
Saint-MARTIN, (pages 334-350)
(Le Philosophe inconnu),
Né en 1743, et mort en 1803.
Voici un nom que nous avions omis dans notre première édition ; nous croyons aujourd’hui devoir le rétablir, afin de rendre plus complet l’examen auquel nous nous livrons. Il est au reste difficile en parlant de Saint-Martin de le rattacher avec analogie à l’une ou l’autre des écoles dont il est question dans cet Essai : c’est à peine un philosophe, ce n’est surtout pas un philosophe d’une école ou même d’une secte ; il y a quelque chose en lui de singulier, de retiré, de bizarre qui l’isole, et le sépare de tous ; s’il appartient à quelque centre c’est plutôt à une initiation, une société secrète de métaphysique, qu’à une philosophie publique, Rien de moins patent, rien de moins avoué que le système dont on peut suivre de loin en loin la trace cachée dans ses ouvrages. Néanmoins quand à travers le mysticisme, et le secret volontaire dont il enveloppe sa pensée, on parvient à la saisir et à la réduire en abstraction, on reconnaît que la doctrine dont elle parait s’éloigner le moins est celle de l’école théologique. Voilà pourquoi nous le plaçons à la suite des écrivains que nous classons dans cette [335] école. Il n’est pas un d’entre eux, ce n’est ni un catholique, ni même précisément un chrétien, dans le sens vulgaire du mot, mais il a des dogmes communs avec les chrétiens et les catholiques. Peut-être que si l’on remontait loin dans le passé, et qu’on recherchât dans toute sa suite la tradition d’idées dont il est l’interprète, on trouverait qu’il se rattache à une de ces religions philosophiques qui, préparées et venues en même temps que le christianisme, sans se confondre avec lui, eurent pourtant de son esprit, et en ont retenu, jusqu’à nos jours, quelques traits et quelques principes. Peut-être arriverait-on au gnosticisme, ou à quelque doctrine du même genre, dont l’histoire montrerait la transmission et la perpétuité. Quoi qu’il en soit, Saint-Martin n’a certainement nulle part ailleurs une place plus convenable qu’a côté des théologiens (1).
[336] Trois principales circonstances semblent avoir influé sur la tournure de son esprit : l’éducation [337] douce et pieuse qu’il dut à sa belle-mère et qui, comme il le disait lui-même, le fit aimer toute sa vie de Dieu et de ses semblables ; la liaison qu’il forma avec Martinez Pasqualis, chef d’une secte d’illuminés ; enfin la connaissance qu’il eut des ouvrages de Jacob Bœhm dont il traduisit les plus importants (2). Il fallait bien que de bonne heure, et avec la sollicitude la plus active, son âme eût été nourrie de sentiments religieux pour que, jeune, libre et militaire, au lieu de la vie de garnison, qu’il pouvait mener comme tant d’autres, il ait consacré ses loisirs à des études saintes et sévères ; pour que, dans le temps où il était, et avec la philosophie qui régnait, il ait pris dans ses spéculations une direction si opposée au sensualisme du jour. Il n’était pas ordinaire alors que, comme début dans le monde savant, on se livrât au mysticisme. En sa position et à son époque, Saint-Martin fut certainement une exception extrêmement rare. On conçoit sans peine comment dans de telles dispositions, mis en rapport avec Martinez, qu’il rencontra à Bordeaux, saisi de cette espèce de révélation qui lui était faite sous le secret par un homme enthousiaste, enchanté de ces dogmes à huis clos, qui satisfaisaient son [338] cœur, il ait, dès ce moment, voué toute sa pensée à ces recherches enveloppées dont il fut occupé toute sa vie. La lecture de Bœhm, en modifiant quelque peu ses premières vues, ne changea cependant rien à la route qu’il suivait : ce ne fut pour lui qu’une nouvelle lumière, du moins comme il l’entendait, qui servit à mieux éclairer tous ses travaux ultérieurs. Ainsi s’explique, en partie, le génie si singulier du philosophe inconnu. Sans doute aussi dans cette âme il devait y avoir, de naissance, de tempérament si l’on veut, une faculté particulière qui se prêtât à ces influences ; toute âme n’y eût pas cédé : il devait y avoir ce besoin de s’instruire par voie d’inspiration ou de croyance, qui porte à se fier à un sentiment comme à une théorie, et, à une confidence comme à une raison ; c’était une curiosité de poète, plutôt que de savant et de philosophe, sur des questions où il est plus aisé de rêver et d’espérer, que de savoir et de comprendre. On voit de ces esprits qui aiment à aller vite à la lumière, et qui, dans l’impatience de la trouver, descendent d’abord dans des profondeurs, sans autre guide que la foi, ou une ardente imagination ; leur penchant est le mysticisme ; car le mysticisme consiste à ne faire de la vérité qu’un objet de tradition ou de simple intuition : il y avait de cela dans Saint-Martin, c’était une intelligence mystique, merveilleusement propre en conséquence à recevoir les impressions des maîtres qu’il écouta.
[339] Ajoutons que bientôt, quittant le métier des armes pour être mieux à ses études, donnant presque à sa vie quelque chose du secret de sa doctrine, retiré, solitaire, lié seulement avec quelques amis qui étaient ses adeptes, discutant peu, prêchant beaucoup, mais dans des livres ; ne répondant aux objections que par des obscurités ou des réticences, s'y croyant obligé, et rentrant à chaque instant dans l’arcane mystérieux où il était impossible de le suivre, il eut nécessairement peu d’occasion de réformer ses idées, et de sortir de son système. La révolution même, qui le trouva en pleine méditation, ne parvint pas à le troubler, quoiqu’il n’y fût pas indifférent : il y vit une image en miniature du jugement dernier ; un événement dont le mobile secret et la venue se liaient avec ses idées, et le comblaient d’avance d’une satisfaction inconnue même à ceux qui s’en montraient les plus ardents défenseurs ; c’est-à-dire qu’au bruit que faisaient les choses autour de sa solitude, il se détourna un moment de ses paisibles imaginations pour jeter un regard, les juger de son point de vue, et revenir ensuite à ses pensées habituelles. Tel fut Saint-Martin jusqu’à la fin de ses jours ; dévoué à ses travaux avec un calme, un désintéressement et une constance admirables.
Il y a deux choses dans ses ouvrages, la critique et le dogme ; il importe de les distinguer.
Dans la critique, il s’adresse aux observateurs de son temps ; c’est le mot dont il se sert pour dési- [340] gner les sensualistes. Il les attaque sur plusieurs points, et les attaque avec avantage ; il a toute raison contre eux dans les objections qu’il leur propose sur leur manière d’expliquer Dieu, l’homme et la nature ; il leur en montre clairement le défaut et la fausseté.
N’admettre au monde que la matière avec ses éléments et ses propriétés, nier les forces, les esprits, les principes simples et actifs, ne pas leur accorder une existence propre, et les confondre avec les corps, c’est, selon lui, se réduire à l'impossibilité de reconnaître dans la cause première la puissance qui crée et gouverne tout, dans l’homme la moralité ; dans la nature, la vie et le mouvement, dont elle est pleine. A chaque instant il arrête les observateurs par quelques remarques, qui sont aussi justes qu'embarrassantes : il y joint fréquemment des paroles du fond du cœur, dans lesquelles, avec son amour de tout ce qui lui semble beau, saint, consolant pour l’humanité, il déplore des erreurs qui tournent contre ses croyances. Il ne manque ni de force, ni de vérité, ni d’éloquence tant qu’il demeure en ces termes, et, comme la plupart des hommes, tant qu’il critique il a l'avantage ; mais il est plus fort pour détruire que pour construire et édifier.
Aussi, dans la partie dogmatique est-il loin de valoir autant. D’abord, ainsi que nous l’avons dit, il pèche par une double obscurité, celle qui lui est naturelle comme mystique, et celle qu’il s’impose comme croyant, comme membre d’une loge [341] métaphysique qui a ses secrets et son chiffre. En voici un exemple : il pense que l’homme, à son origine, a vécu dans un tel état de pureté et de lumière, qu’il approchait de Dieu même ; une faute l’a souillé et depuis, dégradé, désunit de son principe, il ne lui reste plus qu’à expier en lui-même ou dans les siens le crime dont il s’est rendu et dont il les a rendus coupables. Saint-Martin énonce à peu près en ces termes ce dogme déjà obscur d’une ontologie toute mystique : autrefois l’homme avait une armure impénétrable, il était muni d’une lance, composée de quatre métaux, et qui frappait toujours en deux endroits à la fois ; il devait combattre dans une forêt formée de sept arbres, dont chacun avait seize racines et quatre cent quatre-vingt-dix branches ; il devait occuper le centre de ce pays ; mais s’en étant éloigné il changea sa bonne armure contre une autre qui ne valait rien, il s’était égaré en allant de quatre à neuf, et il ne pouvait se retrouver qu’en revenant de neuf à quatre. Il ajoute que cette loi terrible était imposée à tous ceux qui habitaient la région des pères et des mères, mais qu’elle n’était point comparable à l’effrayante et épouvantable loi du nombre cinquante-six, et que ceux qui s’exposaient à celle-ci ne pouvaient arriver à soixante-quatre qu’après l’avoir subie dans toute sa rigueur, etc., etc. — Il est clair que, pour saisir le sens caché sous ces ses énigmes, il faut avoir le mot de passe, sans quoi il y a impossibilité d’interpréter ; or, ce mot n’est pas donné, [342] ou ne l’est qu’aux initiés. Pour les autres, qu’ils ne cherchent pas, ils ne trouveraient pas : on ne veut pas qu’ils entendent, et certainement ils n’entendront pas.
C’est dans le livre des erreurs et de la vérité, le principal des ouvrages de Saint-Martin, celui dans lequel il philosophe le plus (car, dans les autres, il ne fait guère que prêcher et prier), qu’il faut surtout voir quel est son système sur les principales questions dont il s’occupe. On y peut démêler un certain nombre de points tous liés les uns aux autres, dont se compose son hypothèse.
Il n’est pas bien certain, en premier lieu, et, dans son idée du bien et du mal, il n’y ait pas un fonds de manichéisme ; on pourrait le conclure de certains passages, où il semble regarder ces deux choses comme deux substances, deux êtres, deux principes, qui ne sont pas, il est vrai, égaux en pouvoir, le bien étant infiniment supérieur au mal, mais qui n’en pas moins en présence et en combat. Cependant quelquefois, on dirait aussi qu’il n’admet qu’un principe, le bon, et qu’il explique le mal par l’activité nécessairement imparfaite, ou [350] volontairement déréglée des forces libres et intelligentes. Il serait difficile de dire quelle est au juste son opinion ; cependant ce serait peut-être plutôt dans ce dernier sens qu’il conviendrait de la comprendre.
Quoi qu’il en soit, l’homme, sujet du bon principe, a d’abord vécu uni en lui, et tant qu’a duré [343] cette union, parfait, puissant, presque divin, il a commandé à la nature, n’a eu ni besoin ni souffrance, n’a point connu l’expiation. Mais sa volonté a failli ; il s’est détaché de Dieu ; en tombant, il s’est affaibli, corrompu, mis dans la dure condition de se laver de son péché, et de revenir par le repentir à la source de toute pureté, de toute lumière et de toute force.
Cela explique ses misères vis-à-vis de la nature, et le rude travail qu’il lui faut faire pour reprendre sur elle un pouvoir qu’il avait primitivement dans toute sa plénitude.
Cela explique aussi la société telle que nous la voyons aujourd’hui, avec ses institutions, ses lois, et ses gouvernements. Il est assez curieux de voir quelle politique Saint-Martin déduit de ces données.
Si les hommes étaient restés dans leur pureté primitive, il n’y aurait point parmi eux d’inférieurs ni de supérieurs, il n’y aurait point de souveraineté ; tous seraient égaux parfaitement ; ils l’étaient tous dans leur état de gloire ; il n’y avait pas alors de rangs entre eux ; il n’y avait nulle distinction, parce qu’ils jouissaient tous sans défaut de la plénitude de leurs facultés. Si donc ils commandaient, ce n’était pas leurs semblables, qui ne pouvaient être leurs sujets, c’était des êtres moins parfaits, aux animaux, à la nature, à tout ce qui avait besoin d’être relevé et amélioré. Mais eux, dans leur espèce, ils n’avaient ni maîtres, ni esclaves, ni rois, ni gou- [344] vernés, ils vivaient libres et sans loi. Il a fallu la chute, et des degrés dans la chute, il a fallu des vices et des défauts de toute espèce pour amener dans l’ordre social, des inégalités et des différences, pour y introduire la souveraineté. Elle n’a sa raison que dans le plus ou moins de malice qui se trouve dans chacun de nous. « Dans cet état de réprobation où l’homme est condamné à ramper, et où il n’aperçoit que le voile et l’ombre de la vraie lumière, il conserve plus ou moins le souvenir de sa gloire ; il nourrît plus ou moins le désir d’y remonter, le tout en raison de l’usage libre de ses facultés intellectuelles, en raison des travaux qui lui sont préparés par la justice, et de l’emploi qu’il doit avoir dans l’œuvre.
« Les uns se laissent subjuguer, et succombent aux écueils semés sans nombre dans ce cloaque élémentaire, les autres ont le courage et le bonheur de les éviter.
« On doit donc dire que celui qui s’en préservera le mieux aura le moins laissé défigurer l’idée de son principe, et se sera le moins éloigné de son premier état. Or, si les autres hommes n’ont pas fait les mêmes efforts, qu’ils n’aient pas les mêmes dons, il est clair que celui qui aura tous ces avantages sur eux doit être leur supérieur et les gouverner. »
Ainsi la valeur morale des individus, mesurée sur la règle d’expiation, voilà ce qui doit faire, en politique, le rang des classes et des personnes.
[345] Si telle est l’origine du pouvoir souverain, il est aisé de s’expliquer les différentes formes, selon lesquelles il a été et dû être exercé. Un seul homme, une seule grande âme s’est-elle élevée à un point de purification et de lumière, qui dépasse de bien loin tout ce qui est autour d’elle, celle-là a de droit la monarchie ; quand un seul est capable, un seul doit gouverner : mais un certain nombre a-t-il ce mérite, c’est-à-dire a-t-il le mérite de s’être rapproché davantage de cette bonté originelle, qui est la seule légitimité, il doit régner de concert avec tel arrangement et en telles combinaisons que la justice exige : enfin si un plus grand nombre encore, si les masses, si le peuple entier est en position morale de faire lui-même ses affaires, qu’il contribue directement ou indirectement en personne ou par représentation, peu importe, pourvu que l’autorité soit toujours en raison de la pureté ; car c’est toujours là le principe. Les formes quelles qu’elles soient n’ont pas vertu par elles-mêmes, elles ne sont bonnes que par la manière dont elles satisfont à l’ordre social : c’est pourquoi toutes ont et doivent avoir leurs chances et leur moment.
Du reste, l’idéal des souverains serait non pas seulement de posséder les lumières qu’on leur voit communément, mais d’avoir cette science qui, embrassant tout, comprenant tout, universelle et complète, véritable omniscience, ne les laisserait étrangers à rien : alors ils ne borneraient pas leurs soins au gouvernement général de la société ; ils [346] pourvoiraient à mille besoins que d’ordinaire ils négligent ; ils veilleraient à mille affaires qui leur échappent trop souvent ; en se montrant plus éclairés, ils deviendraient plus puissants, et leur sagesse serait le titre et la garantie de leur pouvoir.
Telles sont quelques unes des idées extraites de l’ouvrage que nous avons citées, et ramenées, non pas sans peine, du langage mystique qu’emploie l’auteur, au langage commun qui pourrait les rendre.
Si on ne l’aperçoit bien nettement, on l’entrevoit du moins ; cette politique, a dans son mysticisme, une tendance au fond libérale ; elle est certainement philanthropique ; il ne faudrait, pour s’en convaincre, que lire un peu l’auteur, que faire connaissance avec lui, et apprécier les sentiments qui lui dictent ses écrits. Ce n’est pas comme M. de Maistre avec lequel il a quelque rapport de croyance et de système, au sujet du premier état, de la chute et de l’expiation. Tandis que celui-ci, avec son génie sévère, haut et implacable, ne tire de ces principes que de dures maximes d’état, Saint-Martin, avec son cœur si bienveillant et si tendre, n’aspire qu’à les tourner au bonheur de ses semblables ; il les tempère de toute son âme, les adoucit par pitié, y mêle une onction qui en corrige heureusement la terrible austérité. S’il a de l’analogie avec quelqu’un qui est aussi un peu de sa foi, c’est plutôt avec M. Ballanche : il a même affection, même charité, même sympathie pour le genre humain.
[347] Pour achever de donner une idée de l’espèce de philosophie qu’on trouve dans les ouvrages de Saint-Martin, nous rapporterons un morceau extrait d’article inséré dans les Archives littéraires (3) : cet article est d’un rédacteur qui parait avoir étudié avec attention les diverses productions du philosophe inconnu : « Son système permet d’expliquer tout par l’homme : l’homme, selon lui, est la clef de toute énigme et l’image de toute vérité. Prenant ainsi à la lettre ce fameux oracle de Delphes, noce te ipsum, il soutient que, pour ne pas se méprendre sur l’harmonie de tous les êtres de l'univers, il suffit à l’homme de se bien connaître lui-même, parce que le corps de l’homme a un rapport nécessaire avec tout ce qui est visible, et que son esprit est le type de tout ce qui est invisible. Que l’homme étudie donc, et ses facultés physiques dépendantes de l'organisation son corps, et ses facultés intellectuelles, dont l’exercice est souvent influencé par les sens ou par les objets extérieurs, et ses facultés morales ou sa conscience, qui suppose en lui une volonté libre. C’est dans cette étude qu’il doit rechercher la vérité, et il trouvera en lui-même tous les moyens nécessaires pour y arriver : voilà ce que l’auteur appelle la révélation naturelle. Par exemple, la plus légère attention suffit, dit-il, pour nous [348] apprendre que nous ne communiquons, et que nous ne formons même aucune idée qu’elle ne soit précédée d’un tableau ou d'une image engendrée par notre intelligence : c’est ainsi que nous créons le plan d’un édifice et d’un ouvrage quelconque. Notre faculté créatrice est vaste, active, inépuisable mais, en l’examinant de près, nous voyons qu’elle n’est que secondaire, temporelle, dépendante, c’est-à-dire qu’elle doit son origine à une faculté créatrice supérieure, indépendante, universelle, dont la notre n’est qu’une faible copie : l’homme est donc un type qui doit avoir son prototype, et ce prototype est Dieu. » Voilà pourquoi Saint-Martin dit quelque part que l’homme n’est qu’une pensée de Dieu, pensée qu’il peut laisser s’obscurcir et s’altérer, mais qu’il peut aussi ramener à la vérité et à la lumière en prenant soin de se purifier, et alors il connaît Dieu, qui est cette pensée même, il l’a et le sent en lui. Celui qui connaît Dieu, disent les philosophes indiens, devient Dieu lui-même ; selon Saint-Martin, il en devient au moins l’image, quand il s’est lavé de la corruption dont sa chute l’a souillé.
On sait trop ce qu’il peut y avoir de faux et de vrai, ou plutôt d’ombre et de vérité dans les idées que nous venons de parcourir, pour qu’il soit nécessaire de le montrer expressément ; la manière seule dont elles ont été exposées en est une critique suffisante. Nous nous bornerons donc à [349] remarquer que, sauf la forme et la couleur, rentrant dans celles de M. de Maistre, au moins sous quelques rapports principaux, elles donneraient lieu aux objections, et laisseraient prise aux mêmes arguments ; ce seraient mêmes preuves à reproduire, nous aimons mieux y renvoyer.
Ajoutons que, si l’on voulait suivre le système de Saint-Martin dans sa partie physique et mathématique, on n’y trouverait que des étrangetés qui, dans l'état actuel de ces sciences, ne mériteraient pas une discussion sérieuse.
Tel est, dans sa plus grande généralité, c’est-à-dire dans tout ce qui peut avoir quelque intérêt pour le public, l’illuminisme de Saint-Martin (4). Pour qui aurait plus de curiosité, nous citerons les ouvrages suivants, que chacun peut consulter : 1° des Erreurs et de la Vérité (Lyon) 1775, in-8° ; 2° du Tableau naturel ; 3° de l’Esprit des choses ; 4° du Crocodile, la plus bizarre et la obscure [357] des compositions de l’auteur ; 5° du Ministère de l’Homme-esprit ; 7° Éclair sur l’Association humaine (Paris, an V, 1797 ), in-8°.
Il va sans dire qu’en plaçant Saint-Martin à la fin de l'École théologique, nous ne suivons pas l’ordre de date, car à ce compte il serait en tête ; c’est plutôt comme un lieu à part, que nous avons voulu lui donner ; nous l’avons placé le dernier [350] pour isoler, et par là mieux marquer la nuance qui le distingue ; à peu près comme nous avons fait, dans l’École sensualiste pour le docteur Gall et M. Azaïs.
![]() SAINT-MARTIN, Le Philosophe inconnu
SAINT-MARTIN, Le Philosophe inconnu
Notes
1. Voici comment M. de Maistre s’explique sur les Illuminés en général, et sur Saint-Martin en particulier ; il peut être curieux de voir ce qu’il en pense.
« En premier lieu, je ne dis pas que tout illuminé soit franc-maçon ; je dis seulement que ceux que j’ai connus, en France surtout, l’étaient ; leur dogme fondamental est que le christianisme, tel que nous le connaissons aujourd’hui, n’est qu’une véritable loge bleue faite pour le vulgaire ; mais qu’il dépend de l’homme de désir de s’élever de grade en grade jusqu’aux connaissances sublimes, telles que les possédaient les premiers chrétiens, qui étaient de véritables initiés. C’est ce que certains Allemands ont appelé le christianisme transcendantal. Cette doctrine est un mélange de platonisme, d’origénianisme, et de philosophie hermétique sur une base chrétienne.
» Les connaissances surnaturelles sont le grand but de leurs travaux et de leurs espérances ; ils ne doutent point qu’il ne soit possible à l’homme de se mettre en communication avec le monde spirituel, d’avoir un commerce avec les esprits, et de découvrir ainsi les plus rares mystères.
» Leur coutume invariable, est de donner des noms extraordinaires aux choses les plus connues sous des noms consacrés : ainsi, un homme pour eux est un mineur, et sa naissance, une émancipation. Le péché originel s’appelle le crime primitif, les actes de la puissance divine ou de ses agents dans l’univers s’appellent des bénédictions, et les peines infligées aux coupables, des pâtiments. Souvent je les ai tenus en pâtiment lorsqu’il m’arrivait de leur soutenir que tout ce qu’ils disaient de vrai n’était que le catéchisme couvert de mots étranges.
» J’ai eu l’occasion de me convaincre, il y a plus de trente ans, dans une grande ville de France, qu’une certaine classe de ces illuminés avait des grades supérieurs inconnus aux initiés admis à leurs assemblées ordinaires ; qu'ils avaient même un culte et des prêtres qu’ils nommaient du nom hébreu Cohen.
» Ce n’est pas, au reste, qu’il ne puisse y avoir et qu’il n’y ait réellement dans leurs ouvrages des choses vraies, raisonnables et touchantes, mais qui sont trop rachetées par ce qu’ils ont mêlé de faux et de dangereux, surtout à cause de leur aversion pour toute autorité et hiérarchie sacerdotales. Ce caractère est général parmi eux : jamais je n’y ai rencontré d’exception parfaite parmi les nombreux adeptes que j'ai connus.
» Le plus instruit, le plus sage et le plus élégant des théosophes modernes, Saint-Martin, dont les ouvrages furent le code des hommes dont je parle, participait cependant à ce caractère général. Il est mort sans avoir voulu recevoir un prêtre ; et ses ouvrages présentent la preuve la plus claire qu’il ne croyait pas à la légitimité du sacerdoce chrétien. » (Soirées de Saint-Pétersbourg, tome 2, page 332.).
2. Entre autres : l’Aurore naissante, ou la Racine de la Philosophie.
3. En 1804 peu après la mort de Saint-Martin. [Il s’agit de l’article de René Tourlet (1757-1836) Notice historique sur les principaux ouvrages du Philosophe inconnu et sur leur auteur Louis-Claude de Saint-Martin, publiée en 1804 dans Le Moniteur, puis dans Archives littéraires de l’Europe. Cette dernière version comporte des notes additives de l’éditeur. Le Site Le Philosophe inconnu : www.philosophe-inconnu.com/Homme/notice_tourlet_1.htm a publié cette notice].
4. Voyez l’article Saint-Martin dans la Biographie universelle, tome 40.



