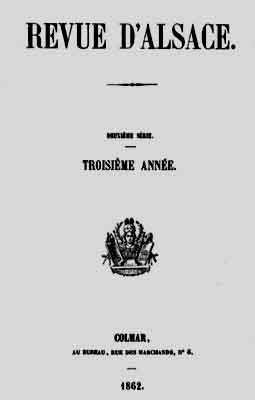 1862 - Revue d'Alsace - Ad. Schæffer - Compte-rendu du livre de J. Matter
1862 - Revue d'Alsace - Ad. Schæffer - Compte-rendu du livre de J. Matter
Revue d’Alsace
Deuxième série.
Troisième année
Colmar
Au bureau, rue des Marchands, n° 8
1862
Bibliographie.
Compte-rendu du livre de Jacques Matter, par Adolphe Schæffer (1826-1896), pasteur. Pages 580-586.
Adolphe Schæffer, docteur en théologie (Strasbourg, 1853), licencié ès lettres, pasteur à Colmar, publie également un compte rendu du livre de Jacques Matter dans la Revue chrétienne en trois articles en 1862-1863. Voir : Saint-Martin et le mysticisme en France, vers 1800
SAINT-MARTIN, le philosophe inconnu, sa vie et ses écrits, etc., d'après des documents inédits par M. Matter, conseiller honoraire de l'Université de France, etc., Paris, chez Didier, 1862, 1 vol. in-8° XII-460 pages.
Un savant dont les nombreux ouvrages ont conquis, depuis longtemps, les suffrages du monde lettré, qui n'est point d'ailleurs un inconnu pour les lecteurs de cette Revue, M. Matter, conseiller honoraire de l'université de France et professeur au séminaire protestant de Strasbourg vient de publier un volume sur lequel nous nous proposons d'appeler, dans ces pages-ci, l'attention du public sérieux de l'Alsace.
Saint-Martin, le philosophe inconnu, tel est le sujet du volume que nous annonçons.
 Bien des littérateurs distingués se sont occupés de Saint-Martin : Chateaubriand, Cousin, de Maistre, Sainte-Beuve ; nous ne nommons que les plus illustres. Et presque tous ceux qui en ont fait l'objet d'une étude attentive, sont arrivés à voir en lui un écrivain, un penseur, un homme enfin digne d'une sérieuse sympathie. Le dernier des écrivains que nous venons de nommer estime que Saint-Martin mérite une étude ou du moins une première connaissance, même de la part des profanes qui n'aspirent point à pénétrer dans ce qu'il a d'obscur, d'occulte, de réservé aux seuls initiés. C'est tout au moins une noble nature, une belle et douce âme qui a de sublimes perspectives dans le vague, des éclairs d'illumination dans le nuage, qui excelle à pressentir sans jamais rien préciser, et sait atteindre en ses bons moments à des aperçus d'élévation et de sagesse.
Bien des littérateurs distingués se sont occupés de Saint-Martin : Chateaubriand, Cousin, de Maistre, Sainte-Beuve ; nous ne nommons que les plus illustres. Et presque tous ceux qui en ont fait l'objet d'une étude attentive, sont arrivés à voir en lui un écrivain, un penseur, un homme enfin digne d'une sérieuse sympathie. Le dernier des écrivains que nous venons de nommer estime que Saint-Martin mérite une étude ou du moins une première connaissance, même de la part des profanes qui n'aspirent point à pénétrer dans ce qu'il a d'obscur, d'occulte, de réservé aux seuls initiés. C'est tout au moins une noble nature, une belle et douce âme qui a de sublimes perspectives dans le vague, des éclairs d'illumination dans le nuage, qui excelle à pressentir sans jamais rien préciser, et sait atteindre en ses bons moments à des aperçus d'élévation et de sagesse.
Après tant d'autres, M. Matter s'est mis à étudier la figure agréable, touchante de Saint-Martin : grâce à l'ardeur de ses recherches, grâce aussi au secours que lui ont prêté quelques amis dévoués, il a pu s'appuyer sur des documents inédits pour ajouter quelques traits à la physionomie du mystique penseur ; il s'est acquis de la sorte un titre de plus à la reconnaissance des amis des bonnes et sérieuses études. C'est en Alsace surtout que son ouvrage semble appelé à trouver bon accueil. Nous dirons pourquoi. Quelques mots d'abord pour faire connaître quelque peu Saint-Martin à ceux d'entre nos lecteurs qui jusqu'ici n'en sauraient guère que le nom.
La vie de Saint-Martin est aisée à raconter. Il naquit à Amboise en Touraine, d'une noble famille, vers le milieu du XVIIIe siècle. Ses [page 581] biographes nous le font voir, enfant, en possession d'une âme délicate, tendre, aisément timorée, logée dans un corps débile bien que sain ; puis, jeune homme, s'adonnant avec ardeur à l'étude de la littérature et de la philosophie. Son père, quelque respectable qu'il fut du reste, ne le comprit point ; mais il trouva dans une belle-mère la tendresse dont il avait besoin. Ce n'est pas elle qui eût essayé d'en faire un magistrat. Pas plus qu'un officier. Officier ! Magistrat ! Rien n'était plus contraire aux goûts de Saint-Martin que ces deux carrières-là.
« Dans le temps qu'il fut question de me faire entrer dans la magistrature, raconte-t-il lui-même, j'étais si affecté de l'opposition que cet état avait avec mon genre d'esprit, que de désespoir, je fus deux fois tenté de m'ôter la vie. » [Louis-Claude de Saint-Martin, Mon Portrait historique et philosophique (1789-1803) publié par Robert Amadou. Julliard, 1961. § 207. Cité ici par Mon portrait]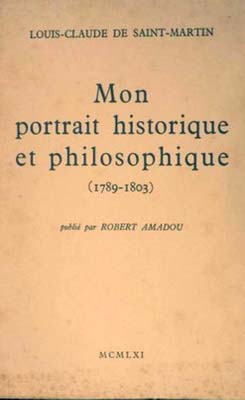
La profession militaire ne lui sourit point davantage.
« J'ai reçu, dit-il, de la nature trop peu de physique pour avoir la bravoure des sens. » [Mon portrait, 298]
Et cependant, chose curieuse, entré par le plus grand des hasards dans le seul des deux cents régiments de France (celui de Foix) où il put rencontrer la veine mystique à laquelle il aspirait vaguement, ce fut grâce à quelques-uns de ses camarades que le jeune officier entra en rapport avec le juif converti Don Martinez de Pasqualis qui, à cette époque, était le chef d'une certaine franc-maçonnerie mystique. À partir de là, Saint-Martin se trouva dans le milieu pour lequel son esprit semblait créé. Tout le reste de sa vie appartient au mysticisme. Les jambes débiles, la tête un peu trop grosse pour le corps qui la portait, une figure charmante, une extrême sensibilité de nerfs, l'âme singulièrement ouverte aux choses divines, le cœur, selon sa propre expression, sujet du royaume évangélique : tel était alors Saint-Martin.
C'est en 1771, à Lille [sic pour Bordeaux], qu'il quitta le régiment pour se donner, tout entier, à l'étude des grands objets, des sciences occultes vers lesquelles se sentait attirée sa nature si pure, si suave, où l'imagination et le sentiment prenaient volontiers le dessus sur la faculté pensante. Il ne saurait entrer dans notre plan d'exposer, dans cette Revue, les théories mystiques de Saint-Martin, telles qu'elles se montrèrent dans les divers écrits qu'il publia à partir de ce moment ; on les trouvera longuement racontées et discutées dans le savant écrit de M. Matter. Qu'il nous suffise de dire que Saint-Martin n'eut pas, lorsque parut son premier ouvrage, de théorie arrêtée ; que dans aucun de ses livres ses idées mystiques ne se trouvent exposées avec toute la clarté désirable ; que peut-être même elles ne se montrèrent jamais à Saint-Martin lui-même que dans cette espèce de clair-obscur où se complait volontiers le mysticisme. Faisons remarquer surtout que la mission spéciale de Saint-Martin semble avoir été non pas tant de poser de hardies affirmations sur des choses que l'œil humain ne saurait apercevoir dès ici-bas, que de relever le drapeau du spiritualisme à une époque où le matérialisme menaçait d'envahir tous les esprits. Tel fut le rôle pour lequel il semblait né. À Rome comme à Lyon, à Paris, à Strasbourg, dans la belle société du XVIIIe siècle où on l'admettait très volontiers, à l'école normale où il s'assit à un âge déjà avancé, dans ses livres comme dans les conversations qu'il recherchait, c'est du spiritualisme qu'il se montrait l'apôtre plus encore [page 582] que du mysticisme. Il vivra moins dans les fastes de la philosophie mystique que dans ceux du spiritualisme. Homme du monde, il l'aime.
Il tâche de gagner à ses sentiments la haute société, la marquise de Coislin, le duc d'Orléans, la duchesse de Bourbon, tout en plaisantant agréablement sur l'esprit futile qui y domine. Voici, à cet endroit, un curieux aveu :
« Les gens des grandes villes, et surtout des villes de plaisir et de frivolité comme Paris, sont des êtres qu'il faudrait en quelque sorte tirer à la volée, si l'on voulait les atteindre. Or, ils volent mille fois plus vite que les hirondelles ; et en outre ils ont grand soin de ne vous laisser qu'une lucarne si petite, qu'à peine avez-vous le temps de les voir passer : et c'est cependant tout ce que vous avez de place pour tirer. Puis, si vous les manquez, ils triomphent. » [Mon portrait, 997]
C'est dans le monde féminin qu'il tient surtout à faire des conquêtes... spirituelles, et néanmoins il n'ignore pas quel est le côté faible de l'esprit de la femme :
« La femme a en elle un foyer d'affection qui la travaille et l'embarrasse ; elle n'est à son aise que lorsque ce foyer-là trouve de l'aliment ; n'importe ensuite ce que deviendra la mesure et la raison... tenons-nous en garde contre les fournaises ». [Mon portrait, 265]
Parmi les amis de Saint-Martin, il était des personnes qui se croyaient en rapports intimes avec le monde des esprits. Une telle avait avec les esprits des relations si rares qu'on la voyait interrompre la conversation pour ces audiences hors ligne. Une telle n'avait que « des éclairs » ; une autre, mieux partagée, des visions, des apparitions. À cet égard, Saint-Martin usait d'une grande circonspection. Il était persuadé, lui aussi, que la sagesse divine se sert d'Agents et de Vertus pour faire entendre son Verbe dans notre intérieur, de Puissances intermédiaires entre Dieu et l'homme. Cependant, à tout prendre, les opérations théurgiques de Martinez lui répugnaient ; à la voie extérieure d'agents, agissant sur l'organisme, il préférait la voie intérieure. Il se contentait d'ordinaire du mysticisme chrétien. Il revenait volontiers à certaines doctrines positivement chrétiennes. Il croyait de toutes les forces de son âme à la chute morale de l'humanité, à la possibilité de relever notre nature gâtée et corrompue. Il savait peindre, avec une éloquence émue et souvent très heureuse,
« les splendeurs dont était vêtu l'homme entrant dans la création, les misères où il est tombé en écoutant le principe du désordre qui ne cesse de lui faire sentir sa puissance, et la gloire à laquelle il est assuré d'aller s'il se laisse rappeler dans la vraie voie. »[Matter, p.180]
Plusieurs de ses biographes ont pris plaisir à citer de lui certaines paroles qui témoignent de la pureté et de l'élévation de ses sentiments. En voici quelques-unes que l'on nous saura gré de reproduire.
« J'ai vu que les hommes étaient étonnés de mourir et qu'ils n'étaient point étonnés de naître : c'est là cependant ce qui mériterait le plus leur surprise et leur admiration. » [Mon portrait, 323]
« C'est un grand tort aux yeux des hommes que d'être un tableau sans cadre, tant ils sont habitués à voir des cadres sans tableaux. » [Mon portrait, 1130]
« C'est une chose douloureuse de voir les hommes ne s'apporter réciproquement (dans la société) que le poids et le vide de leurs jours, pendant qu'ils ne devraient tous s'en apporter que les fruits et les fleurs. » [Mon portrait, 767] [page 583]
« J’ai été attendri un jour jusqu'aux larmes, à ces paroles d’un prédicateur : Comment Dieu ne serait-il pas absent de nos prières, puisque nom n'y sommes pas présents nous-mêmes ! » [Mon portrait, 10]
« Quand j'ai aimé plus que Dieu quelque chose qui n'était pas Dieu, je suis devenu souffrant et malheureux : quand je suis revenu à aimer Dieu plus que tout autre chose, je me suis senti renaître et le bonheur n'a pas tardé à revenir en moi. » [Mon portrait, 232]
« J'aurais peut-être été bien malheureux sur la terre si j'avais eu ce que le monde appelle du pain ; car il ne m'aurait rien manqué. Or, il faut ici-bas qu'il nous manque quelque chose pour que nous y soyons à notre place. » [Mon portrait, 276]
« À force de dire Notre Père, espérons que nous entendrons un jour dire : Mon fils. » [Œuvres posthumes de Mr. de St. Martin, Tome 1, Tours, 1807, p. 209]
Ne sont-ce pas là comme des perles précieuses ?
Et les pensées que Saint-Martin savait exprimer si finement, il les vivait. Il en faisait l'âme de sa conduite. La charité, l'humilité, la douceur, l'amitié, la pureté morale, les plus belles vertus du chrétien, il les pratiquait sincèrement.
Pas toujours cependant. Le vieil homme, l'homme astral, reparaissait quelquefois en lui ; il eut ses mauvaises heures.
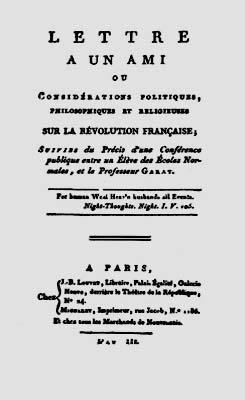 Ce fut une mauvaise heure par exemple, celle où, pendant que la Révolution soumettait le clergé catholique aux dernières rigueurs, il se rangea parmi ses ennemis, reprochant aux prêtres d'avoir rempli les temples d'images et par là d'avoir « égaré et tourmenté la prière, tandis qu'ils ne devaient s'occuper qu'à lui tracer un libre cours » [Lettre à un ami, ou Considérations politiques, philosophiques ou religieuses sur la Révolution française. Paris, 1795, p.14] ; je n'examine point si, au fond, il n'avait point raison : mais le moment était mal choisi.
Ce fut une mauvaise heure par exemple, celle où, pendant que la Révolution soumettait le clergé catholique aux dernières rigueurs, il se rangea parmi ses ennemis, reprochant aux prêtres d'avoir rempli les temples d'images et par là d'avoir « égaré et tourmenté la prière, tandis qu'ils ne devaient s'occuper qu'à lui tracer un libre cours » [Lettre à un ami, ou Considérations politiques, philosophiques ou religieuses sur la Révolution française. Paris, 1795, p.14] ; je n'examine point si, au fond, il n'avait point raison : mais le moment était mal choisi.
Mauvaise heure encore, celle où le philosophe d'ordinaire si réservé, si humble, si disposé à se ranger parmi les demi-élus, les demi-esprits, ose néanmoins s'assigner une place parmi les plus grands apôtres de l'humanité.
Nous craignons de trop nous laisser entraîner. Nous renvoyons au volume de M. Matter ceux de nos lecteurs qui seraient désireux de connaître le rôle de Saint-Martin dans le Révolution française, ses rapports avec Chateaubriand, avec Voltaire, avec La Harpe, avec Bernardin de Saint-Pierre, son caractère tout entier où se rencontraient toutes les audaces de l'imagination et la plus naïve crédulité de l'esprit, mais où dominaient après tout de très aimables qualités, l'aménité, la bénignité, l'amour passionné du vrai, quelque fonds de mélancolie. Nous ne considérerons plus qu'un aspect de sa vie, celui qui rentre d'avantage dans le cadre de cette Revue, ses relations avec Strasbourg.
Les lecteurs de la Revue, connaissent une partie du chapitre où M. Matter raconte le séjour de Saint-Martin en Alsace (1).
Le théosophe d'Amboise en parle dans des termes qui touchent à l'enthousiasme.
« Je dois dire que cette ville de Strasbourg est une [page 584] des villes à qui mon cœur tient le plus sur la terre. » et ailleurs, « Il y a trois villes en France dont l'une est mon paradis, et c'est ; l'autre est mon enfer (Amboise) et l'autre est mon purgatoire (Paris). » [Mon portrait, 282]
Voilà qui est flatteur pour Strasbourg. Se voir préférer par un homme tel que Saint-Martin, à Bordeaux, à Lyon, à Paris ! Examinons toutefois les motifs de cette préférence.
Strasbourg avait, en 1788, plus d'un titre à la bienveillance de Saint-Martin. Citons, à ce sujet, l'une des plus excellentes pages de M. Matter.
« Tout à coup transporté en Italie, Saint-Martin passe de Rome, sans transition, dans une ville française de nom, mais allemande et protestante de pensée ; une ville où se plaisait singulièrement une colonie française très nombreuse et très puissante, mais pleine de curiosité et de déférence pour les nouveautés où elle se trouva mêlée et qu'elle n'avait pas même soupçonnées de loin. A ce moment cela donnait à Strasbourg le plus singulier aspect. Des étrangers distingués par la naissance et par la fortune, attirés par l'amour de cette espèce de France encore si allemande et si cordiale de mœurs, mais déjà si française de sympathies et d'idées, ajoutaient aux agréments du commerce et aux sources d'instruction. En général cette époque était belle. On était en 1788. C'était l'aurore des plus vives aspirations de la pensée nationale à ses plus glorieuses destinées. Les utopies de la raison, car elle aussi a ses utopies, n'étaient pas exclues de ce mouvement universel mais d'ailleurs très pacifique des esprits. Des accents émus, retentissant sur les rives un peu agitées de la Seine, faisaient vibrer tous les cœurs parmi ces Français des bords du Rhin, si jeunes encore dans les annales du pays. Dans les contrées voisines, le mouvement un peu autre, n'était pas moins beau. Il était plus grave. C'était l'ère des plus grands et plus hardis enseignements de la philosophie allemande. Le magnifique complément de la Critique de la raison pure, celle de la raison pratique parut au moment même où le Philosophe inconnu, déjà célèbre, venait de s'installer à Strasbourg. Il ne savait pas encore l'allemand, et il ne le sut jamais assez bien pour lire facilement les écrits de Kant. Mais ces écrits étaient lus, sinon dans toutes les familles qu'il voyait, du moins dans celles dont il s'honorait le plus d'être accueilli. Or ils remuaient tout, changeaient toutes les études et donnaient à toutes les idées une importance que jusque-là on n'accordait pas aux produits abstraits de la pensée. On respirait ces hardiesses d'examen et de critique, ces nobles vertus de l'esprit non pas seulement dans les ouvrages de philosophie, mais dans les livres de morale, de politique et de littérature. Strasbourg, il est vrai, n'offrait pas de penseurs éminents, pas d'écrivains nationaux. Il y a quatre-vingts ans, ses poètes et ses orateurs, bégayant à peine le français, publiaient leurs œuvres en allemand et même en Allemagne. Toutefois on eût dit que, Français de conquête depuis sept générations sans l'être ni de mœurs ni de langue, ils s'impatientaient eux-mêmes de leur étrange situation. Aussi les principes et le mouvement national tout entier de 1788 et 1789 ne rencontrèrent nulle part en France, pas même à Paris, plus de bruyantes sympathies et ne virent éclater plus de verte jubilation qu'à Strasbourg. L'esprit protestant, très heureux [page 585] de son droit d'examen, qui n'est pourtant le monopole de personne, l'esprit philosophique, très plein de ses récentes libertés et de ses prochaines perspectives de triomphe, s'y appuyaient l'un l'autre, flattés là même où l'on se défiait un peu de ces libertés et de ces perspectives qui d'ailleurs ont toujours eu pour elles, les uns et les autres, la même légitimité. Voilà l'atmosphère, si nouvelle pour lui, que Saint-Martin revenu d'Italie se sentit d'autant plus heureux de respirer qu'elle différait davantage de celle d'où il sortait. Aussi, loin de s'y trouver dépaysé, il s'y mouvait avec une volupté inconnue, jouissant d'un bien-être spirituel que rien ne venait troubler... » [Matter, p. 186-188]
On le voit : Saint-Martin eut bien des raisons de se plaire à Strasbourg,
II y rencontra des savants tels que Haffner, Blessig, l'antiquaire Oberlin, l'historien Koch, des mystiques tels que Mme Westermann, le baron de Razenried, le major de Meyer, Rodolphe Salzmann si propre à l'initier au mysticisme allemand et en particulier aux écrits de Bœhme ; il y trouva, toutes disposées à lui faire le plus gracieux accueil, les premières familles du pays, M. de Turckheim, M. de Klinglin, la baronne d'Oberkirch, la baronne de Franck.
Il y fit enfin la connaissance de Mme de Bœcklin. C'est elle qui prit la plus grande place dans les affections spirituelles de Saint-Martin. C'est à elle qu'il aime, au dire de son dernier biographe, à rapporter le plus fécond événement de sa vie d'études, la connaissance du théosophe de Gœrlitz, qu'il appelle le Prince des philosophes divins. Obligé en 1791 de quitter la vieille cité du Rhin, c'est surtout sa délicieuse amie qu'il regrette, elle qui lui trouvait des yeux doublés d'âme. Cette tendresse du philosophe pour Mme Bœcklin fut-elle autre chose qu'une affection sublime, platonique ? M. Matter ne le pense pas. Selon lui, la seule vraie et grande raison de cet attachement, ce n'est pas dans le cœur de Saint-Martin qu'il faut la chercher « malgré ce qu'il en croit et ce qu'il en dit », c'est dans son esprit. Mme de Bœcklin, la spirituelle allemande qui lui a fait apprendre la langue de Bœhme, n'eut été que le symbole le plus sensible de sa transformation, l'objet chéri auquel sa mystique tendresse aimait à rattacher son enthousiasme.
Quoi qu'il en soit, ce qui semble hors de conteste, c'est que, si Saint-Martin appelle Strasbourg son paradis, il lui devait beaucoup en effet ; il y était arrivé avec des vues assez étroites en matière de science, d'histoire, de philosophie et de critique et en sortit au bout de trois ans avec des lumières générales qu'il n'a pu tenir que de l'ensemble des idées et du mouvement au sein duquel il avait vécu. Les trois ouvrages composés ou ébauchés en Alsace portent des traces nombreuses d'habitudes nouvelles, plus pures, plus sérieusement spéculatives. La résolution si grave qu'il prendra plus tard d'embrasser la carrière de l'enseignement ; son entrée à l'école normale pour s'y préparer ; la lutte qu'il y soutiendra, non pas au nom du spiritualisme contre le matérialisme, mais au nom du rationalisme contre le sensualisme ; la science et la fermeté qu'il mettra à réfuter un maître célèbre et habile : voilà selon M. Matter, les fruits et les résultats de la transformation, tant mystique que philosophique, qu'il subit dans la savante et illustre cité. [page 586]
Saint-Martin mourut subitement en 1803. Vers la fin de ses jours, il ne se sentait ni fatigué ni accablé de la vie et la tenue du vaillant soldat ne changea pas. Il voyait, au dire de M. Sainte-Beuve, dans la mort comme l'aurore d'une seconde et meilleure naissance. Le secret de son courage moral, nous aimons à le trouver dans ces belles paroles que Saint-Martin aimait à se redire et que nous nous plaisons à citer en terminant :
« Ce n'est point à l'audience que les défenseurs officieux reçoivent le salaire des causes qu'ils plaident, c'est hors de l'audience et après avoir fini. Telle est mon histoire et telle est aussi ma résignation de n'être pas payé dans ce bas monde ». [Mon portrait, 1099]
Ad. Schæffer, pasteur.



