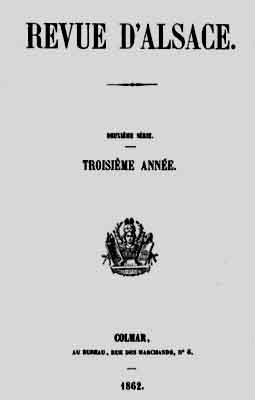 1862 - Revue d’Alsace
1862 - Revue d’Alsace
Saint-Martin à Strasbourg, par Jacques Matter.
Sa rencontre avec Madame la duchesse de Bourbon. — Ses relations avec les savants et les mystiques : Oberlin, Madame de Bœcklin, R. Salzmann, Mesdames d'Oberkirch, de Frank, de Rosemberg, la comtesse Potoka. — Ses nouvelles études. — Sa conversion au mysticisme de Bœhme. — Le paradis, l'enfer et le purgatoire terrestres de Saint-Martin.
Deuxième série.
Troisième année
Colmar
Au bureau, rue des Marchands, n° 8
1862
Saint-Martin à Strasbourg*. Pages 278-288
* Les pages que nous publions feront l'objet d'un chapitre dans le livre que M. Matter prépare sur la vie et les écrits de Saint-Martin.
1788-1791.
Les trois années que Saint-Martin alla passer à Strasbourg ont été à la fois les plus décisives pour sa doctrine et pour ses idéalités. Je ne veux pas dire pour ses affections, ce qui d'ailleurs se confond tout naturellement dans une âme mystique.
Il s'écoula bien peu de temps entre son voyage d'Italie et son arrivée à Strasbourg, dont il est facile de déterminer la date. Saint-Martin nous apprend lui-même qu'il fut arraché de cette ville par un ordre de son père, après un séjour de trois ans, au mois de juin 1791, à l'époque de la fuite de Varenne. Prises à la lettre, ces deux indications fixent son arrivée au mois de juin 1788. Or, en la rapprochant de sa visite à Etupes, il en résulte qu'il ne se trouve pas d'intervalle pour un voyage en Allemagne, qui aurait eu lieu à cette époque et qu'il me parait difficile d'admettre, ainsi que je l'ai déjà dit.
Saint-Martin ne dit pas un mot sur les motifs qui ont pu l'engager à se diriger sur Strasbourg en quittant Rome, à s'y établir malgré d'anciennes habitudes qui l'attachaient à Lyon en dépit des apparences, et malgré ses prédilections réelles pour Paris. Mais il est aisé de comprendre qu'il avait entendu parler de Bœhme par ses amis de Londres [page 279] et qu'on l'avait entretenu à Etupes des facilités qu'il trouverait à Strasbourg pour faire connaissance avec l'illustre théosophe. Strasbourg était d'ailleurs un des principaux théâtres des expériences mesmériennes et venait d'être celui des initiations si fameuses et des cures si extraordinaires du comte Cagliostro. Alfieri venait à peine de quitter l'Alsace qu'il avait habitée, ainsi qu'avaient fait Voltaire et Goethe, et que Rousseau avait voulu visiter avant eux. Jamais un ensemble d'excitations plus séduisantes pour un aussi vif admirateur des grands écrivains du siècle et pour un adepte de Martinez ne s'était encore rencontré ; et si la princesse de Wurtemberg ne l'a pas mis elle-même au courant des attraits littéraires et mystiques qu'il trouverait là, c'est peut-être à la baronne d'Oberkirch, qui visitait souvent Etupes, qu'il faudrait attribuer son pèlerinage vers la vieille cité du Rhin.
D'après sa note sur Strasbourg, la maison de la spirituelle baronne fut une de celles qu'il y fréquentait habituellement.
A ne consulter que cette note, ou du moins à ne la consulter qu'un peu superficiellement, il y rechercha surtout le monde aristocratique et quelques hommes d'études. Mais avec un peu plus d'attention on voit très bien que ce qui l'intéresse réellement, c'est ce qu'il appelle ailleurs ses objets.
Son premier point de vue est d'ailleurs assez morose et son jugement général sur les personnes avec lesquelles il se trouve en rapport à Strasbourg, un peu sévère, je ne dis pas injuste.
« J'ay vu des hommes qui n'étoient mal avec personne, mais dont on ne pouvoit pas dire non plus qu'ils y étoient bien ; car ils n'avoient pas assez de mesures développées (termes favoris de Saint-Martin) pour être saisis de ce qui est vrai et vif, ni choqués de ce qui est mal et faux. C'est à Strasbourg où j'ay fait cette observation, »
Cela est dur. Je dois même faire remarquer que si telles sont les premières lignes du voyageur, rien ne m'autorise réellement à dire que les sentiments qu'il y exprime ne furent que ses premières impressions.
Fussent-elles transitoires ou permanentes, qu'est-ce qui a pu les motiver ?
Strasbourg, il y a soixante-dix ans, et avant les trois ou quatre révolutions essentielles qui en font une ville française de mœurs comme de langue et de nationalité, avait conservé des habitudes de froideur et de réserve très propres à nous expliquer les rudes appréciations de l'observateur. Je ne veux pas même rappeler, pour le justifier, que c'est le [page 280] commun penchant des voyageurs de généraliser leurs rapides observations. En effet, chacun se passe à son tour le privilège de s'y laisser aller, et si tous se moquent de ce coureur de chaises de poste du dernier siècle qui trouvait que les femmes de Troyes avaient les cheveux roux, ceux de la maîtresse de poste du relais de Troyes étant d'un blond animé, tous sont plus ou moins entraînés par la force des choses à ces généralisations téméraires. Saint-Martin a donc pu très-légitimement formuler son jugement tel qu'il a fait ; car, après tout et tel qu'il est, il va fort bien à toutes les villes du monde : c'est le portrait du cœur humain pris en un moment de brouillard.
Après la sentence morale vient, sous la formule accoutumée de Saint-Martin, l'énumération des personnages principaux, ou plutôt des principales maisons qu'il a fréquentées ; car, pour lui, c'est presque toujours la famille qui est l'essentiel, c'est rarement le chef.
« Et icy, dit-il, je dois me rappeler au moins les noms de plusieurs personnes qui m'y ont intéressé ou que j'y ai vues (le nom de ma chère B... est à part de tous ces noms). »
En effet, il nomme les familles de Frank, de Turckheim, d'Oberkirch, de Baltazar, de Mouillesaux, d'Aumont, de Klinglin, de Lutzelbourg, de Saint-Marcel, Lefort, Falkenheim, Delort, et quelques autres. Mais il fait l'énumération de ces noms uniquement parce qu'il a besoin d'en graver le souvenir dans sa mémoire ; il n'y ajoute rien ou presque rien pour nous, quoiqu'il pose un peu au fond, comme tous ceux qui rédigent leurs souvenirs.
Parmi les personnages qu'il vient de nommer, il y en a qui figurent un peu dans l'histoire locale. La baronne de Frank, à la tête de sa maison de banque, a longtemps exercé une sorte de mécénat auquel il n'a manqué qu'un Horace ; le nom de la baronne d'Oberkirch a reçu un beau lustre par des Mémoires pleins d'esprit et d'imagination qu'a publiés son petit-fils, le comte de Montbrison ; la famille de Klinglin a joué un rôle dans quelques-unes des plus considérables révolutions du pays ; celle de Turckheim, qui a figuré dans plusieurs de nos chambres législatives, a fourni dans la personne du baron Jean d'Altdorf un diplomate et un historien estimé.
En vrai militaire, Saint-Martin cite ceux des officiers de la garnison qui portaient un nom un peu distingué : Mercy, Murat (ce n'était pas le futur roi des Deux-Siciles), Tersac, de Vogué, Chasseloup, d'Hauterive [page 281] (ce n'était pas l'ancien condisciple, le mystique ou l'extatique ami de Saint-Martin), Laborde, etc.
Saint-Martin, dont la note est trop courte, ne mentionne parmi les savants qu'il a vus, que l'antiquaire Oberlin, le frère du célèbre apôtre du Ban-de-la-Roche, Blessig, Haffner, le P. Ildefonse, bénédictin d'Ettenheim, et un professeur d'astronomie et de mathématiques dont il ne se rappelle plus le nom.
En vrai amateur de musique, car il cultivait le violon, il ajoute à ces savants le nom de Pleyel avec l'épithète de fameux.
A ces noms, qu'il donne la plupart altérés, qu'ils soient allemands ou français, Saint-Martin joint encore ceux de quelques étrangers plus ou moins illustres qu'il connut à Strasbourg, tels que le comte de Welsberg, ancien ministre à Vienne ; M. Wittenkof (Wittinghof, de Courlande, parent de Madame la baronne de Krüdener).
Au premier aspect on dirait que Saint-Martin n'est allé en Alsace que pour en visiter les familles les plus notables ; et tout ce qu'il aurait fait à Strasbourg ressemblerait singulièrement à ce qu'il avait fait à Londres, à Rome, à Toulouse, à Lyon ou à Versailles.
Et pourtant il s'y est passé quelque chose de plus ; car cette même note, qui débute d'un ton si maussade et si peu flatteur, se termine ainsi :
« Je dois dire que cette ville de Strasbourg est une de celles à qui mon cœur tient le plus sur la terre. »
Que s'y est-il donc passé pendant les trois ans qu'il l'a habitée ? et quels charmes la vieille cité des bords du Rhin avait-elle pu offrir à son cœur, pour qu'il y tint plus qu'à nul autre sur la terre ?
A cette époque la jeunesse russe, allemande et scandinave de la plus haute aristocratie s'y rencontrait aux cours d'histoire et de diplomatie de Koch, futur législateur et futur tribun, avec la jeune aristocratie de France. Metternich s'y coudoyait avec Galitzin et Narbonne. Une grande aisance, une ample et cordiale hospitalité, des mœurs peut-être plus douces et plus pures qu'ailleurs régnaient encore dans les plus honorables familles de la société. Un reste d'institutions électives et délibérantes demeurait à l'ancienne ville libre et impériale. Tout cela pouvait plaire à l'esprit de Saint-Martin ou se prêter à ses vues de propagande, s'il voulait renouer ses relations avec la noblesse russe, qui l'avait comblé d'hommages à Londres et appelé à Saint-Pétersbourg. Mais tout cela n'a pas dû suffire pour le charmer au point qu'il l'a été.
On n'est pas davantage dans la vraie voie quand on s'imagine qu'il [page 282] faut chercher son secret dans une courte phrase de sa note que je n'ai pas encore signalée, et qui nomme, parmi les personnes qu'il voyait, la baronne de Rosemberg, « qui voulait m'emmener à Venise pour fuir la révolution de France; la belle comtesse de Potoka, qui m'avait promis de m'écrire et qui n'en a rien fait. »
Sans doute, Saint-Martin aimait la société des femmes distinguées par de hautes aspirations de mysticisme ou de piété. Il s'y attachait profondément et même avec enthousiasme : il nous le dira et le prouvera tout à l'heure. Mais il se défiait beaucoup de celles qui n'arrivaient pas à un sérieux progrès dans la spiritualité, ou qui ne s'y prêtaient pas. Il ne se passionnait pas le moins du monde pour celles qui l'arrêtaient dans son développement propre, si sincère que fut, d'ailleurs, son amitié pour elles, témoin Madame la duchesse de Bourbon elle-même, dont il parle toujours avec estime, jamais avec chaleur. Il nous faut même remarquer que cette princesse se trouvait à Strasbourg en même temps que lui, et qu'il ne la nomme pas même. Or, si jamais elle eût mérité une mention exceptionnelle, c'eut été en ce moment. Elle venait d'Étupes et s'était établie sur les bords du Rhin pour des raisons de famille et des raisons politiques. Quoique séparée de son mari, qui émigra de bonne heure avec son père, le prince de Condé, et son fils, le duc d'Enghien, elle était avec lui dans les meilleurs termes où elle pouvait être. De plus, et sans nul doute, le désir de trouver à Strasbourg les pieuses consolations de M. de Saint-Martin, dont elle aimait la direction, avait pesé dans la balance pour lui faire prendre le chemin de l'Alsace. Aussi Saint-Martin, qui avait pour elle une de ces amitiés qui ne se démentent jamais, lui faisait-il habituellement à Strasbourg le sacrifice des heures de recueillement qu'il aimait le plus, celles du soir. Il l'accompagnait volontiers au spectacle, qu'il aima toujours, quoiqu'il s'en privât souvent pour des plaisirs plus doux à son cœur charitable.
Mais, malgré cette affection si sincère, ce ne fut pas la présence de la princesse qui fit de la ville de Strasbourg le séjour préféré du théosophe. Qu'on en juge par ses belles confidences sur l'influence qu'elle exerçait sur son esprit, confidences qui s'étendent sur ses principaux attachements, et confidences qui nous feront bien comprendre, je crois, l'amitié si exceptionnelle qu'il voua à la personne qu'une seule fois il nomme en toutes lettres, et qu'il désigne d'ordinaire par les mots, ma B.... ou ma chérissime B. [page 283]
Ces confidences nous feront voir en même temps ce que nous devons penser réellement de toutes ces prédilections féminines qui paraissent jouer un rôle si considérable dans la vie du grave mystique.
« Plusieurs personnes ont été funestes à mon esprit, mais non pas de la même manière. La première voulait absolument le faire mourir d'inanition ; la seconde, qui était ma tante, voulait ne le nourrir que de vent ; la troisième, qui est W..., opérait sur lui comme un étouffoir ; la quatrième, qui est Madame de La Cr..., lui mettait les fers aux pieds et aux mains ; la cinquième, qui est Madame de L..., lui eût été utile si elle n'avait pas voulu le couper en deux ; la sixième, qui est Madame de Cosl..., le grattait en-dessous et le déracinait ; la septième, qui est Madame de B... B..., lui mettait un cilice pointu sur tout le corps. »
Cette appréciation, qui est peut-être un peu plus symbolique et surtout plus épigrammatique qu'il ne fallait, est fine, à la fois sérieuse pour le fond et railleuse pour la forme.
A l'exception de la troisième de ces diverses et piquantes individualités, et à l'exception de la première, qu'il ne veut pas même laisser deviner à son lecteur — car ses réticences témoignent qu'il n'écrit pas pour lui seul — nous mettons facilement les noms complets. Et sans bien comprendre peut-être toute la portée de ces épigrammes figurées, nous nous faisons une idée suffisante de la nature de ces rapports mystiques. Madame W... nous reste aussi inconnue que le personnage qu'il ne veut pas nous livrer du tout. Saint-Martin nomme un prince Woronzow, mais il ne nomme pas la princesse, que d'ailleurs, en sa qualité d'étrangère, il n'aurait pas pu traiter bien convenablement d'étouffoir. On reconnaît du premier coup Madame de La Croix, mais on ne voit nullement comment cette grande dame, qui prenait si bien son vol et donnait si gracieusement audience aux esprits au milieu même de la compagnie dont elle était entourée, mettait l'esprit de son ami aux fers. Etait-ce quand il composait près d'elle ses belles pages du Tableau naturel ? On ne comprend pas davantage comment Madame de Lusignan, chez qui il composa une partie du même ouvrage, coupait son esprit en deux. Etait-ce pour en retenir sur la terre au moins l'un des deux ? Madame de Coislin, car c'est d'elle qu'il s'agit au n°6, en dépit de l'orthographe, jouait un rôle plus dangereux encore pour l'esprit de Saint-Martin : elle le détachait du monde céleste où il avait jeté racine, en grattant le sol sous la racine même. Madame la duchesse de Bourbon, nommée la dernière, se bornait du moins à faire souffrir son esprit ; mais elle le [page 284] faisait souffrir, car elle lui mettait un cilice pointu sur tout le corps, figure un peu hardie pour un esprit, mais qui exprime la douleur que la princesse faisait éprouver à son ami, à la voir dans sa crédulité consulter des somnambules et d'autres praticiens d'un ordre inférieur.
Dans tous les cas, ce n'était pas la personne qui suivait si mal le théosophe dans les hautes sphères de la spiritualité et arrêtait ainsi le libre développement de son esprit, ce n'était pas Madame la duchesse de Bourbon, qui, par sa présence, répandait sur la ville de Strasbourg cette magie qui la fit qualifier de paradis. Quels autres attraits ou quels développements inattendus, Saint-Martin, qui n'appréciait les villes, comme les personnes, que d'après leur rang dans l'ordre de ses objets et de ses grandes aspirations, Strasbourg lui a-t-il donc présentés ?
Il ne le dit pas nettement, mais il le fait deviner en vingt endroits, où éclate un sentiment unique dans son âme, un sentiment qu'il ne confond avec aucun autre. Il a trouvé à Strasbourg une source de spiritualité, non pas inconnue, mais inabordée jusque-là, Jacques Bœhme. Cette source, un théosophe très savant, Rodolphe Salzmann, et une femme très aimable, Madame de Bœcklin, la lui ouvrirent en l'initiant à l'étude de cet illuminé, et en le décidant à apprendre l'allemand, les anciennes traductions, française ou anglaise, du philosophe teutonique ne pouvant lui donner aucune idée de tout ce que renfermaient les originaux.
A ces deux personnages, dont l'un devait prendre la première place dans les affections de Saint-Martin, et dont l'autre eut la même place dans celles de Young-Stilling, il s'en joignit plusieurs autres, qu'on ne nomme qu'en passant. Ce sont le major de Meyer, le baron de Razenried, Madame Westermann, et une personne que le voyageur ne désigne que par le nom de la rue qu'elle habitait.
C'est ce groupe de six personnages très divers, mais très liés entre eux, auxquels se rattachaient assurément bien d'autres, qui embellit la vieille et savante cité aux yeux du théosophe. Et je vais essayer de coordonner le mieux qu'il me sera possible ce qu'il m'a été donné de recueillir sur chacun d'eux, les prenant dans l'ordre inverse de leur importance pour Saint-Martin.
La personne qu'il ne nomme pas, mais qui figure dans la correspondance de Madame de Bœcklin avec la baronne de Razenried, portait un nom allemand très poétique, mais aussi difficile à écrire qu'à prononcer pour un débutant tel que Saint-Martin. Elle s'appelait Mademoiselle [page 285] Schwing (aile), et son esprit s'élevait volontiers dans les plus hautes régions du monde spirituel. Elle avait des visions ou des apparitions qui ressemblaient plus à celles de Swedenborg qu'à celles de l'abbé Fournié ; elle voyait, non pas comme ce dernier, des esprits d'un ordre supérieur, mais des trépassés ; elle en suivait les progrès ou l'élévation successive dans l'autre monde, à la grande joie de leurs familles et de ceux de ce monde qui s'intéressaient à leur sort.
La dame Westermann avait ces dons de seconde vue qui étaient jadis si communs dans certaines contrées de l'Allemagne, de la Suède et de l'Ecosse. Elle voyait, en esprit, suivant les traditions que je consulte, les événements qui se passaient à de grandes distances, et il circulait à ce sujet, dans le cercle des intimes de Saint-Martin, des récits fort extraordinaires. Dans sa note, le théosophe prend d'abord à l'égard de la voyante une attitude de réserve. Il lui donne avec un peu de dédain l'épithète de cordonnière, étrange dans la bouche d'un admirateur enthousiaste de Bœhme, le cordonnier. Il semble mettre le crédit qu'il lui accorde sous le pavillon d'un autre, en disant qu'elle avait la confiance de Salzmann. Le fait est qu'il change un instant après, qu'il ne manque pas lui-même de la consulter, sur l'avis de Madame de Bœcklin, lors de l'aventure romanesque, et qu'il finit par constater qu'on lui répondit assez juste, mais qu'il ne dit pas un mot sur cette aventure.
Le troisième personnage mystique qu'il nomme, le baron de Razenried, noble étranger arrivé en France très souffrant, à l'époque où l'on opérait à Strasbourg, sous l'installation de M. de Puységur, les grandes cures magnétiques, avait trouvé dans cette ville un médecin d'une vive clairvoyance, une jeune fille d'une rare beauté, et avait fini par lui offrir sa main et son nom. A la grande joie de la famille, la jeune baronne, d'origine très bourgeoise, n'avait pas tardé à prendre le ton et les manières de la meilleure compagnie, le goût des lettres et des saines études. Nous avons sous les yeux des Vues sur le ciel étoilé qu'elle doit avoir écrites d'inspiration, comme Jacques Bœhme écrivait la plupart de ses traités. Elles ne portent pas plus le cachet de la science que celui de la révélation ; mais quand l'astronomie était moins avancée, elles ont pu faire le charme du cercle intime de la belle baronne. Si elles ne font plus celui de personne par leur valeur scientifique, elles peuvent plaire à tout le monde par l'élévation de la pensée et même par l'éclat d'un style que Madame de Razenried était loin de mettre dans ses pages ordinaires, ses lettres familières, par exemple. [page 286]
Le major de Meyer, que Saint-Martin met à la tête de tous ses amis de Strasbourg, querellait ces Vues au nom de l'astronomie savante. Il leur accordait cependant, comme aux expérimentations magnétiques, un intérêt sérieux A la différence de son neveu, Frédéric de Meyer, écrivain plus connu, il était d'une nature mi-sceptique, mi-croyante ; mais dans sa correspondance, que j'ai sous les yeux, il cite des textes de Saint-Martin avec autant de sympathie que son neveu le fait lui-même dans ses lettres et dans ses Feuilles périodiques pour la culture supérieure de l'intelligence.
Le personnage qui fut, je crois, le principal initiateur de Saint-Martin à l'étude du philosophe teutonique, Rodolphe de Salzmann, comme l'appelaient ses correspondants d'Allemagne depuis qu'il avait reçu de la cour de Saxe-Meiningen des lettres de noblesse et un brevet de conseiller de légation, titres dont il n'a jamais fait usage pour son compte, — Salzmann était un savant avancé dans le mysticisme ordinaire et dans la haute théosophie. Il faut le distinguer de son cousin Daniel Salzmann, l'ami de Goethe et de Herder, singulièrement célébré par le premier et par les biographes de l'incomparable poète. Insister ici sur la distinction des deux Salzmann, dont aucun n'a marqué dans les lettres françaises ; quoique l'un des deux ait été journaliste pendant quarante ans, serait chose inutile. Qu'il nous soit permis seulement de dire en passant, dans l'intérêt de la critique historique et pour l'appréciation de la valeur réelle de ce qu'on appelle l'autorité du témoignage, que les propres concitoyens et les amis des deux les ont si souvent confondus ensemble qu'enfin ils les ont fondus en un seul et même personnage. L'excellent Schubert, un des principaux mystiques de notre temps et celui-là même qui s'est fait remarquer en France par une touchante biographie de Madame la duchesse d'Orléans, raconte très sérieusement qu'il a visité en 1820 le mystique Salzmann, l'ami de Goethe. Or, l'ami de Goethe était mort en l8l2, et Schubert n'avait jamais eu avec lui le moindre rapport; il n'en connaissait le nom que par les mémoires si poétiques de Goethe, et il était persuadé que son ami véritable, Salzmann le mystique, qu'il a réellement visité en 1820, portait encore sur sa noble physionomie d'aigle les traces du génie qui avait charmé le poète. Or, Rodolphe Salzmann n'avait jamais eu de relations avec Goethe.
Si Saint-Martin se rendit à Strasbourg pour y étudier le mysticisme allemand, et en particulier les écrits de Bœhme, traduits en anglais par son ami Law, il n'y pouvait mieux s'adresser qu'à Rodolphe Salzmann. [page 287] Issu d'une de ces anciennes famille de sa ville dont la plus haute ambition était de figurer dans le ministère évangélique, dans une chaire de l'université ou sur la chaise curule d'un Quinze ou d'un Treize, le jeune théosophe, après de solides études de droit et d'histoire, avait habité l'Allemagne et fréquenté la plus savante de ses écoles, celle de Gœttingue, avec son élève, le baron de Stein, depuis le célèbre ministre de Prusse. Jouissant d'une fortune indépendante et partageant ses loisirs entre des travaux de religion et de politique, il dirigeait, quand Saint-Martin le rechercha, un journal et écrivait des volumes de haute piété, c'est-à-dire de mysticisme et de théosophie. Il publiait beaucoup sans jamais mettre son nom à aucun de ses ouvrages. Une correspondance assez étendue, mais très intime, avec les mystiques de Lyon, de Genève, de la Suisse allemande et de l'Allemagne en général, le mettait d'autant mieux au courant, qu'il dirigeait lui-même « la librairie académique » Toutes ces études lui avaient donné une entière familiarité, d'une part avec les textes sacrés, d'autre part avec ceux de Jane Leade, de Pordage, de Law, de Swedenborg et de Jacques Bœhme. Il possédait surtout les interprètes des écrits apocalyptiques et il affectionnait particulièrement les questions qui jouent un rôle si considérable dans ces textes. Rien n'allait mieux à Saint-Martin. La scrupuleuse exactitude de l'érudition germanique ne l'effarouchait pas. Grandes furent un instant les sympathies des deux théosophes. Mais il y avait des divergences sur des questions essentielles, soit de théorie, soit de pratique, et même sur le principe très mystique de la fuite du monde, fuite que Saint-Martin, homme du monde, voulait tempérée, et que Salzmann, homme de cabinet, voulait absolue ; fuite que le premier aimait plus en théorie, le second plus en pratique. D'un autre côté, Salzmann voulait contenir le mysticisme dans ces limites évangéliques où se mouvait l'âme à la fois tendre et ambitieuse de Fénelon, un peu entraînée par les extases de Madame Guyon ; Saint-Martin, au contraire, ne goûtait pas Madame Guyon, parlait peu ou point de Fénelon, et ajoutait volontiers à la portée légitime des Saintes-Ecritures les traditions occultes de son ancien maître, dom Martinez. Enfin, Salzmann, tout en tenant beaucoup à l'existence du monde spirituel et à la science de nos rapports avec lui, rejetait absolument la théurgie, dans ses opérations comme dans ses principes. Saint-Martin, au contraire, blâmant les opérations, professait les principes de l'art. D'ailleurs, la piété sincère et les sérieuses aspirations qui devaient rapprocher les deux théosophes ne les [page 288] unirent pas. La stoïque austérité de l'un, si adoucie, qu'elle fût dans ses formes et dans son langage, contrastait trop avec l'humble et gracieuse tenue d'âme de l'autre, pour que leurs rapports prissent les caractères de l'intimité et les conditions de la permanence. Au moment de la séparation, ce fut, non pas à Salzmann que Saint-Martin donna son portrait, mais à Madame Salzmann, femme d'un grand caractère, d'une rare prudence et plus sceptique que croyante, mais pleine d'admiration pour la séduisante humilité du mystique. Après leur séparation ils n'échangèrent plus que quelques lettres. A la correspondance de Salzmann Saint-Martin préféra celle du baron de Liebisdorf, qui sympathisait avec ses principes théurgiques et l'aidait dans ses traductions de Bœhme ; à la correspondance de Saint-Martin, Salzmann préféra celle du conseiller Young-Stilling, qui sympathisait avec ses doctrines millénaires et l'assistait dans ses études pneumatologiques.
La première, la plus grande place dans les affections spirituelles de Saint-Martin, fut prise par Madame de Bœcklin ; c'est à elle qu'il aime à rapporter le plus fécond événement de sa vie d'études, la connaissance du théosophe de Görlitz. Et de même qu'il mit le célèbre philosophe teutonique au-dessus de tous ses autres maîtres, il mit Madame de Bœcklin au-dessus de toutes ses autres amies. D'après mes notes, il a donné trois fois son portrait, et je viens de nommer celle des trois personnes qui a reçu de sa main la charmante gouache aux traits fins et inspirés que j'ai recueillie. Madame de Bœcklin est la seconde ; mais je dois dire que dans la pensée de Saint-Martin il n'y avait pas de comparaison possible entre elle et les deux autres. La place que cette aimable Allemande occupait dans son âme est, je crois, unique même dans l'histoire du mysticisme. Du moins je n'y connais pas d'autre Egérie qui ait été l'objet, de la part d'un théosophe, de sentiments aussi élevés, rendus dans des termes aussi vifs que le sont ceux de Saint-Martin parlant de sa noble amie.
Jacques Matter.



