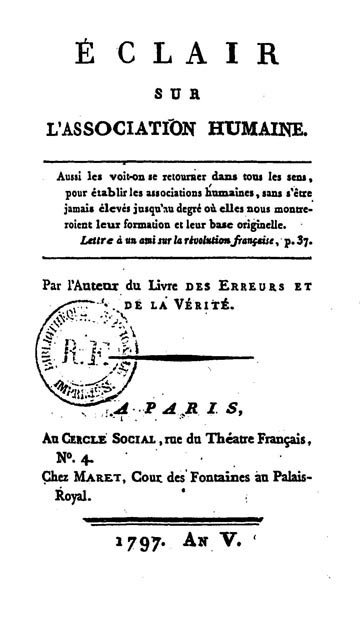 |
Des religions.
{p. 94}
[43]
J’ai assez montré dans ma lettre et dans le présent écrit combien j’étais persuadé que les premières associations humaines avaient été théocratiques, et que tous les gouvernements devraient l’être ; j’ai assez fait entendre que c’était là le terme du niveau auquel tendaient toutes les nations, et que cette tendance était la preuve que c’était de ce même [44] niveau qu’elles étaient primitivement descendues, quoique la chose religieuse ait autant dégénéré parmi les hommes que la chose sociale.
Je ne puis m’empêcher de témoigner ici de nouveau ma surprise de ce que parmi toutes les nations civilisées, et parmi tous les gouvernements que l’on nomme policés, nous sommes le seul peuple chez qui la chose religieuse soit absolument étrangère à la chose publique ; chez qui elle ne soit regardée que comme une influence suspecte et dont le souverain ne puisse trop se garantir, et qu’il ne puisse pas tenir trop loin de lui ; tandis que, selon nos principes, si elle était pure, il ne pourrait pas trop se rapprocher d’elle, et il ne pourrait rien faire de mieux que de la rendre le régulateur de sa propre marche, puisqu’il ne peut être réellement régulier, ou, ce qui est la même chose, rentrer dans les lois de son origine primitive, qu’autant qu’il deviendra entièrement théocratique. Ainsi le point où il est et le point où il devrait être sont à une telle distance l’un de l’autre, qu’il y a sûrement une raison cachée de ce phénomène unique dans l’histoire des nations.
Je laisse à d’autres à prononcer si c’est réellement la chose publique qui s’est éloignée de la chose religieuse, ou si c’est la chose religieuse qui s’est éloignée de la chose publique, et qui veut la laisser livrée à sa propre lumière pour lui en faire sentir l’insuffisance, ou qui enfin voudrait ramener les nations à leur degré primitif théocratique, en les faisant revenir sur leurs pas et en leur faisant parcourir d’abord les sentiers de la pure nature.
Quoi qu’il en soit, lorsque je plaide pour le règne théocratique pris dans sa perfection originelle, je suis bien loin de me laisser conduire dans cette idée par les maximes vulgaires, qui ne regardent la chose religieuse que comme un simple frein politique, qui prétendent qu’il faut une religion aux hommes, si on veut les contenir, et qui ne voient par conséquent dans la chose religieuse qu’un épouvantail que les législateurs font fort bien de montrer au peuple pour l’asservir plus facilement.
Voici, au contraire, ce que je dirais à ceux qui répandraient ces maximes : « Pourquoi avez-vous avili l’homme ? Si vous ne l’aviez pas rendu peuple, vous ne seriez pas dans le cas de le traiter comme tel, et de lui tenir un semblable langage. C’est parce que vous avez fermé en lui toutes les voies de l’intelligence et de la véritable vertu, que vous ne vous trouvez plus envers lui d’autres armes que celle de la crainte et de la déception, et que vous voulez les employer n’importe [45] à quel prix, car la fable et le mensonge vous paraissent propres à remplir vos vues tout aussi bien que la vérité, et vous ne vous occupez pas même d’en faire la différence. [1797 : à la ligne]. Mais, pour vous montrer le peu de justesse de vos calculs, vous voyez sous vos yeux la chose publique se soutenir sans cet appui que vous considérez que politiquement, et qui, comme tel, vous paraissait indispensable. »
« Cessez donc d’être de l’avis de ceux qui, comme Rousseau, veulent étayer l’édifice social avec une religion civile. Comment ce mot pourrait-il entrer dans la pensée, puisqu’au contraire, selon le principe, ce serait le civil même des nations qui pourrait et devrait être religieux ? et le plus grand malheur des peuples a été, lorsque, par l’abus qu’ils ont fait de la chose religieuse, ils ont mérité de retomber dans leur simple naturalisme, qui les égare et les plonge de plus en plus dans le précipice. Gardez-vous encore plus de confondre la chose religieuse avec ce monstrueux fanatisme qui n’a rempli la terre que d’extravagances et de crimes, et ne voyez en elle que ce lien primitif qui devait embrasser toute la famille humaine et la tenir fixée sur sa base originelle, comme un arbre l’est sur sa racine. »
« Aussi, dirais-je encore à ces hommes égarés : Que savez-vous si lorsque les peuples auront subi leur temps d’épreuve, la main suprême ne leur rendra pas la chose religieuse plus développée et plus imposante par sa majestueuse virtualité, que lorsqu’elle a été séparée de la chose publique, et par conséquent plus digne encore des hommages et de la confiance des hommes qui, par l’usage libre de leurs facultés, auront été préparés à la recevoir ? Qui vous a dit que, si dans sa justice elle a opéré devant vous un jugement si terrible, relativement à cette chose religieuse, elle ne puisse pas en rendre un plus terrible encore envers ceux qui auraient été les organes de sa vengeance, et qui, dans ces actes imposants, n’auraient voulu reconnaître que leur propre main, et la substituer à la sienne ? Croyez-vous avoir réellement retranché la vigne parce que vous avez retranché des vignerons qui se sont rendus répréhensibles ? »
« Croyez-vous aussi satisfaire à tous les besoins de l’homme-esprit par de pompeux établissements pour vos sciences externes, et par des institutions doctorales qui ne s’occupent pas de lui ? Sans doute ces institutions pourraient lui être utiles si elles savaient lui parler la vraie langue des sciences, mais loin d’employer ces sciences comme [46] une préparation et une sorte d’initiation de l’homme-esprit aux vérités qui seules sont de son ordre, et qui seules peuvent le nourrir, comme étant seules sa véritable source, vous le reculez, au contraire, par tous vos efforts dirigés en sens inverse de ce qu’il lui faudrait, puisque ces doctes assemblées, toutes glorieuses qu’elles soient de leur élévation et de leurs lumières, sont bien loin de croire à l’homme-esprit, et sembleraient bien plus avides d’effacer en lui cet imposant caractère que de lui en faire manifester les fruits ? »
« Croyez, croyez plutôt que la main suprême est trop surveillante et trop puissante dans ses justes compensations, pour ne pas rendre un jour à l’homme-esprit ce qu’il peut perdre par les imprudentes précipitations des hommes ; croyez que si c’est par ces imprudences que la chose religieuse qui aurait dû être au sommet et comme le premier mobile de la chose publique, lui est devenue totalement subordonnée ou tout à fait étrangère, l’œil de l’éternelle justice, qui ne se ferme point, ne peut manquer de la replacer un jour à son rang naturel, et de lui subordonner à son tour cette chose publique dont elle n’eût jamais cessé d’être le flambeau si l’homme eût su la conserver dans son intégrité radicale. C’est alors que la clef des associations sera vraiment connue ; c’est alors que la pensée pure formera le centre et le noyau de la société humaine ; c’est alors que les nations découvriront ce point primitif du niveau auquel elles tendent toutes, ainsi que les publicistes même qui veulent les conduire sans s’être assurés de ce terme fécond et lumineux vers lequel ils devraient tous diriger leurs pas ; c’est alors enfin que les hommes pourront prendre l’idée de cette universelle volonté générale dont on leur fait tous les jours des peintures si mensongères, en ne la composant qu’avec des éléments pris de la volonté humaine. »
Nous ne disons pas pour cela que les hommes profiteront tous de ces merveilles, puisque depuis l’origine des choses, nous avons vu qu’ils n’avaient fait qu’abuser de toutes les faveurs qui leur avaient été faites, et de toutes les lumières qui leur avaient été communiquées ; oui, sans doute, ils en abuseront encore, mais les droits de la justice ne s’en seront pas moins manifestés et les hommes qui ne les auront pas reconnus et qui n’en auront pas profité, n’en seront pas moins inexcusables. [1797 : à la ligne]. Et vous, lecteur, si je ne me suis pas étendu davantage sur le développement des bases sociales que je vous expose dans cet écrit, c’est que je ne vous avais annoncé qu’un éclair [1797 : Éclair], et qu’il suffisait à mon plan de vous [47] démontrer que l’homme étant esprit, et esprit divin, tout, jusqu’au plus petit détail de son association, avait dû avoir primitivement le caractère théocratique et religieux, et d’après cette grande loi du niveau que tous les faits de la nature nous enseignent et nous attestent. D’ailleurs, les principales ramifications de l’arbre social ainsi que les nuances particulières qui leur sont affectées, ont déjà été développées en grande partie dans la lettre dont j’ai parlé. Si cette lettre renferme, à la vérité, quelques passages, qui, sans être tout à fait étrangers au sujet, auraient pu cependant être réservés pour d’autres écrits où ils tiendraient encore mieux leur place, je dois dire également que les différents principes politiques qui y sont contenus ont paru assez neufs à quelques penseurs pour que je ne me reproche pas de les avoir écrits
Mais faut-il vous donner la véritable raison pour laquelle je ne me suis livré à ces deux ouvrages qu’avec réserve, et comme à regret ? C’est la persuasion où je suis que l’homme, qui retire déjà si peu de fruit des livres en général, en retire encore moins de ceux qui traitent de son association, de ses droits et de sa puissance politique. Si ces livres ne sont pas établis plus solidement que ne le sont ceux des publicistes, ils le trompent, et ce qu’il y aurait de plus pernicieux pour lui, ce serait de les entendre et de les adopter ; s’ils sont appuyés sur la base réelle et primitive, comme le sont ceux que je vous présente, il ne les entend plus, ils sont comme inutiles pour lui, parce que les doctrines humaines ont fermé en lui les portes de l’intelligence sur ce grand objet.
Ainsi quelque confiance que j’aie dans les principes que je lui ai exposés, je n’ignore pas cependant qu’il pourrait y avoir pour lui quelque chose de plus profitable, ce serait de mettre en action son être même et de ne rien négliger pour redevenir complètement homme-esprit, dans la véritable étendue que ce mot comporte. Je le lui ai déjà dit, je le lui répète, et je crois qu’un livre qui à toutes les pages et à toutes les lignes ne contiendrait que cette seule et unique vérité, serait le seul livre qui lui serait vraiment nécessaire.
FIN
Paris. Typographie Morris et Cie, rue Amelot, 64
[1797 : De l’Imprimerie de Le Clere, rue St Martin, près celle aux ours, Nos. 254 et 89].