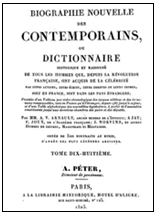
1825 - Biographie nouvelle des contemporains
Par MM. A. V. ARNAULT, ancien membre de l’Institut ;
A. JAY ;
E. JOUY, de l’Académie française ;
J. NORVINS, et autres Hommes de lettres, Magistrats et militaires.
A. PÉTER, Directeur de pensionnat.
Paris -
A la librairie historique,
Hôtel d’Aligre, rue Saint Honoré, n° 125 -1825.
Tome 18e Article Saint-Martin, pages 363-367
SAINT-MARTIN (Louis-Claude de), dit le Philosophe inconnu, naquit à Amboise, le 18 janvier 1743. La manière inexacte et quelquefois calomnieuse dont cet article a été traité dans quelques dictionnaires historiques, nous fait un devoir de le rétablir d’après des documents puisés à de bonnes sources. Placé de bonne heure au collège de Pontlevoy, il eut occasion de parcourir le livre d’Abadie, intitulé : l’Art de se connaître soi-même ; et c’est la lecture de cet ouvrage qui parait lui avoir inspiré une indifférence sans doute réelle pour les choses de ce monde.
Ses parents, désirant en faire un magistrat, lui firent étudier la jurisprudence, mais il s’attacha bien moins aux règles du droit civil qu’aux bases des lois naturelles, dont l’étude convenait mieux à son esprit contemplatif. C’est pour satisfaire son pendant à la méditation qu’il préféra à la magistrature la profession des armes, qui, pendant la paix, lui donnait pleinement le loisir de se livrer à ses recherches psychologiques. Il entra à 22 ans dans le régiment de Foix. Il s'attacha d’abord à Martinez Pasqualis, chef de la secte des Martinistes, dont il exposa la doctrine dans ses premiers ouvrages ; et ce fut par là qu’il se fit connaître dans la voie du spiritualisme.
Après la mort de Martinez, l’école fut transférée à Lyon, où Saint-Martin publia son livre des Erreurs et de la vérité, dans lequel il se montre l’adversaire des encyclopédistes. Cette même école, dont les opérations cessèrent en 1778, vint se fondre, à Paris dans la société des Philalèthes, qu’on accusait de ne professer qu’en apparence la doctrine de Martinez et de Swedenborg, et de chercher réellement les secrets de l'alchimie. Saint-Martin fut invité, en 1784, à se rendre à cette réunion, mais il s’y refusa, dans la persuasion que ses membres n’agissaient pas en véritables initiés, c’est-à-dire unis à leur principe. Il n’aimait que les sociétés où l’on s’occupait de bonne [364] foi d’exercices qui annonçaient des vertus actives ; il voyait une science des esprits dans les séances de Martinez, et une science des âmes dans les visions de Swedenborg.
Quant aux phénomènes du magnétisme somnambulique, il y croyait quoiqu’il les regardât comme étant d'un ordre sensible inférieur. Dans une conférence qu’il eut avec Bailly, l’un des commissaires rapporteurs, il raconte que, pour le convaincre de l’existence d’un agent magnétique indépendant du malade, il lui cita des opérations de ce genre pratiquées sur des chevaux. Bailly lui répondit : Que savez-vous si les chevaux ne pensent pas ?
Avide de vérités, Saint-Martin s’appliqua à l’étude des mathématiques, pour y découvrir l’esprit que pouvait recéler la connaissance des nombres ; il se lia alors avec Lalande, mais bientôt ils se séparèrent, par suite de l’opposition du caractère de chacun d’eux. Il croyait avoir plus de rapports avec J. J. Rousseau ; comme lui, il pensait que les hommes sont naturellement bons, néanmoins il jugeait que le philosophe de Genève était devenu misanthrope par trop de sensibilité, voyant les hommes non tels qu'ils étaient, mais tels qu’il voulait qu’ils fussent. Pour lui, il aima toujours les hommes, et les jugeait meilleurs qu’ils ne paraissaient être ; et les charmes de la bonne société lui faisaient songer à ce que pouvait être une réunion dont les rapports auraient été plus intimes avec son principe. Aussi ses occupations et ses plaisirs furent-ils toujours analogues à cette manière de voir. Ses principales jouissances après l’étude étaient la musique, les promenades champêtres et les conversations amicales : la bienfaisance était aussi une de ses plus douces occupations ; il n’avait rien à lui tant qu’il lui restait quelque chose à donner.
Dans les liaisons qu’il entretenait avec des personnages de distinction (tels que le marquis de Lusignan, le maréchal de Richelieu, le duc d'Orléans, le chevalier de Boufflers, etc.), il croyait avoir trouvé la confirmation et le développement de ses idées sur les grands objets dont il cherchait le principe. Désirant étudier l’homme et la nature, il voyagea comme Pythagore, pour confronter avec son témoignage celui d’un grand nombre d’individus. Dans cette vue, il quitta le service militaire pour se livrer exclusivement à ses recherches spirituelles.
Ce fut à Strasbourg qu’il entendit parler, pour la première fois, du philosophe allemand Jacob Bœhm, regardé en France comme un visionnaire. Il se mit à étudier la langue allemande, afin de comprendre et de traduire les ouvrages de ce célèbre illuminé, où il crut découvrir ce qu’il n’avait qu’entrevu dans les leçons de Martinez.
En 1787, Saint-Martin visita l’Angleterre, et s’y lia avec l’ambassadeur Barthélemy et William Law, éditeur d’une traduction anglaise de Bœhm. L’année suivante, il fit un voyage à Rome avec le prince Alexis Gallitzin, qui ne se croyait un homme que depuis qu’il avait connu Saint-Martin. A son retour de ses excursions en Allemagne, en Angleterre et en Italie, il fut, pour ainsi dire malgré lui, décoré de [365] la croix de Saint-Louis.
La révolution n’influa en rien sur ses sentiments et ses opinions. Élevé au-dessus des préjugés de la naissance, il n’émigra point ; les excès du despotisme ou de l’anarchie lui inspirèrent une égale horreur. En 1793, il alla donner ses soins et rendre les derniers devoirs à un père infirme et paralytique, et se montra alors bon fils et bon citoyen, car, outre les obligations que lui imposait la piété filiale, il sacrifia une partie de son modique revenu aux besoins publics de sa commune. Mais peu de temps après son retour dans la capitale, il fut compris dans le décret du 27 germinal an 2, et quitta Paris. Tandis que la France et même l’Europe entière étaient absorbées dans de grands intérêts politiques, il correspondait sur des objets d'une sphère plus élevée avec un baron suisse, membre du conseil souverain de Berne.
Vivant solitaire au milieu d’une mer orageuse, il se regardait comme le Robinson Crusoé de la spiritualité. Mais quoiqu’il fût étranger à tout ce qui se passait autour du lui, il fut cependant impliqué dans la conspiration dite de la mère de Dieu, et atteint d’un mandat d’arrêt, qu’heureusement le 9 thermidor rendit sans effet. Il se lia intimement avec le membre du conseil de Berne, dont il a été parlé ; néanmoins ils ne se virent jamais, et se contentèrent de s’envoyer réciproquement leurs portraits, et firent échange d’une bienfaisance mutuelle, en venant au secours l’un de l’autre dans l’adversité qu’ils éprouvèrent alternativement. Fidèle à sons pays comme à ses amis, il fut incorporé dans la garde nationale, et s’acquittait personnellement de son service ; il fut chargé, en 1794, de garder la porte du Temple, où était détenu le jeune prince, fils de Louis XVI ; et par un rapprochement non moins singulier que fortuit, il avait été, trois ans auparavant, compris sur la liste des candidats pour le choix d’un gouverneur du dauphin.
Vers la fin de la même année, Saint-Martin, quoique sa qualité de noble lui interdît le séjour de Paris, fut désigné, par le district d’Amboise, comme un des élèves aux écoles normales ; il accepta, espérant, disait-il, qu’il pourrait, en présence de deux mille auditeurs animés de ce qu’il appelait le spiritus mundi, déployer utilement son caractère de spiritualité et sa doctrine du sens moral. Il retourna dans son département, et fit partie des premières assemblées électorales.
A l'âge de soixante ans, Saint-Martin disait qu’il s’avançait vers les grandes jouissances qui lui étaient annoncées depuis longtemps. Depuis quelque temps il ressentait des attaques de la maladie qui avait enlevé son père ; mais il était loin de s’en affliger, et il vit, sans crainte, approcher le terme de son existence. Un entretien qu’il avait désiré avoir avec un mathématicien profondément versé dans la science des nombres, dont le sens caché l’occupait toujours, eut lieu en effet avec M. de Rossel, par l’entremise d’une personne amie de Saint-Martin, et à laquelle nous devons plusieurs documents de cet article. A la fin de cet entretien, il dit : « Je sens que je m’en vais : [366] la Providence peut m’appeler, je suis prêt ; les germes que j’ai tâché de semer fructifieront. Je pars demain pour la campagne d’un de mes amis : je rends grâce au Ciel de m’avoir accordé la dernière faveur que je demandais. »
Le jour suivant, il se rendit à Aunay, près de Sceaux, où était située la maison de campagne de M. Lenoir-Laroche, aujourd’hui pair France (il vient de mourir : février 1825). Après un léger repas, il se retira dans sa chambre, où il eut une attaque d’apoplexie. Quoique sa langue fût embarrassée, il put cependant se faire entendre de ses amis réunis auprès de lui. Peu de moments après il expira sans agonie et sans douleur, le 13 octobre 1803. Saint-Martin a beaucoup écrit, et ses ouvrages ont été de plus commentés et traduits en partie, mais principalement dans les langues du nord de l’Europe. Cependant il était si peu connu dans le monde, que les feuilles publiques, annonçant sa mort, le confondirent avec Martinez Pasqualis, son maître, mort à Saint-Domingue, en 1779. Bien que le disciple ait passé pour être le chef d’une doctrine religieuse, ses sentiments étaient bien loin d’avoir leur source dans des vues particulières ou exclusives.
Les livres
Les ouvrages de Saint-Martin ont pour but, non seulement d’expliquer la nature par l’homme, mais encore de ramener toutes nos connaissances au principe dont l’esprit humain peut devenir le centre. Voici ses principaux ouvrages :
-
1° Examen des erreurs et de la vérité, ou les Hommes rappelés au principe universel de la science, Edimbourg (Lyon), 1775, in-8°. Cet ouvrage a donné naissance au suivant, imprimé sans nom d’auteur, intitulé : Suite des erreurs et de la vérité, etc. Salomonopolis (Paris), 5784 [sic au lieu de 1784] in-8°.
Les autres ouvrages de Saint-Martin sont :
- 2° Tableau naturel des rapport qui existent entre Dieu, l’homme et l’univers, avec l’épigraphe (tirée de l’ouvrage précédent, suivant l’usage de l’auteur) : Expliquer les choses par l’homme, et non l’homme par les choses, Edimbourg (Lyon), 1782, in-8°. Ces deux premiers ouvrages de Saint-Martin ont été traduits en allemand avec un commentaire, par un anonyme, 2 vol. in-8°, 1784.
- 3° L’Homme de désir, Lyon, 1790, in-8°, réimprimé à Metz, an 10 (1802), in-12 ;
- 4° Ecce homo, de l’imprimerie du Cercle Social, 1792, in-12. Dans cet opuscule, l’auteur se propose de montrer à quel degré d’abaissement l’homme infirme est tombé, et de le guérir du penchant au merveilleux d’un ordre inférieur.
- 5° Le Nouvel Homme, Paris, 1792, in-8° ;
- 6° De l’esprit des choses, ou Coup d’œil sur la nature des êtres et sur l’objet de leur existence, Paris, an 8 (1800), 2 vol. in-8° ;
- 7° Lettres à un ami, ou Considérations politiques, philosophiques et religieuses sur la révolution française, Paris, an 3 (1795) ;
- 8° Éclair sur l’association humaine, Paris, an 5 ((1797), in-8° ;
- 9° Réflexions d’un observateur sur cette question proposée par l'Institut : Quelles sont les institutions les plus propres à fonder la morale d'un peuple, an 6 (1798) ;
- 10° Discours en réponse au citoyen Garat, professeur d’entendement [367] humain aux écoles normales, prononcé à la suite d’une conférence publique, le 9 ventôse an 3 ( 27 février 1795) ;
- 11° Essai relatif à la question proposée par l’institut : Déterminer l’influence des signes sur la formation des idées, an7 (1799), in-8° ;
- 12° Le crocodile, ou Guerre du bien et du mal, arrivée sous le règne de Louis X, poème épico-magique, en 102 chants et en prose, mêlé de vers, œuvre posthume d’un amateur de choses cachées, Paris, an 8 (1799), in-8° de 460 pages ;
- 13° le Ministère de l’homme-esprit, Paris, Migneret, an 11 (1802), in-8° : ouvrage assez ténébreux, quoique plus clair que les précédents.
- 14° Traductions d’ouvrages de Bœhm, savoir : l’Aurore naissante ; les Trois principes de l’essence divine ; de la Triple vie de l'homme ; quarante questions sur l’âme, d’après l’édition allemande de Gichtel, 1682, par le philosophe inconnu, avec une notice sur Jacob Bœhm, Paris, an 9 in-8° (1800) : ces diverses traductions forment à peu près le tiers des œuvres de Bœhm.
- 15° Œuvres posthumes de Saint-Martin, 2 vol. in-8° Tours, 1807.
Note
Pour rendre la lecture plus claire et plus facile, nous avons disposé des séparations qui n'existent pas dans l'original.