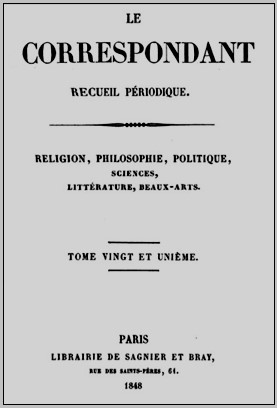 1846 - Examen des doctrines du Philosophe inconnu, Louis-Claude de Saint-Martin
1846 - Examen des doctrines du Philosophe inconnu, Louis-Claude de Saint-Martin
Par Louis Moreau
Le Correspondant, Recueil périodique
Religion, philosophie, politique, sciences, littérature, beaux-arts.
Paris. Librairie de Sagnier et Bray, rue des Saint Pères, 64
Le Correspondant a publié en avant première 4 articles du livre de Louis Moreau
Louis-Ignace Moreau (1807-1881) est un littérateur français, né et décédé à Paris. Conservateur de la bibliothèque Mazarine (1845-1879), traducteur des Confessions (1840) et de La Cité de Dieu (1843-1845) de saint Augustin. Il a également traduit L’Imitation de Jésus-Christ (1850).
Louis Moreau a publié :
- Du Matérialisme phrénologique, de l’Animisme et de l’Influence (2e édition 1846)
- Considérations sur la vraie Doctrine (1844).
- La destinée de l'homme, ou du Mal, de l'Épreuve et de la Stabilité future (1857)
- Jean-Jacques Rousseau et le siècle philosophe (1870)
- Joseph de Maistre (1879)
Nous avons mis des titres lorsqu'il n'y en avait pas. Ces titres entre crochets sont ceux de l'ouvrage de Louis Moreau, puisque les 4 articles publiés ici ne sont que les "bonnes feuilles" publiées en "avant-première" dans la revue Le Correspondant.
Louis Moreau, Le Philosophe inconnu. Réflexions sur les idées de Louis-Claude de Saint-Martin, le Théosophe, suivies de fragments d'une correspondance inédite entre Saint-Martin et Kirchberger. Paris, Lecoffre, 1850.
Nous avons publiés les différentes notes à la suite du texte. Ces notes sont mises entre parenthèses. Lorsqu'il nous a paru nécessaire de faire un commentaire ce dernier est entre crochets.
Voici le texte de que Louis Moreau donne en préambule à son ouvrage qui explique son point de vue sur Saint-Martin :
En publiant ce livre, je me suis proposé un double but, savoir : de rendre témoignage à des vérités impérissables que le théosophe Saint-Martin a su venger des longues dénégations de la philosophie incrédule ; en second lieu, de signaler aux lecteurs trop favorablement prévenus quelques-unes des erreurs où LE PHILOSOPHE INCONNU lui-même est tombé. Il y a un plus grand nombre d'esprits que l'on ne pense qui se laissent éloigner des simples et fortes croyances par l'attrait qu'exercent toujours les spiritualités déréglées et les illusions d'un mysticisme indépendant. Je m'attends et me résigne d'avance au reproche de n'avoir pas creusé jusques au fond des idées que je combats. Je [p.2] me suis en effet borné à relever les contradictions, les lacunes qu'elles présentent, et les dangers du principe même dont elles émanent. Je sais qu'il y aurait encore des sceaux à briser et d'épaisses ténèbres à sonder, mais je suis certain que, de ce chaos patiemment débrouillé, il sortirait peu de jour. Je ne crois pas aux lumières humaines qui se cachent, et je tiens pour suspectes les doctrines qui affectent la profondeur et le secret. Le peu d'énigmes que la correspondance inédite des deux théosophes m'a permis d'interpréter, ne me laissent pas une grande estime pour celles que le sphinx tient encore sous le voile.
1846 - Le Correspondant – T 14
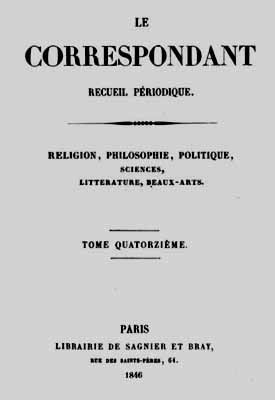 Le Correspondant, Recueil périodique
Le Correspondant, Recueil périodique
Religion, philosophie, politique, sciences, littérature, beaux-arts.
Tome quatorzième
Paris. Librairie de Sagnier et Bray, rue des Saint Pères, 64
1846 - Examen des doctrines du Philosophe inconnu
Examen des doctrines du Philosophe inconnu, Louis-Claude de Saint-Martin, Louis Moreau
1er article - [Sur la vie et les écrits de Saint-Martin]
Pages 495-512
À l'avènement du Christianisme, la seule religion qui survécût à toutes les autres dans le monde romain, c'était la religion du plaisir ou la foi à la débauche. La famille et le foyer domestique n'avaient plus leur culte; les grands dieux, relégués au loin dans leur béatitude et leur indifférence, laissaient à leur place régner Epicure, c'est-à-dire l'homme lui-même avec ses passions. De nobles âmes protestaient vainement contre la doctrine facile qui place dans la jouissance le souverain bien ou la vertu, et les derniers sages du paganisme s'élevèrent d'un effort désespéré contre cette incrédulité grossière et cynique. Mais entre les débris de ces croyances inanimées et les clartés nouvelles voilées à leurs yeux, les philosophes du Portique eurent beau glorifier la liberté morale ; ils exaltèrent l'homme quand il fallait l'humilier ; ils négligèrent la raison du devoir et méconnurent l'instinct de l'espérance. Les néo-platoniciens eurent une notion plus profonde et plus vraie des besoins de l'âme, mais ils livrèrent la philosophie à toutes les puériles superstitions du mysticisme et de la thaumaturgie. Une immoralité effrénée avait envahi la conscience humaine.
Quelque chose de semblable se passe en France dans le cours du XVIIIe siècle. Les hautes classes de la société professent l'épicuréisme pratique de la philosophie voltairienne, et, à leur exemple, le peuple et la bourgeoisie poursuivent ce divorce avec la vérité, qui doit avoir dans la révolution française sa consommation dernière et son expiation. [p.496] On renaît de toutes parts au paganisme, à ses mœurs, à sa sagesse. En présence de ces orgies et de ces molles opinions, quelques-uns reprennent le pallium stoïque; l'Eloge de Marc-Aurèle obtient un succès presque populaire. Sous le nom de tolérance, le scepticisme (mais un scepticisme avide de ruines) détruit la foi dans les âmes, où règne l'égoïsme sous le nom d'amour de l'humanité.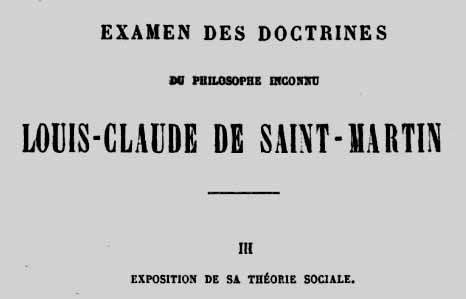
La philanthropie est la charité du déisme. Le dogme de l'indifférence de Dieu pour les hommes implique en morale l'indifférence de l'homme pour ses frères : c'est le moi qui s'affranchit également de Dieu et des hommes. Cependant l'homme ne saurait demeurer dans cette fausse indépendance ; il ne tient pas dans cet égoïsme étroit et sauvage. L'une répugne à son intelligence, qui a besoin de croire ; l'autre à son cœur, qui a besoin d'aimer. Son intelligence est trop vraie pour ne croire qu'en soi-même, et son cœur est trop grand pour n'aimer que soi-même. Si une heureuse inspiration ne le ramène aux pieds de la vérité, il ira plutôt demander aux conceptions les plus monstrueuses, ou aux fantaisies les plus vaines, de quoi remplir ce vide que Dieu laisse en lui par son absence. Aussi voyons-nous à la fin de ce siècle beaucoup d'esprits, fatigués du doute ou blasés, incapables par eux-mêmes de revenir aux croyances saines et durables, chercher un réveil funeste dans les pratiques de rites abominables ou honteux. Mesmer et Cagliostro exploitent la crédulité d'une époque incrédule. Les uns poursuivent la satisfaction d'une infatigable curiosité dans la recherche du grand œuvre ; d'autres se flattent de pénétrer au plus intime de notre nature pour y surprendre le mystère de l'âme et dominer la volonté : ils empruntent à un sommeil néfaste des révélations étrangères à la science. D'autres enfin, combinant le néo-platonisme alexandrin avec les spéculations de la kabbale et de la gnose, et accommodant le Christianisme à cet informe mélange de doctrines, prétendent s'élever à Dieu, non plus par la foi, mais par la connaissance ; non plus par l'abaissement volontaire de l'esprit et du cœur, mais par l'intuition particulière ou la notion vive ; non plus par l'humble acceptation des mystères, mais par le raffinement d'une science ténébreuse, par les rites occultes de la magie et de la théurgie renfermés dans l'enceinte des loges maçonniques.
Un juif portugais conduit par la kabbale au Christianisme (Je ne sais trop quel Christianisme), Martinez Pasqualis, avait fondé un système de théosophie et de magie qui se rattachait, même par une sorte de filiation historique, à la kabbale et au néo-platonisme. Dès 1754, il avait introduit un rite kabbalistique d’élus, appelés COHENS ou PRÊTRES, dans plusieurs loges de France, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux. Il ralliait à sa doctrine ces intelligences égarées, flottantes entre la philosophie d’alors et la religion, [p.497] également incapables de douter et de croire : âmes malades que le sourire de Voltaire avait blessées, et à qui le pain des forts, qui est aussi celui des humbles, ne pouvait plus suffire. Au nombre des disciples de Martinez était un jeune officier au régiment de Foix, qui cependant n'accordait à cet enseignement qu'une adhésion imparfaite. Il avait vingt-trois ans, et toutefois il ne se laissait guère séduire par ces voies extérieures qu'il ne regardait que comme les préludes de notre œuvre. Il préférait déjà la voie intérieure et secrète, et, comme lui-même le raconte, au milieu de ces choses si attrayantes, au milieu des moyens, des formules et des préparatifs de tous genres auxquels on le livrait, il lui arriva plusieurs fois de dire au maître : « Comment, maître, il faut tout cela pour prier le bon Dieu ? » Et le maître répondait : « Il faut bien se contenter de ce que l'on a. » [Correspondance inédite, lettre IV, p.15]
Le philosophe inconnu ne s'est pas assez souvenu de cette question simple et profonde du jeune officier.
Louis-Claude de Saint-Martin (car c'est de lui dont il s'agit) était né d'une famille noble, le 18 janvier 1743, à Amboise, en Touraine, à quelques lieues de la patrie de Descartes, qui n'a pas été sans influence sur lui, et non loin du berceau de Rabelais, qu'il semble vouloir rappeler dans le poème bizarre du Crocodile.
Quoiqu'il ait beaucoup parlé de lui, on n'a presque aucun détail sur sa famille, sur les circonstances privées de son enfance et de sa jeunesse. C'est moins sa vie dans le temps et avec les hommes que sa vie intérieure et avec lui-même dont il aime à s'entretenir.
Il a écrit ces belles paroles :
« Le respect filial a été, dans mon enfance, un sentiment sacré pour moi. J'ai approfondi ce sentiment dans mon âge avancé, et il n'a fait que se fortifier par là. Aussi, je le dis hautement, quelque souffrance que nous éprouvions de la part de nos père et mère, songeons que sans eux nous n'aurions pas le pouvoir de les subir et de les souffrir, et alors nous verrons s'anéantir pour nous le droit de nous en plaindre ; songeons enfin que sans eux nous n'aurions pas le bonheur d'être admis à discerner le juste de l'injuste, et, si nous avons occasion d'exercer à leur égard ce discernement, demeurons toujours dans le respect avec eux pour le beau présent que nous avons reçu par leur organe et qui nous a rendu leur juge. Si même nous savons que leur être essentiel est dans la disette et dans le danger, prions instamment le souverain Maître de leur donner la vie spirituelle en récompense de la vie temporelle qu'ils nous ont donnée. » [Œuvres posthumes, « Mon portrait », n°67].
Il gardait de sa belle-mère un tendre souvenir ; mais le témoignage qu’il lui rend, dicté par une vive reconnaissance, nous laisse entrevoir, sous le voile un peu mystique du langage, que cette affection n’était pas sans inquiétude et sans contrainte. [p.498]
« J'ai une belle-mère, disait-il, à qui je dois peut-être tout mon bonheur, puisque c'est elle qui m'a donné les premiers éléments de cette éducation douce, attentive et pieuse, qui m'a fait aimer de Dieu et des hommes. Je me rappelle d'avoir senti en sa présence une grande circoncision intérieure qui m'a été fort instructive et fort salutaire. Ma pensée était libre auprès d'elle et l'eût toujours été, si nous n'avions eu que nous pour témoins ; mais il y en avait dont nous étions obligés de nous cacher comme si nous avions voulu faire du mal. » [idem, n°111]
Au collège de Pont-Levoy, où il fut envoyé vers l'âge de dix ans, il lut le beau livre d'Abbadie : l'Art de se connaître soi-même, et cette lecture parait avoir décidé de sa vocation pour les choses spirituelles. Cependant, ses études terminées, il lui fallut suivre un cours de droit, et, cédant au désir de son père, il se fit recevoir avocat du roi au siège présidial de Tours. Mais les fonctions assidues de la magistrature ne pouvaient retenir cette intelligence méditative et profonde, plus capable de remonter aux sources mêmes du droit que de s'astreindre à la lettre de la jurisprudence. Il renonça bientôt à la magistrature pour embrasser la profession des armes, et ce ne fut pas l'instinct militaire qui lui fit prendre l'épée ; car « il abhorrait la guerre, » quoiqu'il « adorât la mort » (« J’abohrre la guerre, j’adore la mort », Œuvr. post., Pensées, 952) ; mais il trouvait dans les loisirs d'une garnison cette espèce d'indépendance que le barreau ne laisse ordinairement ni à l'esprit ni aux habitudes.
Ce fut à Bordeaux que, affilié avec plusieurs officiers du régiment de Foix à l'une des sociétés fondées par Martinez Pasqualis, il suivit les leçons de ce maître, en qui il reconnaissait « des vertus très actives, » mais dont il s'éloigna depuis pour se donner tout entier au fameux cordonnier de Görlitz, Jacob Böhm, le prince des théosophes allemands. « Excepté mon premier éducateur Martinez Pasqualis, disait-il, et mon second éducateur Jacob Böhme, mort il y a cent cinquante ans, je n'ai vu sur la terre que des gens qui voulaient être maîtres et qui n'étaient pas même en état d'être disciples. » [Portrait, n°73].
Martinez, selon le témoignage de Saint-Martin, avait la clef active des spéculations théosophiques de Bœhm. Il professait l'erreur d'Origène sur la résipiscence de l'être pervers à laquelle le premier homme aurait été chargé de travailler. Cette idée paraît à Saint-Martin digne du plan universel, mais il prétend n'avoir à cet égard aucune démonstration positive, excepté par l'intelligence. « Quant à Sophie et au Roi du Monde, dit-il encore, Martinez Pasqualis ne nous a rien dévoilé sur cela, et nous a laissé dans les notions ordinaires de Marie et du démon. Mais je n'assurerai pas pour cela qu'il n'en eût pas la connaissance. » [Correspondance, Lettre XCII, p.272] On voit reparaître dans ces obscurs et téméraires enseignements cette [p.499] distinction entre la doctrine livrée au vulgaire et celle dont le sanctuaire ne s'ouvre que pour un petit nombre d'initiés, cette doctrine ésotérique qui n'est que le système des castes intellectuelles, et dont le Christianisme a horreur.
Martinez Pasqualis était venu à Paris en 1768, et, pendant les dix années de son séjour en cette ville, il se fit de nombreux prosélytes, qui, vers 1775, formèrent une secte connue sous le nom de Martinistes, et très répandue dans l'Allemagne et dans le Nord. Saint-Martin venait de publier à Lyon son livre des Erreurs et de la Vérité, et cette circonstance a pu concourir avec la similitude du nom à faire passer le disciple pour le fondateur même de l'école. Après le départ de Martinez, mort en 1779 [sic, pour 1774] au Port-au-Prince, l'école se fondit à Paris dans la Société des Grands-Profès ou dans celle des Philalèthes. Invité en 1784 à cette dernière réunion, Saint-Martin refusa de s'y rendre. Il dédaignait la recherche du grand œuvre et les opérations de la franc-maçonnerie.
(Il écrivait plus tard, touchant ces premières initiations théurgiques et cabalistique» : « Dans l'école où j'ai passé, les communications de tout genre étaient fréquentes. J'en ai eu ma part comme beaucoup d'autres. Les manifestations ou signes du réparateur étaient visibles; j'y avais été préparé par des initiations... Mais le danger de ces initiations est de livrer l'homme à des esprits violents, et je ne puis répondre que les formes qui se communiquaient à moi ne fussent pas des formes d'emprunt. » — Satan se transfigure en ange de lumière, dit l'Apôtre). [Correspondance, lettre XIX, p.62].
Les manifestations sensibles lui révélaient, dans la doctrine de Martinez, une science des esprits, dans la doctrine de Swedenborg une science des âmes ; les phénomènes du magnétisme somnambulique appartenaient, suivant lui, à un ordre inférieur, mais il y croyait. Cherchant dans une conférence avec Bailly à convaincre ce savant de l'existence d'un pouvoir magnétique où l'on ne pouvait soupçonner la complicité du malade, il signale plusieurs opérations faites sur des chevaux que l'on traitait par le magnétisme. « Que savez-vous, dit Bailly, si les chevaux ne pensent pas ? — Monsieur, lui répondit Saint-Martin, vous êtes bien avancé pour votre âge. » [Portrait, n°122]
Dans cette même année 1784, il rédigea un mémoire sur cette question proposée par l'Académie de Berlin : « Quelle est la meilleure manière de rappeler à la raison les nations, tant sauvages que policées, qui sont livrées aux erreurs et aux superstitions de tout genre ? » L'intention de cette niaiserie philosophique est évidente. C'était le temps où les Nicolaïtes ou illuminants, Aufklœrer, précurseurs immédiats des rationalistes, comparaient hautement le divin Maître au célèbre imposteur tartare, le dalaï-lama. Saint-Martin entreprit de démontrer que la solution demandée était impossible par les seuls moyens humains : ce n'était pas la réponse que voulait l'Académie, et la question ayant été [p.500] remise au concours pour l'année suivante, un pasteur de l'Eglise française, nommé Avrillon, obtint le prix en donnant au problème une solution platonicienne. La thèse qu'il avait soutenue en face de l'Académie de Berlin, Saint-Martin la développa quatorze ans plus tard dans ses «Réflexions d'un observateur sur la question proposée par l'Institut (de France) : Quelles sont les institutions les plus propres à fonder la morale d'un peuple ? » (An VI, 1798.)
Je reviendrai sur ce sujet.
C'est à peu près vers cette époque de sa vie que, pendant un séjour qu'il fit à Strasbourg, il dut à l'une de ses amies, Mme Bœcklin, de connaître les écrits du célèbre illuminé Jacob Bœhm. Il avait déjà dépassé les dernières limites de la jeunesse, et cependant il se mit avec ardeur à l'étude de la langue allemande, afin d'entendre les ouvrages de ce théosophe qu'il regarda toujours depuis « comme la plus grande lumière humaine qui eût paru. » Cette admiration exaltée jusqu'au fanatisme lui inspirait ces paroles bizarres :
« Ce ne sont pas mes ouvrages qui me font le plus gémir sur cette insouciance générale ; ce sont ceux d'un homme dont je ne suis pas digne de dénouer les cordons de ses souliers (sic), mon charissime Bœhm. Il faut que l'homme soit entièrement devenu roc ou démon pour n'avoir pas profité plus qu'il n'a fait de ce trésor envoyé au monde il y a cent quatre-vingts ans. » [Œuvres Posthumes, pensée 334].
Dans un voyage qu'il fit en Angleterre en 1787, il se lia avec l'ambassadeur Barthélémy et connut William Law, éditeur d'une version anglaise et d'un précis des livres de Jacob Bœhm. En 1788, il alla visiter Rome et l'Italie avec le prince Alexis Galitzin, qui disait à M. de Fortia d'Urban : « Je ne suis véritablement un homme que depuis que j'ai connu M. de Saint-Martin.» Il vit l'Allemagne et la Suisse. [Ndw : Saint-Martin n’est jamais allé en Allemagne ni en Suisse !]. Il voyageait plutôt en sage qu'en artiste ou en poète. « Je n'ai jamais goûté bien longtemps, disait-il, les beautés que la terre offre à nos yeux, le spectacle des champs, les paysages. Mon esprit s'élevait bientôt au modèle dont ces objets nous peignent les richesses ou les perfections. » [Portrait, n°1051]
A son retour, quoique retiré du service, il fut fait chevalier de Saint-Louis. [Saint-Martin n’a jamais reçu cette distinction, il s’en est expliqué dans son Portrait, n°153].
Ses recherches sur la science des nombres amenèrent entre Lalande et lui une liaison passagère. Le théosophe qui voyait Dieu partout pouvait-il s'accorder longtemps avec le géomètre qui éliminait Dieu de partout ?
Le maréchal de Richelieu voulait le mettre en rapport avec Voltaire qui mourut dans la quinzaine (Pensées, 129). Il aurait eu plus d'agrément, il le [p.501] croyait du moins, et plus de succès auprès de Rousseau ; mais il ne le vit jamais.
« Rousseau, dit-il, était meilleur que moi Il tendait au bien par le cœur ; j'y tendais par l'esprit, les lumières et les connaissances. Je laisse cependant aux hommes de l'intelligence à discerner ce que j'appelle les vraies lumières et les vraies connaissances, et à ne pas les confondre avec les sciences humaines, qui ne font que des ignorants et des orgueilleux. » (Pensées, 423. Il dit encore: « A la lecture des Confessions de J.-J. Rousseau, j'ai été frappé de toutes les ressemblances que je me suis trouvées avec lui, tant dans nos manières empruntées avec les femmes que dans notre goût tenant à la fois de la raison et de l'enfance, et dans la facilité avec laquelle on nous a jugés stupides dans le monde, quand nous n'avions pas une entière liberté de nous développer. Notre temporel a eu quelque similitude, vu nos positions sociales dans le monde ; mais sûrement, s'il s'était trouvé à ma place, avec ses moyens et mon temporel, il serait devenu un autre homme que moi ». Pensées, 60).
Les charmes de la bonne compagnie, suivant un de ses biographes, lui faisaient imaginer ce que pouvait valoir une réunion plus parfaite dans ses rapports intimes avec son principe. C'est à cet ordre de pensées qu'il ramenait ses liaisons habituelles avec les personnes du rang le plus élevé, telles que le duc d'Orléans, le maréchal de Richelieu, la duchesse de Bourbon, la marquise de Lusignan, etc. Ce fut en partie chez cette dernière, au Luxembourg, qu'il écrivit le Tableau naturel.
Il dicta son Ecce Homo à l'intention de la duchesse de Bourbon, cette princesse si malheureuse, femme séparée du dernier prince de Condé et mère du dernier duc d'Enghien, persécutée, chassée par la Révolution qu'elle avait acceptée, et dans les ennuis de l'exil réduite à conjurer le meurtrier de son fils de lui permettre de revoir la France.
Revenue depuis de ses erreurs mystiques à la pratique simple de la religion, elle se laissait alors entraîner au merveilleux de l'ordre inférieur, comme le somnambulisme et les prophéties d'une visionnaire, Suzanne Labrousse, dont l'ex-Chartreux Dom Gerle et l'évêque constitutionnel Pontard étaient les ardents prosélytes.
« A moins que la Clef divine n'ouvre elle-même l'âme de l'homme, dit Saint-Martin dans cet ouvrage, dès l'instant qu'elle sera ouverte par une autre clef, elle va se trouver au milieu de quelques-unes de ces régions (d'illusion ou de lumière douteuse), et elle peut involontairement nous en transmettre le langage. Alors, quelque extraordinaire que nous paraisse ce langage, il se peut qu'il n'en soit pas moins un langage faux et trompeur ; bien plus, il peut être un langage vrai sans que ce soit la vérité qui le prononce, et, par conséquent, sans que les fruits en soient véritablement profitables. » (Ecce Homo, p. 124.) [p.502]
Saint-Martin pensait sans doute à son illustre amie, quand il laissait échapper de son cœur ces paroles touchantes :
« J'ai par le monde une amie comme il n'y en a point. Je ne connais qu'elle avec qui mon âme puisse s'épancher tout à son aise et s'entretenir sur les grands objets qui m'occupent... Nous sommes séparés par les circonstances. Mon Dieu, qui connaissez le besoin que j'ai d'elle, faites-lui parvenir mes pensées et faites-moi parvenir les siennes, et abrégez, s'il est possible, le temps de notre séparation ». (Pensées, 103).
Il disait encore :
« Il y a eu deux êtres dans ce monde en présence desquels Dieu m'a aimé. Aussi, quoique l'un d'eux fût une femme [ma B.], j'ai pu les aimer tous deux aussi purement que j'aime Dieu, et, par conséquent, les aimer en présence de Dieu, et il n'y a que de cette manière que l'on doive s'aimer si l'on veut que les amitiés soient durables. » (Pensées, 7).
Le saint pénitent de Thagaste, s'accusant de la trop vive douleur qu'il a ressentie de la perte d'un ami, s'écrie d'un accent plus pieux et plus sûr : « Heureux qui vous aime, ô Dieu ! et son ami en vous, et son ennemi pour vous ! Celui-là seul ne perd aucun être cher, à qui tous sont chers en celui qui ne se perd jamais. » (Beatus qui amat te, et amicum in te, et inimicum propter te. Solus enim nullam charum amittit, cui omnes in illo chari sunt qui non amittitur. (Confessions I. VI, 9, 2)).
La Révolution française survint. Saint-Martin fut du petit nombre d'hommes éminents qui eurent l'intelligence de ce grand événement. Supérieur aux passions politiques, il l'accepta avec cette religieuse épouvante que répand dans les âmes recueillies la vue des justices divines. Il fit plus peut-être que de maudire ce terrible passage de notre histoire ; le premier il le jugea. Vers le temps où il publia sa Lettre à un ami sur la Révolution, publication antérieure aux célèbres Considérations du comte de Maistre, il écrivait ces paroles remarquables :
« La France a été visitée la première, et elle l'a été très sévèrement, parce qu'elle a été très coupable. Ceux des pays qui ne valent pas mieux qu'elle ne seront pas épargnés quand le temps de leur visite sera arrivé. Je crois plus que jamais que Babel sera poursuivie et renversée progressivement dans tout le globe ; ce qui n'empêchera pas qu'elle ne pousse ensuite de nouveaux rejetons qui seront déracinés au jugement final ». (Correspondance inédite de Saint-Martin et de Kirchberger, baron de Liebisdorf. J'ai dû la communication d'un manuscrit de cette précieuse correspondance à l'obligeance toute aimable de M. Alexandre de Tourgueneff, ancien ministre de l'instruction publique en Russie, sous l'empereur Alexandre. Ce savant et excellent homme est mort à Moscou, le 15 décembre dernier. Avant son départ, j'avais eu une conversation avec lui sur Saint-Martin, fort instructive pour moi. Quoiqu'il eût déjà comme un pressentiment de sa fin prochaine, j'étais loin de penser que notre entretien sur les théosophes serait le dernier de nos entretiens). [p.503]
Ma mémoire ne me rappelle rien dans ses écrits imprimés qui fasse une allusion précise aux mémorables événements de cette époque, si ce n'est peut-être cette pensée que je lis dans ses Œuvres posthumes :
« Une des choses qui m'a le plus frappé dans les récits qui m'ont été faits de la conduite de Louis XVI lors de son procès a été de ce qu'il aurait été tenté, comme roi, de ne pas répondre à ses juges, qu'il ne reconnaissait pas pour tels, mais de ce qu'il oublia sa propre gloire, disant que l'on ne pourrait pas savoir ce que ses réponses pourraient produire, et qu'il ne fallait pas refuser à son peuple la moindre des occasions qui pourraient l'empêcher de commettre un grand crime. J'ai trouvé beaucoup de vertu dans cette réponse. (Pensées 751).
Au moment même où le torrent de la Révolution roulait en flots de sang, à la lueur des incendies, au bruit de la guerre ([Maximin] Isnard [de l’Immortalité de l’âme, 1802]), Saint-Martin, retiré à Amboise pour rendre à son vieux père les derniers soins et les derniers devoirs, entretenait une correspondance suivie sur les plus hautes questions de la métaphysique et de la théosophie avec le baron suisse Kirchberger de Liebisdorf, membre du conseil souverain de la république de Berne.
Singulier contraste entre le bruit épouvantable que fait tout ce siècle qui croule et ce paisible dialogue sur les mystères de l'âme, sur les mystères des nombres, sur toutes les questions relatives à l'infini et à l'ordre futur ! Ce contraste est surtout remarquable dans une lettre datée du 25 août 1792, où, racontant en quelques mots la sanglante journée du 10 :
« Les rues, dit-il, qui bordent l'hôtel où je loge étaient un champ de bataille; l'hôtel lui-même était un hôpital où l'on apportait les blessés, et en outre il était menacé à tout moment d'invasion et de pillage (l'hôtel de la duchesse de Bourbon). Au milieu de tout cela, il me fallait, au péril de ma vie, aller voir et soigner ma sœur (Bathilde de Bourbon, sœur en initiation) à demi-lieue de chez moi... » [L’auteur ici se trompe, il s’agit bien de la sœur de Saint-Martin]
Il ajoute presque aussitôt :
« Je suis dans une maison où Mme Guyon est très en vogue. On vient de m'en faire lire quelque chose. J'ai éprouvé à cette lecture combien l'inspiration féminine est faible et vague en comparaison de l'inspiration masculine. Dans Bœhme je trouve un aplomb d'une solidité inébranlable ; j'y trouve une profondeur, une élévation, une nourriture si pleine et si soutenue que je vous avoue que je croirais perdre mon temps que de chercher ailleurs ; aussi j'ai laissé là les autres lectures. » [Correspondance, lettre VIII, p.29]
Ces paroles étaient en même temps une petite leçon adressée à [p.504] Kirchberger, qui, lui, cherchait ailleurs, qui cherchait partout, et dont la curiosité s'étendait à des objets dont Saint-Martin faisait fort peu de cas.
« La maçonnerie dont vous me parlez, lui écrivait-il en 1794, je ne la connais point et ne puis vous en rendre aucun compte. Vous savez mon goût pour les choses simples et combien ce goût se fortifie en moi par mes lectures favorites. Ainsi tout ce qui tient encore à ce que je dois appeler la chapelle s'éloigne chaque jour de ma pensée Quant aux ouvrages de Swedenborg, mon opinion est imprimée dans l'Homme de désir..... Je vous avoue qu'après de semblables richesses qui vous sont ouvertes (les œuvres de Jacob Bœhm), et dont vous pouvez jouir à votre aise à cause de votre langue et de tous les avantages terrestres que la paix politique vous procure, je souffre quelquefois de vous voir me consulter sur des loges et sur d'autres bagatelles de ce genre ; moi qui, dans les situations pénibles en tous sens où je me trouve aurais besoin qu'on me portât sans cesse vers ce pays natal où tous mes désirs et mes besoins me rappellent, mais où mes forces rassemblées tout entières sont à peine suffisantes pour me fixer par intervalle, vu l'isolement absolu où je vis ici sur ces objets. Je me regarde comme le Robinson Crusoé de la spiritualité, et, quand je vous vois me faire des questions dans ces circonstances, il me semble voir un fermier général de notre ancien régime, bien gros et bien gras, allant consulter l'autre Robinson sur le chapitre des subsistances ; je dois vous dire ce qu'il lui répondrait : « Monsieur, vous êtes dans l'abondance et moi dans la misère ; faites-moi plutôt part de votre opulence. » [idem, lettre LI, p.138]
Le moment d'ailleurs n'était pas favorable aux idées mystiques. La théosophie même devenait suspecte. La prétendue conjuration de Catherine Théos, la mère de Dieu, et les folles prédications auxquelles l'ex-Chartreux Dom Gerle se livrait dans l'hôtel même de la duchesse de Bourbon, appelèrent l'attention du gouvernement révolutionnaire sur l'innocente correspondance du philosophe inconnu avec le baron de Liebisdorf. Dans la lettre que je viens de citer Saint-Martin invoque à l'appui de ses réflexions des avertissements d'une autre nature.
« Dans ce moment-ci, ajoute-t-il, il est peu prudent de s'étendre sur ces matières. Les papiers publics auront pu vous instruire des extravagances spirituelles que des fous et des imbéciles viennent d'exposer aux yeux de notre justice révolutionnaire. Ces imprudentes ignorances gâtent le métier, et les hommes les plus posés dans cette affaire-ci doivent eux-mêmes s'attendre à tout: c'est ce que je fais, parce que je ne doute pas que tout n'ait la même couleur pour ceux qui sont préposés pour juger de ces choses et qui n'ont pas les notions essentielles pour en faire le départ Mais en même temps que je prévois tout, je suis bien loin de me plaindre de rien. Le cercle de ma vie est tellement rempli et d'une manière si délicieuse que, s'il plaisait à la Providence de le fermer dans ce moment, de quelque façon que ce fût, je n'aurais encore qu'à la remercier, Néanmoins, comme on est comptable de ses actions, faisons-en le moins que nous pourrons et ne parlons de tout ceci dans nos lettres que succinctement (Correspondance inédite et manuscrite de Saint-Martin, 5 messidor, 23 juin 1794.). [p.505]
Dès le 21 mai de l'année précédente, il écrivait à son ami :
« Celle de vos lettres qui a été accidentellement retardée est du 5 avril. Votre dernière, du 14 mai, a été aussi retenue au Comité de sûreté générale à Paris, d'où elle m'a été renvoyée avec un cachet rouge par-dessus votre cachet noir. Vous voyez combien il est important de ne nous occuper que des choses qui ne sont pas de ce monde. »
Mais l'autre monde n'était plus même un asile sûr pour les méditations de la pensée suspecte. La police révolutionnaire ne comprenait pas que l'on pût se réfugier là de bonne foi et sans nourrir des projets de contre-révolution. Saint-Martin avait cependant donné des preuves suffisantes de son désintéressement politique. Quoique noble, il n'avait pas émigré ; chevalier de Saint-Louis [SM n’a pas obtenu cette distinction], il avait fait son service dans la milice bourgeoise et monté la garde au Temple, prison et tombeau de Louis XVII ; trois ans auparavant, son nom était inscrit sur la liste des candidats proposés par l'Assemblée nationale pour le choix d'un gouverneur de ce jeune prince. Ces gages de soumission donnés à la République ne purent le mettre à l'abri d'un mandat d'arrêt, sous la prévention de complicité dans l'affaire de Catherine Théos. Fort heureusement le 9 thermidor vint le soustraire au jugement du sanguinaire tribunal. Car il faut bien reconnaître à ce régime sauvage le mérite d'une activité rare ; il n'a laissé passer aucune tête éminente sans la persécuter, l'outrager ou l'abattre !
En méditant sur ces faits étranges et si pleins d'enseignements, Saint-Martin disait encore :
« Je crois voir l'Evangile se prêcher aujourd'hui par la force et l'autorité de l'esprit, puisque les hommes ne l'ont pas voulu écouter lorsqu'il le leur a prêché dans la douceur, et que les prêtres ne nous l'avaient prêché que dans leur hypocrisie. Or, si l'esprit prêche, il le fait dans la vérité, et ramènera sans doute l'homme égaré à ce terme évangélique où nous ne sommes plus absolument rien et où Dieu est tout. Mais le passage de nos ignorances, de nos souillures et de nos impunités à ce terme ne peut être doux. Ainsi je tache de me tenir prêt à tout. C'est ce que nous devrions faire, même quand les hommes nous laisseraient la paix; à plus forte raison quand ils joignent leurs mouvements à ceux qui agitent naturellement tout l'univers depuis le crime de l'homme. Notre royaume n'est pas de ce monde ; voilà ce que nous devrions nous dire à tous les moments et exclusivement à toute autre chose sans exception, et voilà cependant ce que nous ne nous disons jamais, excepté du bout des lèvres. Or, la vérité qui a annoncé cette parole ne peut permettre que ce soit une parole vaine, et elle rompt elle-même les entraves qui nous lient de toutes parts à cette illusion apparente, afin de nous rendre à la liberté et au sentiment de notre vie réelle. Notre révolution actuelle, que je considère sous ce rapport, me paraît un des sermons les plus expressifs qui aient été prêchés en ce monde. Prions pour que les hommes en profitent. [p.506] Je ne prie point pour n'être pas compris au nombre de ceux qui doivent y servir de signe à la justice; je prie pour ne jamais oublier l'Evangile, tel que l'esprit veut le faire concevoir à nos cœurs, et, quelque part où je sois, je serai heureux, puisque j'y serai avec l'esprit de vérité » (25 fructidor, septembre 1794).
Vers la fin de l'année 1794, il dut revenir à Paris dont il était expulsé comme noble par le décret du 27 germinal an II. Voici quelles circonstances le rappelaient.
L'échafaud de Robespierre venait de rendre la liberté à la France. La Terreur, fatiguée de crimes, commençait à défaillir. Mais sur ce sol si profondément remué tout n'était plus que sang et décombres. La dispersion du clergé, l'abolition des Ordres religieux et des corporations enseignantes, enveloppés dans la ruine de l'ancien gouvernement, laissaient la France à ses profondes ténèbres. L'impiété elle-même en fut épouvantée : Impia æternam timuerunt sæcula noctem. Elle eut peur de la nuit qu'elle avait faite et de l'état sauvage dans lequel grandissaient les générations nouvelles. Il s'agissait donc de ranimer « le flambeau des sciences prêt à s'éteindre ; » il s'agissait de « garantir la génération suivante des funestes effets du vandalisme. » « A la vue des ruines sur lesquelles l'ignorance et la barbarie établissaient leur empire, » il fallait bien reconnaître que l'instruction était le premier mobile de la félicité publique (Introduction aux cours de l'Ecole normale, 1808). Mais il ne s'agissait pas seulement de répandre l'instruction, il fallait former des instituteurs ; tel était le but des écoles normales.
« Dans ces écoles, disait le rapporteur du projet, Lakanal, ce n'est pas les sciences que l'on enseignera, mais l'art de les enseigner. Au sortir de ces écoles les disciples ne devront pas être seulement des hommes instruits, mais des hommes capables d'instruire. Pour la première fois sur la terre, la nature, la vérité, la raison et la philosophie vont donc avoir aussi un séminaire (voir l’encadré). [p.507]
|
Encadré, note de L. Moreau Rapport à la Convention, séance du 3 brumaire an III. Ce rapport contient, sur le désarroi moral des hommes influents de cette époque et leur impuissance à conduire les faits dans la Révolution les aveux les plus instructifs et les plus involontaires. Nous citerons les lignes suivantes : « Lorsque du milieu de tant de causes, de tant d'expériences morales si nouvelles il sortait tous les jours de nouvelles vérités, comment songer à poser par l'instruction les principes immuables ? Les hommes de l'âge le plus mûr, les législateurs eux-mêmes, devenus les disciples de cette foule d'événements qui éclataient à chaque instant comme des phénomènes, et qui avec toutes les choses changeaient toutes les idées, les législateurs ne pouvaient pas se détourner de l'enseignement qu'ils recevaient pour en donner un à l'enfance et à la jeunesse : ils auraient ressemblé à des astronomes qui, à l'instant où des comètes secouent leur chevelure étincelante sur la terre, se renfermeraient dans leur cabinet pour écrire la théorie des comètes... Le temps, qu'on a appelé le grand maître de l'homme, le temps, devenu si fécond en leçons plus terribles et mieux écoutées, devait être en quelque sorte le professeur unique et universel de la République. » |
Puis il ajoute :
« Aussitôt que seront terminés, à Paris, ces cours de l'art d'enseigner les connaissances humaines, la jeunesse savante et philosophe qui aura reçu ces grandes leçons ira les répéter à son tour dans toutes les parties de la république d'où elle aura été appelée.... Cette source de lumière si pure, si abondante, puisqu'elle partira des premiers hommes de la République en tout genre, épanchée de réservoir en réservoir, se répandra d'espace en espace dans toute la France, sans rien perdre de sa pureté dans son cours. Aux Pyrénées et aux Alpes l'art d'enseigner sera le même qu'à Paris, et cet art sera celui de la nature et du génie La raison humaine, cultivée partout avec une industrie également éclairée, produira partout les mêmes résultats, et ces résultats seront la recréation de l'entendement humain chez un peuple qui va devenir l'exemple et le modèle du mande. »
Ainsi, pour que la nation française devînt incontinent l'exemple et le modèle du monde, il ne fallait rien moins que recréer l'entendement humain. Telle était la manie de ce siècle ; détruire, que dis-je, détruire ? anéantir les ruines mêmes, afin de créer ex nihilo, afin de créer comme Dieu, sans Dieu ! Aussi les hommes de ce temps n'ont-ils été puissants qu'à l'œuvre de destruction. Pour détruire, l'homme suffit ; mais pour rétablir et fonder, Dieu ne permet pas qu'on se passe de lui.
Saint-Martin fut choisi comme élève à l'Ecole normale par le district d'Amboise, mais obligé de remplir certaines formalités, vu sa tache nobiliaire qui lui interdisait le séjour de Paris jusqu'à la paix. Voici comme il envisageait d'abord cette mission inattendue.
« Elle peut, disait-il, me contrarier sous certains rapports ; elle va me courber l'esprit sur les simples instructions du premier âge. Elle va aussi me jeter dans la parole externe, moi qui n'en voudrais plus entendre ni proférer d'autre que la parole interne. Mais elle me présente aussi un aspect moins repoussant : c'est celui de croire que tout est lié dans notre grande révolution, où je suis payé pour voir la main de la Providence. Alors, il n'y a plus rien de petit pour moi, et ne serais-je qu'un grain de sable dans l'édifice que Dieu prépare aux nations, je ne dois pas résister quand on m'appelle, car je ne suis que passif dans tout cela... Le principal motif de mon acceptation est de penser qu'avec l'aide de Dieu je puis espérer, par ma présence et mes prières, d'arrêter une partie des obstacles que l'ennemi de tout bien ne manquera pas de semer dans cette grande carrière qui va s'ouvrir et d'où peut dépendre le bonheur de tant de générations... Et, quand je ne détournerais qu'une goutte du poison que cet ennemi cherchera à jeter sur la racine même de cet arbre qui doit couvrir de son ombre tout mon pays, je me croirais coupable de reculer » (Correspondance manuscrite, 15 nivôse an III (4 janvier 1795).
Il arriva à Paris dans les premiers jours de janvier 1795 ; mais [p.508] l’ouverture des conférences fut retardée. Le projet n'était pas mûr ; il s'éloignait déjà du but simple de son institution.
« Je gèle ici faute de bois, écrivait-il à Kirchberger, au lieu que dans ma petite campagne je ne manquais de rien. Mais il ne faut pas regarder à ces choses-là ; faisons-nous esprit, il ne nous manquera rien ; car il n'y a point d'esprit sans parole, et point de parole sans puissance. »
Les conférences ne tardèrent pas à justifier toutes ses prévisions, et quelles difficultés les principes spiritualistes trouveraient à se faire entendre en présence de ces chaires et de cet auditoire incrédules.
« Quant à nos écoles normales, écrit-il encore, ce n'est encore que le spiritus mundi tout pur, et je vois bien qui est celui qui se cache sous ce manteau. Je ferai tout ce que les circonstances me permettront pour remplir le seul objet que j'aie eu en acceptant ; mais ces circonstances sont vaines et peu favorables. C'est beaucoup si, dans un mois, je puis parler cinq ou six minutes, et cela devant deux mille personnes à qui il faudrait auparavant refaire les oreilles » (ibidem, 5 ventôse, 25 février 1795).
Il trouva cependant une occasion éclatante de rompre en visière à l'esprit du siècle et de proclamer hardiment ses propres principes. « J'ai jeté une pierre dans le front d'un des Goliath de notre Ecole normale ; les rieurs n'ont pas été pour lui, tout professeur qu'il est. » Mais il n'eut pas le loisir de poursuivre à son gré cette piquante controverse avec le professeur Garat. Les écoles normales furent dissoutes le 30 floréal de cette même année, mesure qu'il regarda dès lors comme un événement heureux. Ces écoles n'avaient d'autre but que de continuer l'œuvre des philosophes et de perpétuer le système d'impiété qu'ils avaient, disait-il, « assez provigné en France depuis soixante ans.» Et il ajoutait :
« Je regarde comme un effet de la Providence que ces écoles-là soient détruites... Ne croyez pas que notre révolution française soit une chose indifférente sur la terre : je la regarde comme la révolution du genre humain... C'est une miniature du jugement dernier, mais qui doit en offrir toutes les traces, à cela près que les choses ne doivent s'y passer que successivement, au lieu qu'à la fin tout s'opérera instantanément » (30 prairial, juin 1795).
De retour dans son département, Saint-Martin fut membre des premières réunions électorales; mais sa vie publique devait se borner à son passage à l'Ecole normale et à son démêlé avec le professeur d'analyse de l'entendement humain : il ne fit jamais partie d'aucune assemblée politique. Il poursuivit son active correspondance avec le baron de Liebisdorf. Les deux amis, qui ne devaient point se voir en ce monde, s'envoyèrent mutuellement leur portrait. Le discrédit des assignats [p.509] ayant réduit Saint-Martin à une extrême détresse, Kirchberger lui fit passer dix louis d'or. Le premier mouvement de Saint-Martin fut de les renvoyer sur-le-champ ; un second le retint. La fierté de Rousseau lui eût paru plus dans la mesure, si elle eût été fondée sur la haute foi évangélique qui donne et crée les moyens de ne connaître aucun besoin. « Mais, dit-il, quoique sa ferme philosophie me paraisse toujours très estimable sans s'élever à ce point, elle ne m'a pas paru assez conséquente ; car s'il prêche tant l'exercice des vertus et de la bienfaisance, il faut donc aussi leur laisser un libre cours quand elles se présentent » (Correspond, manuscrite, 8 nivôse an IV). Saint-Martin reçut les dix louis, et, à son tour, il put offrir plus tard à Kirchberger, dont la maison de Moral fut pillée par les Français, plusieurs pièces d'argenterie qui lui restaient.
Les dernières années de sa vie s'écoulèrent en silence dans des relations studieuses avec des amis. Il tenait un journal de ses liaisons, et regardait comme des acquisitions précieuses celles qu'il ajoutait aux précédentes.
« Il y a plusieurs probabilités, disait-il, que ma destinée a été de me faire des rentes en âmes. Si Dieu permet que cette destinée-là s'accomplisse, je ne me plaindrai pas de ma fortune, car cette richesse-là en vaut bien d'autres (Pensées, 202).
Il était homme de bien et charitable. On lit dans les Archives littéraires de l'année 1804 une conversation sur les spectacles entre M. de Gérando et le philosophe inconnu. De Gérando lui demandait un jour pourquoi il n'allait plus au théâtre : était-ce rigidité de principes, ou défaut de loisir ? Après un peu d'hésitation, Saint-Martin lui répondit :
« Rien n'est plus simple. Je suis souvent parti de chez moi pour aller au théâtre. Chemin faisant, je doublais le pas, j'éprouvais une vive agitation par une jouissance anticipée du plaisir que j'allais goûter. Bientôt, cependant, je m'interrogeais moi-même sur la nature des impressions dont je me sentais si puissamment dominé ; je puis vous le dire : je ne trouvais en moi que l'attente de ce transport enivrant qui m'avait saisi autrefois lorsque les plus sublimes sentiments de la vertu, exprimés dans la langue de Corneille et de Racine, excitaient les applaudissements universels. Alors une réflexion me venait incontinent. Je vais payer, me disais-je, le plaisir d'admirer une simple image ou plutôt une ombre de la vertu !... Eh bien, avec la même somme, je puis atteindre à la réalité de cette image ; je peux faire une bonne action au lieu de la voir retracée dans une représentation fugitive. Je n'ai jamais résisté à cette idée ; je suis monté chez quelques malheureux que je connaissais, j'y ai laissé la valeur de mon billet de parterre ; j'ai goûté tout ce que je me promettais au spectacle, bien plus encore, et je suis rentré chez moi sans regrets. »
D'une constitution frêle et n'ayant reçu de corps qu'un projet, à peine [p.510] sur le seuil de la vieillesse il eut l'avertissement de l'ennemi qui avait enlevé son père. Il pressentit sa fin et il la vit s'approcher avec une vive espérance. La mort, qui attriste la nature, n'était à ses yeux que le signal du départ ardemment désiré.
« La mort ! disait-il, est-ce qu'il y en a encore ? Est-ce qu'elle n'a pas été détruite ?.... La mort ! Est-ce la mort corporelle que le sage compterait pour quelque chose ? Cette mort n'est qu'un acte du temps. Quel rapport cet acte du temps pourrait-il avoir avec l'homme de l'éternité ? —Il disait encore : L'espérance de la mort fait la consolation de mes jours ; aussi voudrais-je qu'on ne dit jamais l'autre vie, car il n'y en a qu'une » (Pensées, 109).
Quelques mois avant de mourir il écrivait :
« Le 18 janvier 1803, qui complète ma soixantaine, m'a ouvert un nouveau monde ; mes expériences spirituelles ne vont qu'en s'accroissant. J'avance, grâce à Dieu, vers les grandes jouissances qui me sont annoncées depuis longtemps et qui doivent mettre le comble aux joies dont mon existence a été constamment accompagnée dans ce monde. »
Dans l'été de 1803, il fit un dernier voyage à Amboise, visita quelques vieux amis et revit encore une fois la maison où il était né.
Au commencement de l'automne de la même année, après un entretien avec un savant géomètre sur le sens mystérieux des nombres : « Je sens que je m'en vais, dit-il: la Providence peut m'appeler; je suis prêt. Les germes que j'ai tâché de semer fructifieront. Je pars demain pour la campagne d'un de mes amis. Je rends grâces au Ciel de m'avoir accordé la faveur que je demandais. »
Le lendemain, il se rendit à Aulnay, dans la maison de campagne du sénateur Lenoir-Laroche. Le soir, après un léger repas, il se retira dans sa chambre, et bientôt il se sentit frappé d'apoplexie. Il put cependant dire quelques mots à ses amis accourus auprès de lui, les exhortant à mettre leur confiance dans la Providence et à vivre entre eux en frères dans les sentiments évangéliques. Puis il pria en silence et expira vers onze heures du soir, sans agonie et sans douleurs, le 13 octobre 1803 (22 vendémiaire an XII).
Je lis dans les Soirées de Saint-Pétersbourg qu'il mourut sans avoir voulu recevoir un prêtre. Aucune biographie ne fait mention de ce refus. Mais il est clair que, Saint-Martin ne croyant ni à l'Eglise, ni à la légitimité du sacerdoce catholique, le ministère du prêtre devait être indifférent à sa mort comme à sa vie. Ne disait-il pas : « Ma secte est la Providence; mes prosélytes, c'est moi; mon culte, c'est la justice ? » Et n'osait-il pas dire aussi: « Oui, Dieu, j'espère que malgré mes fautes tu trouveras encore en moi de quoi te consoler ! » Quand on est [p.511] parvenu dès ici-bas à cette intimité familière avec Dieu, il est évident que son Eglise et ses sacrements deviennent inutiles.
Tant de confiance étonne de la part d'un homme si éclairé sur les misères du cœur de l'homme, et qui devait l'être sur les misères de son propre cœur ! Mais il est des temps malheureux où les intelligences, même les plus élevées, semblent chanceler dans leurs propres lumières. Détourné de la voie simple par l'influence de ces erreurs qu'il combattait chez les philosophes, sa religion et sa vertu mêmes lui sont devenues un piège, et il n'a pas su s'en préserver. Il a cru à la mission du Réparateur, mais il n'est pas entré dans le sens pratique de ses enseignements ; il a accueilli avec amour la parole de la Sagesse incarnée et le sacrifice du Calvaire, mais il n'a pas compris la perpétuité sur la terre de cette parole et de ce sacrifice ; il a cru en la divinité de Jésus-Christ, mais il n'est pas entré dans l'humilité de Jésus-Christ, et, après une vie de méditation, de prière et de culte intérieur, il n'a pas laissé que de mourir hors de la voie du salut ; il est mort en philosophe, à la manière de Porphyre ou de Plotin.
Il n'avait jamais été marié. Lui-même raconte ce qui arriva quand une occasion vint à s'offrir.
« Je priai, dit-il, un peu de suite pour cet objet, et il me fut dit intellectuellement, mais très clairement : Depuis que le Verbe s'est fait chair, nulle chair ne doit disposer d'elle-même sans qu'il en donne la permission. Ces paroles me pénétrèrent profondément, et, quoiqu'elles ne fussent pas une défense formelle, je me refusai à toute négociation ultérieure » (Correspondance inédite et manuscrite).
Toujours communications intimes avec Dieu! toujours cette illusion d'être l'objet de la prédilection divine ! On ne saurait après cela s'étonner de l'immense et naïf orgueil qui perce à chaque ligne des Pensées où il a voulu se peindre.
« J'ai été gai, dit-il, mais la gaieté n'a été qu'une nuance secondaire de mon caractère ; ma couleur réelle a été la douleur et la tristesse, à cause de l'énormité du mal... »
Il s'applique la parole du prophète. Il semble gémir du mal qui se fait chaque jour sur la terre, comme si lui-même n'y avait aucune part : c'est la plainte de l'ange ou le gémissement de l'Agneau qui porte les péchés du monde !
Ne dit-il pas :
« Je n'ai rien avec ceux qui n'ont rien ; j'ai quelque chose avec ceux qui ont quelque chose ; j'ai tout avec ceux qui ont tout. Voilà pourquoi j'ai été jugé si diversement dans le monde et la plupart du temps si désavantageusement ; car, dans le monde, où sont ceux qui ont tout ? où sont même ceux qui ont quelque chose ? » [p.512]
Ne dit-il pas encore : « Dieu sait si je les aime, ces malheureux mortels ! »
Jamais un apôtre n'a parlé ainsi !
Dans la sphère restreinte et timide de son action, il finit par se prendre sérieusement pour un voyant, pour un consolateur donné à la terre ; c'est partout le ton d'un être inspiré, d'un homme dépositaire de plus de vérités qu'il n'en saurait communiquer aux mortels, d'un homme supérieur à l'homme ! « Pour prouver que l'on est régénéré, dit-il, il faut régénérer tout ce qui est autour de nous ». (Portrait historique et philosophique de Saint-Martin, Pensées, I, 614-795. — Il dit encore de lui (Pensées, 760) : « Une personne dont je fais grand cas me disait quelquefois que mes yeux étaient doublés d'âme. Je lui disais, moi, que son âme était doublée de bon Dieu, et que c'est là ce qui faisait mon charme et mon entraînement auprès d'elle. » Les saints ne s'amusent guère à chercher dans d'autres yeux le miroir de leurs yeux. Ces petites galanteries mystiques devaient un peu distraire l'homme de désir et retarder le développement du nouvel homme »).
Cela est vrai ; mais quel mort spirituel Saint-Martin a-t-il donc ressuscité ? A-t-il jamais pu dire au fils de la veuve : « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ! » Son œuvre est loin de répondre à l'ambition de sa parole. Cependant il n'a pas été sans influence sur son temps, et, quoique ses livres soient généralement peu connus, un grand nombre de ces pensées ont été mises en circulation par des écrivains supérieurs, M. de Maistre, entre autres, qui l'avait lu attentivement, et qui l'appelait le plus instruit, le plus sage et le plus élégant des théosophes modernes. Malgré l'énormité de ses erreurs, cet homme a servi la cause de la vérité, et l'on ne saurait oublier que le premier, au milieu des saturnales révolutionnaires, il a donné le signal de la réaction spiritualiste contre les doctrines sceptiques et athées du XVIIIe siècle. Il est peut-être le seul laïc qui ait osé dire alors une parole pieuse et touchante comme celle-ci : « A force de répéter mon Père, espérons qu'à la fin nous entendrons dire mon fils. »
1846 - Le Correspondant – T 16
 Le Correspondant, Recueil périodique
Le Correspondant, Recueil périodique
Religion, philosophie, politique, sciences, littérature, beaux-arts.
Tome seizième
Paris. Librairie de Sagnier et Bray, rue des Saint Pères, 64
1846 - Discussion avec Garat
Examen des doctrines du Philosophe inconnu, Louis-Claude de Saint-Martin, Louis Moreau
2e article – Discussion avec Garat – Pages 13-36
Issue de Bacon par Hobbes, Gassendi et Locke, la philosophie du dernier siècle avait conclu au sensualisme en psychologie ; à la doctrine de l'intérêt en morale ; au déisme ou à l'athéisme en religion ; à la souveraineté du peuple en politique; au matérialisme, dans toutes les parties de la science de la nature. Subversive du principe même de la morale, la théorie de la sensation anéantit la spiritualité de l'âme, et par conséquent les rapports de l'homme à Dieu, l'essence et la Providence divine. La négation de la spiritualité de l'âme équivaut à la négation de l'âme elle-même : l'homme n'est plus que corps. Un corps dénué d'âme implique logiquement un monde sans Dieu et une vie sans règle : c'est ainsi que toutes les erreurs sont solidaires, parce que la vérité est une. Cependant, comme il n'est pas plus possible à l'homme de s'affranchir de l'idée de loi que de se débarrasser du principe de cause, dès qu'il cesse de placer en Dieu la source de son être et la raison de ses devoirs, c'est dans la matière ou dans lui-même qu'il cherche sa loi. Il se substitue à Dieu ; ou bien, à la cause souverainement intelligente et libre, il substitue la force aveugle, l'énergie de la nature, en un mot la créature au Créateur. La philosophie du XVIIIe siècle en était venue là. Elle avait exclu Dieu et de la nature et de la science; elle l'avait banni de l'esprit et du cœur de l'homme. Appliqué par Condillac à l'idéologie, par Helvétius à la morale, par d'Holbach au système de l'univers, le sensualisme, dans les écrits de Rousseau, de Voltaire et de Boullanger, avait faussé la science politique et sociale, l'étude de l'histoire et de l'antiquité.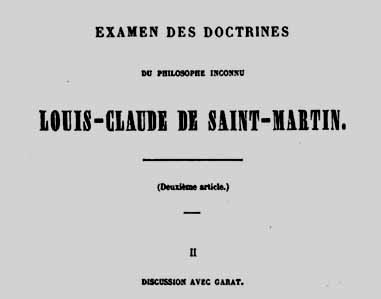
C'est la gloire de Saint-Martin d'avoir voulu rasseoir toutes les institutions humaines sur les bases religieuses que cette téméraire philosophie avait renversées. Il s'indigne de lire dans Boullanger que les religions de l'antiquité n'ont eu d'autre origine que la frayeur causée par les catastrophes de la nature, et il écrit son premier ouvrage Des Erreurs et de la Vérité. Il y rappelle les hommes au principe universel de la science, à la source unique de l'autorité, de la justice, de l'ordre civil, des sciences, des langues et des arts. Ce livre est un véritable manifeste publié contre les doctrines générales de l'époque. Plus tard, dans sa Lettre à un ami sur la Révolution française, dans l'Éclair sur l'Association humaine, dans les Réflexions d'un observateur, il combat en particulier les théories sociales d'Helvétius et de Rousseau. Enfin la réponse au professeur Garat et l'Essai sur les signes et les idées sont une réfutation originale et animée du système de Condillac.
Je veux commencer par ce débat psychologique l'examen de ces travaux, dont l'ensemble constitue une vaste polémique, engagée contre l'esprit même du XVIIIe siècle au moment où de telles ruines attestaient l'étendue de sa victoire. L'esprit d'une époque est tout entier dans sa manière de concevoir la nature et les facultés de l'âme humaine, la destinée de l'homme et ses rapports avec Dieu. Soit que cette conception vienne associer son témoignage à celui des croyances, soit qu'elle amène la négation ou le doute, il n'en est pas moins vrai qu'elle donne le branle aux idées, que les idées font les mœurs, qui à leur tour font les événements, les institutions et les lois. [p.15]
Ce duel philosophique est donc l'événement le plus remarquable de la vie de Saint-Martin, et ce n'est pas l'épisode le moins intéressant de l'histoire littéraire du temps. En effet, attaquer dans le sensualisme le principe destructeur de tout sentiment religieux et de toute notion morale, n'était-ce pas porter le fer à la racine même de l'arbre dont les générations d'alors recueillaient les tristes fruits ?
Aussi je m'étonne que le souvenir ait été sitôt perdu de cette singulière rencontre qui eut lieu dans l'enceinte des premières écoles normales entre le mystique auteur de l'Homme de désir et le rhéteur conventionnel Garat. Cette séance du 9 ventôse an III devrait être mémorable; car c'est à peu près de ce jour que date le réveil des doctrines spiritualistes, si longtemps opprimées et muettes. Et cependant les écrivains qui depuis, en des jours meilleurs, ont voué leurs méditations à la recherche des grands problèmes, théologiens ou philosophes, unanimes dans la réprobation du sensualisme, ne semblent pas moins unanimes pour oublier l'homme qui, dès 1795, jeta le gant aux opinions triomphantes. Les uns adjugent à M. de Bonald l'honneur d'avoir le premier soutenu le grand principe de Rousseau : la nécessité de la parole pour l'institution de la parole ; les autres saluent dans M. Royer-Collard le penseur qui a le premier secoué le joug de Condillac. Je suis loin de contester à ces deux hommes célèbres la part qu'ils ont prise au rétablissement des grandes vérités ; mais je prends acte des leçons mêmes de l'École normale pour en restituer au Philosophe inconnu la principale gloire. C'est bien lui, en effet, qui a, le premier, devant deux mille auditeurs, développé le grand principe de Rousseau, et, le premier, réduit à leur juste valeur la statue de Condillac et son système des sensations.
Le cours de Garat n'est qu'un hymne perpétuel à la louange de ce philosophe, une ingénieuse paraphrase du Traité des sensations. Il est difficile de rencontrer un disciple plus fidèle et plus désintéressé ; cette soumission va jusqu'au dépouillement de toute pensée propre; l'ombre d'une conception originale lui fait peur. Je lis à chaque page les phrases convenues sur la liberté d'examen, sur la raison heureusement délivrée du joug de la tradition et de l'autorité ; mais il semble que la raison du professeur ne veut de cette indépendance que pour la sacrifier à la parole d'un homme. Victime volontaire, elle se couronne de toutes les fleurs d'une élégante rhétorique pour s'immoler de sa propre main sur l'autel du maître. [p.16]
Or, tout excès arrive bientôt à l'impuissance. Il est dans la nature de l'admiration fanatique de compromettre l'objet qu'elle divinise ; car c'est surtout aux erreurs et aux défauts de l'idole qu'elle adresse son culte. Aucune critique peut-être ne rend les méprises de Condillac plus sensibles que le servile engouement de son disciple.
L'exposé de la conférence va nous en convaincre.
Garat avait pris pour épigraphe du programme de son cours ces paroles de Bacon:
« Etenim illuminationis puritas et arbitrü libertas simul inceperunt, simul corruerunt, neque datur in universitate rerum tam intima sympathia quam illa veri et boni.»
Cette épigraphe implique évidemment deux ordres de faits unis, mais distincts : les faits intellectuels et les faits volontaires, et par conséquent l'étude de ces deux ordres de faits : l'étude de l'homme intelligent et celle de l'homme moral. Mais, infidèle à son énoncé, Garat ne voit dans l'homme que l'entendement, et dans l'entendement il ne voit que la sensation
« Nos sensations, dit-il, et les divers usages que nous en faisons, c'est-à-dire les facultés de l'entendement, nous servent à nous faire des idées et des notions, soit des objets que la nature nous présente, soit des affections que nous éprouvons, soit des actions et des ouvrages dont nous sommes nous-mêmes les auteurs. » (Cours, t. II, p.21)
Condillac pense que nous formons nos idées physiques sur des modèles que nous présente la nature, et les idées morales sans modèles. Garat s'enhardit à exprimer une opinion contraire à celle du maître : il demande si nos idées morales, c'est-à-dire les notions sur les vices et les vertus, n'ont pas leur modèle dans nos diverses actions et dans leurs effets, comme les idées physiques ont leur modèle dans les objets extérieurs qui frappent nos sens. Il repousse l'opinion des philosophes anglais qui ont voulu un sens particulier pour la notion de la vertu, le sens moral. Il prétend qu'un sens invisible et spécial n'est pas plus nécessaire pour les notions de la vertu qu'un autre sens qui lui serait opposé pour les notions du vice. Il ajoute que les idées morales, les plus belles de l'entendement humain, n'y entrent pas par un seul sens, mais par tous les sens à la fois : c'est la sensibilité tout entière de l'homme qui a besoin d'être morale, parce qu'elle a [p.17] besoin de fuir la douleur et de chercher le bonheur. La douleur et le plaisir, qui nous enseignent à nous servir de nos sens et de nos facultés, nous apprennent encore à nous faire les notions du vice et de la vertu.
Enfin il reproche à Rousseau d'avoir dit que la parole a été une condition indispensable pour l'institution de la parole. « Rousseau dénoue le problème, dit-il, comme les mauvais poëtes ont souvent dénoué l'intrigue d'une mauvaise tragédie, en faisant descendre la divinité sur la terre, pour enseigner les premiers mots de la première langue aux hommes, pour leur apprendre l'alphabet. »
Mais suivant lui, Condillac a trouvé à ce problème, « qui a tant fatigué le génie de Rousseau et si inutilement, une solution bien simple, bien facile, et qui répand de tous les côtés une lumière très-éclatante et sur la théorie des idées et sur la théorie des langues. »
Voici comment il expose cette merveilleuse solution :
« Sur le visage de l'homme, dans ses regards qui s'attendrissent ou s'enflamment, dans son teint qui rougit ou qui pâlit, dans son maintien qui annonce l'abattement ou le courage, dans son sourire où se peint la bienveillance ou le mépris, Condillac aperçoit des signes très expressifs des affections les plus vives de l'homme, et dans ces signes un langage d'action qui a suffi pour distinguer les idées auxquelles il fallait donner des noms, qui a servi de modèle aux langues parlées. »
Ce langage de regards, de couleurs, de maintien, d'altitude et de geste est donc l'origine et le modèle de cette langue, qui énonce les vérités de l'ordre géométrique et de l'ordre moral, les vérités intérieures et métaphysiques. Étrange solution d'après laquelle il serait rationnel de dire que le geste oratoire précède l'éloquence, que la récitation du drame est antérieure au drame, que l'acteur préexiste au poète; et cette chimérique hypothèse, que la philosophie a renouvelée de nos jours, Garat l'appelle une démonstration.
De jeunes disciples, à cet âge heureux où l'on croit si généreusement à la parole du maître, n'auraient pu s'empêcher de remarquer les contradictions, les impossibilités, l'arbitraire et le vide de cette théorie. Pouvait-elle donc impunément se produire avec ce double caractère de faiblesse et de témérité, devant un auditoire où siégeait plus d'un élève mûri par l'expérience et aguerri aux luttes de la pensée ? Des objections s'élevèrent, plusieurs lettres furent adressées [p.18] à Garat. L'une de ces lettres l'embarrasse visiblement, car elle le met en demeure de décider entre le spiritualisme, alors suspect ou ridicule, et le matérialisme, dont une profession publique semble coûter à sa pudeur. Dans cette lettre, on lisait la phrase suivante : « L'immortalité de l'âme, ce principe attesté solennellement par toutes les nations, qui doit servir de base à la morale, est essentiellement liée à la spiritualité. » Garat accorde que cette liaison peut être réelle, mais il tient à peu près pour impossible de prouver par la raison qu'elle est si essentielle et si nécessaire. Il serait cependant beaucoup plus simple de contester la réalité de cette liaison que d'alléguer la difficulté de cette preuve. Mais Garat veut éconduire habilement le principe de la spiritualité, et il va jusqu'à invoquer l'opinion de beaucoup de chrétiens, mis au nombre des saints, qui ont cru l'âme immortelle et matérielle. Il fait ce singulier raisonnement : l'âme humaine ou la faculté de sentir étant, comme l'a pensé Tertullien (Il se garde bien de citer les expressions mêmes de Tertullien), une modification ou une combinaison des éléments de la matière, puisque la matière est impérissable, l'âme pourrait être matérielle et immortelle encore. « Ce dogme si beau, dit-il, si consolant de notre immortalité, ne se lie essentiellement et exclusivement à aucun système ; il se lie à tous, et c'est ce qui le rend plus solide, plus difficile à ébranler. » Le sophisme est ingénieux et la phrase agréable. Toutefois, et bien qu'il mette sa croyance officielle sous la protection du décret de la Convention (Le principe de l’immortalité de l’âme, dit-il, « est déclaré solennellement : car il l’est par un décret. »), il craint le sourire des partisans de la matière, et cherche aussitôt à réduire l'importance du dogme de l'immortalité de l'âme. « La morale, dit-il, qui a ses plus magnifiques espérances dans une autre vie, a ses racines dans celle-ci. »
Ainsi il n'admet pas que la spiritualité de l'âme soit la condition de son immortalité, et il ne regarde pas l'immortalité comme la base de la morale ; en d'autres termes, il ne demande pas mieux que de nier et la spiritualité et l'immortalité de l'âme.
Saint-Martin avait commencé de prendre la parole dans la séance du 23 pluviôse an III ; mais, interrompu au milieu de la lecture de son discours, il le reprit à la séance suivante (le 9 ventôse). Ce discours est une réfutation générale de l'enseignement du professeur. [p.19]
Il commence par confronter le programme de Garat avec l'épigraphe qu'il a choisie, et lui fait remarquer que l'épigraphe présente deux facultés très différentes : illuminationis puritas et arbitrii libertas, tandis que le programme n'en offre qu'une, en ramenant tout à l'entendement. S'il fallait placer sur une seule tige ce qui est vrai et ce qui est bon, ce serait n'en faire qu'une seule et même chose, et comment alors s'accomplirait l'intima sympathia de Bacon, puisqu'une sympathie ne peut s'établir qu'entre deux objets distincts ?
Il relève ensuite cette singulière objection que le professeur avait élevée contre l'admission d'un sens moral, alléguant que l'on avait eu tort d'admettre un sens moral pour ce qui est moralement bon sans en admettre un pour ce qui est moralement mauvais. Il réfute sans peine ce pauvre argument. Dans la physique, nous n'avons qu'un seul sens de la vue pour apercevoir les objets réguliers et les objets difformes. Dans la métaphysique, nous n'avons qu'un seul sens intellectuel pour juger des propositions qui sont vraies et de celles qui ne le sont pas. Pourquoi aurait-on besoin d'un double sens, moral pour juger des affections morales, bonnes et mauvaises ?
Il conclut en requérant pour premier amendement le rétablissement du sens moral.
Examinant ensuite le reproche fait à Rousseau au sujet de l'origine de la parole, il oppose au professeur le passage de son programme où il dit que les philosophes ont découvert et démontré la liaison nécessaire des idées aux signes pour lier les idées entre elles, c'est-à-dire le fait du langage universellement reconnu comme la condition essentielle, non seulement de la communication, mais encore de la production des pensées. Et il établit le fait suivant : Dans tout ce qui peut être connu de nous, soit par nos yeux intellectuels, soit par nos yeux physiques, il n'y a rien qui ne vienne par une semence, par un germe. « Nous n'en doutons pas, dit-il, dans l'ordre physique, puisque telle est la loi de toutes les productions. Nous n'en doutons pas dans l'ordre intellectuel de toutes les choses imitatives que nous exécutons, et dont nous puisons le germe dans les modèles et les exemples qui nous électrisent assez pour nous féconder. Nous n'en pouvons pas douter dans les langues de signes, soit imitatifs, soit naturels, parce que les uns ont leur germe dans l'exemple et les autres dans la nature. Et vous dites vous-même que les signes donnés par la nature ont précédé nécessairement les signes institués par l'homme ; que [p.20] l'homme n'a pu créer que sur le modèle d'une langue qu'il n'avait pas créée. Pourquoi donc les langues parlées seraient-elles seules exceptées de cette loi universelle ? Pourquoi n'y aurait-il pas une semence pour elles, ainsi que pour tout ce qui est remis à notre usage et à notre réflexion ? Et pourquoi le plus beau de tous nos privilèges, celui de la parole vive et active, serait-il le seul qui fût le fruit de notre puissance créatrice, tandis que pour tous les autres avantages, qui lui sont inférieurs, nous serions subordonnés à un germe et condamnés à attendre la fécondation ?»
D'où il conclut, pour le second amendement, que la parole a été nécessaire pour l'institution de la parole.
Enfin il met encore le professeur en contradiction avec lui-même. Garat, en parlant du doute universel où fut conduite l'école de Socrate, avait dit : C'était le point d'où il fallait partir, mais ce n'était pas le point où il fallait arriver et rester. Et dans une autre séance il disait qu'il était impossible de savoir et inutile de chercher si la matière pense ou ne pense point. Saint-Martin lui objecte, avec une spirituelle ironie, que si, dans ce doute universel où il ne fallait ni arriver ni rester, il était une incertitude qu'il fût intéressant de dissiper, c'était assurément celle-ci. Et, poursuivant le professeur de tous les dédains de sa logique, il fait sortir de la doctrine même de Garat deux conséquences inaperçues qu'il retourne contre son adversaire.
Garat avait proclamé la culture comme le guide des esprits vers la vérité. Or, il est évident que la matière n'a point de culture à elle ; il est donc fort présumable qu'elle n'a point la pensée qui est l'objet de la culture. La nature, en effet, ferait-elle un don à un être en lui refusant l'unique moyen de le mettre en œuvre ?
La seconde conséquence est tirée des expressions mêmes du programme, qui reconnaissait les langues comme nécessaires, non seulement pour communiquer nos pensées, mais même pour en avoir. Or, en prenant le mot de langue dans son sens radical, les langues sont l'expression de nos pensées et de nos jugements ; nos pensées et nos jugements sont l'expression de nos diverses manières de considérer les objets, un même objet ou plusieurs faces de ce même objet ; c'est la diversité de nos manières de voir qui fait la diversité de nos langues. Les langues des animaux, au contraire, sont uniformes dans chaque espèce ; il n'y a pas plus de variété dans leurs langues qu'il n'y en a dans leurs actes. L'uniformité de la langue des animaux, dans [p.21] chaque espèce, est la preuve qu'ils n'ont point de langue ; et le défaut de langue, joint au défaut de culture, est la preuve qu'ils n'ont point la pensée : d'où Saint-Martin conclut, pour le troisième amendement, que la matière n'a pas la faculté de penser.
Garat, dans sa réplique, n'oppose que des raisons assez vagues. Il trouve mauvais que le citoyen de Saint-Martin, après avoir séparé l'intelligence des sensations, veuille encore établir une nouvelle séparation entre l'intelligence et la volonté. Il reproduit la théorie de la sensation avec un redoublement de zèle : « Éléments et agents, dit-il, tout n'est que sensation. Dans cette mécanique intellectuelle, l'ouvrier, l'instrument et la matière travaillée, c'est la même chose ; c'est toujours la sensibilité agissant sur des sensations par des sensations. Par la sensibilité, l'homme sent un rapport qui est réel, qui est vrai entre lui et un objet que la nature lui présente ; par la sensibilité, l'homme sent que ce même objet dans lequel il a saisi ce rapport vrai peut lui être utile, peut lui être BON... Il veut donc comme BON ce qu'il a jugé être vrai. » Garat réduit ainsi la sympathie de Bacon à une véritable identité. Bacon, suivant lui, ne considère l'intelligence et la volonté que dans les effets qui en dérivent, et il parle de leur sympathie ; s'il les eût considérées dans leurs sources, il eût parlé de leur identité.
Puis, enchérissant sur ces airs de hauteur que Condillac prend volontiers avec les grands maîtres, son ridicule disciple traite avec dédain Malebranche, Descartes, Platon, qui pense ou qui rêve beaucoup. Il repousse, sans les comprendre, les idées innées de l'un et la théorie des idées de l'autre. Ce sont là précisément, suivant lui, de ces idoles qui ont si longtemps obtenu un culte superstitieux de l'esprit humain, et dont Bacon le premier a brisé les statues et les autels. « La plupart des savants, dit-il, au milieu de leurs idées et de leurs sciences si mal faites, et dont ils ignorent profondément le dessin et l'artifice, ressemblent aux Egyptiens modernes, aux Cophtes placés à côté des pyramides. Dans leur admiration aveugle pour ces édifices plus énormes que grands ,... dont ils ne connaissent ni le but, ni la formation, ni la durée, ils les croient des ouvrages au-dessus de la nature de l'homme, et ils les attribuent tantôt à la même puissance qui a creusé les mers et élevé les montagnes, tantôt à des génies habitant d'un ancien monde détruit, dont ces pyramides sont les uniques restes. » Phrase ingénieuse, mais vide de sens. [p.22]
Il n'admet pas le sens moral, parce que s'il existait dans l'homme un sens moral indépendant de la raison, la clarté et la force de ses inspirations seraient très indépendantes de la faiblesse et de la force de la raison, de ses égarements et de ses progrès. Il allègue contre l'existence du sens moral l'abrutissement féroce des peuplades sauvages et les horreurs du fanatisme même chez les peuples civilisés.
Cet argument ne serait valable qu'autant que Saint-Martin n'aurait vu dans le sens moral que ce que Garat voit dans les sens ordinaires : un certain appareil organique fonctionnant chez tous les hommes avec une constante et universelle fatalité. L'objection répond donc à une opinion qui n'est pas celle de Saint-Martin. Il n'est pas davantage question d'un sens moral indépendant de la raison. Il s'agit seulement de distinguer dans l'homme l'élément libre et volontaire qui correspond au BIEN, de l'élément intelligent et raisonnable qui correspond au VRAI. Garat prête à son adversaire un sentiment extrême pour dissimuler sous un débat factice la juste critique qu'il subit. Il n'accuse Saint-Martin de vouloir séparer que pour se donner à lui-même le droit de confondre, et il ne tient à maintenir la confusion des deux ordres de faits que parce que cette confusion lui permet de réduire tout à l'entendement, et par l'entendement, à la sensation. Toutefois, le tort de Saint-Martin est d'emprunter au sensualisme ses expressions pour conclure au spiritualisme. « Autant je suis difficile sur les idées, dit-il, autant je suis traitable sur les mots. » Je serais tenté de croire qu'il ne faut être guère plus traitable sur les mots que sur les idées. La tolérance de Saint-Martin laisse trop beau jeu aux objections captieuses et aux réponses illusoires. Quand on combat une théorie, il n'en faut pas accepter le langage.
On pourrait sans doute accorder à Garat l'intimité qu'il revendique entre les idées morales et la raison, s'il reconnaissait dans l'homme, cette faculté souveraine qui participe à la raison immuable, éternelle, infinie. Mais, bien loin de là, la raison n'est, suivant lui, qu'une perception de rapports (ratio, relatio); la raison n'est qu'un art de l'homme, et souvent le dernier de tous ; (Il dit un peu plus bas : « Combien il faut d’artifices pour parvenir à avoir un peu de raison) ; la raison n'est que l'art de penser, ou, en d'autres termes, l'art de sentir. Il détruit donc la notion même de la raison, et renverse la base de la morale, qui n'est que la conséquence d'un dogme immuable ou d'une vérité nécessaire. [p.23]
« La bonne morale, dit Garat, ne peut naître que d'une bonne philosophie, » c'est-à-dire de la philosophie de la sensation. Elle se réduit, dans la pratique, à l'emploi industrieux et au perfectionnement des sens, seuls témoins, seuls guides dans la recherche de la vérité. Ainsi la morale et la philosophie s'embrassent étroitement pour se perdre ensemble dans le sein de l'hygiène.
Quant à la question de l'origine de la parole, Garat ne consent à faire aucun amendement à son opinion sur le principe de Rousseau. Il fait cette jolie phrase : « Rousseau voulait découvrir les sources d'un grand fleuve, et il les a cherchées dans son embouchure : ce n'était pas le moyen de les trouver ; mais c'était le moyen de croire, comme on l'a cru des sources du Nil, qu'elles n'étaient pas sur la terre, mais dans le ciel. »
Toujours ingénieux et toujours vide de sens.
Il accorde que l'établissement de la parole est indispensable pour établir la parole telle qu'elle a été dans Athènes sous Périclès, à Paris au siècle de Louis XIV, etc. Il admet ici l'intervention de la parole de beaucoup d'hommes et de beaucoup de siècles déjà fort éclairés ; mais il demande s'il faut, pour faire jeter aux sauvages des cris inarticulés ou même des sons articulés, aucune connaissance préalable, aucune convention antérieure. « Pour tout cela, dit-il avec confiance, il ne faut pas d'autre école que les forêts. »
Il reconnaît que la langue de Cicéron et la langue de Fénelon n'ont jamais pu être créées par des Hottentots et par des troglodytes ; mais les troglodytes ont pu sans aucun miracle siffler ; les Hottentots ont pu glousser, et leurs gloussements, leurs sifflements sont une parole : ce sont des langues naissantes.
Donc, en remontant aux origines des langues d'Homère et de Bossuet, on retrouverait leurs racines primitives dans des sifflements ou des gloussements. Mais ce que le professeur ne dit pas, et ce qui vaudrait la peine d'être expliqué, c'est comment la langue fatale des besoins et du sens s'est transformée en une parole intelligente et libre ; combien de temps et suivant quels modes il a fallu glousser pour arriver à l'Iliade ou au Discours sur l'histoire naturelle ; comment enfin des voix animales et des gestes instinctifs sont devenus des pensées et des expressions de pensées. Cette genèse de la parole méritait d'être exposée. A défaut de l'autorité de l'histoire, elle eût pu avoir l'attrait du roman. [p.24]
Le dernier reproche que Saint-Martin adressait au professeur était relatif à cette question : si la matière pense ou ne pense point. Sommé d'exprimer à cet égard sa profession de foi, Garat prétend qu'il n'est ni spiritualiste ni matérialiste, parce qu'il ne s'appuie que sur des faits et ne se mêle pas d'hypothèse. « Le spiritualiste et le matérialiste, ajoute-t-il, en disent tous deux plus que moi ; ils n'en savent pas davantage. » Il prétend que c'est une grande inconséquence au spiritualiste d'accorder à la matière de pouvoir sentir, quand il lui refuse absolument de pouvoir penser, quand même Dieu le voudrait. Cette inconséquence donne la victoire au matérialiste, et fait sourire le véritable métaphysicien, qui « a pitié et du triomphe de l'un et de la folle imprudence de l'autre. »
Il repousse l'argument tiré de l'impuissance de la matière à se donner une culture. « Cette assertion, dit-il, la matière ne peut pas se cultiver et se perfectionner, est la même que cette assertion : la matière ne peut pas sentir ; car si elle pouvait sentir, elle pourrait avoir des idées ; par les idées, elle pourrait travailler sur elle-même, se cultiver, se perfectionner, cultiver et perfectionner tout ce qui n'est pas organisé pour sentir. C'est donc la question elle-même, posée en d'autres termes, que le citoyen de Saint-Martin donne pour sa solution. »
Les meilleures preuves, suivant lui, qu'il n'est pas donné à la matière de penser, se tirent de l'impossibilité où nous sommes de concevoir que l'étendue et la pensée appartiennent à une même substance. C'est là que s'arrête la bonne métaphysique ; les révélations seules se chargent de donner d'autres preuves.
Il me tarde de clore l'exposé de ce débat, et d'en venir à la dernière réponse que Saint-Martin fit à Garat, réponse vive et animée. L'amour-propre philosophique mis en jeu donne à son style une clarté et un mordant inaccoutumés.
Il s'étonne que le professeur refuse d'admettre le sens moral : « Tout étant sensation pour vous, lui dit-il, je ne vois pas pourquoi je n'appliquerais pas le mot sens à cette faculté morale, comme je pourrais de droit l'appliquer à toutes les autres facultés dont vous venez d'exposer le tableau. »
Mais il est indifférent qu'on la nomme pensée, âme, raison, entendement, instinct humain, intelligence, cœur, esprit, conscience : elle existe. Tout cela n'est qu'un seul être considéré sous différentes [p.25] faces, et selon celle de ses facultés qui pour le moment se trouve prédominante.
Qu'on veuille expliquer le jeu de cette faculté morale et de toutes les opérations de l'entendement par la sensibilité : peu importe. Ce mot n'exprime que le mode des instruments et non les instruments mêmes. On peut reconnaître que tout est sensible dans les opérations de l'esprit et de l'âme; mais il est impossible d'admettre que tout y soit sensation, parce que cette expression s'applique exclusivement aux impressions physiques. En reconnaissant d'ailleurs à la matière organisée la propriété de sentir, les spiritualistes savent que cette propriété ne lui est que prêtée, et que, rendue à elle-même, la matière rentre dans sa nullité, dans son néant.
Garat écartait l'argument tiré de l'impuissance de la matière à se donner une culture, par la raison que c'était répondre à la question par la question même, la faculté de se donner une culture étant, suivant lui, identique avec celle de sentir.
Mais, dit Saint-Martin, « si j'avais pu imaginer que n'avoir point la culture à soi et ne pas sentir fussent une seule et même assertion, comme vous le prétendez, je me serais grandement contredit moi-même, puisqu'en refusant à la matière la culture qu'en effet elle n'a point à elle, je lui accorde authentiquement les sensations dont elle est évidemment le réceptacle, l'organe et le foyer. Mais vous êtes tellement plein de votre système de sensations que ce ne sera pas votre faute si tous les mots de nos langues, si tout notre dictionnaire enfin ne se réduit pas un jour au mot sentir. Toutefois, quand vous auriez ainsi simplifié le langage, vous n'auriez pas pour cela simplifié les opérations des êtres. »
Or, si la culture est reconnue comme un des droits de l'esprit, et si les sensations sont des propriétés accordées à la matière, il est clair qu'en réduisant ces deux différentes opérations au seul mot sentir, c'est Garat, et non Saint-Martin, qui encourt le reproche de donner pour solution la question elle-même; c'est Garat qu'il faut accuser de présenter sous une même expression deux choses absolument distinctes.
D'autre part, « si nous sommes sûrs, ajoute Saint-Martin , que la matière n'a point la propriété de penser, nous sommes sûrs aussi qu'elle a la propriété de sentir. Or, si, d'après votre système, toutes les opérations de notre entendement ou de notre intelligence, ou de [p.26] ce que d'autres appellent pensée, conscience, âme, sens moral, ne sont autre chose que des résultats de la propriété de sentir et peuvent s'exprimer par le mot sentir, il est certain que, lorsque je prononcerai le mot penser et le mot sentir, je prononcerai des mots équivalents, et par conséquent, lorsque je voudrai exprimer la propriété de sentir qui caractérise la matière et la propriété de penser qui lui est refusée, je pourrai dire que la matière a la propriété de sentir et que la matière n'a pas la propriété de sentir... C'est alors, je l'avoue, que l'imbroglio est à son comble; mais je prétends aussi que c'est sur vous que retombent tous les frais de cette inconséquence. »
Passant aux objections contre l'existence du sens moral que Garat croit pouvoir tirer soit des crimes enfantés par le fanatisme des religions et des prêtres, soit de l'abrutissement des peuples sauvages et de l'inefficacité de ce même sens chez les peuples civilisés, Saint-Martin lui montre sans peine que, le sens moral étant le foyer de nos affections morales comme notre entendement est le foyer de nos réflexions, la seule distinction admissible tient à l'emploi divers de ce sens moral. Le désordre moral prouve l'existence du sens moral, comme l'erreur prouve l'existence de l'intelligence. Celui qui voit juste et celui qui voit faux prouvent tous deux, par l'emploi divers de leur esprit, l'existence de cet esprit.
Le monde entier n'est composé que de deux classes d'hommes : les hommes religieux, y compris les idolâtres, et les impies ou athées ; car les indifférents et les neutres ne sont nuls que parce que leur sens moral est engourdi, et, pour peu qu'il se réveille de son assoupissement, il prendra sur-le-champ parti pour ou contre. Ce n'est donc rien prouver que de nous peindre les abominations et les erreurs que les religions ont répandues sur la terre : les abus n'infirment point les principes ; ils les confirment. On n'abuse que de ce qui est. Aussi la première instruction que nous donne la science de l'entendement humain est que ce ne doit point être l'erreur qui fasse fuir la vérité ; mais qu'au contraire c'est à la vérité à faire fuir l'erreur.
Une autre instruction non moins importante que cette même science nous doit donner, c'est que le sens moral peut, ainsi que toutes nos autres facultés et ainsi que nos sens corporels, être universel et n'être pas universellement développé.
Car le mot universel peut n'exprimer qu'une universalité d'existence, et non une universelle activité, et encore moins une activité [p.27] qui soit uniforme. C'est en ce sens que le langage est universel parmi les hommes, quoiqu'ils ne parlent pas toujours, et surtout quoiqu'ils fassent de leurs langues un usage si différent soit pour la forme, soit pour le fond.
Or, si le sens moral, quoique universel, n'est pas universellement développé ; s'il se laisse altérer et vicier par un faux régime, nous ne devrons pas nous étonner de toutes les conséquences qui s'en suivront. Et cela pourra même aller beaucoup plus loin que dans l'ordre physique ; car nous pourrons tellement déformer notre être moral que nous l'amenions nous-mêmes à l'état de monstre.
Les principes de la nature ont une loi cachée dont nous ne disposons pas, et notre pouvoir à cet égard ne porte le dérangement que sur leurs résultats. Nous ne pouvons nous ingérer dans son gouvernement, tandis que c'est à la fois pour nous un droit et un devoir de nous ingérer dans le gouvernement moral, qui est le nôtre. Que si nous avions la grande main sur l'ordre physique comme nous l'avons sur l'ordre moral, il y a longtemps sans doute que la nature s'en ressentirait, et que les monstruosités qu'elle offrirait seraient aussi nombreuses et aussi inconcevables que celles que nous voyons se produire dans l'ordre moral.
Toutes les objections empruntées au spectacle des horreurs qui souillent la terre sont entièrement destituées de sens et de valeur.
Interpellant Garat sur cette étrange profession de foi par laquelle il se défendait en même temps d'être spiritualiste et d'être matérialiste :
« Si vous ne voulez, lui dit Saint-Martin, ni de la matière ni de l'esprit, je vous laisse le soin de nous apprendre à qui vous attribuez le gouvernement de notre pensée ; car encore faut-il qu'il y en ait un.
« Pour moi, qui ne pourrais m'accommoder d'une position si équivoque, j'aurai la hardiesse de faire ici l'historique de votre propre pensée.
« Vous êtes un esprit qui n'avez point approfondi les deux systèmes, et qui, au premier aperçu, avez été facilement repoussé par l'un et par l'autre : par le matérialisme, parce qu'il n'a point offert de démonstration solide à la rectitude de votre jugement ; par le spiritualisme, parce que la robe sacerdotale et toutes les obscurités qui l'environnent sont venues se mettre en travers dans votre pensée et l'ont empêché de faire route... [p.28]
« Je crois cependant que vous vous porterez plutôt vers le système de l'esprit que vers le système de la matière, parce qu'il est moins difficile à un matérialiste de remonter à la classe du spiritualiste qu'à un spiritualiste de descendre à celle du matérialiste ; à plus forte raison ce mouvement d'ascension sera-t-il plus aisé pour quelqu'un qui, comme vous, sans être spiritualiste, s'est cependant préservé du matérialisme.
« J'admire toutefois comment vous vous êtes garanti du matérialisme en vous rangeant, comme vous le faites, sous les enseignes de Condillac. Encore que je lise peu, je viens de parcourir son Essai sur l'origine des connaissances humaines et son Traité des sensations. Soit que je les aie mal saisis, soit que je n'aie pas votre secret, je n'y ai presque pas rencontré de passages qui ne me repoussent... Sa statue, par exemple, où tous nos sens naissent l'un après l'autre, semble être la dérision de la nature qui les produit et les forme tout à la fois... Pour moi, chacune des idées de l'auteur me paraît un attentat contre l'homme, un véritable homicide ; et c'est cependant là votre maître par excellence !
« Quoique Bacon, qui est également un de vos maîtres, me laisse beaucoup de choses à désirer, il est néanmoins pour moi, non seulement moins repoussant que Condillac, mais encore cent degrés au-dessus. Condillac me paraît, auprès de lui, en fait de philosophie, ce qu'en fait de physique Comus est auprès de Newton. Je ne sais pas comment vous avez pu vous accommoder à la fois de deux nourritures si étrangères l'une à l'autre. »
Garat, nous l'avons vu, terminait sa réplique par un appel moqueur aux révélations, qui commencent où s'arrête la bonne métaphysique. Son adversaire s'empare de ce mot, qu'il détourne de sa signification ordinaire : « Comme vous avez donné, dit-il à Garat, une ample extension au mot sentir, je vous demande la permission d'étendre aussi un peu le mot révélation ; » et il tire de ce mot un principe spécieux qui lui sert à la fois à confirmer sa doctrine du sens moral et à réduire au néant les ridicules assertions de Garat sur l'origine de la parole.
Toute manifestation d'une vérité, quelle qu'elle soit, est une révélation. L'homme qui communique à un autre une connaissance qui lui est particulière révèle à celui-ci ce qui jusqu'alors était un secret pour lui. [p.29]
Le monde entier se révèle par ses phénomènes.
Les fruits des végétaux, les propriétés chimiques des diverses substances minérales, les lois du mouvement des corps, les phénomènes de la lumière et de l'électricité sont autant de révélations qui, sans ce commerce qu'elles ont par nos sens avec notre esprit, seraient comme n'étant pas pour nous.
La nature entière peut se considérer comme étant dans une révélation continuelle, active et effective, ou comme faisant sans cesse, selon tous les degrés et toutes les classes, sa propre révélation.
Dans l'ordre intellectuel et moral, l'homme nait et vit au milieu des pensées. Or, si ces pensées qui l'environnent ne pénètrent pas en lui, ne s'y développent pas et n'y révèlent pas ce qu'elles renferment en elles, il ne les connaîtra pas plus qu'il ne connaîtrait les phénomènes de la nature si elle n'en faisait pas la manifestation devant lui. Ces pensées font donc en lui, dans leur ordre moral, leur propre révélation, comme les phénomènes de la nature font la leur dans leur ordre physique.
L'homme ne peut avoir aucune de ces notions divines et religieuses qu'il possède qu'elles ne proviennent primitivement de la fermentation occasionnée en lui par ces pensées morales et intellectuelles au milieu desquelles il naît et il vit, et il faut nécessairement qu'il ait joui, soit en divers lieux, soit en divers temps, d'un développement sensible de cette sorte de germes religieux, sans quoi le nom de ces objets ne lui serait pas même connu.
Non seulement les choses n'existent pour nous qu'autant qu'elles font chacune par rapport à nous leur propre révélation, mais on peut dire aussi que chaque chose repose sur le siège ou la racine de son propre développement ou de sa propre révélation sans connaitre ce qui appartient au siège d'un ordre supérieur.
Ainsi les animaux ne savent pas ce qui se passe dans notre pensée, quoique d'ailleurs leur instinct soit infaillible.
Et si la nature pouvait croire, on serait fondé à dire que chaque chose ne croit qu'à sa propre révélation.
Aussi les hommes prennent-ils tous la teinte ou la croyance de l'objet dont ils cultivent le développement ou la révélation, et ils ne vont pas plus loin dans leur croyance que cet objet lui-même ne va dans la sphère de sa propre manifestation.
C'est pourquoi les physiciens et tous ceux qui ne s'occupent que [p.30] des sciences de la matière croient volontiers que tout est matière.
C'est pourquoi ceux qui s'occupent de l'homme, mais qui se réduisent à exercer en eux la seule faculté de la raison, ne croient aussi à rien au-delà de leur raison, parce qu'ils ne vivent que dans les développements ou les révélations de la raison.
Or, la raison n'est que le flambeau de l'homme parfait, elle n'en est pas la vie ; il y a en lui une faculté plus radicale encore et plus profonde : c'est le sens moral, qui lui-même a son mode particulier de développement et de révélation.
Saint Martin élève cette révélation naturelle et spontanée du sens moral bien au-dessus de ce que l'on entend ordinairement par révélation. « Les révélations, dit-il, qui sont enfermées dans les livres et dans les doctrines religieuses de tous les peuples de la terre, ne sont que des révélations traditionnelles qui, non seulement ont besoin de l'intermède de l'homme pour se transmettre, mais encore dont vous ne pouvez-vous démontrer la certitude d'une manière efficace que par vos propres facultés et en vous plaçant dans les mêmes mesures où sont censés avoir été ceux qu'on nous donne comme ayant été l'objet et les héros de ces révélations ».
Du principe que chaque chose dans la nature fait sa propre révélation, il passe sans effort à la question du langage.
Une langue, dans le sens le plus étendu, et en même temps le plus rigoureux, peut être considérée comme l'expression manifeste des propriétés données à chaque être par la source qui l'a produit. Il n'y a point d'être qui, à la rigueur, n'ait une langue.
L'expression active, actuelle et muette des propriétés doit être, est en quelque sorte la langue directe et la plus simple, puisque là le jeu de l'être et sa langue ne font qu'un.
Les cris des animaux et les différents actes de leur instinct forment déjà une langue d'un autre ordre, car les désirs et les besoins que cette langue représente ne font point unité avec elle.
Enfin les langues humaines sont des signes encore plus détachés et plus distincts des pensées, des intelligences et des mouvements intérieurs que nous voulons manifester.
Ainsi l'homme possède les trois sortes de langues : celle des êtres matériels non animés, par la seule existence corporelle ; celle des êtres sensitifs, par les cris et les actes de l'instinct qui expriment les affections animales, et enfin celle des êtres intelligents et aimants, [p.31] par le pouvoir de peindre avec la parole tout ce qui tient au mouvement des idées et des sentiments moraux.
Or, si les deux premières langues sont données partout avec la vie aux deux classes d'êtres qui sont susceptibles de manifester, les uns de simples propriétés; les autres, outre ces propriétés, les signes des désirs et des besoins de l'ordre animal, comment l'homme, qui a seul à manifester tout ce qui tient à l'ordre intellectuel et moral, se trouverait-il privé par son principe du moyen d'atteindre ce but ? Comment serait-il réduit à faire sa propre langue dans cet ordre, tandis que les deux autres classes d'êtres si inférieures à la sienne se trouveraient cependant, dans leur genre, beaucoup mieux partagées que lui ?
Les langues humaines, ramenées à leur véritable destination, doivent être l'expression de nos pensées, et nos pensées l'expression de nos affections morales, comme les langues des animaux sont l'expression de leurs affections physiques.
Ainsi la persuasion de la nécessité de la parole pour l'institution de la parole ne peut venir que de la persuasion de l'existence du sens moral de l'homme. « Or, dès que vous ne voulez point du sens moral, dit Saint-Martin à son adversaire, il n'est pas étonnant que la vaste idée de Rousseau ne puisse trouver aucun accès auprès de vous. »
Il ajoute un peu après :
« Les philosophes ont imaginé, dans leur fiction, deux individus privés jusqu'à cette époque de tout commerce, même avec les animaux. Ils ont considéré les différents développements qui vont se montrer successivement dans les facultés de ces deux individus ; ils ont suivi avec beaucoup d'intelligence la génération progressive des signes naturels, des signes indicateurs, des signes imitatifs, des signes figurés, des signes d'habitude ; et, entraînés par l'amour de leur sujet, ils se sont hâtés de porter dans la langue qu'ils cherchent à engendrer tout ce qu'ils trouvent dans les langues déjà existantes ; et, sans avoir pris la précaution de résoudre le problème de la transformation des sons de la voix ou des cris de l'homme animal en un langage expressif et analogue à la pensée, ils ont coupé court en disant d'après cette charmante série d'observations : le langage analogue de la parole s'étendra, s'enrichira chaque jour davantage ; on en formera un système, et les langues prendront naissance. — Ils doutent [p.32] même si peu du succès de leur fiction qu'ils passent bientôt à l'affirmative, et qu'ils disent avec une confiance remarquable : l'institution du langage est expliquée. »
« Mais, dit-il encore, si, par leurs systèmes sur l'origine des langues, ils avaient trouvé le véritable mode selon lequel elles se sont formées, ce serait un supplice pour l'humanité que ce nombre infini de siècles qu'il lui aurait fallu laisser s'écouler avant qu'elle eût découvert, développé et perfectionné le moyen par lequel elle devait satisfaire le besoin qu'elle a de converser et de s'entendre ? Combien de générations sacrifiées à cette décourageante expectative ! Combien de membres retranchés de la famille humaine avant que cette famille humaine eût pu jouir de ses droits !... Les moindres êtres de la nature ne sont pas condamnés à cette loi outrageuse et inconséquente... Et vous, spéculateurs, vous voudriez qu'exclusivement appelés à jouir de ce superbe don de la parole, qui fait de l'homme un prodige perpétuel, il fût cependant le seul qui se trouvât condamné à la privation d'un si beau droit, jusqu'à ce que les torrents des siècles, à force de passer sur cette mine précieuse, fussent parvenus à lui en découvrir toute la richesse ! Vous ne craignez point d'immoler les droits les plus sacrés de l'homme à une éphémère conception de votre esprit ; et cela pendant une série incalculable de générations ! Vous ne craignez point de voir vos enseignements en opposition avec la rectitude d'une rigoureuse intelligence ! Vous ne craignez point d'envoyer vos illusions se confronter avec la réalité ! »
Je termine ici l'exposition de cette remarquable conférence. La doctrine de Saint-Martin ne manque à coup sûr ni de profondeur ni de nouveauté, quoiqu'elle soit moins nouvelle, peut-être, que renouvelée par l'originalité de la forme. Sa théorie du langage, fondée sur ce principe que chaque chose dans la nature fait sa propre révélation, est une théorie ingénieuse et vraie, mais surtout ingénieuse. Loin d'avoir toute la fécondité qu'au premier coup d'ail on serait tenté de lui attribuer, elle ne fournit guère en définitive qu'un argument. C'est un des mérites de Saint-Martin, mérite qui, d'autre part, offre matière à la critique, de savoir relever une conception ordinaire par l'inattendu de la rédaction, de chercher à refondre, en les frappant à une effigie souvent bizarre, des doctrines dont la rouille des siècles a effacé le titre, ou de s'approprier une idée courante par un mot heureux. Cette tendance de son esprit a sa source dans son indifférence [p.33] pour la filiation historique des doctrines. Il dit, il répète jusqu'à l'affectation qu'il a dès longtemps rompu tout commerce avec les livres pour se borner à un seul livre, l'homme même ; que les ouvrages dont il est l'auteur n'ont d'autre objet que d'engager l'homme à oublier tous les livres, sans en excepter les siens. On conçoit donc que, ne tenant aucun compte de la tradition philosophique et scientifique, sans se trouver d'ailleurs dans des conditions qui le distinguent des membres d'élite de la famille humaine, il reproduise à son insu, avec une originalité plus spécieuse que réelle, des observations, des opinions, des systèmes qui ont un nom dans l'histoire de l'esprit humain, et qu'il se croie le mérite de la révélation quand il n'a guère que celui de la formule.
Presque toujours , en effet, il se flatte qu'il invente quand il se souvient, qu'il crée quand il exhume. La vigueur d'un esprit indépendant paie ainsi la rançon de son orgueil par les illusions inséparables de tout effort solitaire. La vérité, du moins, y trouve-t-elle son compte ? Il est permis d'en douter : publiée en dehors de la tradition humaine, ce qu'elle gagne parfois en attrait, elle le perd toujours en autorité.
Cette critique générale trouve son application à différents points de la doctrine que Saint-Martin opposait à l'enseignement de Garat.
Ainsi, quand il pose contre le sensualisme ce principe extrême : « l'homme naît et vit au milieu des pensées, et ces pensées font en lui leur révélation ; » c'est l'antique théorie des idées dont il s'empare et qu'il exagère.
Peut-on dire, en effet, d'une manière aussi absolue que « l'homme naît et vit au milieu des pensées, » en supprimant pour ainsi dire l'élément intérieur qui correspond à ces pensées, ce foyer latent d'où la parole fait jaillir l'étincelle qui met la vie en rapport avec la vie ? Dire que l'homme naît et vit au milieu des pensées, et que ces pensées font en lui leur révélation, n'est-ce pas trancher par une séparation radicale deux choses étroitement unies, la vie et l'intelligence ? Ces pensées font en lui leur révélation ; mais il se révèle à lui-même par ces pensées, et ces pensées sont aussi lui-même. L'homme ne serait-il plus qu'un appareil destiné à recevoir ces pensées sans cesser d'être homme, comme une chambre obscure n'en serait pas moins ce qu'elle est, quoiqu'elle attendît la lumière ? Il n'en peut être ainsi : l'intelligence de l'homme, c'est lui ; l'homme, c'est son intelligence; sa lumière est sa vie, et il ne vit point sans sa lumière. Je sais bien qu'il a été dit : « Tu n'es [p.34] pas ta lumière à toi-même ; » mais il est dit aussi : « Et la vie est la lumière des hommes. » Ici nous touchons à l'éternel problème, au mystère impénétrable ; ici l'alternative se présente ou de placer dans l'homme le principe des idées, d'identifier la raison humaine avec la raison infinie, l'homme avec Dieu ; ou bien de dégrader l'intelligence, l'œuvre de Dieu, qui ne crée que des œuvres vives, en lui refusant la spontanéité, en la réduisant à n'être qu'une table rase, un pur néant. Entre ces deux excès, la conscience de ce que nous sommes doit tenir la balance. Il en est pour la question des idées comme pour celle du libre arbitre : nous sentons la spontanéité de notre intelligence comme nous sentons l'existence de notre liberté, et il ne faut pas plus admettre la fiction de l'indépendance d'un être qui ne s'est pas créé lui-même, qu'il ne faut admettre l'identité substantielle de l'être créé et du souverain créateur. Il faut reconnaître l'illumination de la raison humaine par la lumière incréée, comme nous reconnaissons l'action de la volonté divine sur la nôtre, sans en conclure que c'est Dieu lui-même qui pense, qui veut toutes les pensées et toutes les volontés de l'homme.
L'expression de Saint-Martin, quoique justifiable à certains égards, n'en est pas moins beaucoup trop exclusive et trop absolue.
Sa doctrine du sens moral n'est pas non plus exempte de reproche.
Lorsqu'il dit que le sens moral est une faculté plus radicale encore et plus profonde que la raison, il méconnaît le lien intime et nécessaire qui existe entre ce qui pense et ce qui veut en nous.
Le mot sens, quoique pris métaphysiquement, jette de la confusion dans le style et même dans les idées. Qu'est-ce qu'un sens qui est aussi une faculté, et qui cependant est plus profond et plus radical qu'une faculté ?
Il oublie d'ailleurs qu'il a lui-même établi l'identité de tout ce qu'on nomme tour à tour pensée, âme, raison, entendement, sens moral.., d'où il suivrait que le sens moral est une faculté plus radicale encore et plus profonde que le sens moral.
Et lors même que le vice de l'expression ne l'amènerait pas à cette malheureuse tautologie, il ne serait pas plus facile d'admettre que l'entendement ou la raison soit en nous quelque chose de moins radical et de moins profond que le sens moral. Cela pourrait se dire à la rigueur de la volonté, qui est tout à fait nous-mêmes, où il n'entre rien d'impersonnel; mais le sens moral n'a pas moins d'affinité avec la [p.35] raison qu'avec la volonté, qui se rapportent, l'une à la connaissance, l'autre à l'exécution de la loi morale. Saint-Martin accusait Garat d'oublier les premières paroles de son programme, et de méconnaître l'intima sympathia de Bacon, et lui-même ne sait plus distinguer dans l'homme l'élément qui correspond au bien et celui qui correspond au vrai. Garat n'admettait que la correspondance au vrai ; Saint-Martin en vient presque à n'admettre que la correspondance au bien. Garat réduisait tout à la sensation ; Saint-Martin veut tout réduire au sens moral. Toutefois, il faut le reconnaitre, dans la théorie de Saint-Martin, l'erreur n'est point au fond des choses : c'est le langage qui manque d'exactitude et de rigueur.
Ce qu'il dit en rabaissant les révélations religieuses n'est qu'une concession à l'esprit du temps, appuyée sur un non-sens. Les révélations, suivant lui, roulent dans ce cercle vicieux, d'avoir non seulement besoin de l'intermède de l'homme pour se transmettre, mais encore de ne pouvoir se démontrer d'une manière efficace que par nos propres facultés. - Est-ce donc là une cause nécessaire d'erreur ? Et ce qu'il entend lui-même par révélation, la révélation naturelle procède-t-elle autrement ? L'homme peut-il rien obtenir, dans l'ordre intellectuel comme dans l'ordre physique, qui ne lui soit transmis par l'intermède de l'homme ? N'est-ce pas la parole humaine qui va éveiller dans l'âme naissante la révélation de ses facultés ? Et n'est-ce pas par ces facultés mêmes que nous sommes mis en mesure de juger de la certitude de leurs propres témoignages ? Ce qu'il dit contre les révélations religieuses retombe entièrement sur la révélation naturelle.
Triste époque, où il fallait se défendre comme d'un crime de toute tendance au sentiment religieux ! où c'était un danger que de rester inviolablement fidèle à la vérité dans ses paroles et dans ses actes. Saint-Martin, le diviniste, l'homme de désir, en prenant congé de son adversaire, se croit donc obligé d'écrire cette page qui a la valeur d'un document historique :
« Cette doctrine, lui dit-il, ne doit pas vous donner d'ombrage ; et si vous l'aviez approfondie, vous ne m'auriez pas reproché, comme vous l'aviez fait dans la séance, d'avoir une tendance aux idées religieuses. Je ne répondis rien alors, parce qu'il aurait fallu parler de moi, et que je ne croyais pas à propos, dans des manières aussi importantes, de transformer une question de choses en une question de personne. Je peux y revenir à présent que notre discussion est finie, [p.36] en vous disant que dans ma jeunesse j'ai servi quelques années en qualité d'officier dans les troupes de ligne ; qu'étant entraîné par des goûts d'études, je suis rentré de bonne heure dans ma retraite et dans mon indépendance ; que depuis lors je n'ai rien été ni sous l'ancien régime, ni sous le régime actuel, et qu'ainsi ni mon état ancien ni mon existence présente n'offrent le vernis de la superstition et du fanatisme. »
1847 - Le Correspondant – T 19
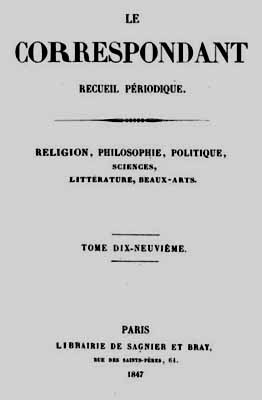 Le Correspondant, Recueil périodique
Le Correspondant, Recueil périodique
Religion, philosophie, politique, sciences, littérature, beaux-arts.
Tome dix-neuvième
Paris. Librairie de Sagnier et Bray, rue des Saint Pères, 64
1847 - Le Correspondant – T 19
Examen des doctrines du Philosophe inconnu, Louis-Claude de Saint-Martin, Louis Moreau
3e article – Exposition de la théorie sociale – Pages 74-95
Cet article comprend également les chapitres VII, Exposition du système métaphysique de Saint-Martin, et VIII, Vue de la nature. Esprit des choses, du livre de Moreau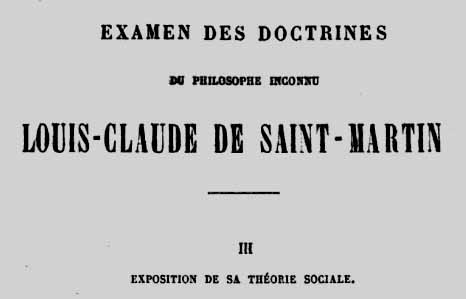
Une même épigraphe pourrait convenir à l'ensemble des divers travaux que le dernier siècle vit éclore ; cette épigraphe serait le mot célèbre de Bacon : Ars instauranda ab imis. Ce mot désespérant, s'il n'était profondément insensé, usurpe alors la puissance d'un axiome. Philosophes, savants et publicistes, tous partent de ce principe, que l'œuvre des devanciers est à peu près nulle et que l'édifice des connaissances humaines est à reprendre par la base. La tradition est proscrite, comme complice des superstitions. Témoin suspect, on récuse les faits qu'elle seule peut fournir, et qui seuls peuvent servir de fondement à la science, surtout à la science de l'homme. Par une contradiction remarquable, bien que peut-être elle ne soit qu'apparente, c'est de l'avènement de l'empirisme que date l'ère des romans les plus libres que puisse inventer l'imagination appliquée aux origines du monde, de l'homme et des sociétés. On refait donc la science, on refait l'esprit humain, on refait la société en théorie, et pour refaire tout cela, on répudie le passé et on le refait. Il faut voir avec quelle hardiesse ce préjugé étroit et injurieux à l'humanité substitue partout les plus étranges hypothèses à la voix de l'antiquité et aux premiers monuments de l'histoire. L'idéologie nous le montre à [p.75] l'œuvre dans l'analyse de l'entendement humain; et aucune de ses spéculations dans l'ordre physique ou dans l'ordre moral ne le trouverait inférieur à lui-même. L'expérience est acquise de tout ce qu'un siècle peut porter de paradoxes, et de quelles fictions l'homme est capable de se satisfaire afin d'échapper à des faits dont il décline le conséquences.
Pour trouver en quelques pages un modèle accompli de la méthode historique que les penseurs du XVIIIe siècle accommodent généralement aux divagations métaphysiques d'Helvétius et de Rousseau, il faut jeter les yeux sur les premières lignes de l'Esquisse d’un tableau des progrès de l'esprit humain, ce long et dernier blasphème que Condorcet proscrit exhale contre la religion et contre toute religion. C'est là que l'on peut admirer avec quelle audace et quel sang-froid, avec quel cynisme d'affirmation quand les faits manquent ou contredisent, un philosophe sait restituer le passé au gré de ses opinions. Ces hommes, contrôleurs si difficiles des titres du Christianisme, prennent une voie plus courte pour substituer leurs préjugés à ses dogmes et à ses preuves : ils érigent leurs opinions en dogmes dispensés de preuve.
Ainsi, veut-on connaître l'état primitif des associations humaines : rien n'est plus simple. Condorcet répond avec assurance : « Le premier état de civilisation où l'on ait observé l'espèce humaine est celui d'une société peu nombreuse subsistant de la chasse et de la pêche, etc. » Donc le premier état social n'est pas différent de l'état de civilisation que l'on observe aujourd'hui chez les sauvages. Mais le mot observer, qu'en dites-vous ? Ce fait que l'on peut observer dans certaines parties du monde, qui donc l'a observé à l'origine du monde ? Quelle est la date de cette précieuse observation ? Quel est le nom du premier observateur ? Condorcet et Rousseau ont-ils préexisté au temps pour observer par eux-mêmes ce phénomène originel ? Mais Condorcet prétend donner à l'hypothèse qui veut que l'homme débute par l'état sauvage, l'autorité d'un fait ; et voici à peu près à quoi se réduit son raisonnement. Le fait de l'état sauvage est observé dans plusieurs contrées du globe : donc il a été observé dès le principe. Ce fait se produit aujourd'hui, rare et avec tous les caractères d'une monstrueuse exception : donc il a dû se produire, et il s'est produit, aux plus anciens jours, comme un fait normal et nécessaire. Condorcet conclut donc du particulier au général, et place [p.76] arbitrairement dans le lointain des temps un fait qui se rencontre dans le lointain des lieux.
Cette méthode indépendante, ou plutôt cette indépendance de toute méthode permet au philosophe de poursuivre avec une rare facilité l'histoire de l'homme.
L'homme commence donc par tirer sa subsistance de la chasse et de la pêche, ou des fruits offerts spontanément par la terre (heureuse périphrase pour désigner sans doute le gland) ; mais la loi de perfectibilité indéfinie qui est inhérente à sa nature fait succéder à ces premiers aliments une nourriture plus certaine, la chair des animaux réduits en domesticité ; à ces moyens se joint bientôt une agriculture grossière ; il forme des provisions, qu'il sème, qu'il plante, et dont il favorise la reproduction par le travail de la culture.
Mais si cette loi innée à l'homme a guidé d'une main sûre ses premiers pas sur la terre, suivant l'induction nouvelle qui de l'exception dans le présent fait la règle du passé, pourquoi ne s'est-elle pas développée chez les peuplades sauvages auxquelles la chasse et la pêche n'offrent encore aujourd'hui qu'une ressource précaire ? Pourquoi l'enseignement du missionnaire ne trouve-t-il pas dans cette faculté du progrès un puissant levier pour les élever jusqu'à la prévoyance, qui est l'âme du travail et la première condition de la perfectibilité ? Pourquoi, au contraire, dans ces races dégradées, la nature oppose-t-elle une résistance si obstinée à sa régénération spirituelle et morale ? La vie des insulaires de l'Océanie est un démenti renouvelé à ces vaines théories qui font de la civilisation une conséquence naturelle et nécessaire de l'organisation humaine. L'anthropophage de Tonga se laisse mourir de faim sur un sol fertile qu'il ne sait ni veut cultiver (Annal. de la propag, de la foi, missions de l'Océanie centrale; septembre 1846).
Veut-on connaître l'histoire de la propriété : rien n'est encore plus simple. Ce n'est d'abord que quelques armes, quelques filets, quelques ustensiles de ménage. Cette propriété devient ensuite celle du troupeau, puis celle de la terre; et à la mort du chef elle se transmet naturellement à la famille.
Quoi de plus court et de plus naturel que cet exposé? Il est vrai qu'il débute par une hypothèse fondée sur un raisonnement ridicule ; [p.77] il est vrai qu'il faut en outre dévorer deux autres hypothèses. Car cette assertion qui fait succéder à l'état sauvage celui des peuples pasteurs, et à l'état des peuples pasteurs celui des peuples agriculteurs, est gratuite. C'est la philosophie qui trouve bon qu'il en soit ainsi ; c'est la philosophie qui imagine une histoire de la propriété en correspondance exacte avec l'histoire imaginaire de l'humanité ; c'est la philosophie qui contredit la Genèse et ne daigne plus même lui faire l'honneur de la nommer.
L'hypothèse en effet de l'état sauvage est démentie par cette seule parole : « Faisons l'homme à notre image et ressemblance, et que les hommes dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux domestiques, etc. »
L'hypothèse de la transition des peuples pasteurs aux peuples agriculteurs disparait devant ce simple récit :
« Eve mit au monde Abel, frère de Cain ; or Abel fut berger, et Caïn laboureur. » (Genèse, I, 26, IV, 2).
La Genèse, c'est-à-dire l'un des premiers monuments du monde, atteste donc que, dès le principe, l'homme fut à la fois pasteur, agriculteur, roi, investi par Dieu même du droit de souveraineté sur toute la nature, et le récit de Moïse n’exclut pas moins la supposition d'un état primitif d'ignorance et de brutalité que celle d'une lente série de progrès qui élèveraient à grand peine l'intelligence de l'homme au niveau de l'instinct animal.
Je n'exige pas d'un libre penseur qu'il attelle son indépendance au joug de l'Écriture ; mais j'ai le droit d'exiger qu'il substitue autre chose que des rêves métaphysiques aux dépositions de ce témoin antique de toutes les origines. Il est loisible à Voltaire de se moquer de la Bible, mais il n'est pas permis à Condorcet de la passer sous silence.
Quoi de plus impudent, en effet, que ces essais de restitution des temps anté-historiques, fondés sur le bon plaisir de l'esprit particulier ? Condorcet nous dit encore avec le même sang-froid : « L'invention de l'arc avait été l'ouvrage d'un homme de génie ; la formation d'une langue fut celui de la société entière ... » (Esquisses d'un tabl. hist. des progrès de l'esprit humain. In-18, p. 20, p.8). Il disait un peu plus [p.78] haut: « Des hommes de génie, des bienfaiteurs éternels de l'humanité, dont le nom, dont la patrie même, sont pour jamais ensevelis dans l'oubli, observèrent que tous les mots d'une langue n'étaient que les combinaisons d'une quantité très limitée d'articulations premières ... Ils imaginèrent de désigner par des signes visibles non les idées ou les mots qui y répondent, mais ces éléments simples dont les mots sont composés. »
A merveille. Mais d'abord comment peut-il rendre un compte si précis des procédés logiques employés par ces hommes de génie dont il ne sait ni le nom, ni la patrie, ni le siècle où ils ont vécu ? Et puis, s'il fait honneur de l'invention du langage à la société entière, où est la raison de ne pas accorder aussi à la société entière l'invention de l'écriture ? Ou bien, pourquoi ne pas attribuer la découverte de l'écriture à tous, et celle du langage à quelques-uns ? L'une de ces suppositions n'est ni plus ni moins aventureuse que l'autre. Mais ce que je ne puis assez admirer, c'est qu'en posant toujours comme point de départ l'état sauvage, l'on rattache aux temps voisins de ce triste berceau de l'humanité d'incomparables inventions et telles que les civilisations les plus florissantes n'en ont jamais su produire de semblable : l'invention de l'écriture, celle du langage et l'institution de la société civile. Car, selon la philosophie du dernier siècle, la société elle-même repose de temps immémorial sur une convention qui impliquerait dans les hommes grossiers, jouets de leurs passions et de leurs appétits, une singulière prévoyance et une métaphysique politique fort déliée, puisque, aux termes de l'hypothèse, cette convention aurait stipulé l'aliénation d'une certaine portion de la force et de l'indépendance personnelle au profit d'un pouvoir public et d'une liberté générale. La contradiction est évidente. Et toutefois les meilleurs esprits y sont tombés ; le penseur comme le déclamateur ; Montesquieu comme Rousseau. Car Montesquieu lui-même va chercher aussi dans les forêts l'homme naturel, l'homme antérieur à l'établissement des sociétés. C'est qu'en définitive il s'agissait moins de donner au problème des origines une solution véritable que d'en exclure les solutions admises ; il s'agissait moins d'établir solidement l'éducation progressive de l'homme par lui-même que d'interdire à Dieu le souci des choses humaines.
La fièvre antireligieuse peut seule expliquer cette manie de refaire à priori l'histoire primitive de l'homme. Comment, en effet, concevoir [p.79] que, obstinément engagés dans une voie de spéculations vaines, des esprits supérieurs s'amusent à tracer du commencement du monde ces étranges tableaux qui ne présentent ni une preuve, ni une date, ni un nom ? Comment concevoir que, négligeant Dieu dès le principe comme un terme inutile, et dédaignant le milieu social et traditionnel dont on ne saurait se dégager sans sortir des conditions qui sont faites à l'intelligence pour atteindre le vrai, l'observateur prenne l'homme comme une abstraction, le retire de la sphère vivante des faits humains, pour ériger en faits les développements hypothétiques qu'il lui prête ; à peu près comme on étudierait les chimériques évolutions d'un germe inconnu, en commençant par le soustraire à l'action des éléments sans lesquels il ne se peut qu'il devienne ce qu'il doit être ? Il fallait donc, je le répète, qu'il y eût à cette intempérance de rêveries manifestes un motif et un dédommagement : de puissants esprits ne sont jamais assez dupes de l'erreur pour affronter naïvement l'absurde et l'impossible.
En abordant l'examen contradictoire de ces questions redoutables, Saint-Martin prend pour point de départ l'homme même, et c'est par l'observation intérieure qu'il prétend arriver à l'explication de l'homme et des choses. « On a voulu, dit-il, expliquer l'homme par les choses et non les choses par l'homme, » et cependant l'homme est la clef des choses. L'âme de l'homme est le miroir universel; miroir terni et brisé, mais qui, par ses brisures mêmes et ses ténèbres, témoigne de toutes les lumières qu'il devrait concentrer et réfléchir. « Les vérités fondamentales, dit encore Saint-Martin, cesseraient de nous paraître inaccessibles si nous savions saisir le fil qui nous est sans cesse présenté ; parce que ce fil, correspondant de la lumière à nous, remplirait alors le principal objet qu'elle se propose, qui est sans doute de nous rapprocher d'elle et de réunir les deux extrêmes. » (Tableau naturel, 2. Édimbourg, 1782).
La méthode psychologique, l'étude de l'homme, si elle est indépendante et désintéressée, est une base solide ; car il est difficile que le sentiment vrai des misères humaines et la conscience de la situation maladive de l'âme ne confirment point de leur douloureux témoignage la tradition de la chute originelle, c'est-à-dire de l'alliance rompue entre l'homme et Dieu. Ce sentiment d'une grande infortune [p80] avec le soupçon d'une grande faute ne manquait pas aux sages de l'ancien monde : monde qui, comme le nôtre, a retenti des plaintes et des aveux de l'humanité déchue. Et toutefois l'unanimité de ce sentiment était loin d'emporter une conclusion unanime dès qu'il s'agissait de poser les prémisses de la destinée humaine. L'antique tradition n'était pas éteinte, et elle trouvait un écho dans les souffrances de l'âme ; ses traces étaient obscures, et de là son impuissance à réunir les opinions. Mais aujourd'hui que la main divine, la main de Celui en qui Saint-Martin croyait, a déchiré les voiles qui jadis couvraient en partie les origines humaines, n'est-il pas étrange qu'on se plaise à rabaisser la voie lumineuse de la tradition au profit de l'observation psychologique, et que l'on affecte de se borner à la simple inspection de l'homme, comme si la lumière de cette tradition n'avait pas une souveraine influence sur la manière même d'inspecter l'homme ? Évidemment l'on peut observer et conclure à merveille lorsqu'on néglige par hypothèse le fait primitif qui éclaire l'observateur, quoique celui-ci, de propos délibéré, ferme les yeux ; mais il est beaucoup moins évident que l'observation dût être aussi juste et la conclusion aussi légitime, si ce fait, dont on tient à se passer, était réellement anéanti dans la mémoire des hommes ; et cette remarque serait encore fondée, lors même qu'elle n'aurait point égard à la solution chrétienne. L'homme, en effet (non pas l'homme naturel, selon le XVIIIe siècle, mais l'homme social, l'homme vrai) naît au milieu d'une civilisation quelconque, c'est-à-dire au milieu d'un dogme et d'une croyance; et comme cet homme ne se fait ni son siècle, ni sa patrie, ni sa religion, ni sa langue, et que sa liberté ne s'exerce que par et sur ce qui lui est donné, il est impossible que plus tard il fasse un juste et fidèle départ de ce qu'il doit à la révélation dont il est saisi dès le berceau et de ce qu'il devrait à la solitude hypothétique de ces facultés individuelles, qui ne possèdent en aucun cas l'instrument de leur activité même, séparé des enseignements que cet instrument enveloppe et communique. Au début de son livre des Erreurs et de la Vérité, Saint-Martin prétend que « des vérités qui ne reposeraient que sur des témoignages ne seraient plus des vérités. » Mais il y a là plus de dédain que de sens, si toutefois il y a là le moindre sens. Je ne vois pas, en effet, comment le Témoignage pourrait destituer la Vérité de ses droits et de sa nature ; comment une vérité attestée cesserait d'être vérité, si le témoignage est [p.81] vrai. Je vais plus loin, et j'affirme au contraire qu'il n'est point de vérité qui se puisse passer du témoignage. Une vérité sans témoignage serait une vérité sans commerce avec notre intelligence, vérité infiniment plus inaccessible que le mystère lui-même, puisqu'elle tiendrait ses propres manifestations repliées en soi. Il n'est point de vérité qui ne s'atteste et ne soit attestée. Les vérités psychologiques elles-mêmes ont pour témoin cette parole intérieure qui les saisit au fond de la conscience, les dévoile et les produit; et l'identité entre la vérité et le témoignage, qui ne saurait être que dans Celui qui est, laisse néanmoins subsister une distinction personnelle entre l'une et l'autre, puisque le Fils, ou le Verbe de Dieu, rend témoignage du Père. Le Témoignage se retrouve ainsi jusque dans les profondeurs de la Vérité même ; il est donc impossible que la vérité s'en sépare, quand elle sort de son secret.
Ces réserves faites sur l'illégitimité des dédains du Philosophe Inconnu pour la voie traditionnelle, qu'on ne saurait sans erreur annuler au bénéfice exclusif de la méthode d'observation, j'entre volontiers dans la pensée de Saint-Martin et reconnais avec lui la vérité de cet adage : MENS HOMINIS RERUM UNIVERSALITATIS SPECULUM EST. J'admire ces nobles paroles au début de l'un de ses principaux écrits contre les erreurs sociales : « Ce sera toujours l'âme humaine, dit-il, qui me servira de flambeau; et cette lampe à la main, j'oserai marcher devant l'homme dans ces obscurs souterrains où tant de guides, soit trompés, soit trompeurs, l'ont égaré, en l'éblouissant par des lueurs fantastiques, et en le berçant jusqu'à ses derniers instants avec des récits mensongers, mille fois plus pernicieux pour lui que l'ignorance de son premier âge. Les publicistes n'ont écrit qu'avec des idées dans une matière où ils auraient dû n'écrire qu'avec des sanglots. Sans s'inquiéter de savoir si l'homme sommeillait ou non dans un abime, ils ont pris les agitations convulsives de sa situation douloureuse pour les mouvements naturels d'un corps sain et jouissant librement de tous les principes de sa vie ; et c'est avec ces éléments caducs et tarés qu'ils ont voulu former l'association humaine et composer l'ordre politique... Je suis le premier, dit-il encore, qui ait porté la charrue dans ce terrain, à la fois antique et neuf, dont la culture est si pénible, vu les ronces qui le couvrent et les racines qui se sont entrelacées dans ses profondeurs. » (Eclair sur l'Association humaine. Paris, an V (1797).). [p.82]
Saint-Martin pose au début le fait de la déchéance humaine, fait qu'il conclut de l'observation des souffrances et des afflictions de notre nature, et l'un des premiers principes qu'il établit pour éclairer la question de l'ordre social est celui-ci :
LE BUT VÉRITABLE DE L'ASSOCIATION HUMAINE NE PEUT ÊTRE AUTRE CHOSE QUE LE POINT MÊME D'OÙ ELLE EST DESCENDUE PAR UNE ALTÉRATION QUELCONQUE.
Si l'homme est un être spirituel, s'il est esprit, comme l'on n'en saurait douter, tout ce qui émane de lui doit avoir eu primitivement le caractère de l'esprit ; car c'est une loi incontestable que tout être, quel qu'il soit, doit offrir des résultats et des productions de sa nature. Or, tout ce qui émane de l'homme doit avoir eu dans le principe, non seulement le caractère de l'esprit, mais encore le caractère d'un esprit régulier ; car l'agent suprême, dont il ne peut émaner que des êtres qui soient esprits, n'en peut laisser sortir de lui aucun qui n'ait en soi ces sages et éminentes propriétés.
Mais quand on voit la pensée de l'homme produire des conceptions et des œuvres puisées tantôt dans un ordre inférieur à celui de l'esprit, tantôt dans des irrégularités de ce même esprit, on peut assurer que ces œuvres et ces conceptions désordonnées tiennent à une altération quelconque, et ne sont point le produit pur de ses facultés primitives. Ces résultats irréguliers n'excluent pas toutefois en lui le désir, souvent efficace, d'en produire de plus parfaits, en vertu de ce penchant radical qui rappelle tout être à sa vraie nature et à sa manière d'être originelle. Le malade, jusque dans ses délires, prouve qu'il tend à la santé; et dans les désordres mêmes de sa pensée, l'homme est un être qui aspire à remonter à un point d'où il est descendu.
N'est-ce pas, en effet, ce mobile secret et antérieur à l'orgueil même qui pousse les hommes aux travaux de l'esprit, à la poursuite de l'autorité et de la gloire ? Ils s'attachent à la conquête de tous ces objets comme à une sorte de restauration, comme s'ils cherchaient à recouvrer ce dont ils ont été dépouillés, c'est-à-dire la jouissance de tous les droits de la pensée pure et divine.
Cette tendance universelle de l'homme à sa réintégration dans ses vraies mesures serait au besoin vérifiée par les lois mêmes de la nature physique.
« Ne voyons-nous pas que le degré où l'eau peut monter est [p.83] toujours égal à celui d'où elle est partie, et qu'ainsi pour elle le point de tendance et le point de départ ne sont absolument que le même point quant à l'élévation ?
« Ne voyons-nous pas que, dans la végétation, le grain quelconque que l'on sème en terre arrive par sa loi ascendante jusqu'à la hauteur ou à la région où il avait pris naissance, en sorte que le terme de sa fructification ou de sa perfection est le même que le terme de son origine ?
« Enfin ne voyons-nous pas que, dans la géométrie, l'angle de réflexion est toujours égal à l'angle d'incidence ? Toutes vérités exactes et profondes qui paraissent comme la traduction sensible du livre des lois des êtres libres, et comme les modulations relatives et harmoniques de leur ton primitif et fondamental.» (Ibid, p. 23-24).
L'homme dans l'état primitif, en communion avec la source suprême de l'ordre et de la puissance, développant en liberté les germes de ses plus douces vertus, n'aurait pas eu besoin d'y faire usage ni de ses facultés délibérantes et judiciaires, puisqu'il n'y aurait eu pour lui que du bien à recueillir, ni de ses facultés coercitives et répressives, puisqu'il n'y aurait pas eu de méchants à contenir. Ces facultés néanmoins eussent toujours résidé en lui, comme en puissance, comme enveloppées et en repos.
Mais l'altération originelle, altération évidente « et mille fois plus démontrée par une seule des inquiétudes de l'âme humaine, que le contraire ne peut l'être par tous les balbutiements des philosophes, » a fait déchoir l'homme de ce haut rang. La pensée divine, qui eût dû perpétuellement servir de centre et de noyau à l'association primitive, s'est éloignée de lui; mais en se retirant elle ne lui a retranché que ses jouissances et lui en a laissé le souvenir.
« A l'instar des grands de la terre, que l'on exile quand ils sont coupables, le premier ancêtre des humains n'a point été précipité, enfant ni ignorant, dans la région ténébreuse où nous errons ; il y a été précipité homme fait, et dans cette chute on ne lui [a] ôté que l'usage de ses forces. [idem, p.28] » Il en a gardé le sentiment, afin de connaître la peine et le remords. Précipité enfant et dans cet état d'imbécillité aussi étrangère au remords qu'à la prévoyance, il eût expiré de misère et de faim longtemps avant l'âge où cette prévoyance eût pu naître en lui. C'est donc en vain que les publicistes vont chercher dans cette [p.84] prévoyance, nulle ou tardive, la racine de l'association humaine.
Si, dans l'ordre social actuel, les illustres disgraciés, plus sensibles au souvenir de leur grandeur éclipsée qu'au sentiment de leurs besoins présents, cherchent néanmoins à diminuer pour leurs descendants le poids de l'épreuve et de la honte ; si le père retrace à ses enfants le glorieux tableau du passé, leur suggérant à la fois le désir et les moyens de le reconquérir ; si le gouvernement lui-même, dans l'intérêt de sa propre gloire, désire encore plus la restauration de ces nobles exilés qu'il n'a désiré leur punition, il n'est pas moins vrai à coup sûr que le premier père du genre humain aura transmis à ses descendants et les souvenirs de son ancienne gloire et les puissantes espérances de retour qui lui étaient accordées. Et ce sont ces notions divines et ces principes consolateurs qui ont dû servir de noyau ou de centre aux anciennes associations terrestres. C'est à cette source commune que remontent les religions, « qui ne sont réellement dans leur origine que de véritables associations restauratrices dans l'ordre divin. »
D'où Saint-Martin conclut que l'ordre social ne repose que sur l'ordre spirituel, et que « le vrai gouvernement est le gouvernement théocratique. »
C'est en l'an III, peu de temps après la Terreur, à l'époque où le nom de Dieu était effacé de toutes les institutions et de tous les actes politiques, c'est alors qu'il développait ces idées si étrangères à l'esprit du temps : « Dieu, dit-il dans sa Lettre sur la Révolution française, Dieu est le seul monarque et le seul souverain des êtres; il veut être le seul qui règne sur les peuples dans toutes les associations et dans tous les gouvernements. Les hommes qui se trouvent à la tête des nations ne devraient être que ses représentants... Et l'on voit comment cette idée est en eux-mêmes par la confiance qu'ils ont en leur autorité et par les soins qu'ils prennent à la montrer comme émanant de la justice même. Or, comme ces représentants de la Providence, quoiqu'égaux par nature aux autres hommes, seraient distincts et supérieurs par leurs dons et par leurs lumières au reste de la nation, il ne serait pas difficile de voir là d'où les hommes qui abusent de tout ont tiré leurs monarchies humaines et leurs aristocraties terrestres, et d'où dérive ce respect, ou réel ou factice, que chacun a communément pour les autorités qui le gouvernent......
« On nous a dit que le peuple était souverain ; je me fais gloire de [p.85] le penser et d'en convenir hautement. Mais si l'existence de l'homme n'a qu'un seul objet, celui de la culture des éternels domaines de la vérité, le peuple ne peut être souverain que pour ce même but et dans le même sens où nous avons entrevu que l'homme eût dû autrefois être propriétaire. Ainsi, tout en reconnaissant les peuples souverains de droit, selon le plan original, nous ne pouvons nous empêcher de dire que, dans le fait, ils ne sont pas moins descendus que l'homme au-dessous de leur destination primitive.... Aussi cette souveraineté se réduit-elle réellement pour les peuples à éprouver le sentiment de toutes leurs misères, à jeter les yeux sur ceux d'entre eux qu'ils croient les moins incapables de leur servir de libérateurs.... La principale propriété actuelle de l'homme est son indigence, et le premier degré de la souveraineté des peuples, c'est leur impuissance et leur servitude..... Ainsi, disons donc hautement ce qui n'a peut-être encore été jamais entendu des hommes : Quand est-ce que les peuples sont souverains dans toute l'étendue que ce terme comporte ? C'est quand ils sont mis à l'œuvre pour l'accomplissement des décrets de la Providence; c'est quand ils ont reçu à cet effet leur sanction; c'est quand ils sont élevés par là jusqu'à une puissance qui soit au-dessus d'eux, et qui les lie, non plus à l'empire de leur volonté, mais à l'empire de la sienne, comme étant plus fixe et plus clairvoyante que la leur. » [Lette à un ami sur la Révolution française. Paris An III, p.60, 61, 62, 63]
Si l'on donnait, en effet, pour la sanction des peuples cette mutuelle adhésion, ce commerce des volontés rêvé par les publicistes, il n'y aurait là qu'un commerce d'égal à égal, commerce précaire et pouvant cesser à la volonté des parties, qui dès lors n'offriraient que des puissances conventionnelles et des sanctions figuratives.
Il n'en pourrait même jamais sortir une loi obligatoire, « puisque toute loi doit porter sa mulcte [Jurisprudence (Encyclopédie de Diderot), se dit au palais pour amende ; et mulcter, pour condamner ou imposer à une amende] avec soi-même, et que dans tous les individus qui seraient censés avoir fait le contrat, s'il en est beaucoup qui veuillent de la loi, il y en a sûrement fort peu qui veuillent de la mulcte pour leur propre compte.... Enfin le dernier terme où sache s'étendre la loi des hommes, c'est de tuer, punition qui n'effraie que l'homme de matière et amende rarement l'homme moral. Elle m'en imposerait davantage, cette loi, si, au lieu de tuer, elle savait ressusciter et environner les coupables de la lumière de leurs crimes.... » [Idem, p.63, 64]
C'est donc de la région supérieure que découle la souveraineté des peuples, « souveraineté qui, dès lors, n'est plus arbitraire et fragile ; [p.86] souveraineté qui s'appuie sur une base vive, et qui place les nations sous la dépendance des choses et non pas sous la dépendance de l'homme ; parce que s'il arrive que des peuples soient appelés à l'œuvre et sanctionnés de cette manière, il doit alors reposer sur eux une puissance appropriée au plan de la main qui les a choisis, et dont ils ne sont plus que les organes ; et ainsi cette puissance ne se calcule plus selon les conseils de la sagesse de l'homme, et selon la force des peuples et la grandeur de leurs armées, parce que, étant liée à l'ordre vif, il ne serait pas étonnant que, par cette union, elle eût le droit d'étendre à son gré la perspicacité des peuples choisis, de même que l'ardeur et le courage de leurs guerriers, de laisser naitre dans l'esprit des uns et des autres des découvertes et des inventions inattendues, et qu'on les vit par là opposer d'un côté une résistance à l'épreuve de tous les obstacles, et de l'autre imprimer une faiblesse à l'épreuve de tous les moyens....
« L'histoire des nations est une sorte de tissu vivant et mobile où se tamise sans interruption l'irréfragable et éternelle justice. » (Lettre à un ami sur la Révolution française, an III, Paris) [p.64-65]
« Les associations humaines ne peuvent être régulières et solides qu'autant qu'elles sont théocratiques, et le véritable contrat social n'est que l'adhésion de tous les membres du corps politique à cette antique volonté générale qui est avant lui, et qu'il ne pourra jamais créer avec toutes ses opinions et toutes ses volontés particulières. » (Eclair sur l'association humaine, an V, Paris) [p.55].
Loin de reconnaître la volonté générale humaine comme base de l'association et comme lien du contrat social, Saint-Martin ne la reconnaît même pas comme base et principe de la forme de gouvernement, ni de tous les modes d'administration que les hommes inventent et varient chaque jour en aveugles.
Les sanglantes vicissitudes du pouvoir dans la crise révolutionnaire où chaque forme de gouvernement s'est toujours donnée comme l'expression de la volonté commune, détruiraient au besoin l'hypothèse qui fonde sur cette volonté les associations politiques.
Mais il n'est pas jusqu'à cet abus de mots qui ne mette les principes en relief. Plus les hommes, au milieu de tant de méprises, parlent de la volonté générale, plus ils annoncent qu'il devrait y en [p.86] avoir une qui le fût ; et quoiqu'ils tendent à faux et à sens inverse vers ce point du niveau dont ils auront besoin pour conserver leur équilibre, il n'est pas moins certain qu'ils y tendent, et constatent par leurs illusions mêmes l'existence de cette volonté supérieure et vraiment universelle.
Ce serait, en effet, le plus inconcevable prodige que tout ne fût pas renversé sans retour « si cette éternelle volonté ne laissait jamais percer au travers des nuages épais qui nous environnent quelque lueur de son inaltérable clarté; et la plus grande preuve que, à notre insu.... elle ne cesse de jeter quelques regards sur l'ordre des choses, c'est que ces choses existent. » [Eclair..., p.66]
De ces principes, Saint-Martin conclut à la soumission aux Puissances. Fussent-elles injustes, ce n'est point à l'homme seul à les redresser ; il ignore toujours « la main cachée qui peut agir sous ces mains visibles. » [Idem, p.67]
Les fausses voies où la science politique s'est engagée ont amené cette absurdité évidente, savoir : « que selon le plan naturel des choses, il y ait dans les mêmes espèces des souverains du même ordre, des chefs du même genre, et que ce soient les individus qui les choisissent. » [Idem, p.68] Ce principe électif peut à la rigueur s'admettre dans des circonstances urgentes, dans le cas d'une altération évidente du corps social et du mobile régulier qui devrait lui servir de boussole ; mais il n'est tolérable qu'autant que l'état social ne s'élève pas au-dessus de l'ordre inférieur et matériel. Dès qu'il monte, « les élections humaines ne sont plus qu'illusoires, parce qu'il aborde des régions dont l'homme n'a plus ni la clef ni la carte, et c'est en voulant agir comme les ayant encore l'une et l'autre, qu'il ravage l'ordre inférieur social au lieu de le restaurer. » [Idem, p.70]
Étrange prétention de ceux qui, demandant à de simples élections humaines une autorité impérieuse, non contents des affaires du ménage, veulent dominer souverainement dans toute la maison ! Mais « n'est-ce pas le père de famille qui choisit les gouvernantes et les instituteurs de ses enfants, ainsi que les fermiers et les laboureurs de ses terres ? Et sont-ce jamais les gouvernantes, les instituteurs, les fermiers et les laboureurs qui choisissent le père de famille ? » [Idem, p.71]
Rousseau a dit que la souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu'elle ne peut être aliénée ; il dit aussi qu'à l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre, il n'est [p.88] plus. Il dit enfin que les députés du peuple ne peuvent être que ses commissaires.
D'accord avec Rousseau, quant à l'idée d'un représentant qu'il regarde en effet comme un être de raison dans le sens ordinairement reçu, Saint-Martin s'éloigne de lui quant à l'idée de la souveraineté du peuple, qu'il place non dans la chimérique volonté générale du peuple, mais dans l'éternelle sagesse ou l'universelle pensée divine. (Voir l’encadré)
|
Encadré, note de L. Moreau, p.88. « Lorsqu'un élu, selon les voies humaines et inférieures, s'annonce pour être le représentant du peuple, il doit, s'il est juste et bon logicien, dire à ses concitoyens: Je ne suis représentant que d'une partie de votre volonté ; savoir : de celle qui a pour objet l'administration de vos affaires domestiques, parce que vous avez le pouvoir de me confier ces soins inférieurs ; mais je vous tromperais et je me mentirais à moi-même, si je me disais le représentant de votre volonté entière ou de celle qui embrasserait tous les degrés de votre existence, et toutes les bases ainsi que tous les ressorts de votre ordre social : car vous n'avez plus la jouissance de toutes les lumières et de toutes les pensées qu'il faudrait pour cela ; et par votre élection, il vous a été impossible de me les donner, et à moi de les recevoir. Ce n'est donc qu'en vous abaissant que je m'élève ; ce n'est qu'en vous ôtant l'usage de vos moyens que je parais en avoir plus que vous ; ce n'est qu'en vous rapetissant journellement que je me fais passer pour grand à vos yeux. Que serait-ce donc si je n'usais de mon ministère que pour vous ruiner, pour vous ôter la liberté ou la vie ! Il est clair que ce n'est point à ces actes-là que vous m'auriez appelé, puisque chaque citoyen peut dissiper ses biens, se tenir renfermé ou se couper le col quand il lui plaît, et qu'il n'a pas besoin d'un représentant pour se satisfaire sur tous ces points. » Éclair sur l'association humaine, p. 71-73. |
Or, comme cette pensée n'est plus la source où les législateurs humains puisent leurs inspirations, ils ne portent plus que des lois prohibitives, lois d'épouvante et d'angoisse. Ces codes humains semblent n'en être jamais qu'au régime de la terreur. « On dirait qu'il n'y a qu'un seul sentiment dans l'âme des législateurs, celui de l'état précaire et fragile de leur édifice politique et celui de la défiance envers les gouvernés, qu'ils regardent moins comme des pupilles que comme des adversaires. » [Idem, p.75-76]
Au lieu de ces lois fécondes et de ces codes productifs, dont la vérité retentirait dans le cœur de tous les hommes, « les législateurs [p.89] humains sont venus gouverner la terre avec des lois mortes qu'ils n'ont su montrer que comme un épouvantail, et qu'en les environnant de menacés et d'échafauds : supplices et menaces qui ne tiennent presque jamais à la nature du délit, tandis que, dans l'ordre réel, l'on nous ouvrirait les yeux sur nos véritables dangers, et nous verrions toujours la peine liée naturellement aux transgressions. » » [Idem, p.78]
Or, l'une des plus incontestables règles de la justice serait que, dans les peines afflictives, les législateurs humains n'ôtassent jamais au criminel que ce qu'ils pourraient lui rendre, s'il venait à s'amender. Qu'ils lui ôtent donc ses dignités, ses biens, sa liberté même ; mais où donc prennent-ils ce droit de mort sur leur semblable ?
Saint-Martin rattache l'origine de la peine à la délégation que souvent, dans les temps antiques, la souveraine puissance a faite de ce droit divin à la voix et à la main de l'homme, en éclairant alors le ministre de ses justices de lumières surhumaines. Or, c'est l'ordre exprès de cette souveraine puissance qui seul peut mettre l'exercice de ce droit à couvert de l'injustice et de l'atrocité, parce que, même en détruisant l'homme, elle peut lui rendre beaucoup plus qu'elle ne lui a ôté ; seule, elle peut apporter à ce droit une exacte compensation.
Mais les législateurs humains , « ne portant que les ombres de ces hautes vérités dans leur justice composite, » [Idem, p.82] se sont approprié un droit qui n'avait été que prêté exceptionnellement à quelques-uns, et ils décident encore, condamnent, tuent, comme s'ils avaient l'autorité divine.
C'est une injustice et c'est aussi une inconséquence ; car les hommes, en s'abrutissant de plus en plus, ont perdu à proportion ces puissantes facultés de mal qui attiraient les vengeances suprêmes. Ennemis moins intelligents et moins actifs de la source-esprit, « ils s'éloignent d'autant des vastes foyers de crimes qui appelaient la mort ; et cependant les lois humaines, sans chercher à se rallier à des lois antérieures à elles et à s'unir à la source vive d'où doivent dériver tous les pouvoirs, ne prononcent pas moins cette mort journellement... La justice prise dans son sens intégral doit être une guérison et une cure, et non pas une destruction ; car si c'est une belle chose que de savoir mettre de la mesure entre les délits et les peines, c'en est une plus belle encore d'en savoir mettre entre la justice et l'amour... et, sous ce rapport, l'homme-esprit pourra trouver, sans que je le lui nomme, quel a été à la fois le plus sage législateur et le meilleur administrateur de la terre » (Éclair sur l'association humaine, p.84).
Mais, dans leurs égarements et leurs ténèbres, les hommes appellent leurs erreurs par des noms de vérités, noms qui représentent les éléments constitutifs de toute association humaine. Or, détournés, pour la plupart, comme celui de la justice, de leur véritable sens, ces noms de liberté, de gloire, d'honneur, d'intérêt national, de religion, etc., deviennent autant d'idoles qui demandent et qui obtiennent en sacrifice le sang de l'homme lui-même.
« Et nous, dit Saint-Martin, qui nous croyons si fort au-dessus des autres peuples... voyons combien nous avons offert de victimes humaines dans la révolution aux mots de nation, de sûreté de l'Etat, etc. N'oublions pas, surtout, combien nous en avons offert au mot liberté, et cela devant une image matérielle qui en porte le nom, mais qui n'est qu'une image muette de cette pensée féroce dont les sacrificateurs ou les bourreaux étaient les ministres... C'est donc malheureusement une vérité trop certaine que toutes les nations de la terre couvrent de morts, soit leurs champs de bataille, soit les théâtres de leurs cruautés, et que sur ces lacs de sang vous entendez planer des voix qui répandent le bruit de leurs actions triomphales, et qui crient : Victoire, gloire, liberté... sans laisser à l’oreille le temps de démêler le sens de toutes ces impostures. Devons-nous avoir une plus grande idée de ce nom de paix qui succède à toutes ces boucheries, et que les peuplent célèbrent avec tant d'exaltation, comme s'ils avaient vaincu leur vrai ennemi, qui est l'ignorance et l'illusion, tandis qu'avec le beau nom de paix et toutes les fêtes qui l'accompagnent, ils ne font tout au plus que mettre des entr'actes à leurs délires ?» [Idem, p.89-91]
Mais cet abus des noms, issu de l'abus des choses, n'en rend pas moins hommage aux principes violés. Dans ce mélange de crimes et d'absurdités, nous découvrons toujours que comme c'est une pensée religieuse qui est le noyau et le principe des associations humaines, c'est cette même pensée qui se montre à faux et en sens inverse dans tous leurs mouvements et dans toutes leurs révolutions ; en d'autres termes, toutes les sociétés continuent de reposer sur des pensées restauratrices et religieuses, puisque ces noms, mobiles de tant de [p.91] faits politiques, ne sont que l'expression défigurée et contournée de ces mêmes pensées.
Dans la main de l'homme dépravé, la marche de la société naturelle est devenue destructive de la nature, parce qu'il n'a cherché qu'à s'y passer de la sagesse et de la vertu; la marche de la société civile est devenue destructive de la justice, parce qu'il n'a cherché qu'à s'y passer de l'esprit de la loi, qui est le bonheur de tous; enfin la marche de la société politique est devenue destructive de la base elle-même ou de la Providence, parce qu'il n'a cherché qu'à s'y passer de ce seul principe de la force réelle et de l'efficacité de toute vraie puissance. Quelle que soit, en effet, la forme des gouvernements, « la Providence ne peut les faire prospérer qu'autant qu'ils sont vivifiés par la sagesse et son invariable raison; en un mot, qu'autant qu'ils ont véritablement l'esprit théocratique, non pas théocratique humain, pour ne pas dire théocratique infernal, mais théocratique divin, spirituel et naturel, c'est-à-dire reposant sur les lois de l'immuable vérité et sur les droits de ce fatalisme sacré qui unit Dieu et l'homme par une alliance indissoluble. » [Lettre a un ami, p.59]
Cette distinction entre le théocratique divin et le théocratique humain ou infernal est une de ces pensées sinistres qui donneraient au besoin la date de l'ouvrage, si elle venait à se perdre. Ces grandes vues sur le principe des sociétés humaines, ces réflexions sur la Révolution française, si profondes et si vraies, ce magnifique exposé des vraies doctrines sociales, où M. de Maistre a évidemment puisé ses immortelles Considérations et son Principe générateur des constitutions politiques ; - tant d'éloquents témoignages rendus à la vérité, Saint-Martin sent, pour ainsi dire, le besoin de les expier. Il s'empresse d'altérer tout cela par un mélange d'idées fausses et de sentiments coupables. Pour se faire pardonner les vérités qu'il a osé dire, comme il est généreux à lui de rivaliser avec les impies d'invectives et de haine contre le clergé qui confesse ces mêmes vérités par son sang ! C'est au moment où le bras de la Révolution est étendu sur les prêtres dépouillés, proscrits, égorgés, c'est au moment où de toutes parts le sang des martyrs crie, que lui, avec la passion d'un sectaire et la lâcheté d'un sophiste, se retournant contre les victimes, il leur impute l'athéisme des bourreaux ! Où trouver en effet une phrase plus insensée, plus abjecte que celle-ci :
« Le dessein de la Providence a été de nettoyer son aire avant d'y [p.92] apporter le bon grain.... Elle saura bien faire naître une religion du cœur de l'homme..... qui ne sera plus susceptible d'être infectée par le trafic du prêtre et par l'haleine de l'imposture, comme celle que nous venons de voir s'éclipser avec les ministres qui l'avait déshonorée : ces ministres qui, tandis qu'aucun gouvernement ne devrait marcher que sous l'égide de la prière, ont forcé le nôtre, pour sa sûreté, à rompre toute espèce de rapport avec cette prière, à la retrancher de lui tout entière, comme étant devenue pestilentielle, et à être ainsi le seul gouvernement de l'univers qui ne la compte plus parmi ses éléments; phénomène trop remarquable pour échapper aux observateurs instruits dans les lois de l'équilibre de la justice et des compensations divines » (Lettre à un ami sur la Révolution française, p. 78. Paris, an III).
On doit plaindre un esprit de cet ordre quand il consent à descendre si bas. Ce penseur original et profond, le voilà qui demande au protestantisme ses calomnies les plus banales et au style révolutionnaire ses expressions les plus néfastes pour relever de quelque nouveauté ces coupables lieux communs. Que reproche-t-il au clergé ? De substituer son règne au règne de Dieu, de vouloir être lui-même la Providence des peuples, de couvrir la terre de temples matériels, dont il se fait partout la principale idole, et de peupler ces temples de « toutes les images que son industrieuse cupidité peut inventer, » [Idem, p.78] égarant ainsi et tourmentant la prière au lieu de lui tracer un libre cours.
Et il ajoute : « Ils n'ont fait partout de leurs livres sacrés qu'un tarif d'exaction sur la foi des âmes; et ce rôle à la main, escortés par la terreur, ils venaient chez le simple, le timide ou l'ignorant, à qui ils ne laissaient pas même la faculté de lire sur le rôle sa quote de contribution de croyance en leur personne, de peur qu'il n'y vit la fraude. » [Idem, p.15] Il s'arrête, parce que ces tableaux répugnent trop à son cœur, et il lui suffit de montrer les prêtres comme les accapareurs des subsistances de l'âme. Voilà le dernier trait, et il ne songe pas un instant que ces tableaux, qui répugnent à son cœur, pourraient bien 'n'être qu'un mauvais rêve de sa raison.
C'est avec une surprenante facilité qu'il se paie d'un mot, d'une image, d'un pur jeu d'esprit pour conclure à un fait qui ne tarde pas à lui donner un principe. Il se souvient, par exemple, que quelquefois [p.93] il a comparé l'état politique de l'homme sur la terre à un édifice composé d'un souterrain, d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage. « J'ai vu, ajoute-t-il, que les gouvernements humains, soit sacerdotaux, soit séculiers, sous quelque forme qu'ils fussent, avaient précipité presque tous les peuples dans le souterrain. Or les Français, par l'effet naturel de leur révolution, sont sortis de ce souterrain et sont montés au rez-de-chaussée ; mais tant qu'ils n'auront pas monté jusqu'au premier, ils n'auront pas consolidé leur œuvre. » [Idem, p.74]
S'imagine-t-on que la mémoire d'un penseur garde cette longue fidélité à une comparaison si banale et si vague pour en tirer une vue si complétement insignifiante ? Il déclare d'un ton de voyant que presque tous les peuples ont été précipités dans le souterrain. Mais si quelques-uns plus heureux ont échappé à cette servitude et à ces ténèbres, que ne nous fait-il connaître le nom de ces rares privilégiés ? Que dis-je ? Ces gouvernants qui précipitent les gouvernés au fond du souterrain habitent-ils donc eux-mêmes, soit le rez-de-chaussée, soit le premier étage, s'il faut entendre par ces deux degrés divers une situation supérieure dans l'ordre intellectuel et moral ? Or, il est évident que montés à ce rez-de-chaussée ou à ce premier étage, selon le sens que Saint-Martin attache à ces expressions, ils n'auraient qu'une pensée et qu'un désir, la pensée et le désir d'élever les peuples jusqu'à leur bonheur, jusqu'à leurs lumières. S'il en est autrement, il faut donc reconnaître que les gouvernants mêmes sont beaucoup moins tyrans qu'esclaves, tendant les mains, comme les autres hommes, aux communes chaînes de l'ignorance et de l'erreur. Cette conséquence me semble rigoureuse ; elle ôte à la pensée de Saint-Martin le sérieux et la portée qu'elle affecte ; elle la réduit aux proportions d'un certain lieu commun qui traine volontiers dans les manuels de philosophie, où l'on ne cesse de mettre aux prises deux fantômes que l'on appelle l'autorité et la liberté, l'un aspirant à une éternelle tyrannie, l'autre s'agitant dans une éternelle révolte. Mais comme, en définitive, c'est à l'esprit humain qu'il faut s'en prendre et de cette tyrannie et de cet esclavage, comme c'est lui qui professe l'autorité, lui qui proclame la liberté, tout revient à dire que l'esprit humain opprime l'esprit humain, que l'esprit humain s'affranchit de l'esprit humain ; en d'autres termes, que l'esprit humain s'opprime lui-même et qu'il s'affranchit de lui-même. Tout se réduit donc à un non-sens. [p.94]
Que dire de ce rez-de-chaussée, que dire de ce premier étage qui permet, suivant Saint-Martin, de distinguer un plus grand espace et de mieux surveiller l'ennemi, c'est-à-dire l'auteur du mal ? N'est-ce pas se faire une étrange illusion que d'accorder aux révolutions politiques, et d'une manière si absolue, ces pieuses et mystiques conséquences ? N'est-ce pas excéder les limites permises de l'optimisme que de prêter aux faits purement temporels le pouvoir d'accroître les richesses spirituelles de l'homme ? Il est incontestable que les dogmes nécessaires à l'ordre de ce monde sont établis, et il n'est pas de raison suffisante pour concevoir l'introduction d'un dogme ou d'un principe nouveau. Toutes les vérités religieuses et morales que l'homme peut porter ont, surtout depuis dix-huit siècles, le degré d'évidence dont elles sont susceptibles sur la terre. Ces crises sanglantes où la justice divine éclate, tempérée par la clémence, les révolutions sont chargées d'appliquer à la propagation de ces vérités les crimes mêmes et les erreurs des hommes ; mais aucun événement humain ne saurait répandre un jour nouveau sur une vérité immuable, encore moins inaugurer une vérité supérieure ; aucun événement humain ne saurait communiquer aux âmes une impulsion de foi et d'amour qu'elle ne vienne de celui qui a réconcilié les pécheurs à son père. La nature du progrès qui nous a mis en possession du rez-de-chaussée me laisse de grands doutes sur la nouveauté des lumières et des vertus que nous offrira le premier étage.
Malheureusement, ces vues si hasardées, ces illusions du théosophe ne sont pas de simples caprices d'imagination ; elles tiennent à une erreur systématique. N'admettant pas que la vérité ait institué sur la terre une société dépositaire infaillible de ses enseignements et de son autorité, il regarde comme un progrès tout ce qui tend à supprimer entre l'homme et Dieu l'intermédiaire humain. Il applaudit donc à la dispersion du clergé, et ce grand désastre des âmes, il le salue comme un décret manifeste de la Providence qui prononce sans retour la déchéance du sacerdoce. C'est le rêve éternel des humanitaires, qui attendent toujours pour prier que la prière se passe de prêtre, d'autel et de paroles. L'homme égaré ne veut pas voir qu'il ne saurait faire l'ange sans se condamner à faire la bête.
Mais, par une contradiction inévitable, en excluant l'homme de l'administration des choses spirituelles, le principe d'indépendance y ramène l'individu. Ainsi, quand Saint-Martin proteste contre la [p.95] théocratie infernale, c'est-à-dire l'Eglise et son immuable autorité, et qu'il appelle de ses vœux et de ses espérances l'avènement de la théocratie divine, qu'est-ce à dire ? Pense-t-il que des anges vont se charger de réaliser sur la terre son utopie mystique ? Il faut après tout en venir à des hommes. Or, à défaut d'une société spirituelle visible, divinement instituée, divinement assistée jusqu'à la fin des temps, régulatrice infaillible et suprême des mouvements de l'humanité, faudra-t-il embrasser l'hypothèse de l'inspiration particulière, et croire à une délégation spéciale de toute puissance divine et humaine aux mains d'un visionnaire ou d'un hypocrite qui s'érige en juge ou en prophète de l'ancienne loi ? Saint-Martin ne détrônerait donc l'Eglise que pour s'incliner devant quelques hommes, ministres ou fléaux de la Providence, qu'il lui plaira d'investir de tous les droits qu'il refuse à l'Epouse de Jésus-Christ ? Mais ne voit-il pas qu'il aspire à la ruine d'une autorité certaine, définie, perpétuelle, pour n'élever à sa place qu'une autorité vague, capricieuse, intermittente ?
Etrange autorité qui, dans l'hypothèse la plus favorable, ne vivrait que sur la crédulité des gouvernés, dupes des gouvernants, et sur l'illusion des gouvernants, dupes d'eux-mêmes !
1848 - Correspondant (le) – T 21
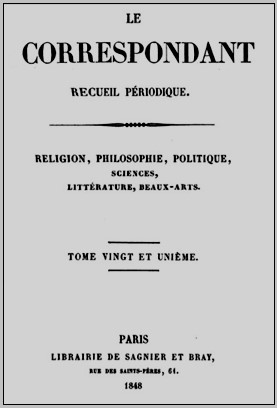 Le Correspondant, Recueil périodique
Le Correspondant, Recueil périodique
Religion, philosophie, politique, sciences, littérature, beaux-arts.
Paris. Librairie de Sagnier et Bray, rue des Saint Pères, 64
Tome vingt et unième
1848 - Le Correspondant – T 21
Examen des doctrines du Philosophe inconnu, Louis-Claude de Saint-Martin, Louis Moreau
4e article – De la théosophie – Pages 826-863
Les théosophes sont les gnostiques des temps modernes ; l'orgueil des prétentions et la stérilité de l’œuvre témoigneraient au besoin de l'identité des doctrines. Comme la gnose ancienne, affectant une égale supériorité et sur le philosophe et sur le fidèle, la théosophie abandonne à l'un les notions préliminaires sur l'existence de Dieu, la spiritualité de l'âme, la rémunération finale ; elle lui cède ces espaces déterminés que mesure avec effort le raisonnement humain. Accueillant le fidèle sous une autre forme de mépris, elle lui permet de s'attacher à la lettre d'une révélation positive, de ranger ses œuvres aux prescriptions des livres divins et à l'autorité des interprètes légitimes ; mais cette révélation n'est qu'un témoignage dont une science plus haute sait se passer ; mais ces livres divins ne sont que les fenêtres de la vérité, ils n'en sont pas la porte ; mais cette autorité spirituelle, bonne peut-être aux faibles et aux simples, ne saurait être [149] imposée à des intelligences qui puisent la science dans le sein de Dieu même. De ces hauteurs où elle habite, inaccessibles à la raison, inconnues à la foi, la théosophie abaisse à peine sur l'une et l'autre un regard de dédaigneuse tolérance ; elle se complaît en soi-même et revendique pour toutes les rêveries d'une imagination exaltée par l'orgueil, faussée par la solitude, le caractère et l'autorité de l'inspiration divine.
« Les théosophes, dit un ami de Saint-Martin, ont accru par leurs lumières surnaturelles le nombre des vérités éparses dans les systèmes des philosophes. (Œuvres posthumes, « Recherches sur la doctrine des théosophes », p.150)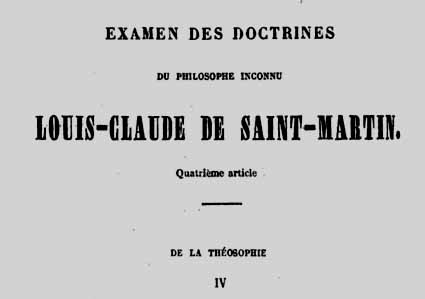
La théosophie, dit le même écrivain, a pris naissance avec l'homme, et il y a eu des théosophes dans tous les temps ; mais on peut les partager en deux classes : ceux qui sont venus avant Jésus-Christ et ceux qui ont paru depuis. Nous reconnaitrons les premiers parmi les philosophes qui ont eu le pressentiment des merveilles que le Réparateur universel est venu opérer sur la terre et dans les cieux. C'est Jésus-Christ qu'il faut reconnaître comme le père des lumières surnaturelles, le chef et le grand-prêtre des vrais théosophes comme des vrais chrétiens. C'est par lui qu'étaient inspirés Moise, David, Salomon, les prophètes, et, hors du peuple choisi, Phrérécide, Pythagore, Platon, Socrate... qui eux-mêmes avaient puisé leur doctrine chez les mages, les brahmes, les Egyptiens. L'on pourrait presque assurer que chaque peuple a eu ses théosophes et ses vrais philosophes. La vérité n'a donc jamais été bannie de dessus la terre, quoique ceux qui la promulguaient aient été si souvent tourmentés... [Ibidem, p.150-151]
Les apôtres, les premiers chrétiens, tous ceux qui ont marché sur leurs traces, et les différents théosophes qui ont paru depuis Jésus-Christ, ont encore reçu de plus grands développements des vérités-principes et des mystères divins » [Ibid., p.151-152].
La théosophie repose donc uniquement sur le dogme de l'inspiration individuelle : elle supprime entre l'homme et Dieu tout intermédiaire ; la confiance, surnaturellement éclairée, concentre et réfléchit toute lumière. Une commune négation de l'autorité rattache la théosophie au principe même du protestantisme ; comme lui elle récuse la souveraineté de l'Eglise ; mais elle se distingue de lui, elle se distingue du moins du protestantisme primitif, par le peu d'état qu'elle fait des monuments authentiques de la tradition. Elle les accepte , elle les consulte ; mais, suivant elle, « ils ne doivent pas être employés comme preuves démonstratives des vérités qui concernent la nature de l'homme et sa correspondance avec son principe ; car ces vérités subsistant par elles-mêmes, le témoignage des livres ne doit [[p.828] jamais leur servir que de confirmation » (Tableau naturel, t.II, p1). J'ai déjà répondu à cette négation erronée de la valeur du témoignage.
Le théosophe donc n'est ni catholique, car il ne relève que du bon plaisir de ses pensées qu'il prend pour des révélations ; ni protestant, car il subordonne à ses inspirations la parole de l'Ecriture (il est d'ailleurs beaucoup plus ancien que le protestantisme, qui n'était que d'hier et qui n'est déjà plus) ; ni philosophe, car il méprise les procédés ordinaires de la raison humaine. Qu'est-ce donc qu'un théosophe ? C'est un ami de Dieu, une espèce de prophète ou d'envoyé divin. La vérité n'est point représentée sur la terre par une autorité visible, permanente, infaillible, dépositaire immortelle d'un corps de doctrines invariables comme elle-même. Non ; elle n'a que des témoins passagers, fortuits, répandus çà et là dans tous les pays et dans tous les siècles. L'esprit souffle où il veut, et cet esprit, qui enseigne toute vérité, a parlé tour à tour par la bouche de Rosencranz, de Reuchlin, d'Agrippa, de Schwenkfeld, de Weigel, précurseur de Jacob Boehm, de Gichtel, de Saint-Martin. Il faut convenir que l'esprit de vérité aurait bien souvent caché la lumière sous le boisseau.
La théosophie nous apprend que plusieurs solitaires, même quelques mystiques, ont été « favorisés des dons de l'intelligence. » Dans l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ elle reconnaît le théosophe à ces paroles : « Il y a eu de saintes âmes qui ont plus profité en quittant tout pour l'amour de moi qu'elles n'auraient fait en s'appliquant pendant plusieurs années à la recherche des sciences les plus subtiles et les plus relevées ; mais je n'en use pas de même envers tous : je dis aux uns des choses communes, et j'en dis de plus particulières à d'autres. Il y en a à qui je me montre doucement sous des ombres et des figures, et il y en aussi à qui je découvre mes plus profonds mystères dans une pleine clarté » (Voici le texte même de l’Imitation : « Aliquibus in signis et figuris dulciter appareo ; quibusdam vero in multo lumine revelo mysteria. » Lib. III, cap. 43.)
La théosophie retrouve encore le don de l'intelligence dans le livre de la Sagesse, où se lisent les passages suivants : « La sagesse est un trésor pour les hommes, et ceux qui en ont usé sont devenus [p.829] les amis de Dieu et se sont rendus recommandables par les dons de la science. Elle est la vapeur de la vertu de Dieu et l'effusion toute pure de la vertu du Très-Haut. C'est pourquoi elle ne peut être susceptible de la moindre impureté, parce qu'elle est l'éclat de la lumière éternelle, le miroir sans tache de la majesté de Dieu et l'image de sa bonté. N'étant qu'une, elle peut tout ; et, toujours immuable en elle-même, elle renouvelle toutes choses : Elle se répand parmi les nations dans les âmes saintes et elle forme les amis de Dieu et les prophètes » (VII, 14, 25, 26, 27).
La théosophie reconnaît encore le sceau de l'inspiration dans ces fragments de Pythagore, qui était initié, comme chacun sait, aux mystères de la sagesse orientale.
« Toi qui veux être philosophe, tu te proposeras de dépouiller ton âme de tous les liens qui la contraignent ; sans ce premier soin, quelque usage que tu fasses de tes sens, tu ne sauras rien de vrai.
« Lorsque ton âme sera libre, tu t'élèveras de connaissances en connaissances, depuis les objets les plus communs jusqu'aux choses incorporelles et éternelles.
« La science des nombres est la plus belle des connaissances humaines ; celui qui la posséderait parfaitement posséderait le souverain bien.
« Les nombres sont ou intellectuels ou scientifiques.
« Le nombre intellectuel subsistait avant tout dans l'entendement divin : il est la base de l'ordre universel et le lien qui enchaîne les choses.
« Le nombre scientifique est la cause génératrice de la multiplicité, qui procède de l'unité et qui s'y résout.
« L'unité est le symbole de l'identité, de l'égalité, de l'existence, de la conservation et de l'harmonie générale.
« Le ternaire est le premier des impairs.
« Le quaternaire est le plus parfait des nombres pairs, la racine : des autres.
« La sagesse et la philosophie sont donc deux choses fort différentes.
« La sagesse est la science réelle. La science réelle est celle des choses immortelles, éternelles, efficientes par elles-mêmes. [p.830]
« La fin de la philosophie est d'élever l'âme vers le ciel, de connaître Dieu et de lui ressembler.
« Il est difficile d'entretenir le peuple de la Divinité. Il y a du danger : c'est un composé de préjugés et de superstitions. ».
Ainsi, la théosophie ne tend à rien moins qu'à s'attribuer un droit infaillible d'éclectisme sur toute[s] les doctrines, en s'appropriant celles que l'esprit lui désigne comme révélées. Elle se substitue naïvement à l'Eglise. Elle choisit en effet avec la même autorité qu'elle affirme ; mais ce choix, mais ce dogmatisme ne produisent qu'une science décousue et fantasque qui répugne à l'intelligence ; mais cette parole, qui affecte sans cesse le secret, est sans amour et sans sympathie ; mais cette autorité, qui s'impose, ne présente à la raison d'autre titre que son bon plaisir, d'autre moyen que l'anéantissement même de la raison. Un théosophe ne dit-il pas « Que le raisonnement et le savoir ont causé la chute de l'homme et qu'ils l'y entretiennent ? » Le premier raisonnement, suivant le même écrivain, eut le diable pour auteur (Muralt, Lettres fanatiques, t. I, lettre VII).
Etrange Eglise qui reconnaît pour ses Pères des hommes dont elle rassemble les noms au hasard, sans s'inquiéter s'ils s'accordent entre eux par l'idée, mais à la condition qu'ils soient fâcheux ou étrangers à l'Eglise catholique. Rosencranz, Reuchlin, Agrippa, Schwenkfeld, Bacon, Boehm, Gichtel, Leibniz, Antoinette Bourignon, Jane Leade, Pierre Poiret, Martinez Pasqualis, Saint-Martin, etc., vrais chrétiens que l'on glorifie d'avoir écrit contre les abus, rappelé aux peuples et aux ministres leurs devoirs mutuels, et ramené les esprits égarés à la pratique des vertus et à la véritable doctrine du Christ.
En vérité!... Ces hommes, ces femmes, étonnés, à coup sûr, du nœud qui les rassemble, c'est à eux que l'on doit l'accomplissement de cette œuvre de conciliation et de paix ? C'est Reuchlin, c'est Pic de la Mirandole, écrivains mystiques, confondus avec Bacon, le promoteur de la philosophie expérimentale ; c'est Pordage, c'est Jane Leade, c'est Antoinette Bourignon, c'est le rêveur Jacob Boehm, c'est Gichtel, son disciple, c'est Swedenborg, c'est, en un mot, cette troupe d'illuminés et de fanatiques auxquels on ose associer le nom à jamais révéré, le grand nom de Leibniz! Ces cœurs passionnés, ces [p.831] esprits sans mesure, ces âmes qui n'ont entre elles rien de commun que l'audace du délire et l'entêtement de l'illusion, voilà ceux que l'on appelle les apôtres et les témoins de la vérité ! voilà les sages et les vrais chrétiens auxquels la mission aurait été donnée de rappeler à l'unité les fidèles trompés par les ministres de l'Eglise catholique, quand eux-mêmes, étrangers l'un à l'autre, s'inquiètent si peu que tout se combatte dans leurs systèmes et jusque dans leurs rêves !
Veut-on savoir, par exemple, ce que Saint-Martin pense de Swedenborg :
« Mille preuves dans ses ouvrages qu'il a été souvent et grandement favorisé !mille preuves qu'il a été souvent et grandement trompé! mille preuves qu'il n'a vu que le milieu de l'œuvre et qu'il n'en a connu ni le commencement, ni la fin... En outre, quels sont les témoignages de Swedenborg ? Il n'offre pour preuve que ses visions et l'Ecriture sainte. Quel crédit ces deux témoins trouvent-ils auprès de l'homme qui n'est pas préparé par la raison saine ? » [LCSM, L’Homme de désir, chant 184, v.7]
Ainsi, de l'aveu de Saint-Martin, la mission de Swedenborg dans l'humanité est à peu près stérile. Les erreurs de ce voyant sont manifestes, ses enseignements sans preuve, ou du moins ne reposent que sur l'abus de l'Écriture sainte ou sur des visions purement imaginaires ; et, par une concession théosophique assez bizarre, Saint-Martin semble exiger la préparation d'une raison saine pour accepter de telles visions. Toutefois, s'il réduit à peu près Swedenborg à sa juste valeur, en revanche il demeure incessamment prosterné devant les lumières et le génie de Jacob Bœhm. Mais tous les théosophes ne partagent pas au même degré cet enthousiasme, qui, à la vérité, tient un peu de la manie. L'apologiste d'Antoinette Bourignon, Pierre Poiret, a exprimé sur le voyant de Gorlitz un jugement qui, à certains égards, mérite d'être connu.
« Plusieurs, dit-il, se prévalent des lumières de Jacob Bœhm sans les bien connaître, et, qui pis est, sans bien s'en servir. Il semble que, parce que cet auteur a écrit des choses sublimes, hautes, et d'une intelligence au delà du commun, que quelques-uns prennent sujet de là d'en mépriser les choses basses et simples, comme sont la doctrine de l'humilité, de l'amour de Dieu, du renoncement à soi-même, de la simplicité et bassesse de Jésus-Christ, qui sont la substance de l'Évangile,... et de la vérité nécessaire et salutaire. Jacob Bœhm a davantage recommandé ceci que ses plus sublimes [p.832] découvertes ; mais quelques-uns de ceux qui se veulent prévaloir de lui, au lieu de l'imiter en cela, n'en veulent qu'aux spéculations sublimes et mystiques, à la façon des Grecs et des sages, qui demandent après la science et la subtilité, tenant à mépris la simple et seule doctrine de Jésus-Christ crucifié, qui suffisait néanmoins à saint Paul. Les principes de Jacob Bœhm, tout divins qu'ils soient (comme je les crois en effet), ne sont pas des choses que Dieu exige des hommes pour qu'ils lui deviennent agréables et qu'ils fassent leur salut. Personne, sans doute, ne dira que pour être sauvé il soit nécessaire de connaître formellement ces trois principes et les sept formes de la nature, de la manière qu'il les propose : ce ne peuvent être tout au plus que des accessoires ou des nouveaux motifs pour nous animer au salut ; et non pas des choses nécessaires au salut même, non plus que n'est l'intelligence de l'Apocalypse, que Jacob Bœhm même n'a pas eue. Jésus-Christ ni les apôtres n'ont pas obligé les hommes à cela, et il ne se trouve pas que, lorsqu'ils étaient sur la terre, ils aient eu formellement ces connaissances-là. (Quoi ! pas même le Sauveur ? Il n'est donc qu'un homme ? Nous arrivons au socinianisme). L'auteur même ne les recommande jamais comme nécessaires ; mais bien la mortification et le renoncement à soi-même, l'abandon à Dieu, qui sont les voies seules et uniquement nécessaires à tous les hommes, aussi bien que proportionnées à la capacité de tous. Très peu de personnes pourraient se convertir s'il fallait le faire par la connaissance de Jacob Bœhm, que je ne crois pas que personne comprenne encore solidement et parfaitement, quelque pertinents discours qu'ils puissent en faire, parce que leur connaissance, comme celle des couleurs, ou des plaisirs, ou des passions, consiste dans une vive expérience et dans de très vifs sentiments de ces formes-là, qu'il exprime par les termes d'austère, d'amer, d'âcre, d'igné, de doux ou de lumineux, de suave ou d'éclatant, et semblables… Il y était lui-même si peu attaché qu'il dit d'avoir souvent prié Dieu avec larmes qu'il lui ôtât ces connaissances-là, parce que la grâce de Dieu lui suffisait. Il semble que Dieu les lui ait données, tant pour montrer par avance un échantillon des connaissances et des biens qu'il élargira un peu avant le renouvellement de la terre à ceux qui auront vaincu la corruption... que pour montrer aux savants qu'en vain ils [p.933] cherchent par des efforts hors de Dieu et de la renaissance les secrets de la nature ; et aussi pour servir de motifs à faire rechercher les choses célestes à ceux qui sont accoutumés de s'y prendre par la voie des connaissances et des spéculations extraordinaires et rares ; car Dieu fournit libéralement tous les moyens de retourner à lui, à un chacun selon sa disposition. Ainsi les connaissances particulières de cet auteur… sont des mets ou des viandes de haut goût, plus pour le plaisir de quelques estomacs de certaine constitution, ou pour les dégoûtés, que pour la nécessité absolue et la nourriture ordinaire ; mais ce serait bien une chose mal prise si quelqu'un de ceux qui seraient affriandés à des ragoûts particuliers voulait mépriser le lait, le pain, le vin et les viandes ordinaires et universelles, qui sont l'aliment commun de toutes sortes d'états, des enfants aussi bien que des adultes. Ce serait assurément faire mourir de faim plus de la moitié des hommes que de leur vouloir ôter ces dernières choses pour ne leur recommander que les premières. Il faut que le monde se nourrisse par cette voie commune, il n'y en a point d'autre » (Préface apologétique pour mademoiselle Antoinette Bourignon (par Poiret). Œuvres complètes d'Ant. Bourignon, t. 1, p. 84, 45. Amsterdam, Henry Wetstein, 1686, in-8°).
Ces paroles offrent çà et là quelques éclairs de bon sens ; mais le bon sens dans un théosophe n'est qu'une courte intermittence de délire. Poiret ne se montre un peu raisonnable dans son jugement sur Jacob Bœhm que pour se réserver le droit d'extravaguer sur Antoinette Bourignon. Voici quelques-unes des révélations dont, suivant lui, cette visionnaire aurait été favorisée.
« Elle a eu des lumières principales, dit-il, au delà de celles de Jacob Bœhm, lequel n'a pas connu si particulièrement ni la venue et le royaume de Jésus-Christ sur la terre, ni la manière dont Adam était formé avant son péché... Il n'a pas aussi su que le serpent, au lieu de la forme monstrueuse qu'il a présentement, avait alors celle du corps de l'homme, mais sans âme divine, justement comme les cartésiens supposent une machine du corps humain et qui en ait toutes les fonctions, sans avoir l’âme raisonnable et immortelle ; ce que Dieu avait fait comme pour servir de poupée au divertissement de l'homme, qui a encore retenu l’impression de celle sorte de récréation. [p.834] Il n'a pas enfin connu que Jésus-Christ subsistât, quant à sa nature humaine, corps et âme, avant la Vierge Marie, ni qu'il fût né d'Adam lors de l'état de sa gloire, comme l'Écriture rend tant de témoignages de ce mystère, qui est demeuré inconnu jusqu'à maintenant que Dieu l'a révélé à mademoiselle Bourignon. »
Le même Poiret met encore les révélations de la célèbre mystique anglaise Jane Leade au même rang que la vision d'Hermas ; mais l'éditeur de Jacob Bœhm, Jean-George Gichtel, prétend que les ouvrages de Jane Leade ne peuvent convenir qu'à des femmes qui suivent la même route, et dédaigne ses manifestations comme émanées d'une source plutôt astrale que divine. Ce vague de doctrines, ce perpétuel désaccord d'opinions, pour ne pas dire cette unanimité de dissentiments ; cette instabilité d'estime qui tour à tour approuve ou répudie ces mobiles témoins de la vérité ; ce contrôle incertain et contradictoire exercé sur l'inspiration même, qui théosophiquement est tenue d'être infaillible (et cependant contradictions inévitables, puisque le critérium de ces jugements n'est autre chose que le caprice du goût sensible sans intervention sérieuse de la raison), permettent-ils aux théosophes de se faire un mérite « s'ils ne font point secte , s'ils ne cherchent pas à se créer des prosélytes ? » Mais cette retenue, qui n'est que la conviction involontaire de l'impuissance, n'a rien qui nous doive édifier ou surprendre. Il faut au moins une erreur commune et une foi commune en cette erreur pour qu'une secte se fonde. Or, il n'y a pas même un seul esprit d'erreur au nom duquel trois théosophes se puissent réunir. La théosophie, comme l'imagination ou l'erreur, s'appelle aussi légion, légion indisciplinée et tumultueuse, où l'on est plusieurs sans cesser d'être solitaire.
Quelle peut être l'action de la théosophie ? religion sans confession de foi, science sans méthode ; et ce mot de méthode répugne même à l'objet de la théosophie. Tantôt elle croit pouvoir se soustraire aux nécessités laborieuses de la méditation et décliner la loi du travail à la sueur du front, revendiquant les jouissances faciles de la vérité, l'intuition ou la notion vive, sorte de quiétisme intellectuel qui prétend aux béatitudes de la pensée par l'anéantissement de l'intelligence. Ainsi, selon Paracelse, l'âme recueillie en elle-même reçoit passivement la vérité par l'illumination divine ; la prière en concentre les rayons au foyer d'un cœur pur. Tantôt c'est la voie de l'observation et du raisonnement qui cherche à s'établir sur ce terrain [p.835] mouvant de la fantaisie et de l'illusion. Rationaliste mystique, Saint-Martin applique les procédés rationnels à des arcanes bizarres, à des dogmes kabbalistiques, aux spéculations abstruses d'une gnose sans rapport avec la science humaine et complètement étrangère à l'ordre normal de nos connaissances.
« Ma tâche dans ce monde, dit-il, a été de conduire l'esprit de l'homme par une voie naturelle aux choses surnaturelles qui lui appartiennent de droit, mais dont il a perdu totalement l'idée, soit par sa dégradation, soit par l'instruction si souvent fausse de ses instituteurs. Cette tâche est neuve, mais elle est remplie de nombreux obstacles, et elle est si lente que ce ne sera qu'après ma mort qu'elle produira ses plus beaux fruits. » [Œuvres posthumes, 1807, p.137 ; Portrait, 1135].
Que veut-il dire ? Veut-il dire seulement que les vérités surnaturelles supérieures à la raison n'impliquent rien qui soit contradictoire à la raison ? S'il borne sa tâche à énoncer cette vérité, sa tâche sera plus utile que neuve. Il est toujours bon de reproduire la vérité, même la plus connue ; mais il ne faut pas s'imaginer que la voie où l'on s'engage soit si nouvelle quand on y trouve pour prédécesseurs la plupart des docteurs de l'Église, tous les théologiens, un grand nombre de philosophes, et en particulier l'immortel auteur de la Théodicée. Veut-il dire que la raison peut, par ses propres forces , atteindre à l'ordre surnaturel et y pénétrer ? Alors il dément sa foi à la Divinité et à la Parole de Celui qui a dit : « Je suis la voie, la vérité et la vie. » Car il est évident que; si la raison petit naturellement s'élever à la compréhension des mystères de Dieu, la parole du Réparateur est vaine et sa mission inutile. C'est en outre se résigner d'avance à se passer de résultats que d'essayer une solution rationnelle des mystères de la déchéance, de l'Incarnation et de la grâce. Tout ce que la raison peut faire en présence de ces vérités sublimes, c'est de leur chercher dans l’ordre naturel des analogies infiniment lointaines, des similitudes infiniment trompeuses, des correspondances infiniment obscures; et de se borner, si elle est sage, à trouver sa force dans la conscience même de son infirmité, sa lumière dans le discernement des ténèbres : Cum enim infirmor, tunc potens sum.(Cor., XII, 10).
Dans de fort belles pages sur le Mysticisme, (Revue des Deux-Mondes, 1845, t. XI, p. 470) M. Cousin a [p.836] supérieurement exposé comment la logique même avait dicté à la théodicée de l'école d’Alexandrie une psychologie toute particulière. La raison ni l’amour « ne pouvant atteindre l'absolue unité, l'Être en soi, l'Être indéterminé, l’Innombrable, [dans son ouvrage, Moreau corrige ce terme par innommable] ce Dieu des alexandrins, qui, considéré dans la pensée et dans l'être, devient inférieur à lui-même, » pour correspondre à un tel objet, il faut constater en nous un état analogue, un état qui nous affranchisse de cette double détermination, la connaissance et l'amour ; il faut en un mot que la conscience s'évanouisse dans l'EXTASE. Cette psychologie peut sembler extraordinaire ; elle est du moins parfaitement en rapport avec la métaphysique néoplatonicienne. L’extase est le lien de ce grand système mystique ; c'est la condition nécessaire des communications de l'homme avec l'Être infini, absolument un, absolument indéterminé.
Le mysticisme de Saint-Martin, mysticisme qui se fonde sur l'observation intérieure et le raisonnement, est beaucoup moins conséquent que celui de Plotin. L'âme humaine, profondément interrogée dans sa nature, dans ses désordres et dans ses souffrances, peut bien découvrir aux yeux de l'observateur les phénomènes variés de son activité, et soulever un coin du voile qui couvre son passé et ses destinées à venir; mais par quels degrés Saint-Martin l'élève-t-il jusqu'à recevoir ici-bas les communications supérieures, ou plutôt par quelle faculté d'intuition naturelle lui donne-t-il accès vers l'absolu ou l'infini ? Ou je m'abuse entièrement, ou cet état psychologique qui nous porte naturellement dans la région surnaturelle n'est signalé nulle part dans les écrits de Saint-Martin. Je lis cependant dans la notice de M. Gence : « Ici, c'est une porte plus élevée; ce n'est pas seulement la faculté affective, c'est la faculté intellectuelle qui connaît en elle son principe divin, et par lui le modèle de cette nature que Malebranche voyait non activement en lui-même, mais spéculativement en Dieu, et dont Saint-Martin découvre le type dans son être intérieur par une opération active et spirituelle qui est le germe de la connaissance. » [Jean Baptiste Modeste Gence, Notice biographique sur Louis-Claude de Saint Martin, ou Le philosophe inconnu Paris, 1824, p.18]
A travers la vague et l'obscurité de cette explication, le seul trait saisissable, et qui pourrait répondre à la question, au lieu de l'éclaircir la complique d'une difficulté nouvelle : « C'est la faculté intellectuelle qui connait en elle son principe divin. » Or, il ne s'agit pas ici de la notion de Dieu telle que l'âme peut la puiser naturellement dans le principe de causalité, per ea quæ conspiciuntur ; il s'agit [p.837] d'une connaissance directe, familière, intime ; de cette conversation spirituelle où il est permis à l'homme réconcilié de dire: Mon Père ! et d'entendre dire : Mon fils. Eh bien ! cette connaissance directe, cette communion mystique de l'âme avec son principe n'est pas un phénomène psychologique : l'observation ou l'analyse ne la donne pas à Saint-Martin. Ce fait a une origine plus haute et plus nouvelle ; il vient de la source même de la pensée et de la vie qui a épanché sur nous les eaux de sa grâce : c'est Dieu lui-même qui est venu nous initier à cette connaissance de Dieu. Mais pour que ce fait surnaturel et divin se produise en nous, il faut précisément commencer par admettre toutes les vérités dont Saint-Martin poursuit la recherche à la lueur imaginaire d'un flambeau qu'elles seules peuvent allumer ; car la conviction de ces vérités prépare l'intelligence au don de la foi ; la foi seule peut ouvrir l'oreille intérieure à la parole de vie. Si du moins, à l'exemple de l'école d'Alexandrie, le philosophe inconnu prenait pour point de départ une théodicée hardie, on concevrait à la rigueur que l'âme, emportée et tout à la fois éclairée par l'audace de la spéculation, pût se créer une faculté illusoire de communication avec Dieu et se faire une psychologie au désir de sa métaphysique. Mais la conscience humaine qui ne veut pas sortir de soi pour explorer les voies de la vérité ne peut découvrir en soi que soi-même, avec tous les faits de douleur et de corruption qu'elle renferme, avec ses doutes, ses erreurs et ses chancelantes lumières. Le soleil divin s'est retiré, emmenant la paix de la nature primitive; ce n'est donc que par une action surnaturelle qu'il reviendra visiter et recueillir les ruines de l'âme. La béatitude infinie de Dieu, l'infinie misère de l'homme, ce double abime se rit du mysticisme confiant qui prétend s'élever naturellement à l'ordre surnaturel. « Nul ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui le Fils daigne en révéler la connaissance » (Neque Patrem quis novit nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare. Matth., XI, 27). On ne parvient à la connaissance du principe que par le Dieu-homme, par le mystère de l'Incarnation et de la Rédemption. Car c'est une vérité de foi, et non pas un fait de conscience, que l'infini se soit abaissé jusqu'à nos ténèbres pour les éclairer, jusqu'à nos blessures pour les guérir, jusqu'à nos crimes pour les expier. L'immolation perpétuelle consommée par l'amour infini, qui [p.838] seule a rétabli le commerce d'amour entre l'homme et Dieu, est l'unique foyer des lumières surnaturelles. Jésus-Christ n'attend donc pas que l'on vienne à lui par la science, car ce n'est pas la science aride qui correspond à l'amour; ce n'est pas à la tête que s'adressent les élans du cœur. Et il n'est pas vrai toutefois qu'il se faille « casser la tête, » non plus qu'il ne se faut « casser le cœur » (« Ce n'est pas la tête qu'il faut se casser pour avancer dans la carrière de la vérité, c'est le cœur ». Portrait, 642). pour arriver à la vérité; ce n'est pas un cœur aveugle ni une intelligence obscurcie et brisée que l'amour demande. Non; mais il faut que dans une juste mesure l'intelligence aime, il faut que le cœur voie, et l'union de ces deux puissances de l'homme indivisible constitue le fait surnaturel que nous appelons la foi. La foi est un acte complet, car c'est tout ensemble un acte d'amour et un acte d'intelligence ; c'est un acte réparateur, car il rend à nos facultés de connaître et d'aimer leur antique élan vers la source de toute béatitude et de toute lumière ; c'est un acte déterminé, car Dieu fait homme est son objet (« La foi de l'homme, dit Swedenborg, ressemble au regard qui se perd dans les profondeurs du ciel ; mais le Dieu fait homme lui a donné des limites et un objet déterminé ».) ; c'est un acte infini, car Jésus-Christ est la vérité et la vie, Jésus-Christ est, selon le chant divin de l'Eglise, « la victime de salut qui nous ouvre la porte du ciel. » La prétention de correspondre directement avec Dieu, en s'affranchissant de cet acte éminemment mystique et éminemment raisonnable, est une conception de l'orgueil, payée d'ordinaire par l'illusion et l'impuissance. Le mysticisme rationnel ou gnostique répugne à la raison elle-même en lui demandant des résultats qu'elle ne peut lui donner ; il l'outrage en voulant, pour ainsi dire, lui arracher sa sanction à des excès qu'elle ignore et dont elle ne saurait être complice. Le mysticisme chrétien est le seul vrai; c'est le mysticisme de l'affection, c'est l'effusion des trésors du cœur. A ce mysticisme-là tout est permis ; il a l'immense liberté accordée à l'amour. Il est vrai, parce qu'il est humble; il est tranquille, parce qu'il se sait infaillible de toute l'infaillibilité de sa foi; il est fort, parce qu'il est tout l'homme intérieurement pacifié, le vivant hommage de sa volonté et de son intelligence réconciliées. « Je suis là où est ma pensée, dit admirablement [p.839] l'auteur de l'Imitation, et ma pensée est d'ordinaire où est ce que j'aime » (Imit., lib. III, cap. 48).
Ce mysticisme, qui, suivant les expressions de Gerson, « a pour but suprême le ravissement, non de l'imagination ou de la raison, mais de l'âme tout entière sortant d'elle-même pour se reposer en Dieu, unique objet de son amour, et pour s'unir à lui d'une union si étroite qu'elle ne fasse plus qu'un esprit avec lui ; » ce mysticisme, qui n'est que l'accomplissement littéral de ces paroles du Sauveur: « Je suis en eux et vous en moi, afin qu'ils soient consommés dans l'unité... » ce mysticisme, pratiqué par les saints et par tous les maîtres de la vie intérieure, ne doit rien et ne ressemble en rien à l'extase alexandrine et orientale, à laquelle il a été comparé. Il en est éloigné de toute la distance qui sépare la doctrine chrétienne du panthéisme indien et de l'hellénisme gnostique. L'union que la parole de Jésus-Christ nous donne en Dieu n'emporte pas, en effet, l'unification de la substance, mais l'unification de l'amour ; elle ne demande pas le renoncement extatique de la personne humaine au sein de l'absolu ; elle n'exige pas de l'être intelligent et moral qu'il sacrifie sa conscience et sa liberté pour s'anéantir dans cette sublime chimère de l'Être en soi ; elle ne présente pas à l'âme fidèle , comme terme suprême de la connaissance et de l'amour, l'évanouissement de toutes ses facultés et de toutes ses puissances dans l'abîme d'une Divinité impersonnelle, puisqu'au contraire, pour atteindre jusqu'à ce Dieu en trois personnes, jusqu'à «cette Trinité dont la communion fait le bonheur des Anges, » (Ad illam Trinitatem cujus et angeli participatione beati sunt. De Civit. Dei, lib. IX, 15) il faut passer par le Dieu-homme, unir sa volonté, son cœur, son esprit, à la volonté, au cœur, à l'esprit du céleste Epoux de toutes nos misères, embrasser cet Esclave médiateur qui élève l'esclave jusqu'à l'infini, humble « voie de la vie qui dans le ciel est la vie même. » (In forma servi ut mediator esset.., idem in inferioribus via vitæ, qui in superioribus vita. Ibid). C'est l'humanité de Jésus-Christ visiblement apparue dans le temps, authentiquement attestée par l'histoire, c'est la personne même de ce Dieu avec nous qui consacre le dévouement et la souffrance, c'est ce divin fondement de notre loi, de notre foi et de nos espérances, qui défend la piété chrétienne [p.840] de toute ressemblance avec l'ascétisme brahmanique et l'extase néoplatonicienne.
1. - Exposé du système métaphysique de Saint-Martin
[p.840] Il y a une loi pour tous les êtres : il doit y avoir une loi, et une loi évidente, pour l'homme. Cette loi assigne un but à son activité, et l'impuissance de ses efforts pour y atteindre ne prouve rien contre la réalité de ce but; elle ne prouve que l'erreur des voies où il s'engage. Le malheur de l'homme ici-bas n'est donc pas d'ignorer qu'il y a une vérité, mais de se méprendre sur la nature de cette vérité. Or, ce qui répand dans son intelligence la confusion et le trouble, c'est ce mélange de lumière et d'ombre, d'harmonie et de désordre, de bien et de mal, qu'il aperçoit dans l'univers et dans lui-même. Ainsi l'observation de la nature et de l'homme suggère l'idée de deux principes opposés. Toutefois cette notion, juste et vraie, est devenue une source d'erreurs graves. Les deux principes admis, on n'a plus su en reconnaitre la différence. Tantôt on les a élevés en un même rang de puissance, de grandeur et de durée ; tantôt on a placé le bien et le mal dans un seul et même principe ; enfin quelques-uns se sont efforcés de croire que tout marchait sans ordre et sans loi, et, ne pouvant expliquer le bien et le mal, ils ont pris le parti de nier l'un et l'autre. Quand on leur a demandé quelle était donc l'origine de tous ces préceptes universellement répandus sur la terre, de cette voix intérieure et uniforme qui force tous les peuples à les adopter, ces observateurs ont alors traité d'habitudes les sentiments les plus naturels ; ils ont attribué à l'organisation et à des lois mécaniques la pensée et toutes les facultés de l'homme (voir l’encadré) ; ils ont prétendu [p.841] qu'opprimé par la supériorité des éléments et des êtres dont il est entouré il avait imaginé qu'une certaine puissance indéfinissable gouvernait et bouleversait à son gré la nature. Et de là ces principes chimériques de subordination et d'ordre, de peines et de récompenses, perpétuées par l'éducation et l'exemple, sauf des différences considérables dues aux circonstances et aux climats.
|
Encadré (Note de L. Moreau) « L'auteur frénétique du Système de la Nature (d'Holbach) a vivement senti que le nombre des philosophes bien imbus de l'esprit de leur état était trop petit. Le peu d'espérance qu'il avait de vivre assez longtemps pour voir de ses yeux la bienheureuse révolution qui devait créer un nouveau monde a fait éclater son indignation contre la réserve et l'indolence de tous ces écrivains qui laissaient encore subsister des idées de Dieu et de la liberté de l'homme; et il a voulu, pour sa consolation, se repaitre en idée du spectacle qu'offrira la terre lorsque le vœu de la philosophie sera accompli. Il a salué de loin et du bord de son tombeau un univers délivré de son auteur et de ses maîtres, et tout le genre humain en possession des prérogatives dont jouissent les autres êtres vivants, sans Dieu, sans autels, sans culte, sans lois et sans tribunaux. Et afin que la génération présente pût goûter quelque chose de cette félicité trop reculée dans l'avenir et que les malheureux de tous les états se ressentissent du pouvoir de la philosophie pour béatifier le genre humain et rendre l'honneur et l'innocence à tout ce que des préjugés insensés appellent des crimes, ce profond interprète de la nature change tous les penchants que les illusions sociales attribuent à l'avilissement et à la dépravation du cœur en des impulsions organiques, en des modes physiques de constitution et de tempérament... Il met au rang des imbéciles et des dévots ceux qui, ayant rejeté la spiritualité et l'immortalité de l'âme, méconnaissant l'énergie de la nature, lui proposent un moteur mystérieux et théologique, et retiennent des idées de morale, de causes finales, de justice et de vertu. Enfin il démontre parfaitement qu'abandonner la foi, sans se faire athée est une inconséquence de la plus haute absurdité, et qu'il n'y a d'autre parti à prendre que de redevenir chrétien pour tout philosophe qui craint de le suivre dans l'essor de son audace ». Pensées sur la philosophie de l'incrédulité, par l'abbé Lamourette. Paris, in-8°, 1786, p. 96, 97, 99. |
C'est que l'on a voulu chercher la vérité dans les apparences de la nature matérielle, au lieu de descendre en soi-même ; c'est que l'on a voulu expliquer l'homme par les choses, et non les choses par l'homme.
Si, en effet, prenant pour point de départ l'observation intérieure qui lui découvre en même temps l'existence de deux principes, le bonheur et la paix avec l'un, le trouble et la fatigue avec l'autre, l'homme eût étendu cette observation à tous les êtres de l'univers, il eût pu fixer ses idées sur la nature du bien et du mal, et sur leur véritable origine.
Or le bien est, pour chaque être, l’accomplissement de sa propre [p.842] loi, et le mal ce qui s'y oppose. Chacun des êtres n'ayant qu'une seule loi, comme tenant tous à une loi première qui est une, le bien ou l'accomplissement de cette loi doit être unique aussi, quoiqu'il embrasse l'infinité des êtres. Au contraire, le mal ne peut avoir aucune convenance avec cette loi, puisqu'il la combat; dès lors il ne peut plus être compris dans l'unité, puisqu'il tend à la dégrader en voulant former une autre unité. Il est faux, puisqu'il ne peut pas exister seul; que, malgré lui, la loi des êtres existe en même temps que lui, et qu'il ne peut jamais la détruire, lors même qu'il en gêne ou qu'il en dérange l'accomplissement.
D'où se conclut cette différence infinie entre les deux principes : le bien tient de lui-même toute sa puissance et toute sa valeur ; le mal n'est rien quand le bien règne; le mal n'a par lui-même aucune force ni aucuns pouvoirs ; le bien en a d'universels qui sont indépendants et qui s'étendent jusque sur le mal même : d'où il suit, en un mot, qu'entre ces deux principes on ne saurait admettre aucune égalité de puissance et de durée.
Si la puissance et toutes les vertus forment l'essence du bon principe, il est évident que la sagesse et la justice en sont la règle et la loi ; d'où il suit que, si l'homme souffre, il doit avoir eu le pouvoir de ne pas souffrir.
Nos peines sont donc un témoignage de notre faute et par conséquent de notre liberté. Nous nous sommes volontairement écartés du bon principe pour nous livrer à l'action du mauvais. Mais ce mauvais principe, s'il s'oppose à l'accomplissement de la loi d'unité des êtres, il faut qu'il soit lui-même dans une situation désordonnée. Il souffre les mêmes souffrances qu'il répand autour de lui. Ses souffrances sont aussi un tribut qu'il paie à la justice et une preuve du dérèglement de sa volonté qui l'a rendu mauvais ; car s'il n'eût abusé primitivement de sa liberté, il ne se serait jamais séparé du bon principe, et le mal serait encore à naître. Le Mal n'est donc qu'un désordre primitif de la Volonté.
En descendant en nous-mêmes, nous sentons que c'est une des premières lois de la justice universelle qu'il y ait toujours un rapport exact entre la nature de la peine et celle du crime. Il est donc juste que l'auteur du mal soit abandonné à sa mauvaise volonté, c'est-à-dire à son impuissante contradiction aux plans de celui qui est à la fois la vérité et la puissance, en sorte qu'il trouve sa peine dans [p.843] l'exercice même de son crime, que ses ténèbres se multiplient par son obstination, et son obstination par ses ténèbres.
La loi de la justice s'exécute également sur l'homme. La durée de cette vie corporelle n'est guère qu'un temps de châtiment et d'expiation, qui implique sa déchéance d'un état antérieur de gloire et de félicité. Chacune de ses souffrances est un indice du bonheur qui lui manque ; chacune de ses privations prouve qu'il était fait pour la jouissance ; chacun de ses assujettissements lui annonce une ancienne autorité...... Mais la justice, qui atteint l'homme dans tout son être, a été tempérée par la miséricorde. Il peut, malgré sa condamnation, se réconcilier avec la vérité, et en goûter de temps en temps les douceurs, comme si, en quelque sorte, il n'en était pas séparé.
Toutefois, ces secours accordés à l'homme pour sa réhabilitation tiennent à des conditions très rigoureuses. Assujetti par son crime à la loi du temps, il ne peut éviter d'en subir les pénibles effets. Les premiers pas qu'il fait dans la vie annoncent qu'il n'y vient que pour souffrir, et qu'il est vraiment le fils du crime et de la douleur. Ce corps matériel dont il est revêtu est l'organe de sa souffrance, l'obstacle à toutes ses facultés, l'instrument de toutes ses privations. La jonction de l'homme à cette grossière enveloppe est la peine même à laquelle son crime l'a assujetti temporellement (Manichéisme). Et cependant, malgré les ténèbres qu'elle répand sur notre intelligence, cette enveloppe est aussi le canal par où arrivent dans l'homme les connaissances et les lumières de la vérité.
Mais de ce que les sens ont aujourd'hui un rôle si important dans les relations de l'homme avec la vérité, quelques-uns ont prétendu qu'il n'y a pour lui d'autres lois que celles de ses sens et qu'il ne peut avoir d'autres guides. Tel est l'humiliant système des sensations, qui ravale l'homme au-dessous de la bête, puisque celle-ci, ne recevant jamais qu'une seule sorte d'impulsion, n'est pas susceptible de s'égarer, au lieu que l'homme, étant placé au milieu des contradictions, pourrait, selon cette opinion, se livrer indifféremment à toutes les impressions dont il serait affecté..
Mais si l'on réduit l'homme à n'être qu'une machine, encore faudrait-il reconnaître qu'il est une machine active, c'est-à-dire [p.844] ayant en elle-même son principe d'action ; car, si elle était purement passive, elle recevrait tout et ne rendrait rien. Alors, dès qu'elle manifeste quelque activité, il faut qu'elle ait au moins en elle le pouvoir de faire cette manifestation ; et sans ce pouvoir inné dans l'homme, il lui serait impossible d'acquérir ni de conserver la science d'aucune chose. Il est donc clair que l'homme porte en lui la semence de la lumière et des vérités dont il offre si souvent les témoignages.
Il y a des êtres qui ne sont qu'intelligents, il y en a qui ne sont que sensibles ; l'homme est à la fois l'un et l'autre. Ces différentes classes d'êtres ont chacune un principe d'action différent ; l'homme seul les réunit tous deux.
Si l'homme actuel n'avait que des sens, ainsi que les systèmes humains le voudraient établir, on verrait toujours le même caractère dans toutes ses actions, et ce serait celui de ses sens. Comme la bête, toutes les fois qu'il serait excité par ses besoins corporels, il tendrait à les satisfaire, sans jamais résister à aucune de leurs impulsions. Pourquoi donc l'homme peut-il s'écarter de la loi des sens ? Pourquoi peut-il se refuser à ce qu'ils lui demandent ? Pourquoi y a-t-il dans l'homme une volonté qu'il peut mettre en opposition avec ses sens, s'il n'y a pas en lui plus d'un être ?
Or, de même qu'entre l'animal et les êtres inférieurs il y a une différence considérable dans les Principes, quoiqu'ils aient les uns et les autres la faculté végétative, de même l'homme a de commun avec l'animal un Principe actif, susceptible d'affections corporelles et sensibles, mais il est essentiellement distingué par son principe intellectuel, qui anéantit toute comparaison entre lui et la bête.
Car, bien que la loi d'un Principe inné à tous les êtres soit unique et universelle, il faut se garder de dire que ces Principes soient égaux et agissent uniformément dans tous les êtres (Monadologie). L'observation découvre entre eux une différence essentielle, et surtout entre les Principes innés dans les trois règnes matériels et le Principe sacré dont l'homme seul est favorisé.
Les auteurs des systèmes injurieux à l'homme n'ont pas su distinguer la nature de nos affections. D'un côté ils ont attribué à notre être intellectuel les mouvements de l'être sensible, et de l'autre ils [p.845] ont confondu les actes de l'intelligence avec des impulsions matérielles, bornées dans leurs principes comme dans leurs effets. Loin d'éclairer l'homme sur le bien et sur le mal, ils le tiennent dans le doute et dans l'ignorance sur sa propre nature, puisqu'ils suppriment les seules distinctions qui pourraient l'en instruire.
Le principal objet de l'homme devrait donc être d'observer continuellement la différence infinie qui se trouve entre ses deux facultés sensible et intellectuelle, et entre les affections qui leur sont propres. Car, dans l'union intime de ces deux facultés, si l'homme cesse de veiller un instant; il ne démêlera plus ses deux natures, et dès-lors il ne saura où trouver les témoignages de l'ordre et du vrai.
«L'usage continuel, dit Saint-Martin, que je fais des mots facultés, actions, causes, principes, agents, propriétés, vertus, réveillera sans doute le mépris et le dédain de mon siècle pour les qualités occultes. Cependant il serait injuste de donner ce nom à cette doctrine uniquement parce qu'elle n'offre rien aux sens. Ce qui est occulte pour les yeux du corps, c'est ce qu'ils ne voient point ; ce qui est occulte pour l'intelligence, c'est ce qu'elle ne conçoit point : or, dans ce sens, je demande s'il est quelque chose de plus occulte pour les yeux et pour l'intelligence que les notions généralement reçues sur tous les objets que je viens d'annoncer ? Elles expliquent la matière par la matière, elles expliquent l'homme par les sens, elles expliquent l'Auteur des choses par la nature élémentaire. » (Erreurs et Vérité, p. 70).
2. - Chute de l’homme
[p.845] L'homme se flatta de trouver la lumière ailleurs que dans l'Être qui en est le sanctuaire et le foyer; il crut pouvoir obtenir la lumière par une autre voie qu'elle-même; il crut enfin que des facultés réelles, fixes et positives, pouvaient se rencontrer dans deux êtres à la fois. Il cessa d'attacher la vue sur celui en qui elles vivaient dans toute leur force et dans tout leur éclat, pour la porter sur un autre être dont il osa croire qu'il recevrait les mêmes secours.
Cette erreur, ou plutôt ce crime insensé, au lieu d'assurer à l'homme le séjour de la paix et de la lumière, le précipita dans l'abime de la confusion et des ténèbres, et cela sans qu'il fût nécessaire [p.846] que le principe éternel de sa vie fît le moindre usage de sa puissance pour ajouter à ce désastre. Etant la félicité par essence et l'unique source du bonheur de tous les êtres, il agirait contre sa propre loi s'il les éloignait d'un état propre à les rendre heureux.
Cessant donc de lire dans la vérité, l'homme ne put trouver autour de lui que l'incertitude et l'erreur. Abandonnant le séjour unique de ce qui est fixe et réel, il dut entrer dans une région nouvelle, et, par ses illusions et son néant, tout opposée à celle qu'il venait de quitter. Il fallut que cette région nouvelle, par la multiplicité de ses lois et de ses actions, lui montrât en apparence une autre unité que celle de l'Être simple et d'autres vérités que la sienne. Enfin il fallut que le nouvel appui sur lequel il s'était reposé lui présentât un tableau fictif de toutes les facultés, de toutes les propriétés de cet être simple, et cependant qu'il n'en eût aucune. L'homme ne voit plus rien de simple ; il n'a que des yeux matériels pour apercevoir des objets matériels, qui représentent, il est vrai, chacun l'unité, mais par des images fausses et défectueuses. Il est réduit à ne saisir que des unités apparentes ; il ne peut connaître que des poids, des mesures et des nombres relatifs, attendu qu'il s'est exilé du séjour de tout ce qui est fixe.
Cependant ces objets sensibles, bien qu'apparents et nuls pour l'esprit de l'homme, ont une réalité analogue à son être sensible et matériel. Mais cela n'est vrai que pour les corps. Ici Saint-Martin se rapproche à son insu du point de vue de Leibniz et de l'harmonie préétablie. Toutes les actions matérielles, n'opérant rien d'analogue à la véritable nature de l'homme, sont en quelque sorte ou peuvent être étrangères pour lui; car la matière est vraie pour la matière, et ne le sera jamais pour l'esprit. D'où l'on voit « comment doit s'apprécier ce que l'on appelle la mort, et quelle impression elle peut produire sur l'homme sensé qui ne s'est pas identifié avec les illusions de ces substances corruptibles. En effet, le corps de l'homme, quoique vrai pour les autres corps, n'a, comme eux, aucune réalité pour l'intelligence, et à peine doit-elle s'apercevoir qu'elle s'en sépare. Et tout nous annonce qu'elle doit gagner alors au lieu de perdre ; car, avec un peu d'attention, nous ne pouvons que nous pénétrer de respect pour ceux que leur loi délivre de ces entraves corporelles, puisqu'alors il y a une illusion de moins entre eux et le vrai. A défaut de cette utile réflexion, les hommes croient que c'est [p.847] la mort qui les effraie, tandis que ce n'est point d'elle, mais de la vie, qu'ils ont peur. » (Tableau naturel, p. 83-84, passim. — Voir aussi Abbadie, l'Art de se connoître soy-même, chap. VIII et IX. Rotterdam, 1693).
3. - Misère de l’homme
[p.847] « La douleur, l'ignorance, la crainte, voilà ce que nous rencontrons à tous les pas dans notre ténébreuse enceinte, voilà quels sont tous les points du cercle étroit dans lequel une force que nous ne pouvons vaincre nous tient renfermés... Tous les éléments sont déchaînés contre nous. A peine ont-ils produit notre forme corporelle qu'ils travaillent à la dissoudre, en rappelant continuellement à eux les principes de vie qu'ils nous ont donnés. Nous n'existons que pour nous défendre contre leurs assauts, et nous sommes comme des infirmes abandonnés et réduits à panser continuellement nos blessures. Que sont nos édifices, nos vêtements, nos serviteurs, nos aliments., sinon autant d'indices de notre faiblesse et de notre impuissance ? (Saint Augustin dit: « Reficimus quotidianas ruinas corporis edendo et bibendo.... » Confess., X, 31). Enfin, il n'y a pour nos corps que deux états : le dépérissement ou la mort ; s'ils ne s'altèrent, ils sont dans le néant. De tous les hommes qui ont été appelés à la vie corporelle, les uns errent comme des spectres sur cette surface, pour y être sans cesse livrés à des besoins, à des infirmités; les autres n'y sont déjà plus : ils ont été, comme le seront leurs descendants, entraînés dans le torrent des siècles; leurs sédiments amoncelés formant aujourd'hui le sol de presque toute la terre, l'on n'y peut faire un pas sans fouler aux pieds les humiliants vestiges de leur destruction. L'homme est donc ici-bas semblable à ces criminels que, chez quelques nations, la loi faisait attacher vivants à des cadavres. Portons-nous les yeux sur l'homme invisible: incertains sur les temps qui ont précédé notre être, sur ceux qui le doivent suivre et sur notre être lui-même, tant que nous n'en sentons pas les rapports, nous errons au milieu d'un sombre désert dont l'entrée et l'issue semblent également fuir devant nous. Si des éclairs brillants et passagers sillonnent quelquefois dans nos ténèbres, ils ne font que nous les rendre plus affreuses ou nous avilir davantage, en nous laissant apercevoir ce que nous avons perdu; et encore, s'ils y pénètrent, ce n'est qu'environné [p.848] de vapeurs nébuleuses et incertaines, parce que nos sens n'en pourraient soutenir l'éclat s'ils se montraient à découvert. Enfin, l'homme est, par rapport aux impressions de la vie supérieure, comme le ver, qui ne peut soutenir l'air de notre atmosphère... Ce lieu serait-il donc en effet le véritable séjour de l'homme, de cet être qui correspond au centre de toutes les sciences et de toutes les félicités ? Celui qui, par ses pensées, par ces actes sublimes qui émanent de lui, et par les proportions de sa force corporelle, s'annonce comme le représentant du Dieu vivant, serait-il à sa place dans un lieu qui n'est couvert que de lépreux et de cadavres ; dans un lieu que l'ignorance et la nuit seules peuvent habiter; enfin, dans un lieu où ce malheureux homme ne trouve pas même où reposer sa tête ? Non. Dans l'état actuel de l'homme, les plus vils insectes sont au-dessus de lui. Ils tiennent au moins leur rang dans l'harmonie de la nature, ils s'y trouvent à leur place, et l'homme n'est point à la sienne. Il est attaché sur la terre comme Prométhée, pour y être comme lui déchiré par le vautour. Sa paix même n'est pas une jouissance : ce n'est qu'un intervalle entre des tortures ..» (Tableau naturel, t. 1er, p. 89, 90, 92). — « Cependant on a voulu nous persuader que nous étions heureux, comme si l'on pouvait anéantir cette vérité universelle : QU'IL N'Y A DE BONHEUR POUR UN ÊTRE QU'AUTANT QU'IL EST DANS SA LOI. »
Cette vérité, qui d'ailleurs est toute la tradition et tout le Christianisme, je la trouve exprimée par saint Augustin avec plus de force et de profondeur quand il dit : « Vous avez ordonné, et il est ainsi, que tout esprit qui n'est point dans l'ordre soit sa peine à lui-même : JUSSISTI ENIM, ET SIC EST, UT POENA SUA SIBI SIT OMNIS INORDINATUS ANIMUS. » (Confess., I, 12. L'abbé de la Trappe (M. de Rancé) proclame aussi cette loi quand il dit : « Les choses sont en repos lorsqu'elles sont dans leur place et dans leur situation naturelle; celle de notre cœur est le cœur de Dieu, et lorsque nous sommes dans sa main, et que notre volonté est soumise à la sienne, il faut par nécessité que nos inquiétudes cessent, que ses agitations soient fixées, et qu'elle se trouve dans une paix entière et dans une tranquillité parfaite. »).
J'ai cité textuellement ces plaintes éloquentes de Saint-Martin sur la déchéance et la misère de l'homme, parce que le dogme de la chute est le point de départ de son système théosophique, et qu'en [p.849] outre il m'a paru intéressant de reproduire ces aveux partis de la conscience d'un philosophe et d'un homme du monde au milieu d'un siècle qui a poussé jusqu'au délire l'orgueil de la vie.
VI - Vue de la nature des choses ; esprit des choses
[p.849] Les théosophes, suivant la déclaration expresse de l'un d'eux, admettent la Trinité, la chute des anges rebelles, la création après le chaos causé par leur chute, la création de l'homme dans les trois principes, pour gouverner, combattre ou ramener à résipiscence les anges déchus. Les théosophes sont d'accord sur la première tentation de l'homme, le sommeil qui la suivit, la création de la femme lorsque Dieu eut reconnu que l'homme ne pouvait plus engendrer spirituellement; la tentation de la femme, la suite de sa désobéissance qui occasionna celle de son mari ; la promesse de Dieu que de la femme naîtrait le briseur de la tête du serpent, la Rédemption, la fin du monde.
C'est, on le voit, l'enchaînement des grands faits de la tradition altéré par le mélange des idées gnostiques associées aux deux principales erreurs d'Origène sur la préexistence des âmes et sur la résipiscence des anges déchus. Les articles de ce symbole théosophique sont pour la plupart professés par Saint-Martin ; mais ce qu'il expose surtout avec des développements inépuisables, c'est la chute de l'homme, sa misère, sa privation, ses ténèbres, sa séparation des vertus intellectuelles, son asservissement aux vertus sensibles, tous les désordres de cet univers « écroulé sur l'être puissant qui devait l'administrer et le soutenir. »
Le point de vue sous lequel il envisage le crime primitif et ses suites, par rapport à l'homme et par rapport à la nature, est tout à fait entaché de manichéisme. Ainsi la nature, s'il faut l'en croire, est faite à regret. Elle semble occupée sans cesse à retirer à elle les êtres qu'elle a produits. Elle les retire même avec violence, pour nous apprendre que c’est la violence qui l’a fait naître (Pensées extraites d’un manuscrit de Saint-Martin, n°16). Cette nature n’est-elle pas la hyle, la matière manichéenne, substance mauvaise, région du mal et de la discorde ? Le manichéisme est encore tout entier dans [p.850] cette proposition étrange : La nature a pour objet de servir d'absorbant et de prison à l'iniquité.
« Observe, dit-il , la nature elle-même, et tu verras, par l'infection, qui est le résidu final de tous les corps, quel est l'objet de l'existence de ces mêmes corps, et s'ils ne sont pas destinés à servir d'enveloppe et de barrière à la putréfaction, puisque cette putréfaction est leur base fondamentale comme elle est leur terme... Enfin, ajoute-t-il, observe les propriétés de ton propre corps relativement à son être moral. Compare l'impétuosité de tes désirs désordonnés et injustes avec la lenteur des moyens que ton corps te laisse pour accomplir tes projets de vengeance criminelle, tes meurtres et tous les plans de ta désastreuse ambition, et tu verras par là si réellement ton corps n'est pas destiné à réprimer le mal moral qui est en toi, et à contenir l'iniquité qui germe et végète en toi. » (Esprit des choses, t. 1er, p. 132).
A moins d'admettre l'hypothèse des générations spontanées et de reconnaître à la corruption la puissance créatrice, il est difficile de prêter à ces paroles un sens vraiment raisonnable. La logique la plus vulgaire n'est-elle pas intéressée à savoir comment la corruption ou putréfaction peut être à la fois la base et le terme de ces corps destinés précisément à servir d'enveloppe et de barrière à la putréfaction ? Ces corps putréfiables ou corruptibles seront donc à eux-mêmes leur propre enveloppe et leur propre barrière ? La corruption fait donc la guerre à la corruption ? Elle se combat donc elle-même ? Ou bien faut-il distinguer une corruption mauvaise qui s'attache au bien, et une corruption bonne qui s'attache au mal ? Qu'est-ce à dire ? La corruption est donc une substance, pour être déterminée soit au bien, soit au mal ? C'est là évidemment une conception manichéenne, et cette conception, appliquée à l'ordre moral, n'est pas moins irrationnelle et insoutenable ; car s'il est vrai que les désirs coupables, les dérèglements impétueux de la volonté trouvent dans la lenteur des organes physiques un heureux obstacle à de funestes accomplissements, il est également vrai que ces mêmes désirs, ces instincts violents et grossiers ont une base dans les révoltes de la chair et du sang : Infelix ego homo! quis me liberabit de corpore mortis hujus ? Et si l'homme du péché murmure contre ce corps qui comprime son activité malfaisante, l'homme renouvelé ne [p.851] gémit-il pas de cette chaîne corporelle qui retarde l'élan de son esprit vers la lumière et la liberté ? (« Tu, quos molesti corporis / Gravis retardat sarcina, / Fac mentis alis libero / Sursum volatu tendere » Hymne pendant le Carême). Que peut-on conclure de là, sinon l'indifférence de la matière au bien et au mal moral, et la légèreté de la preuve dont Saint-Martin prétend autoriser une opinion assez étrange dans un spiritualiste si raffiné ? Car, enfin, est-ce bien sérieusement qu'on attribue au corps, à la nature, une force répressive du mal ? Le mal véritable, le mal de coulpe n'est que le dérèglement d'un esprit, la révolte ou la défaillance d'une volonté. A moins de faire résider le mal dans l'acte, et non dans l'intention, la plus imperceptible volonté triomphe de toutes les forces de la nature. Le non-moi peut faire obstacle à l'action, mais que peut-il contre un désir ? Si, comme il n'en faut pas douter, le désordre physique a sa cause dans un désordre moral, c'est l'âme pacifiée qui rendra la paix à la nature. Qui sait quelle réparation pourrait réaliser dans le monde sensible le parfait amendement de l'homme moral ? Et Dieu, qui désire le retour de sa créature à la justice, l'aurait-il donc enfermée dans un corps comme dans une prison, semblable aux faibles autorités humaines qui n'enchaînent l'homme nuisible à l'homme que parce que l'homme intérieur leur échappe, n'ignorant pas toutefois ce que, dans l'hypothèse, eût ignoré le Dieu des âmes : c'est que l'on n'emprisonne pas une volonté ? Cette hypothèse, puérile et misérable, amène assez logiquement comme conséquence la définition suivante de la chute. « Elle consiste, dit-il, en ce qu’elle nous a soumis au règne élémentaire, et par conséquent au règne astral ou sidérique qui en est le pivot. Elle consiste en ce que nous sommes tombés au- dessous du firmament, tandis que par notre nature nous devions être au-dessus » (Esprit des choses, t. 1er, p. 190). Je le demande, est-ce à une chute de cœur, d'intelligence et de volonté, ou bien à une chute d'espace et de corps, que ces paroles semblent convenir ?
En vingt endroits de ses écrits Saint-Martin présente l'incorporation, ou plutôt, suivant la langue théosophique, la corporisation de l'homme, comme une déchéance et comme un châtiment. Renouvelant [p.852] l'hérésie condamnée par le concile général IVe de Latran, il attribue au péché la cessation de l'antique hermaphrodisme, la création de la femme et le mode actuel de génération (« Si homo non peccasset, in duplicem sexum partitus non fuisset, nec generatus, sed eo modo quo angeli sancti multiplicati fuissent homines. » Telle est la proposition d'Amaury, condamnée par le concile). Dans l'état d'innocence, l'homme eût engendré spirituellement. Toutes ces opinions, posées avec assurance, mais destituées de preuves (Suivant Saint-Martin, pour apercevoir des témoignages physiques de l'hermaphrodisme primitif, il suffit de considérer les seins de l'homme, etc. Ce genre de preuves est à tout le moins bizarre.) et enveloppées d'une obscurité qui vainement aspire à la profondeur, renferment en outre une contradiction choquante. Que pourraient-elles répondre à cette objection :
L'homme était-il déjà coupable antérieurement à l'origine de la femme ? Il faut le croire, puisqu'il était uni à des organes et que cette union est une peine et le témoignage d'une faute. Le théosophe n'a-t-il pas expressément déclaré que la matière est la prison et l'absorbant de l'iniquité ? Si l'homme était déchu, comment pouvait-il exercer cette sublime fonction d'engendrer spirituellement ? Et que faut-il entendre par cet engendrement spirituel ? Est-ce une délégation de la toute-puissance, la faculté de donner la vie par un acte pur de sagesse et de volonté? Est-ce l'accomplissement solitaire de l'œuvre génératrice, dans un parfait détachement de la chair et des sens ? Comment concilier l'une ou l'autre de ces hypothèses avec le péché et la déchéance de l'homme ? Quoi ! malgré son péché, l'homme partage encore avec Dieu l'auguste privilège de créer ? Quoi ! malgré sa chute, il ne connait pas la honte de la concupiscence ? Il demeure spirituel dans sa chair, étant devenu charnel dans son esprit ?
Saint-Martin prétend trouver dans le moi intime de l'homme une image de cet hermaphrodisme primitif. « Ne voyons-nous pas, dit-il, que notre esprit porte encore, comme Dieu, son enveloppe ou sa terre avec lui-même ? Si nous nous sondons profondément et jusqu'à notre centre, nous trouverons encore en nous un terrain capable de recevoir nos propres pensées et où nous pourrons les faire germer, sans les déposer dans des matras étrangers, comme nous y sommes obligés pour notre génération animale. On voit ici pourquoi nous [p.853] devons tant surveiller la distribution de nos pensées, pour ne les pas semer hors de nous dans des terrains qui ne seraient pas analogues, pour ne les placer que dans des matras qui soient animés du même esprit.... » Tout cela est plein d'erreurs et de ténèbres. Ces expressions plus bizarres que hardies, plus fausses que bizarres, telles que l'enveloppe ou la terre de l'esprit, que l'esprit porte avec soi comme Dieu même, et ce terrain capable de recevoir nos pensées, etc., ne donnent pas la moindre lumière sur les procédés générateurs de nos pensées. Sans doute que, pour produire au dehors ses conceptions mentales, l'homme-esprit n'a pas besoin, comme l'homme-animal, du concours extérieur d'un autre lui-même; mais s'ensuit-il que ces conceptions naissent en lui par une action solitaire, tout à la fois puissante et féconde, et que leur être ne doive rien à la vie intellectuelle qui circule partout ? s'ensuit-il qu'une pensée qui éclot, au moment où je parle, avec tous les dehors de la spontanéité la plus vive, n'ait pas dès longtemps pour auteur une parole inaperçue qui a porté son fruit dans le silence, une parole qui pour se reproduire a peut-être percé la cendre de vingt siècles? Prolem sine matre creatam n'est pas plus applicable au monde moral qu'au monde physique, et quand, d'ailleurs, Saint-Martin établit la nécessité d'une surveillance rigoureuse sur la distribution de nos pensées, ce qui implique évidemment la loi de génération et de solidarité qui les gouverne, n'infirme-t-il pas lui-même son opinion de l'hermaphrodisme spirituel de l'homme ?
Ce que l'on ne saurait trop reprocher à Saint-Martin, c'est cette fâcheuse habitude d'esprit qui le conduit presque toujours à prendre un aperçu hasardé pour un principe, une simple allégorie pour une preuve : de l'hypothèse il conclut le fait, et de l'imagination, la science. J'admire avec quelle confiance, partant de données contestables, arbitraires ou chimériques, il arrive aux résultats les plus extraordinaires. Ainsi ses opinions sur la matière, sur la chute et la corporisation de l'homme, trouvent dans la danse un argument fort singulier, mais dont la valeur ne lui paraît pas douteuse.
« Si la danse, dit-il, peint les élans que l'homme se donne pour atteindre à la région de la liberté, le poids qui le fait retomber vers la terre peint la loi terrible de la région inférieure et matérielle qui le retient et le force à subir le joug de cette prison dans laquelle on ne lui permet de respirer l'air libre que par de légers intervalles. [p.854] Ainsi, dans ses récréations mêmes, l'homme trouve à la fois une image de son ancienne gloire et un témoignage impérieux et irrécusable de sa condamnation. C'est cette combinaison des élans de notre être avec le poids de notre condamnation qui forme la mesure dans nos danses ainsi que dans nos compositions musicales. » (Esprit des choses, t. 1er, p. 190).
Que de choses dans un menuet ! Que d'esprit dans les choses ! Mais, en vérité, elles ont trop d'esprit. Toutefois ces considérations bizarres se terminent par ce principe admirablement vrai et admirablement énoncé : « LA LOI ET LA LEÇON DE L'HOMME LE SUIVENT PARTOUT. »
Il dit dans le même ouvrage : « Nous employons journellement et sans réflexion, lorsque nous nous rencontrons, cette formule vague : Comment vous portez-vous ? Mais nous sommes bien loin d'en comprendre le sens. Au moins nous devrions être bien sûrs qu'il ne peut pas toujours tomber sur la santé de notre physique actuel..... Serait-ce donc une idée exagérée et contraire à la raison de supposer que cet usage ait eu primitivement pour objet notre véritable santé ?... Pourquoi ne serions-nous pas portés naturellement à nous informer auprès de nos semblables où ils en sont de leur véritable rétablissement ; si leur santé divine et spirituelle fait des progrès salutaires ; si leur corps réel reprend ses forces et ses vertus ; en un mot comment ils se portent ?... » Il ajoute : « Si nous étions dans les mesures où nous devrions être sur ce point, nous ne devrions nous aborder, traiter et conférer ensemble que dans cet esprit... Et comme nous avons vu que notre être était un fruit divin qui avait des propriétés attractives, peut-être par ces questions d'un véritable zèle, par ces entretiens affectueux, réveillerions-nous mutuellement les uns chez les autres cette saine existence dont nous avons tous un si grand besoin. » (Ibid, p. 106, 108, 109).
Il est évident que l'origine de l'emploi de cette formule : Comment vous portez-vous ? ne saurait être antérieure à la chute de l'homme. Au temps de son innocence, l'âme se portait bien, et, à cet égard, le doute même qui interroge, et qui implique le soupçon de la maladie, n'est pas admissible; il répugne à l'état de justice et de bon heur. Si cet usage date de la chute, y découvrir avant la Rédemption [p.855] le sens mystique que Saint-Martin lui prête, n'est-ce pas supposer à l'homme tombé un bien grand souci de la santé spirituelle, quand le mal et la cause qui entretient et perpétue le mal, c'est l'ignorance où il vit sur ce point et son repos dans cette ignorance ?
On peut admettre que certaines paroles, ou plutôt qu'un certain enchaînement de raisons et d'idées, entraînent souvent l'homme au-delà du terme qu'il se propose. Il n'est pas rare que la vérité et même l'erreur développe des conséquences qui trompent l'attente de la logique humaine. Mais croire qu'une formule simple, claire, usuelle, portant avec soi son évidence, va au-delà, bien au-delà de l'intention de celui qui l'emploie ; vouloir assigner à une locution, presque aussi ancienne que le temps, une vertu profonde, une portée inconnue, c'est tomber dans le fantastique et le puéril.
A force de trouver aux Choses l'esprit que souvent elles n'ont pas, il arrive à Saint-Martin de ne pas leur trouver celui qu'elles ont. Ainsi, Comment vous portez-vous [t.1, p.106-107] est à ses yeux plein de révélation et de lumière ; et il ne se doute pas que ces questions d'un véritable zèle, que ces entretiens affectueux par lesquels nous réveillerions les uns chez les autres la vie spirituelle, n'expriment que bien imparfaitement ce qui se passe chaque jour au tribunal catholique de la Pénitence.
Je lis plus loin cette proposition: Nous ne venons ici-bas que pour nous faire habiller. En qualité d'hommes-esprits, nous devrions avoir des vêtements plus beaux et plus parfaits que ceux qui ne proviennent que de l'œuvre de notre principe animal. Il ajoute : « C'est parce que nous avons perdu nos anciennes et éminentes propriétés que nous y suppléons par nos habits artificiels ; mais le principe et la loi nous suivent dans cette dégradation. Si ces habits artificiels ne sont pas le fruit de l'œuvre vive de notre esprit..., ils sont au moins, quant à leur forme, le fruit de notre industrie. Ainsi, dans le soin que nous prenons de nous habiller, nous montrons toujours que tous les êtres quelconques ne peuvent être vêtus que de leurs propres œuvres. » Les animaux n'ont pas besoin de vêtements, « parce qu'ils n'ont point d'œuvre spirituelle à faire ; » et « les nations sauvages qui vont nues sont peu avancées dans leur esprit et encore moins dans l'œuvre spirituelle. » (Esprit des choses, t. II, p. 57). Je ne vois encore ici qu'une réminiscence de [p.856] l'Ecriture, qui affecte vainement l'originalité en se déguisant sous des expressions ridicules et de mauvais goût.
« Nous soupirons, dit l'apôtre, dans cette tente (la tente de notre corps), désirant avec ardeur d'être revêtus de la céleste demeure qui nous est destinée, comme d'un second vêtement, si toutefois nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » (Nam et in hoc ingemiscimus, habitationem nostram, quæ de cælo est, superindui cupientes. Si tamen vestiti, non nudi inveniamur. 2 Cor., V, 2, 3).
On lit encore dans l'Apocalypse : « Voici que je viens comme un voleur. Heureux qui veille et qui garde ses vêtements, afin de ne point marcher nu, et qu'on ne voie pas sa honte? » (Ecce venio sicut fur. Beatus qui vigilat et custodit vestimenta sua, ne nudus ambulet et videant turpitudinem ejus. Apoc., XVI, 15).
Ainsi, selon saint Paul, le manteau de l'immortalité bienheureuse ne peut couvrir que le vêtement de nos œuvres : si vestiti, non nudi inveniamur ; et dans le langage de saint Jean, garder ses vêtements, c'est se défendre de la nudité spirituelle, ne nudus ambulet. Ce dénuement d'œuvres de foi et de charité, cette nudité morale est notre véritable honte. La nudité corporelle est le symbole et ne saurait être la conséquence rigoureuse du dénuement intérieur. La Genèse ne nous dit-elle pas, en parlant de nos premiers auteurs avant le crime et la chute : « Ils étaient nus et ne rougissaient pas. » Le vêtement de notre corps est donc indifférent à celui de notre âme, bien qu'en vertu d'une loi profonde, et qui se rattache à l'ordre universel, l'œil de l'homme ne s'ouvre sur la nudité de son corps que lorsqu'il se sent l'âme nue. Mais c'est là un de ces faits dont la raison scientifique nous manque, et où il ne nous est guère permis de voir au-delà du demi-jour de l'allégorie ou du symbole. Prétendre aller plus avant, faire violence à des rapports qui se dérobent pour les amener à une évidence qu'ils ne souffrent pas, trouver dans le non-usage de se vêtir la preuve et comme la conséquence de l'incapacité spirituelle, c'est atteindre à ces régions vagues où la raison s'égare, c'est confondre deux ordres de faits dont la distinction est sensible, c'est arriver à matérialiser les choses de l'esprit bien plutôt qu'à spiritualiser les choses de la matière. [p.857]
Cependant, il faut le reconnaître, l'idée est grande et hardie de rechercher par la voie de la science l'esprit des choses. Si l'erreur, la confusion et le désordre présupposent l'ordre, l'harmonie, la vérité, ce qu'il nous reste de rectitude et de lumière peut en effet nous aider à pénétrer dans les détours ruineux et obscurs de ce monde que nous sentons et de ce monde que nous sommes. Dans les altérations, dans les irrégularités ou les catastrophes de l'ordre élémentaire, qui semblent défier la loi et que la loi atteint toujours, on peut jusqu'à un certain point suivre la trace d'un ordre antérieurement stable ; nos traditions et nos usages, qui souvent n'offrent aux yeux vulgaires qu'une lettre morte, nos institutions faussées ou perverties, nos arts dégénérés, nos sciences profondément indifférentes à la recherche de toute cause finale, peuvent néanmoins, par le caractère même de leurs développements, de leurs écarts ou de leurs négations, révéler quelque chose du but réel de l'art, de la science et de la société humaine; en d'autres termes, les fragments humiliés de l'homme déchu trahissent le dessin primitif de l'homme droit et la réédification future de l'homme justifié. La nature, sous la loi du temps et du péché, conserve encore le plan de l'Eternelle Nature, selon l'expression de Jacob Boehm, c'est-à-dire la perpétuité de l'idéal divin à travers les perturbations du monde et les égarements de l'âme. Cet essai de restitution des choses, en recueillant à la trace de leurs débris les indices de leur état antérieur et de leur destination future, est une tentative téméraire peut-être, mais que la vérité ne saurait entièrement désavouer ; car elle s'appuie sur un principe certain, à savoir que le présent est à la fois gros du passé et de l'avenir. Ce grand principe, posé par Leibniz, développé par Bonnet, et transporté par Cuvier de la région des hypothèses dans celle des faits, est loin d'avoir subi tous les genres de vérification qu'il appelle. L'empire de ce principe est universel : il domine l'étude sérieuse de la nature et de l'homme ; mais les dissentiments des philosophes sur les questions qui nous importent le plus et l'aversion des savants spéciaux pour la recherche des causes finales ont éliminé de la science humaine ce puissant élément de coordination, d'unité et de vie. Les théologiens mystiques et les maîtres de la vie intérieure, en méditant sur les analogies de la nature et de la grâce, éclairent souvent d'un jour vif et nouveau le secret des correspondances de l'homme au monde visible et au monde invisible. Mais la règle de la [p.858] foi qui, en donnant l'essor à leur pensée, la contient et l'assure, ne leur permet pas de chercher à systématiser scientifiquement des spéculations qui, d'ordinaire, n'ont d'autres bases que des similitudes et des allégories heureuses, des rapprochements ingénieux, ces richesses souvent un peu imaginaires de l'interprétation anagogique où la vérité, spécieuse et subtile, se sent elle-même trop voisine de l'hypothèse pour revêtir la forme déterminée et rigoureuse de l'évidence scientifique. Vraie à la condition de demeurer demi-voilée, elle dégénère en illusion et en erreur aussitôt qu'elle veut appuyer sur des rapports qui appartiennent au pressentiment plutôt qu'à la connaissance. C'est cet ordre de conception, intermédiaire entre l'intuition et la science, que Saint-Martin a tenté d'amener à un état de précision ou plutôt de détermination impossible. L'entreprise devait séduire cet esprit original et glorieux ; car évidemment la gloire d'entreprendre pouvait compenser le danger de l'inévitable écueil où il devait échouer. La bizarrerie et la légèreté des assertions, ce dogmatisme tranchant qui se dispense de démontrer, ou qui ne démontre qu'en vertu d'une hypothèse gratuitement érigée en principe, cette affectation à s'envelopper de nuages et de mystères, comme si l'on craignait de communiquer à l'homme trop de lumière et trop de vérité, cette spiritualité abusive qui se flatte de lire couramment chaque lettre de l'alphabet universel, et qui ne déchiffre guère en définitive que des caractères de son invention, tels sont peut-être les moindres défauts de la gnose moderne. La foi et la philosophie répugnent à cette théologie et à cette métaphysique illuminées ; les sciences positives réservent-elles un meilleur accueil à ces hypothèses cosmologiques et cosmogoniques ?
Qu'est-ce qu'un monde, et l'univers est-il un monde ? demande Saint-Martin. Suivant lui, un monde est une société ou famille d'êtres placés sous une sorte de gouvernement, soumis à « un principe ou faculté première qui puisse vouloir et appuyer ses volontés par des motifs justes et sages, » en sorte que « toutes les autres facultés soient coordonnées à celle-ci ; mais qu'elles soient en même temps susceptibles de la comprendre, de la goûter, d'y adhérer par inclination autant que pour leur propre utilités. » (Esprit des choses, t. 1er, p. 202).
Dieu est un monde, et il est, à proprement parler, le seul et [p.859] véritable monde. « L'éternel désir ou l'éternelle volonté divine est cette faculté centrale qui, dans Dieu, s'unit à l'infinité de toutes ses facultés et puissances, et qui leur sert éternellement et sans interruption de point de mire et de foyer.
« Dans l'ordre spirituel, si cette harmonie n'est pas toujours aussi parfaite, elle pourrait l'être si l'esprit ne perdait point de vue le centre universel ou ce désir qui fait à la fois la base et la vie du monde divin ; ainsi l'esprit et Dieu pourraient nous offrir un monde spirituel très régulier ; » et en effet, « pour peu que nous nous approchions de ce centre supérieur, nous devenons à l'instant un monde tout entier par l'universalité des aperçus et des renouvellements que nous recevons. » [p.202-203]
Mais, sans nous élever à cet état si rare d'union avec notre principe, ne sentons-nous pas en nous « une volonté ou un désir qui est comme le centre, le chef et le dominateur de toutes nos autres facultés, puisque la pensée même lui est subordonnée en ce qu'il est le maître de l'adopter comme de la rejeter quand elle se présente ? Ne sentons-nous pas que cette faculté centrale a en même temps de l'analogie avec toutes nos autres facultés, qui sont comme autant de citoyens d'un même empire ayant le pouvoir de comprendre cette faculté maîtresse et dominatrice, et de s'harmoniser avec elle ? » [Esprit des choses, t.1, p.203]
Image de Dieu, l'homme offre cependant « une défectuosité que n'a pas le modèle. Quoique notre être spirituel puisse être un monde complet et régulier, il peut aussi être un monde divisé et en discordance. Mais, dans sa désharmonie même, ce qui se révolte en lui conserve encore dans un sens inverse la forme et le titre de monde, puisqu'on y voit une volonté qui réunit, domine et entraîne les facultés égarées ou rebelles. »
Il suit de cette définition que le nom de monde ne saurait convenir au monde physique, parce que la faculté centrale, la volonté lui manque; car l'instinct des animaux, centre de toutes les choses physiques, n'a pas la propriété nécessaire pour former un monde; « et la volonté supérieure qui est au-dessus de ce même centre se trouve, par le moyen de cet intermède, trop distante des choses pour avoir de l'analogie avec elles, en sorte que l'harmonie qui règne dans l'ensemble des êtres physiques n'est pas une harmonie éclairée, une harmonie où la justice et l'intelligence puissent s'exercer par le [p.860] concours d'un assentiment sympathique entre le centre et ses rayons » (Ibid. 203, 204, 205).
De cette définition du monde, obscure, contestable, arbitraire, Saint-Martin se croit en droit de conclure que, n'ayant ni la volonté fixe du monde divin, ni la volonté mobile du monde spirituel régulier, ni la volonté corrompue du monde spirituel irrégulier, le monde physique ne peut avoir puisé la naissance dans la même source que les trois autres mondes ; que ce monde, n'étant que l'ombre des autres et une pure apparence pour notre pensée, ne peut avoir été produit par une cause directe, mais par « une cause extralignée, par une cause courbe ou indirecte, cause occasionnelle et de circonstance, qui ne tient point immédiatement à la racine de la vérité. » [Esprit des choses, t.1, p.206]. Ce monde enfin « paraît plutôt un secours, une ressource, un remède pour rappeler à la vie qu'il ne paraît être la vie même. » Cette conclusion est assurément fort inattendue, fort irrationnelle, et les précédentes propositions, qui n'ont pas l'air de soupçonner les difficultés métaphysiques qu'elles soulèvent, décident de la valeur des prémisses et de la définition.
Saint-Martin rejette l'hypothèse de la pluralité des mondes en tant qu'habités par d'autres hommes, et cette idée vient, suivant lui, de ce que notre incorporisation matérielle nous fait tenir, « selon nos essences élémentaires, à toutes les régions physiques et à toutes les puissances de l'univers qui ont concouru à notre formation corporelle; » en sorte que « nous nous sentons vivre dans tous ces mondes, quoique notre corps ou le produit de toutes ces puissances n'existe réellement que sur la terre » [Esprit des choses, t.1, p.213]. Cette cosmogonie fantastique introduit assez logiquement les rêveries de l'astrologie judiciaire ; le théosophe amène l'astrologue. « L'astral, dit-il, domine sur notre terrestre, puisqu'il l'entretient ; l'astral lui-même est dominé par l'esprit de l'univers qui le gouverne ; la source d'iniquité s'insinue au travers de toutes ces régions pour parvenir jusqu'à nous » [idem, p.197]. Le manichéisme a infecté toutes ces pensées.
Saint-Martin trouve que mal à propos ceux-là sont accusés d'orgueil qui croient que la terre est la seule habitée, quoiqu'étant une si petite planète ; car, si l'homme se glorifiait d'une telle demeure, ce serait un prisonnier qui se vanterait de son cachot. Si, d'autre part, « la terre se glorifiait de posséder seule la race coupable et [p.861] abâtardie de l'homme, ce serait comme si les cachots de Bicêtre se glorifiaient d'être le repaire de tous les bandits de la société. » [Esprit des choses, T.1, p.215] Bon comme saillie, mais détestable comme doctrine.
A quel ordre de science peut se rapporter cette étrange proposition : « Il faut se souvenir que l'axe de l'écliptique est incliné ; que la terre est descendue, et que la femme elle-même l'est aussi, quoique cette notion soit aujourd'hui si peu répandue ; car la source génératrice était autrefois dans le cœur de l'homme, dont la poitrine était alors le siège de la douceur. » [idem, p.217]
Il réduit le problème de l'univers à la composition de deux forces : la force impulsive et la force compressive ; en d'autres termes, la force et la résistance. S'il n'y avait que de la résistance, il n'y aurait point de mouvement, et s'il n'y avait que de la force sans résistance, il n'y aurait point de corps.
La nature est comme la résultante douloureuse de ces deux forces ; il n'est aucune de ses productions qui, dans son développement successif, n'atteste la constance et l'universalité de cette lutte. « Dans le noyau d'un fruit, la résistance l'emporte sur la force ; aussi reste-t-il dans l'inaction. Lorsqu'on l'a planté et que la végétation s'établit, la force combat la résistance et se met en équilibre avec elle. Lorsque le fruit parait, c'est la force qui l'a emporté... » [idem, p.142] Aussi la nature est-elle dans un état d'angoisse et de souffrance. L'univers est sur [son] un lit de douleur, s'écrie Saint-Martin dans le Ministère de l'homme-esprit. [Ministère de l’Homme-esprit, p.55] Car « n'est-ce pas une plaie que ces suspensions auxquelles nous voyons que cette nature actuelle est condamnée ?... N'est-ce pas une plaie que ces incommensurables lenteurs auxquelles est assujettie la croissance des êtres et qui semble tenir la vie comme suspendue en eux ? N'est-ce pas surtout une plaie que ces énormes amas de substances pierreuses et cristallisées où non seulement la résistance l'emporte sur la force, mais où elle l'emporte à un tel degré qu'elle semble avoir totalement absorbé la vie de ces corps et les avoir condamnés à la mort absolue ? » [idem, p.142-143] Autant vaudrait dire : N'est-ce pas une plaie que la nature entière ?
La végétation ne s'accomplit que par de laborieux mariages ; les semences confiées à la terre brisent péniblement leur enveloppe pour unir leurs propriétés captives aux propriétés analogues dispersées dans le sein de la terre, et l'effort de ces propriétés divisées, qui tendent à l'union, triomphe enfin de la résistance. « Tous les [p.862] détails de ce combat sont écrits sur la production qui en résulte, ainsi que les indices des propriété diverses qui ont eu part à l'action, et l'étude de ces détails serait pour nous un livre très instructif si nous avions les moyens et le bonheur d'y pouvoir lire. » [idem, p.154] Cette vue originale amène ce grand et beau principe, qui demanderait toutefois d'autres modes de vérification : IL N'Y A AUCUN ÊTRE QUI NE SOIT L'HISTOIRE VIVANTE DE SA PROPRE NAISSANCE ET DE SA PROPRE GÉNÉRATION. » [Esprit des choses, T.I, p.155]
Ses idées sur la lutte des deux forces vont aux applications les plus imprévues. Il en trouve la confirmation dans les propriétés et la forme du chêne, par exemple ; dans les propriétés du café et de la vigne ; enfin, dans le règne animal. Ainsi, suivant lui, « la force a été si concentrée dans le chien par la compression de la résistance qu'en même temps il peut supporter des marches si longues et si étonnantes, et que ses forces digestives sont si remarquables... Dans le lion, cette force est plus grande encore... et la compression ayant été comme universelle en lui, elle a fait jaillir la force dans tous les organes de son être. Voilà pourquoi tout en lui est si imposant et si redoutable... Dans le bœuf et le mouton, il semble que la force et la résistance se soient maintenus en harmonie ; ils paraissent être du petit nombre qui a, en quelque sorte, résisté au grand choc. On en peut juger par les nombreux secours qu'ils nous apportent.. Les poissons, en général, ont éprouvé dans le grand choc un double degré de résistance ; voilà pourquoi leur forme est véritablement informe... Les insectes sont le fruit d'une victoire usurpée de la force sur la résistance. Ils sont, sous le rapport d'une troisième nature, la démonstration la plus sensible du péché de l'homme. » [idem, p.159-163] Je m’arrête ; il est impossible de discuter des opinions de cette nature. Ce dogmatisme à vol d'oiseau frappe la raison de vertige : le sol lui manque ; elle chancelle comme un homme ivre, ne sachant où se prendre. Saint-Martin parle une langue dont le sens, sous des expressions connues, sous des formes grammaticales régulières et des procédés de raisonnement usuels, se dérobe à l'intelligence. Il parle la langue de tous, et cependant il parle la langue la plus étrangère à tous ; idiome singulier qui prétend ne relever ni de la tradition religieuse, ni de la tradition scientifique, ni du sens commun. « Tout parle dans la nature, dit Saint-Martin, et tout n'y parle que pour se faire entendre et exercer notre intelligence. » Cela est vrai ; mais il [p.863] n'est pas moins vrai que l'on interroge la nature de manière à en obtenir les réponses que l'on désire ; on lui impute même celles que l'on fait pour elle. Or, ces réponses, où la voix de l'imagination se substitue à celle des faits, réunissent ces deux caractères, moins incompatibles qu'on ne pense, la hardiesse et la stérilité : notre orgueil est si grand et notre imagination si pauvre ! Aussi, la moindre observation due à la patience et au désintéressement de l'esprit scientifique est-elle infiniment plus féconde en révélations que ces aperçus particuliers et ces idées aventureuses qui ne correspondent qu'à la fantaisie qui les a fait naître. Les vues ou les idées qui reposent sur l'étude sérieuse et modeste des choses s'enchaînent, se combinent et se perpétuent, comme les faits qu'elles énoncent : la nature leur communique de sa fécondité. Peut-être même trouvent-elles l'espérance de survivre à l'ordre mobile des faits et de la nature, dans ce lien vivant qui les rattache à la vérité, à la raison infinie, à l'Idée-Mère par excellence. Quant à la pensée qui ne représente qu'elle-même, qui ne donne rien de plus que ce fruit capricieux et mensonger qu'elle porte, pensée impuissante et orgueilleuse, sans auteurs légitimes et sans postérité viable, elle ne peut que retourner à ce quasi-néant dont elle est sortie.



