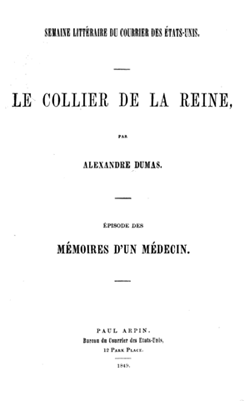 1849 - Le collier de la reine
1849 - Le collier de la reine
Épisode des mémoires d’un médecin
Alexandre Dumas
Paris
Dufour, Mulat et Boulanger, éditeurs
21, quai Malaquais
Édition de 1856.
Page publiée le 7 janvier 2009 - Mise à jour le 2 juillet 2023
Deuxième volume de la série Mémoires d'un médecin qui comporte en outre Joseph Balsamo, Ange Pitou et La Comtesse de Charny. Ce livre paraît dans le journal La Presse en feuilleton en première page entre le 29 décembre 1848 (début de la publication) et le 27 janvier 1850 (fin de la publication). Cette publication qui s'étale sur près de deux années est entrecoupées par Les Mémoires d'Outre-tombe de Chateaubriand et les Confidences d'Alphonse de Lamartine.

![]() Voir sur Gallica : Mémoires d’un médecin - Le Collier de la Reine en feuilleton
Voir sur Gallica : Mémoires d’un médecin - Le Collier de la Reine en feuilleton
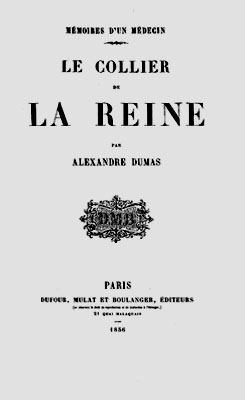 XVI – Mesmer et Saint-Martin, pages 138-145
XVI – Mesmer et Saint-Martin, pages 138-145
Il fut un temps où Paris, libre d'affaires, Paris, plein de loisirs, se passionnait tout entier pour des questions qui, de nos jours, sont le monopole des riches, qu'on appelle les inutiles, et des savants, qu’on appelle les paresseux.
En 1784, c’est-à-dire à l’époque où nous sommes arrivés, la question à la mode, celle qui surnageait au-dessus de toutes, qui flottait dans l’air, qui s’arrêtait à toutes les têtes un peu élevées, comme font les vapeurs aux montagnes, c’était le mesmérisme, science mystérieuse, mal définie par ses inventeurs, qui, n’éprouvant pas le besoin de démocratiser une découverte dès sa naissance, avaient laissé prendre à celle-là un nom d’homme, c’est-à-dire un titre aristocratique, au lieu d’un de ces noms de science tirés du grec à l’aide desquels la pudibonde modestie des savants modernes vulgarise aujourd’hui tout élément scientifique.
En effet, à quoi bon, en 1784, démocratiser une science ? Le peuple qui, depuis plus d’un siècle et demi, n’avait pas été consulté par ceux qui [page 139] le gouvernaient, comptait-il pour quelque chose dans l’état ? Non : le peuple, c’était la terre féconde qui rapportait, c’était la riche moisson que l’on fauchait ; mais le maître de la terre, c’était le roi ; mais les moissonneurs, c’était la noblesse.
Aujourd’hui, tout est changé : la France ressemble à un sablier séculaire ; pendant neuf cents ans, il a marqué l’heure de la royauté ; la droite puissante du Seigneur l’a retourné : pendant des siècles, il va marquer l’ère du peuple.
En 1784, c’était donc une recommandation qu’un nom d’homme. Aujourd’hui, au contraire, le succès serait un nom de choses.
Mais abandonnons aujourd’hui pour jeter les yeux sur hier. Au compte de l’éternité, qu’est-ce que cette distance d’un demi-siècle ? pas même celle qui existe entre la veille et le lendemain.
Le docteur Mesmer était donc à Paris, comme Marie-Antoinette nous l’a appris elle-même en demandant au roi la permission de lui faire une visite. Qu’on nous permette donc de dire quelques mots du docteur Mesmer, dont le nom, retenu aujourd’hui d’un petit nombre d’adeptes, était, à cette époque que nous essayons de peindre, dans toutes les bouches.
Le docteur Mesmer avait, vers 1777, apporté d’Allemagne, ce pays des rêves brumeux, une science toute gonflée de nuages et d’éclairs. À la lueur de ces éclairs, les savants ne voyaient que les nuages qui faisaient, au-dessus de leur tête, une voûte sombre ; le vulgaire ne voyait que des éclairs.
Mesmer avait débuté en Allemagne par une thèse sur l’influence des planètes. Il avait essayé d’établir que les corps célestes, en vertu de cette force qui produit leurs attractions mutuelles, exercent une influence sur les corps animés, et particulièrement sur le système nerveux, par l’intermédiaire d’un fluide subtil qui remplit tout l’univers. Mais cette première théorie était bien abstraite. Il fallait, pour la comprendre être initié à la science des Galilée et des Newton. C’était un mélange de grandes variétés astronomiques avec les rêveries astrologiques qui ne pouvait, nous ne disons pas se populariser, mais s’aristocratiser : car il eût fallu pour cela que le corps de la noblesse fût converti en société savante. Mesmer abandonna donc ce premier système pour se jeter dans celui des aimants.
Les aimants, à cette époque, étaient fort étudiés ; leurs facultés sympathiques ou antipathiques faisaient vivre les minéraux d’une vie à peu près pareille à la vie humaine, en leur prêtant les deux grandes passions de la vie humaine : l’amour et la haine. En conséquence, on attribuait aux aimants des vertus surprenantes pour la guérison des maladies. Mesmer joignit donc l’action des aimants à son premier système, et essaya de voir ce qu’il pourrait tirer de cette adjonction. [page 140]
Malheureusement pour Mesmer, il trouva, en arrivant à Vienne, un rival établi. Ce rival, qui se nommait Hall, prétendit que Mesmer lui avait dérobé ses procédés. Ce que voyant, Mesmer, en homme d’imagination qu’il était, déclara qu’il abandonnerait les aimants comme inutiles, et qu’il ne guérirait plus par le magnétisme minéral, mais par le magnétisme animal.
Ce mot, prononcé comme un mot nouveau, ne désignait pas cependant une découverte nouvelle ; le magnétisme, connu des Anciens, employé dans les initiations égyptiennes et dans le pythisme grec, s’était conservé dans le Moyen Age à l’état de tradition ; quelques lambeaux de cette science, recueillis, avaient fait les sorciers des XIIIe, XIVe et XVe siècles. Beaucoup furent brûlés qui confessèrent, au milieu des flammes, la religion étrange dont ils étaient les martyrs.
Urbain Grandier n’était rien autre chose qu’un magnétiseur. Mesmer avait entendu parler des miracles de cette science.
Joseph Balsamo, le héros d’un de nos livres, avait laissé trace de son passage en Allemagne, et surtout à Strasbourg. Mesmer se mit en quête de cette science éparse et voltigeante comme ces feux follets qui courent la nuit au-dessus des étangs ; il en fit une théorie complète, un système uniforme auquel il donna le nom de mesmérisme.
Mesmer, arrivé à ce point, communiqua son système à l’Académie des sciences à Paris, à la Société royale de Londres, et à l’Académie de Berlin ; les deux premières ne lui répondirent même pas, la troisième dit qu’il était un fou.
Mesmer se rappela ce philosophe grec qui niait le mouvement, et que son antagoniste confondit en marchant. Il vint en France, prit, aux mains du docteur Storck et de l’oculiste Wenzel, une jeune fille de dix-sept ans atteinte d’une maladie de foie et d’une goutte sereine, et, après trois mois de traitement, la malade était guérie, l’aveugle voyait clair.
Cette cure avait convaincu nombre de gens, et, entre autres, un médecin nommé Deslon : d’ennemi, il devint apôtre.
À partir de ce moment, la réputation de Mesmer avait été grandissant ; l’Académie s’était déclarée contre le novateur, la cour se déclara pour lui ; des négociations furent ouvertes par le ministère pour engager Mesmer à enrichir l’humanité par la publication de sa doctrine. Le docteur fit son prix. On marchanda, M. de Breteuil lui offrit, au nom du roi, une rente viagère de vingt mille livres et un traitement de dix mille livres pour former trois personnes, indiquées par le gouvernement, à la pratique de ses procédés. Mais Mesmer, indigné de la parcimonie royale, refusa et partit pour les eaux de Spa, avec quelques-uns de ses malades. [page 141]
Une catastrophe inattendue menaçait Mesmer. Deslon, son élève, Deslon, possesseur du fameux secret que Mesmer avait refusé de vendre pour trente mille livres par an ; Deslon ouvrit chez lui un traitement public par la méthode mesmérienne.
Mesmer apprit cette douloureuse nouvelle ; il cria au vol, à la fraude ; il pensa devenir fou. Alors, un de ses malades, M. de Bergasse, eut l’heureuse idée de mettre la science de l’illustre professeur en commandite ; il fut formé un comité de cent personnes au capital de trois cent quarante mille livres, à la condition qu’il révélerait la doctrine aux actionnaires. Mesmer s’engagea à cette révélation, toucha le capital et revint à Paris.
L’heure était propice. Il y a des instants dans l’âge des peuples, ceux qui touchent aux époques de transformation, où la nation tout entière s’arrête comme devant un obstacle inconnu, hésite et sent l’abîme au bord duquel elle est arrivée, et qu’elle devine sans le voir.
La France était dans un de ces moments-là ; elle présentait l’aspect d’une société calme, dont l’esprit était agité ; on était en quelque sorte engourdi dans un bonheur factice, dont on entrevoyait la fin, comme, en arrivant à la lisière d’une forêt, on devine la plaine par les interstices des arbres. Ce calme, qui n’avait rien de constant, rien de réel, fatiguait ; on cherchait partout des émotions, et les nouveautés, quelles qu’elles fussent, étaient bien reçues. On était devenu trop frivole pour s’occuper, comme autrefois, des graves questions du gouvernement et du molinisme ; mais on se querellait à propos de musique, on prenait parti pour Gluck ou pour Piccini, on se passionnait pour l’Encyclopédie, on s’enflammait pour les mémoires de Beaumarchais.
L’apparition d’un opéra nouveau préoccupait plus les imaginations que le traité de paix avec l’Angleterre et la reconnaissance de la République des États-Unis. C’était enfin une de ces périodes où les esprits, amenés par les philosophes vers le vrai, c’est-à-dire vers le désenchantement, se lassent de cette limpidité du possible qui laisse voir le fond de toute chose, et, par un pas en avant, essaie de franchir les bornes du monde réel pour entrer dans le monde des rêves et des fictions.
En effet, s’il est prouvé que les vérités bien claires, bien lucides, sont les seules qui se popularisent promptement, il n’en est pas moins prouvé que les mystères sont une attraction toute-puissante pour les peuples.
Le peuple de France était donc entraîné, attiré d’une façon irrésistible par ce mystère étrange du fluide mesmérien, qui, selon les adeptes, rendait la santé aux malades, donnait l’esprit aux fous et la folie aux sages.
Partout, on s’inquiétait de Mesmer. Qu’avait-il fait ? sur qui avait-il opéré ses divins miracles ? À quel grand seigneur avait-il rendu la vue ou [page 142] la force ? à quelle dame fatiguée de la veille et du jeu avait-il assoupli les nerfs ? à quelle jeune fille avait-il fait prévoir l’avenir dans une crise magnétique ?
L’avenir ! ce grand mot de tous les temps, ce grand intérêt de tous les esprits, solution de tous les problèmes. En effet, qu’était le présent ? Une royauté sans rayons, une noblesse sans autorité, un pays sans commerce, un peuple sans droits, une société sans confiance.
Depuis la famille royale, inquiète et isolée sur son trône, jusqu’à la famille plébéienne affamée dans son taudis – misère, honte et peur partout.
Oublier les autres pour ne songer qu’à soi, puiser à des sources nouvelles, étranges, inconnues, l’assurance d’une vie plus longue et d’une santé inaltérable pendant ce prolongement d’existence, arracher quelque chose au ciel avare, n’était-ce pas là l’objet d’une aspiration facile à comprendre vers cet inconnu dont Mesmer dévoilait un replis ?
Voltaire était mort, et il n’y avait plus en France un seul éclat de rire, excepté le rire de Beaumarchais, plus amer encore que celui du maître. Rousseau était mort : il n’y avait plus en France de philosophie religieuse. Rousseau voulait bien soutenir Dieu ; mais depuis que Rousseau n’était plus, personne n’osait s’y risquer, de peur d’être écrasé sous le poids.
La guerre avait été autrefois une grave occupation pour les Français. Les rois entretenaient à leur compte l’héroïsme national ; maintenant, la seule guerre française était une guerre américaine, et encore le roi n’y était-il personnellement pour rien. En effet, ne se battait-on pas pour cette chose inconnue que les Américains appellent indépendance, mot que les Français traduisent par une abstraction : la liberté ?
Encore, cette guerre lointaine, cette guerre, non seulement d’un autre peuple, mais encore d’un autre monde venait de finir.
Tout bien considéré, ne valait-il pas mieux s’occuper de Mesmer, ce médecin allemand qui, pour la deuxième fois depuis six ans, passionnait la France, que de lord Cornwallis ou de M. Washington, qui étaient si loin qu’il était probable qu’on ne les verrait jamais ni l’un ni l’autre !
Tandis que Mesmer était là : on pouvait le voir, le toucher, et, ce qui était l’ambition suprême des trois quarts de Paris, être touché par lui.
Ainsi, cet homme qui, à son arrivée à Paris, n’avait été soutenu par personne, pas même par la reine sa compatriote, qui cependant soutenait si volontiers les gens de son pays ; cet homme qui, sans le docteur Deslon, qui l’avait trahi depuis, fût demeuré dans l'obscurité, cet homme régnait véritablement sur l’opinion publique, laissant bien loin derrière lui le roi, dont on n’avait jamais parlé, M. de La Fayette, dont on ne parlait pas encore, et M. de Necker, dont on ne parlait plus.
Et, comme si ce siècle avait pris à tâche de donner à chaque esprit [page 143] selon son aptitude, à chaque cœur selon sa sympathie, à chaque corps selon ses besoins, en face de Mesmer, l’homme du matérialisme, s’élevait Saint-Martin, l’homme du spiritualisme, dont la doctrine venait consoler toutes les âmes que blessait le positivisme du docteur allemand.
Qu’on se figure l’athée avec une religion plus douce que la religion elle-même ; qu’on se figure un républicain plein de politesses et de regards pour les rois ; un gentilhomme des classes privilégiées, affectueux, tendre, amoureux du peuple ; qu’on se représente la triple attaque de cet homme, doué de l’éloquence la plus logique, la plus séduisante contre les cultes de la terre, qu’il appelle insensés, par la seule raison qu’ils sont divins !
Qu’on se figure enfin Épicure poudré à blanc, en habit brodé, en veste à paillettes, en culotte de satin, en bas de soie et en talons rouges ; Épicure ne se contentant pas de renverser les dieux auxquels il ne croit pas, mais ébranlant les gouvernements qu’il traite comme les cultes, parce que jamais ils ne concordent, et presque toujours ne font qu’aboutir au malheur de l’humanité.
Agissant contre la loi sociale qu’il infirme avec ce seul mot : elle punit semblablement des fautes dissemblables, elle punit l’effet sans apprécier la cause.
Supposez, maintenant, que ce tentateur, qui s’intitule le philosophe inconnu, réunit, pour fixer les hommes dans un cercle d’idées différentes, tout ce que l’imagination peut ajouter de charmes aux promesses d’un paradis moral, et qu’au lieu de dire : les hommes sont égaux, ce qui est une absurdité, il invente cette formule qui semble échappée à la bouche même qui la nie :
« Les êtres intelligents sont tous rois. » [1]
Et puis, rendez-vous compte d’une pareille morale tombant tout à coup au milieu d’une société sans espérances, sans guides ; d’une société ; archipel semé d’idées, c’est-à-dire d’écueils. Rappelez-vous qu’à cette époque les femmes sont tendres et folles, les hommes avides de pouvoir, d’honneurs et de plaisirs ; enfin, que les rois laissent pencher la couronne sur laquelle, pour la première fois, debout et perdu dans l’ombre, s’attache un regard à la fois curieux et menaçant. Trouvera-t-on étonnant qu’elle fît des prosélytes, cette doctrine qui disait aux âmes :
— Choisissez parmi vous l’âme supérieure, mais supérieure par l’amour, par la charité, par la volonté puissante de bien aimer, de bien rendre heureux ; puis, quand cette âme, faite homme, se sera révélée, courbez-vous, humiliez-vous, anéantissez-vous toutes, âmes inférieures, afin de laisser l’espace à la dictature de cette âme, qui a pour mission de vous réhabiliter dans votre principe essentiel, c’est-à-dire dans l’égalité [page 144] des souffrances, au sein de l’inégalité forcée des aptitudes et des fonctionnements.
Ajoutez à cela que le philosophe inconnu s’entourait de mystères ; qu’il adoptait l’ombre profonde pour discuter en paix, loin des espions et des parasites, la grande théorie sociale qui pouvait devenir la politique du monde.
— Écoutez-moi, disait-il, âmes fidèles, cœurs croyants, écoutez-moi et tâchez de me comprendre, ou plutôt ne m’écoutez que si vous avez intérêt et curiosité à me comprendre, car vous y aurez de la peine, et je ne livrerai pas mes secrets à quiconque n’arrachera point le voile.
Je dis des choses que je ne veux point paraître dire, voilà pourquoi je paraîtrai souvent dire autre chose que ce que je dis.
Et Saint-Martin avait raison, et il avait bien réellement autour de son œuvre les défenseurs silencieux, sombres et jaloux de ses idées, mystérieux cénacle dont nul ne perçait l’obscure et religieuse mysticité.
Ainsi travaillaient à la glorification de l’âme et de la matière, tout en rêvant l’anéantissement de Dieu et l’anéantissement de la religion du Christ, ces deux hommes qui avaient divisé en deux camps et en deux besoins tous les esprits intelligents, toutes les natures choisies de France.
Ainsi se groupaient autour du baquet de Mesmer, d’où jaillissait le bien-être, toute la vie de sensualité, tout le matérialisme élégant de cette nation dégénérée. Tandis qu’autour du livre Des erreurs et de la vérité se réunissaient les âmes pieuses, charitables, aimantes, altérées de la réalisation après avoir savouré des chimères.
Que si, au-dessous de ces sphères privilégiées, les idées divergeaient ou se troublaient ; que si les bruits s’en échappant se transformaient en tonnerres, comme les lueurs s’étaient transformées en éclairs, on comprendra l’état d’ébauche dans lequel demeurait la société subalterne, c’est-à-dire la bourgeoisie et le peuple, ce que plus tard on appela le tiers, lequel devinait seulement que l’on s’occupait de lui, et qui dans son impatience et sa résignation brûlait du désir de voler le feu sacré, comme Prométhée, d’en animer un monde qui serait le sien et dans lequel il ferait ses affaires lui-même.
Les conspirations à l’état de conversations, les associations à l’état de cercles, les partis sociaux à l’état de quadrilles, c’est-à-dire la guerre civile et l'anarchie, voilà ce qui apparaissait sous tout cela au penseur, lequel ne voyait pas encore la seconde vie de cette société.
Hélas ! aujourd’hui que les voiles ont été déchirés, aujourd’hui que les peuples Prométhées ont dix fois été renversés par le feu qu’ils ont dérobé eux-mêmes, dites-nous ce que pouvait voir le penseur dans la fin de cet étrange dix-huitième siècle, sinon la décomposition d’un monde, sinon quelque [page 145] chose de pareil à ce qui se passait après la mort de César et avant l’avènement d’Auguste.
Auguste fut l’homme qui sépara le monde païen du monde chrétien, comme Napoléon est l’homme qui sépara le monde féodal du monde démocratique.
Peut-être venons-nous de jeter et de conduire nos lecteurs après nous dans une digression qui a dû leur paraître un peu longue ; mais en vérité il eût été difficile de toucher à cette époque sans effleurer de la plume ces graves questions qui en sont la chair et la vie.
Maintenant l’effort est fait : effort d’un enfant qui gratterait avec son ongle la rouille d’une statue antique, pour lire sous cette rouille une inscription aux trois quarts effacée.
Rentrons dans l’apparence. En continuant de nous occuper de la réalité, nous en dirions trop pour le romancier, trop peu pour l’historien.
![]() Alexandre Dumas, Le Collier de la Reine : Chap XVIII, Mesmer et Saint-Martin
Alexandre Dumas, Le Collier de la Reine : Chap XVIII, Mesmer et Saint-Martin



