Charles-Augustin Sainte-Beuve - Volupté
Tome premier - Bruxelles, 1835 - Louis Hauman - http://books.google.fr/books?id=S7AUAAAAQAAJ
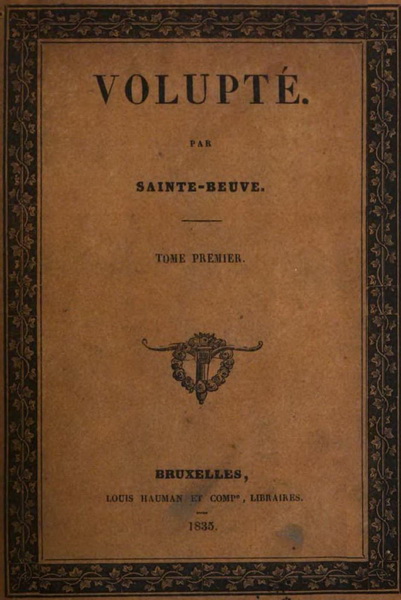 IV – Extrait, pages 69-71
IV – Extrait, pages 69-71
L'hiver, qui me parut long, s'écoula : avec le printemps, mes retours au manoir se multiplièrent et n'eurent plus de nombre. Tout un cercle de saisons avait déjà passé sur notre connaissance, j'étais devenu un vieil ami. La chambre que j'occupais désormais, non plus pour une nuit seulement, mais quelquefois pour une semaine entière et au-delà, avait vue sur les jardins et sur la cour de la ferme, au-dessus de la voûte d'entrée. J'y demeurais les matinées à lire, à méditer des systèmes de métaphysique auxquels mon inquiet [70] scepticisme prenait goût, et que j'allais puiser, la plupart, aux ouvrages des auteurs anglais depuis Hobbes jusqu'à Hume, introduits dans la bibliothèque du marquis par un oncle esprit fort. Quelques écrits bien contraires du Philosophe inconnu me tombèrent aussi sous la main, mais alors je m'y attachai peu. Cette curiosité de recherche avait un périlleux attrait pour moi, et, sous le prétexte d'un zèle honnête pour la vérité, elle décomposait activement mon reste de croyances. Lorsqu'au travers de ces spéculations ruineuses sur la liberté morale de l'homme et sur l'enchaînement plus ou moins fatal des motifs, quelque bouffée du printemps m'arrivait, quand un torrent d'odeurs pénétrantes et de poussières d'étamines montait dans la brise matinale jusqu'à ma fenêtre, ou que, le cri de la barrière du jardin m'avertissant, j'entrevoyais d'en haut la marquise avec ses femmes, en robe flottante, se dirigeant par les allées pour boire les eaux, selon sa coutume de huit heures en été, à la source ferrugineuse qui coulait au bas, — à cet aspect, sous ces parfums, aux fuyantes lueurs de ces images, rejeté soudainement dans le sensible, je me trouvais [71] bien au dépourvu en présence de moi-même. Mon entendement, baissant le front, n'avait rien à diminuer du désœuvrement de mon cœur, le livre rien à prétendre dans mes soupirs. Plus de foi à un chemin de salut, plus de recours familier à l'Amour permanent et invisible ; point de prière. Je ne savais prier que mon désir, invoquer que son but aveugle ; j'étais comme un vaincu désarmé qui tend les bras. Toute cette philosophie de la matinée (admirez le triomphe !) aboutissait d'ordinaire à quelque passage d'anglais à demi compris, sur lequel j'avais soin d'interroger M. de Couaën au déjeuner. La marquise, en effet, qui était là, se donnait parfois la peine de me faire répéter le passage pour m'en dire le sens et redresser ma prononciation.
X - Extrait, page 219-221
J'appris enfin (et c'est là, ô mon ami, en cette science ténébreuse où je me plais trop à revenir, c'est le seul endroit qui m'ait été immédiatement fructueux), j'appris à peser, à corriger ce qu'a dit de la femme l'antique Salomon dans sa satiété de roi ; à chérir ce qu'a dit de clément le Philosophe inconnu, ce Salomon moderne, invisible et plus doux ; à comprendre, à pratiquer, l'avouerai-je ? ce qu'a fait le Christ envers la Samaritaine ; à ne pas maudire! Salomon, qui avait trouvé la femme plus [220] amère que la mort, s'écrie : « qu'il y a un homme sur mille, mais qu'il n'y a pas une femme entre toutes ! » Le philosophe profond, qui vécut voilé, a écrit aussi, en un moment de saint effroi, qu'il n'y a pas de femmes, tant la matière de la femme paraissait à ses yeux plus dégénérée et plus redoutable encore que celle de l'homme. Mais, se souvenant bientôt que le Christ est venu et que Marie a engendré, il ajoute ces consolantes paroles : « Si Dieu pouvait avoir une mesure dans son amour, il devrait aimer la femme plus que l'homme. Quant à nous, nous ne pouvons nous dispenser de la chérir et de l'estimer plus que nous-même : car la femme la plus corrompue est plus facile à ramener qu'un homme qui n'aurait fait même qu'un pas dans le mal. » Aussi, je ne vous ai jamais maudites, ô créatures sur lesquelles on marche et qu'on ne nomme pas ; ni vous, superbes et forcenées, qui enlevez audacieusement celui qui passe ; ni vous, discrètes et perfides, qui le long des ombrages, semblez dire en fuyant : « Les eaux furtives sont les plus douces, et le pain qu'on dérobe est le plus savoureux ! » Je ne vous ai pas retranchées de l'humanité, vous toutes [221] qui êtes un peuple effréné, immense ! Je vous ai trouvées souvent meilleures que moi, dans le mal que vous me faisiez. Mes misères intérieures, mes versatilités infinies m'ont aidé à expliquer les vôtres. Rieuses, ulcérées ou repenties, je vous ai plaintes, je me suis reconnu et j'ai gémi pour moi en vous. Comme les abîmes de vos cœurs, comme les opprobres de vos sens étaient les miens ! ô femmes à qui l'on ne jette même plus la pierre, ô Cananéennes !
XII - Extrait, pages 264-270
Mais, pour revenir aux lectures dont je vous parlais, celle qui contrastait sans doute le plus avec le tourbillon agité de cette crise, et qui me rappela un moment assez haut vers la région invisible, avait pour objet quelques écrits d'un théosophe que j'aime à vous citer souvent, parce qu'il a beaucoup influé sur moi. Le livre des Erreurs et de la Vérité, et l'Homme de Désir, m'apportèrent avec obscurité plusieurs dogmes précieux, mêlés et comme dissous au milieu de mystiques odeurs. Une réponse de Saint-Martin à Garat, que j'avais trouvée dans le Recueil des Ecoles Normales, me renvoya à ces deux ouvrages, dont j'avais déjà feuilleté le premier à Couaën, mais sans m'y arrêter. Cette réponse elle-même, où le sage énonce ses principes le plus simplement qu'il a jamais fait, cette manière calme et fondamentale, si opposée en tout à l'adresse de langage, et, comme l'auteur les désigne, aux brillantes fusillades à poudre de l'adversaire, ce ton prudent, toujours religieux à l'idée, me remettaient aisément en des voies de spiritualisme ; car, sur ce point, j'étais distrait et égaré plutôt que déserteur. Une vérité entr'autres m'y toucha sensiblement, et fit révélation en moi ; c'est l'endroit où il est dit que « l'homme naît et vit dans les pensées. »
Bien des vérités qu'on croit savoir de reste et tenir, si elles viennent à nous être exprimées d'une certaine manière imprévue, se manifestent réellement pour la première fois, en [266] nous arrivant sous un angle qui ne s'était pas rencontré jusqu'alors, elles font subitement étincelle. Ainsi ce mot opéra à l'instant sur moi, comme si j'avais les yeux dessillés. Toutes les choses visibles du monde et de la nature , toutes les œuvres et tous les êtres, outre leur signification matérielle, de première vue, d'ordre élémentaire et d'utilité, me parurent acquérir la signification morale d'une pensée, — de quelque pensée d'harmonie, de beauté, de tristesse, d'attendrissement, d'austérité ou d'admiration. Et il était au pouvoir de mon sens moral intérieur, en s'y dirigeant, d'interpréter ou du moins de soupçonner ces signes divers, de cueillir ou du moins d'odorer les fruits du verger mystérieux, de dégager quelques syllabes de cette grande parole qui, fixée ici, errante là, frémissait partout dans la nature. J'y voyais exactement le contraire du monde désolant de Lamarck, dont la base était muette et morte. La création, comme un vestibule jadis souillé, se rouvrait à l'homme, ornée de vases sonores, de tiges inclinées, pleine de voix amies, d'insinuations en général bonnes et probablement peuplée en réalité d'innombrables esprits vigilants. Au-dessous des [267] animaux et des fleurs, les pierres elles-mêmes, dans leur empêchement grossier, les pierres des rues et des murs n'étaient pas dénuées de toute participation à la parole universelle. Mais, plus la matière devenait légère, plus les signes volatils et insaisissables, et plus ils étaient pénétrants. Pendant plusieurs jours, tandis que je marchais sous cette impression, le long des rues désertes, la face aux nuages, le front balayé des souffles de l'air, il me semblait que je sentais en effet, au-dessus de ma tête, flotter et glisser les pensées.
Ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'on peut être homme et tout-à-fait ignorer cela. On peut être homme de valeur, de génie spécial et de mérite humain, et ne sentir nullement les ondulations de cette vraie atmosphère qui nous baigne ; ou, si l'on n'évite pas sans doute d'en être atteint en quelque moment, on sait y rester glacé, s'en préserver comme d'un mauvais air et fermer les canaux supérieurs de l'esprit à ces influences aimables qui le veulent nourrir.
Il est donc un grand nombre d'hommes, et d'hommes de talents divers, dont on doit dire qu'ils ne vivent jamais dans les pensées. Parmi ceux-là, il en est d'habiles à toutes les sortes [268] d'anatomie, de logique et de tactique, aux récits des faits et des histoires, à l'observation ou à l'expression des phénomènes, et de ce premier masque qu'on appelle la réalité. Mais au-delà du sens immédiat, ne leur demandez rien des choses. Ils se sont retranché de bonne heure la cime aérée, ils se sont établis dans l'étage qu'ils estiment le seul solide; ils n'en sortent pas. Ce vide exact qu'ils font autour d'eux, par rapport à l'atmosphère divine, les appesantit et les attache avec succès à ces travaux plus ou moins ingénieux, où ils excellent. Qui croirait, à voir de tels exemples, que les pensées sont l'aliment naturel des esprits ? S'il en circule quelques-unes devant eux dans les conversations, ils ne s'y mêlent que pour les nier ou les restreindre, ou bien ils se taisent jusqu'à ce qu'elles soient passées. S'il leur en vient, au réveil, dans le lit, par surprise, entendez leur aveu ! ils se hâtent de les secouer, non pas comme orageuses parfois, ce qui serait prudent, mais comme vagues, comme follement remuantes et importunes en tant que pensées. Quelle idée écrasée se font de la nature humaine des hommes, rares après tout, et qui en sont eux-mêmes un ornement ? Si on [269] leur crie, comme Descartes à Gassendi : O Chair! ils s'honorent, comme celui-ci de l'injure, et vous répondent en raillant : O Esprit ! — Que ce soit chez eux caractère, habitude ou système, remercions le ciel d'être moins négatifs que cela, mon ami. La nourriture délicate et préparatoire des âmes est souvent la vôtre ; ne désespérez pas ! S'il convient de la tempérer dans l'usage, comme trop enivrante en cette vie et peu rassasiante sans la foi, il serait mortel de s'en sevrer. A certains moments que discerne d'abord un cœur sincère, laissons sans crainte les pensées venir, les sources d'en haut s'essayer ; ouvrons-nous à cette rosée qui pleut des nuages ; la Grâce elle-même n'est qu'une goutte féconde.
Le soudain attrait qu'avait pour moi la lecture de Saint-Martin, me suggéra l'envie toute naturelle d'entrevoir sa personne. Je n'aurais jamais songé à l'aborder, lui si humble, à l'interroger, lui, homme de prière et de silence; je désirais de l'apercevoir seulement. M'étant informé à son sujet auprès de mon ami l'idéologue, j'appris que, durant l'été, il vivait volontiers à Aulnay, dans la maison du sénateur Lenoir-Laroche. Un jour de septembre, à tout [270] hasard et dans le plein de ma disposition précédente, je tentai ce petit pèlerinage : « Si je le rencontre en quelque sentier, me disais-je, je le devinerai bien, et le doute même où je resterai ensuite ajoutera à l'effet de sa vue. » J'allai, et par une sorte de retenue conforme à l'objet, sans vouloir questionner personne, je parcourus cet étroit vallon, ce coteau boisé, qu'il regardait, le doux vieillard, comme un des lieux les plus agréables de la terre. Je rôdai aux charmilles des jardins; je crus découvrir les détours par lesquels il gravissait de préférence; en m'asseyant au haut, je m'imaginai occuper une des places qui lui étaient familières. Mais je ne fis pas de rencontre qui pût prêter à ma fantaisie. Cette course timide dans les bois, sur les traces de l'homme pieux, me laissa un intérêt, riant d'abord, puis bientôt solennel et consacré. Après moins de quinze jours, je sus qu'il ne se trouvait pas à Aulnay lors de ma visite, mais qu'y étant retourné depuis, il venait subitement d'y mourir.



