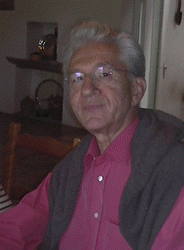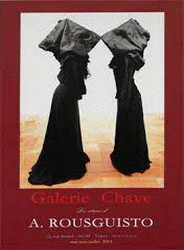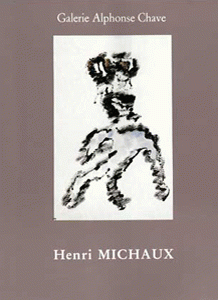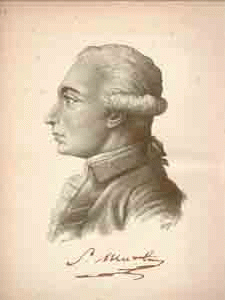1908 - Une présidente de province au dix-huitième siècle
1908 - Une présidente de province au dix-huitième siècle
La Revue hebdomadaire et son Supplément illustré
Paraissant le samedi
Dix-septième année
Librairie Plon,
8, rue Garancière
Paris 6e
1 mars 1908
Pages 207-228
Louis Batifol - Une présidente de province au dix-huitième siècle
À Toulouse, entre l'église Saint-Étienne et la place du Salin, s'étend un quartier vieillot, propret et mal pavé. C'est l'ancien quartier occupé jadis par les membres du Parlement de Toulouse et habité aujourd'hui par leurs descendants. Les rues sinueuses et tranquilles sont bordées d'antiques hôtels dont quelques-uns ont des détails exquis de la Renaissance. Derrière de grandes façades muettes, sur des cours grises, un peu sombres, que quelques plantes grimpantes égaient vaguement de feuilles vertes remuant de loin en loin, sont de grands appartements silencieux, tapissés de vénérables portraits d'ancêtres et meublés de fauteuils de style fanés. On y vit de souvenirs. L'attention est seulement troublée par le bruit exceptionnel de quelques « citadines » roulant sur le pavé inégal de la rue, et l'oreille caressée par le tintement mélancolique d'une cloche de couvent du voisinage ou le son argentin des carillons de la métropole et de la Dalbade. A la place du Salin se dressent les constructions du Parlement de jadis, édifice du dix-huitième siècle, sans grand caractère, abritant encore les vieilles archives judiciaires de la compagnie disparue, et 80,000 sacs de [page 208] procès entassés. Mais les habitants du quartier ne connaissent plus cette maison aujourd'hui entre les mains des magistrats de la République. À l'autre extrémité restent toujours debout le grand clocher en brique rouge de la cathédrale Saint-Étienne, sa nef romane immense, son chœur élancé et superbe, où se déroulent des cérémonies pontificales pleines de consolation pour les natures méridionales qu'attriste le malheur des temps. Ici, les descendants des conseillers du Parlement sont toujours chez eux ; ils y viennent quotidiennement ; ils veillent à ce que les portes fermées ne laissent pas entrer quelque mauvais air moderne troublant l'atmosphère recueillie de moyen âge qu'on respire dans le magnifique édifice taché de poussière. Gardiens respectueux des traditions du passé, aimant le parfum de l'antique église, mélange d'encens, d'humidité et de moisi, ils conservent précieusement les idées de leurs aïeux de 1817.
Ceux de l'époque de Louis XV étaient un peu différents. Ils étaient de leur temps, c'est-à-dire légers, charmants et frondeurs. Avec l'opposition parlementaire, surtout au moment du chancelier Maupeou, ils traitaient cavalièrement les ordres du roi ; inspirés de Rousseau et de Voltaire, au moins atteints par leurs doctrines, ils parlaient de la religion d'un ton insuffisamment pénétré. Les « épreuves » de la Révolution ont été une dure école. Leurs petits-fils se sont recueillis et ils ont blanchi leur âme ils l'ont même empesée. Il y a contraste avec les sémillantes silhouettes, gaies, joyeuses et spirituelles des grand'mères qui, dans leurs cadres d'or accrochés aux murs, sourient toujours de leurs petites bouches moqueuses.
Sur la place Saintes-Scarbes, au coin de plusieurs rues étroites fermées de hautes murailles et hérissées de cailloux pointus, s'élève l'hôtel du Bourg. C'est le logis [page 209] d'une respectable famille d'anciens conseillers et présidents du Parlement qui vint d'Auvergne à Toulouse vers le quinzième siècle et depuis ne l'a jamais quitté. Au dix-septième siècle, par un mariage avec la petite-fille de Riquet, l'auteur du canal du Midi, elle entra en possession du château de Rochemontès, une construction Louis XIII à tourelles, surplombant du haut d'une falaise de trente mètres la Garonne qui coule doucement au milieu de- ses peupliers, là-bas au nord de Toulouse, dans la direction de Grenade. Le site est agréable. De la terrasse bordant la falaise, la vue s'étend sur toute la plaine du Toulousain, molle, ondulée, poussiéreuse et recuite par le soleil d'été, avec, pour perspective, au fond, l'élégante flèche de la basilique Saint-Sernin. Le château est environné d'un parc à la française, Louis XIV, inévitablement tracé par Le Nôtre. Les conseillers du dix-huitième siècle allaient passer là leurs vacances judiciaires et y envoyaient leurs enfants prendre l'air.
Le 11 juillet 1745, M. Valentin du Bourg, conseiller à la grand'chambre du Parlement de Toulouse, épousait Mlle Élisabeth d'Aliez, nièce de M. de la Croix de Castries, coadjuteur de l'archevêque d'Albi, lequel bénissait le mariage. Quelque vingt-cinq ans plus tard, le conseiller était nommé président à mortier du même Parlement et appelé à diriger la troisième chambre des enquêtes. La conseillère devenait Mme la présidente.
C'était une femme charmante de beaux yeux, grands et expressifs, un joli front, un ovale de figure fin et distingué, si tant est que le nez fût un peu fort et la bouche pas très élégamment dessinée, elle pouvait passer pour une créature agréable ; mais surtout elle avait un esprit ouvert, curieux, attentif aux idées ; elle causait d'une façon délicieuse elle était maîtresse de maison accomplie. Ayant tout ce qu'il fallait pour [page 210] devenir le centre d'un cercle mondain, elle réussit. Magistrats et gentilshommes se pressèrent dans son grand salon de la place Saintes-Scarbes que dominait- et que domine encore -le portrait immense d'un Antoine du Bourg qui a été chancelier du roi François Ier. On se fit fête d'être invité à Rochemontès pour assister à ses réceptions brillantes. Elle était en même temps épouse parfaite elle eut vingt enfants.
Quoique habitant loin de Paris et n'allant jamais à la cour, le méridional Languedoc est presque, par rapport à Versailles, un autre continent, elle était très informée de ce qui passionnait le public parisien. Tout autour d'elle on suivait. Chacun prenait parti avec ardeur ; loin d'être en retard d'une année et d'une idée, il semblait qu'elle se fît un point d'honneur de témoigner de sa liberté d'esprit par une rapide compréhension des nouveautés les plus hardies. Au moment de la lutte des Parlements contre l'autorité royale, elle se jeta à corps perdu dans l'opposition, colportant les épigrammes, commentant les remontrances avec animation, poussant aux délibérations agressives ; elle y gagna, elle et son mari, un exil de trois ans à Rochemontès, d'où, heureusement, la chute de Maupeou la fit revenir. « Nous reprendrons possession de la place Saintes-Scarbes, lui écrivait gaiement le procureur général de Rességuier ; j'aurai un grand plaisir, madame, de vous y trouver et d'être à portée de jouir de votre société. J'espère que vous n'attendrez pas le dernier moment pour venir à Toulouse (1). »
Elle rentra avec joie.
Elle était tenue au courant du mouvement des idées à Paris par des correspondances régulières avec des [page 211] amies amusées comme elle, curieuses comme elle, mais plus indépendantes encore et délibérées. La principale était la marquise de Livry., ancienne amie d'enfance, -fille de M. de Maniban, premier président au Parlement de Toulouse, que les hasards de la vie avaient mariée à un maître d'hôtel du roi, colonel du régiment du Perche, M. de Livry. Chaque quinze jours, les deux femmes échangeaient leurs impressions ou leurs nouvelles, parlant de tout et de tous, affaires politiques, chiffons ; se communiquant des édits, des recettes, des titres de livres, des opinions motivées, toujours d'un ton vif, spirituel, léger et désordonné. L'une et l'autre étaient philosophes. « Si vous lisez souvent Platon, écrivait Mme de Livry, vous parviendrez à radoter tout le reste de votre vie. » Dès qu'une œuvre de Voltaire paraissait, elles se la communiquaient, surtout si elle était interdite. « Je n'ai pu encore avoir les commentaires de Voltaire sur la Bible, mandait la Parisienne ; deux ou trois colporteurs ont été mis en prison pour en avoir vendu. » Mais c'était surtout J.-J. Rousseau qui était leur passion. Elles se disaient avec attendrissement ses moindres mots, ses moindres faits et gestes. L'engouement de la présidente pour l'auteur de l’Émile fut tel qu'elle prit résolument le parti d'élever un de ses vingt enfants, le dix-neuvième, Bruno, selon les principes et la méthode du maître. Malheureusement, sur ces entrefaites, le petit bonhomme tomba gravement malade et le projet n'eut pas de suite.
Avec Rousseau, un autre objet d'enthousiasme fut le baquet de Mesmer, le mystérieux spécifique, si troublant, si singulier. La présidente expliquait à ses amis, alarmés de ses hardiesses ingénues, qu'elle ne s'occupait que des moyens de guérir les malheureux : « Vous êtes une mère de miséricordes », lui répondait quelqu'un. Elle lut tout ce qui parut sur la question ; elle envoya même un de ses fils, Joseph, à Paris, pour [page 212] questionner le héros, le grand homme, Mesmer. Un élève émérite du physicien, le comte de Puységur, gentilhomme de l'Albigeois, fut reçu chez elle, expliqua, parla. Elle avait dans son grand salon un baquet, un vrai baquet ; et toute la société, entraînée par cet exemple, accourait assister aux phénomènes, écoutait jaser les somnambules, se laissait endormir « Quelle drôle de chose, trouvait un assistant, que quelqu'un sache tout quand il dort et plus rien quand il est éveillé ! » La vive et spirituelle présidente, du fond de son grand hôtel de la place Saintes-Scarbes, perdue dans le Languedoc, vivait aussi étroitement de la vie aimable de son temps et de son siècle que si elle eût habité au milieu de Paris.
Ceux qui l'entouraient faisaient comme elle. Société charmante et étourdie. Chacun tenait sa place, mais la tenait exactement, avec les qualités et les défauts de la fonction, sans rien voir des nuages qui montaient à l'horizon, sans deviner qu'une foule d'idées auxquelles ils étaient attachés étaient à la veille de devenir ou de paraître fausses et inutiles. Un des plus agréables de ces amis de l'entourage était l'évêque d'Agde, M. de Saint-Simon de Sandricourt.
Sorti d'une bonne famille de Lorraine, M. de Saint-Simon de Sandricourt était un de ces prélats de l'époque Louis XV, qui savaient être en même temps hommes du monde, philosophes, gens pleins de bon sens et esprits fins et ironiques. Peu dévot, mais d'un sentiment religieux aussi suffisant que possible pour un évêque, il était fort au courant de la littérature du jour, et se piquait aussi d'être savant en toutes matières ecclésiastiques. Sa vie était irréprochable. Il parlait et écrivait en homme d'une correction parfaite, bien élevé, tenant son rang. Son écriture est élégante, régulière, très propre ; son orthographe, impeccable. On se le figure constamment rasé de frais, la perruque [page 213] poudrée légèrement, les mains toujours blanches, les manchettes éclatantes de blancheur, écrivant sans remuer un pli de la figure, très droit devant sa table. À un haut degré, il est représentatif d'un clergé pontifical qui ne conçoit pas d'état social autre que celui qui existe, appuyé inébranlablement sur les deux bases essentielles, le trône et l'autel. Il défend cet ordre dont il bénéficie et qui le protège ; il blâme tout ce qu'il devine de nature à en compromettre la stabilité. Il est une pierre de l'édifice, un rouage de l'organisme ; avec cela pas sot, pondéré, bien informé, voire même non dépourvu de nuances. La lettre suivante qu'il écrivait le 15 mars 1774 à la présidente, en réponse à une missive dans laquelle celle-ci témoignait d'un enthousiasme exubérant et imprudent pour Helvétius, témoigne d'une manière admirable de cet état d'esprit.
« Je ne peux pas être de votre avis sur le livre d'Helvétius, mande l'évêque ; il est essentiellement mauvais, ruinant la révélation et ôtant tout sentiment de religion. Je conviens bien qu'il peut y avoir de bonnes choses, des idées fort justes sur bien des points, mais il y en a encore plus de mauvaises. Ce livre est justement condamnable et condamné par les deux puissances. Franchement, vous faites mal de le lire ; votre présomption à cet égard est téméraire. Le poison empoisonne toujours, quelque tournure ou tempérament qu'on y mette. Vous dites que ce sont des dévots qui le condamnent ; je vous assure que c'est la raison ; qu'en paraissant raisonner, il raisonne assez mal pour renverser le trône et l'autel et que les hommes seraient bien à plaindre si l'évangile d'Helvétius devenait la règle des mœurs et des sociétés ce serait une société horrible. Je ne suis pas dévot. J'aime ma religion par principe autant que par état ; je fuirai toute ma vie Helvétius et son très mauvais livre. Je vous exhorte [page 214] à faire de même et à comprendre que c'est le langage de la raison car elle suffit pour montrer et faire détester les abominations de toutes espèces qui résultent aujourd'hui de cette nouvelle morale devenue très commune. »
Lorsque arrivèrent les mouvements d'idées du règne de Louis XVI, les grands mots des économistes, les appels de liberté et de droit, le bon M. de Saint-Simon s'effraya du délire des foules, il trembla : il assurait la présidente que pourtant la religion suffisait à tout. « La liberté ! la liberté ! s'écriait-il dans une lettre du 9 avril 1770 ; mais les révoltes des paysans et des vassaux sont journalières, mais le peuple armé contre les seigneurs sera bientôt capable de tout ! D'ailleurs, pendant qu'on crie de toutes parts à la liberté, on éprouve tous les jours des voies de fait qui paraissent inimaginables. Le prince de Conti disait aux Chambres assemblées (du Parlement) : « La liberté dont on nous parle est celle de faire tout ce qu'on veut. » Il est pourtant vrai que le mépris de la religion est le plus grand malheur de l'État. Il ne faut pas de superstition, mais bien un culte public qui soit respecté. Tout peuple qui s'en est écarté s'est perdu. » Exquise société que celle qui se contente ainsi d'une tenue extérieure décente avec de la dorure et des formes de respect, et où un évêque peut écrire dignement qu'il est religieux « par état »
Avec le temps, la douleur vint atteindre la spirituelle présidente et lui fit découvrir l'insuffisance de toutes les philosophies pour consoler sa peine. Au bout de trente-quatre ans de ménage uni et calme, le président, M. Valentin du Bourg, mourait. Sa veuve en ressentit une affliction profonde. Elle se retourna vers la religion ; elle demanda la piété et à la dévotion l'apaisement d'une plaie cruelle que les livres des encyclopédistes ne pouvaient panser. Mais, vive et ardente, [page 215] elle apportait dans ses nouvelles idées l'instinct d'action qu'elle avait eu dans les autres. Elle écrivit à Mme de Livry des lettres combatives dans lesquelles elle prenait à partie maintenant ceux qu'elle avait autrefois trop goûtés, Voltaire et Rousseau. Elle recevait de l'autre, demeurée sceptique, insouciante, une réponse polie et contenue, mélangée d'une vague nuance d'ironie légèrement impertinente et détachée « Je vois avec plaisir, ma chère présidente, que vous êtes entièrement tournée vers la dévotion et qu'elle est déjà pour vous une consolation dans tous les événements de votre vie. Je voudrais bien pouvoir penser comme vous. Ce n'est pas que j'aie des chagrins qui aient besoin de consolation. Si je vis encore quelque temps, j'aurai celui de voir la décadence de mes forces et de ma santé. Quand je serai dans cet état-là, ce sera une espèce de consolation pour moi de pouvoir l'offrir à Dieu. Jusqu'à présent, je ne me sens aucun penchant à changer de façon de penser. Vous seriez bien capable d'opérer ce miracle ; malheureusement pour moi, nous sommes bien éloignées l'une de l'autre ; il n'y a pas d'apparence que j'aie jamais le plaisir de vivre avec vous. Je m'en dédommage en vous écrivant souvent. » La présidente allait vieillir doucement, tout appliquée à suivre ses nombreux enfants qui grandissaient et se dispersaient. Sur les vingt, elle avait eu deux fois deux jumeaux.
C'était une petite troupe fort gaie que celle de ces enfants, s'amusant follement sur la terrasse de Rochemontès ou dans les allées de buis du parc, rieuse, spirituelle, parfois assez drôle, tout à fait ancien régime.
L'aîné, Mathias, appelé pompeusement M. de Rochemontès, devait avoir les honneurs et la fortune. On lui avait donné un précepteur spécial, M. Terrade, prêtre du diocèse d'Auch ; il était destiné à la magistrature. Dès que son père fut devenu président, on [page 216] s'empressa, bien qu'il n'eût que dix-neuf ans et qu'il eût à peine pris ses premiers grades juridiques, de le proposer pour la charge de conseiller. Les anciennes règles défendaient que deux membres d'une même famille siégeassent dans un parlement. On fit adresser des pétitions au roi ; les influences agirent à Versailles, la dispense vint, et Mathias fut reçu conseiller, après quoi il alla finir ses études et passer le baccalauréat de droit devant M. Pierre de Compunaut, recteur de l'Université de Toulouse. Pourvu de ses parchemins, il entreprit un voyage en Italie, complément nécessaire depuis trois siècles de toute éducation soignée d'un jeune homme de bonne maison. La mère le suit dans ses pérégrinations. Elle a peur pour lui de tout, des brigands, de la malaria, des précipices ; elle l'interroge, s'informe. L'autre, esprit assez piquant, répond d'un ton badin, raconte ses aventures avec humour, se moque des jésuites et des cardinaux. Rentré à Toulouse, le jeune conseiller prit part avec fougue aux luttes parlementaires, se fit exiler comme son père. Afin d'occuper ses loisirs, il composa de longs travaux d'histoire inédits qui remplissent de grands cartons gris, après quoi il se maria avec une jeune fille intelligente et extrêmement riche, Mlle Jacquette d'Arboussier. « J'ai dit mon petit Te Deum de bon cœur », écrivait paternellement et gaiement le bon ami, l'évêque d'Agde, sans qu'on sût si sa joie tenait aux qualités de la fiancée, à l'excellence de sa race ou à la notable suffisance de la dot.
Quand on a vingt enfants et un patrimoine ordinaire, il faut que quelques-uns de la lignée se dévouent des filles entrèrent au couvent, trois garçons se firent chevaliers de Malte. Fondé autrefois pour combattre les Turcs, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem les regardait passer maintenant sur leurs caravelles du haut des remparts solides de la Valette à l'île de Malte. Les [page 217] biens immenses de l'ordre, jadis employés à la guerre sainte, servaient à constituer de confortables prébendes aux cadets -qui avaient besoin de vivre. On se faisait chevalier de Malte pour être religieux tout en restant militaire. Le chevalier ne se mariait pas, ou devait quitter l'ordre à la place, il avait de bons revenus, ce qui ne l'empêchait pas, d'ailleurs, de vivre le plus honnêtement du monde en dehors du mariage et du célibat ; le chevalier de Boufflers en a été un illustre exemple. Le jeune homme allait à Malte, faisait son noviciat, suivait « des caravanes » sur « les galères de la religion » ; après quoi, ayant théorie et pratique, rentrait dans son pays, toucher les revenus des bénéfices attribués, et servait dans l'armée du roi de France comme officier, si bon lui semblait.
Le numéro 2 de la présidente, Henri, partit ainsi. Il mourra jeune. Le numéro 18 suivit, Joseph, que Mme du Bourg appelle Josille. Il arriva à Malte pour être placé parmi les pages du grand maître, et celui-ci étant mort peu après, la première fonction publique du jeune Toulousain frais arrivé se trouva être de monter la garde autour du catafalque somptueux, afin de chasser les mouches de la figure jaunie du grand maître exposé. C'était un garçon vif que Josille, aux yeux noirs, doux et fort, aimable, plein d'entrain, très courageux. Sa mère l'aimait beaucoup. Il restera à Malte comme capitaine, puis major général, reviendra en France et n'ayant pas obtenu dans l'armée de Louis XVI le grade et le poste qu'il désirait, se retirera à Toulouse pour y être élu député de la noblesse du Languedoc aux états généraux de 1789.
Le numéro 19, Bruno, imita ses deux aînés. C'était le Benjamin de la famille, l'enfant choyé, celui sur lequel la mère attentive essaya la méthode d'éducation de Rousseau. Il partit à douze ans pour Malte rejoindre le précédent, Joseph, et alla s'embarquer à Marseille. [page 218] Retenu plusieurs jours dans le port par un contretemps quelconque, avant d'appareiller, il recevait de sa mère, inquiète de le voir dans une grande ville, oisif, cette lettre délicieuse d'une maman dix-huitième siècle parlant à un bambin de douze ans « Je désire, mon cher fils, que le vent ne vous retienne pas plus longtemps. Je tremble que les compagnies où vous allez ne vous donnent des doutes sur la religion. Je sais que Marseille est une ville remplie d'incrédules, parce qu'elle est pleine d'ignorants qui ne veulent pas s'éclairer. J'espère que, si vous vous rappelez ce que vous avez entendu ici, ce que votre frère le chevalier (de Malte) a fait, doit prouver que l'on ne trouve son bonheur que dans Dieu : il est très pieux et très éclairé ; aussi est-il heureux. Voilà, mon cher fils, mon avis pour le séjour de Marseille, qui me fait trembler ; je ne pense pas sans frémir que votre foi et vos mœurs sont en danger toutes les bonnes âmes de Toulouse sont en prière pour vous ! « La foi et les mœurs » d'un moutard de douze ans menacés par un séjour de quelques heures à Marseille, voilà évidemment de quoi alarmer toutes « les bonnes âmes » du monde ! La présidente convertie, jadis férue de Voltaire et de Rousseau, maintenant à de tout autres principes, prépare insensiblement les idées de la Restauration.
Les trois entrés dans la religion de Malte étaient pourvus ; un quatrième cadet se tira d'affaire en se destinant aux ordres, ou du moins on l'y destina dès la première heure, et le petit, Philippe, accepta sans rien dire. Avec des parents bien en cour, pensait la famille, prélats influents, et des amis actifs, on parviendrait bien à faire avoir à Philippe, de bonne heure, quelque bénéfice lucratif en attendant la mitre et la crosse. Il était de son rang et de sa situation sociale d'être couché sans tarder sur la liste des bénéfices. En tout cas, « il serait d'Église ». L'état se trouvait ainsi [page 219] assuré. Philippe reçut la tonsure de l'archevêque de Toulouse d'assez bonne heure : il était clerc. Plein de zèle, il fut pieux, prit des airs graves. Il s'amusait à édifier de petits autels sur lesquels il s'essayait à dire la messe. La famille était charmée. Elle l'appelait déjà « M. l'abbé du Bourg ». L'enfant n'était pas bête. Il avait même un fonds d'esprit assez imprévu. À douze ans il écrivait à son petit frère Bruno, âgé de deux ans, la jolie lettre suivante, datée de Rochemontès où on avait Installé toute la bande trop encombrante à Toulouse, Bruno, tout petit, et l'aîné, M. de Rochemontès, étant momentanément à la place Saintes-Scarbes.
« À M. Bruno, frère de M. de Rochemontès, son frère, seigneur en dernier rang des lieux de Clapes-sarde, Chante Lausetous, Kyrieleison et autres places, à Toulouse. Ce 4 novembre 1763. Nous avons appris avec plaisir, notre cher et dernier frère, que vous vous portiez bien et que vous alliez toujours croissant en fraîcheur et gaillardise ; nous en sommes tous joyeux ; voilà ce que c'est que d'avoir une parfaite nourrice. L'intérêt que nous prenons à ce qui vous regarde doit vous engager à agir pour nous dans le besoin. M. de Rochemontès, lorsqu'il nous quitta, nous fit des promesses qu'il n'a point tenues, et certes ce n'est pas bien. Il devait envoyer à Lolote un pâté chaud ; à Victoire, des échaudés ; à la jumelle un plat de caillé ; au jumeau un plein pot de crème, à Josille une croustade de pigeons, et à moi (qui suis abbé) une crème au chocolat ; il a manqué à sa parole. Représentez-lui, dans votre langage, que cela ne convient pas à un honnête homme. Parlez-lui bon français pour qu'il vous entende. Ce faisant, vous saurez que, pour humecter le tout, nous boirons à votre santé. Nous vous prions d'embrasser papa et de le chasser de sa prison (sa chambre où il est malade). Embrasse aussi [page 220] maman, la bonne maman, la tata de Bioule, la tata de Caylus et autres (2) ».
(Signé : l'abbé DU Bourg et communauté rochemonteloise.)
À peine eut-il le moindre âge canonique qu'on se mit à chercher pour lui une prébende. Il y avait nécessité. La famille n'était pas des plus riches et l'éducation de tant d'enfants assez lourde. On se démena : ce fut sans succès. En vain le coadjuteur de l'archevêque d'Alby, M. de Castries, tâcha d'avoir pour l'enfant un canonicat dans le chapitre de Brioude ; il n'aboutit pas. En vain l'évêque de Vabre, Jean de Castries, agit de son côté. Il n'obtint rien. Il promettait bien une place de vicaire général chez lui quand il y en aurait une vacante, ou une stalle de chanoine dans sa cathédrale dès qu'un décès se serait produit ; mais les membres de son chapitre ne voulaient pas mourir. « M. votre fils, écrivait l'évêque à la présidente, aura plus que l'âge compétent pour posséder un canonicat dans une cathédrale : il suffit d'avoir quatorze ans. Je regarderai comme un des plus beaux jours de ma vie celui où je pourrai lui donner une marque de mon amitié ». Ce qui était aimable, mais insuffisant. Et puis Vabre n'était pas un paradis.
En attendant, la famille fit le sacrifice d'envoyer le jeune clerc à Paris, au collège d'Harcourt, continuer ses études. Il y trouva tout gris, la maison morose, les gens froids. II fut triste ; pour se distraire, il joua du violon. Où était le clair soleil de la vallée de la Garonne, son ciel ouvert et aéré, et les mille bruits des insectes [page 220] sifflants dans les après-midi implacables de l'été ? Ses humanités finies, il passa à la Sorbonne afin d'y étudier la théologie, prit pension chez les pères de l'Oratoire du séminaire de Saint-Magloire. Et la prébende n'arrivait toujours pas. Malgré les efforts répétés de la famille pour soulager le poids de frais un peu lourd d'une vie d'étudiant même ecclésiastique, la bienfaisante nomination se faisait attendre. Les insuccès répétés devenaient inquiétants. Le jeune du Bourg fut ordonné prêtre et rentra à Toulouse. Enfin, un chanoine de la cathédrale Saint-Étienne consentit à lui abandonner sa prébende, et, le 14 décembre 1775, M. Philippe du Bourg fut, dans les formes réglementaires, installé membre du chapitre de la métropole toulousaine. Il sera, plus tard, avec le Concordat, évêque de Limoges.
Ainsi l'hôtel de la place Saintes-Scarbes se vidait peu à peu. La présidente, toujours et de plus en plus adonnée aux bonnes œuvres, convertissait des juifs, vieillissait. La société s'éclaircissait autour d'elle préoccupation des temps qui devenaient sombres, éloignement progressif des mondains à l'égard d'une maîtresse de maison vieillissante et dévote. Les conversations vives, détachées et souples sont malaisées avec une respectable personne qui tremble toujours pour la foi et les mœurs du prochain. Sur quoi la tempête de la Révolution arriva.
Il est rare, quand on parle d'une famille de la fin du dix-huitième siècle qui a le moins du monde joué un rôle dans la société, de ne pas arriver à des hécatombes pendant la Terreur. Ceux qui ont eu le prestige et les dignités sociales de l'ancien régime les payent ce fut le sort des du Bourg.
Pendant la tourmente la présidente attristée demeura dans son grand hôtel. Son fils Mathias, le conseiller, ne la quitta pas, ainsi que sa propre famille, femmes et [page 222] enfants. Il avait pour expliquer sa présence à Toulouse une théorie juridique élégante et courageuse. Il disait que, nommé magistrat par le roi, il ne pouvait quitter son poste sans congé de son souverain. Or la Révolution avait supprimé les parlements, et Louis XVI, enfermé au Temple, était occupé par bien autre chose que la régularisation de l'état du conseiller du Bourg. Celui-ci n'admit pas la destruction de sa compagnie judiciaire non confirmée par Sa Majesté et resta fidèle. L'abbé du Bourg, le chanoine, était là aussi. Mais, dès la première heure, chargé par son archevêque, parti, de diriger le diocèse en son absence, il était poursuivi, traqué, et dut quitter la place Saintes-Scarbes afin d'aller se cacher à droite et à gauche dans des recoins perdus. Joseph et Bruno, les deux militaires, les deux chevaliers, avaient, eux, émigré. Il s'étaient retirés en Espagne où ils avaient rejoint un corps d'émigrés en armes. Deux fois l'hôtel du Bourg fut envahi, cerné, fouillé de fond en comble pour trouver le chanoine qui, au surplus, était ailleurs. L'abbé venait de nuit, déguisé, frôlant les murs, évitant le veilleur de nuit qui alors et encore aujourd'hui dans les anciens quartiers parcourait de son pas sonore et régulier les rues désertes afin de crier d'un ton lugubre, sur deux notes descendantes le renseignement dont autrefois, sans doute, on avait besoin en dormant « Une heure est sonnée ! La vieille mère ne vivait pas, au milieu des transes mortelles que lui faisait subir pareille vie. Un beau jour, en avril 1793, une troupe nouvelle fit irruption dans l'hôtel, et vint arrêter Mathias sous l'inculpation d'avoir été membre de l'ancien parlement. Il ne devait pas être gardé longtemps heureusement : on le relâcha peu après.
Que devenaient les autres, ceux qui étaient là-bas, en Espagne, dans les montagnes ? La présidente n'en avait aucune nouvelle. Les deux chevaliers, encore [page 223] plus inquiets, ne recevant pas de lettres, se demandaient avec anxiété ce qui se passait à Toulouse : mille bruits venaient de France, inquiétants, terribles. Finalement, Joseph coiffant un chapeau de paysan, s'enveloppant d'un grand manteau, franchit les Pyrénées et arriva à cheval à Toulouse, voyageant de nuit, évitant les bourgs, se cachant le jour dans les bois. Ce fut une surprise, un soir, à la place Saintes-Scarbes, lorsqu'on le vit. Il leur proposa de partir tous pour l'Espagne. Mathias refusa, invoquant ses scrupules ; la présidente n'eût pas été en mesure d'entreprendre pareil voyage. Force fut à Joseph désolé de s'en retourner seul. Le retour fut plus dangereux que l'aller. Au milieu des Pyrénées, il fut suivi de gendarmes qui trouvaient le voyageur louche. Il pressa le pas les gendarmes prirent le galop. Au moment d'être atteint, Joseph abandonna sa monture afin de grimper sur une petite hauteur devant lui s'étalait un glacier étincelant qui dévalait d'une pente rapide vers la ligne de frontière : il se mit à califourchon sur sa valise, et d'un vigoureux coup de pied se lança après une glissade affolée au milieu d'effrayantes culbutes, il parvenait à la frontière d'Espagne sans que ses poursuivants l'eussent atteint.
Pris et relâché une première fois, Mathias ne devait pas échapper à l'orage. Le 22 août 1793, une nouvelle visite domiciliaire aboutissait à son arrestation, toujours à titre d'ancien magistrat du parlement. Comme s'il avait prévu l'événement fatal, il avait écrit son testament la veille. Les adieux furent tristes, dans ce grand salon qui avait vu tant de fêtes joyeuses et animées. La présidente était anéantie au fond de son fauteuil, pauvre femme de quatre-vingts ans, aux cheveux blancs, aux lèvres tremblantes elle pleurait silencieusement en regardant partir ce fils qu'elle ne reverrait plus. Celui-ci embrassa sa mère, pressa dans ses bras tous ses enfants, dont le dernier venait de naître [page 224] quelques jours auparavant et avait reçu le nom de Philippe-Fleur, - la fleur allait être bientôt fauchée, - puis, d'un pas délibéré, il sortit. II avait à peine franchi le seuil de la porte qu'un de ses jeunes frères, Melchior, s'affaissait : une rupture d'anévrisme venait de l'emporter. La vieille présidente se courba davantage, secouée par ses sanglots : elle perdait deux fils en même temps. On écroua Mathias au couvent de la Visitation transformé en prison.
Puis, à la place Saintes-Scarbes, ce fut le dénuement complet. La famille n'était pas très riche avant la Révolution. Elle était maintenant dans la misère. Le 19 novembre 1793, une bande d'individus avait envahi Rochemontès, pillé, saccagé tout ; rien n'était resté : les meubles avaient été brisés, les tableaux lacérés, les œuvres d'art emportées, la cave ouverte et les barriques déménagées. La maison, victime d'une grande opération de brigandage, semblait abandonnée, toutes fenêtres ouvertes, comme livrée au délabrement du temps et à la ruine lente. On vécut à l'hôtel du Bourg pauvrement, sans quitter ce cadre témoin des joies des anciens jours. On utilisa tout ce qu'on put pour se procurer le pain quotidien et on travailla. L'industrie des chaussons de lisière, occupation aujourd'hui des prisonniers, fut le labeur ingrat de ces recluses morales, – il ne restait plus que des femmes et des enfants, pénible tache, peu rétribuée, rude à ces doigts aristocratiques qui n'avaient connu encore que les mille riens de la vie facile des mondains, et qui, s'il est vrai qu'il faille trois siècles d'oisiveté pour façonner d'élégantes et fines mains, rompait la prescription.
De jour en jour, on n'attendait que des nouvelles sinistres sur le compte de Mathias enfermé à la Visitation. Elles ne tardèrent pas. Le 1er floréal an II, six des anciens conseillers du Parlement de Toulouse, membres de la Chambre des vacations, montaient à l'échafaud. [page 225] Le 19, quatorze de leurs collègues, mis sur des chariots, partaient pour Paris entourés de gendarmes, afin d'aller trouver le tribunal révolutionnaire de là-bas, plus rapide et plus sûr. Ils mettaient vingt et un jours à effectuer le trajet et étaient écroués à la Conciergerie. Le 20, ce fut une nouvelle fournée de douze autres qui partit. Cette fois, Mathias était compris dans le nombre. Sa femme avait cherché par tous les moyens à obtenir la délivrance de son mari ; elle avait adressé une supplique à la société des Amis du peuple de Toulouse dans le style littéraire réclamé par le goût et le ton du jour « La citoyenne Dubourg. Citoyen président. Salut et fraternité. » Rien n'y avait fait. Grâce à des complaisances et à des dévouements obscurs, elle avait pu correspondre avec son mari, celui-ci lui écrivant sur des cartes à jouer, des bouts de papier ; se tenant au courant de la santé de ses enfants, de leurs travaux ayant la sérénité de mander à son petit garçon Armand « Je suis très content que tu aies repris tes études. Tu fais bien d'apprendre la géographie. Reprends aussi tes exercices. » Lorsque la nouvelle du départ pour Paris, c'est-à-dire - il n'y avait pas de doute à avoir - du dénouement fatal, fut connue, Mme du Bourg obtint l'autorisation de venir voir une dernière fois le condamné avec ses enfants. L'entrevue eut lieu dans le parloir des religieuses de la Visitation, derrière les grilles mises là pour les moniales et au moins privées de leurs rideaux. Ce fut une douloureuse scène. Les enfants regardaient, ouvrant de grands yeux, sans tout comprendre, mais instinctivement attristés comme en présence d'un événement grave. La présidente n'avait pu venir, cassée, brisée. Les derniers mots furent ce qu'ils pouvaient être, entre cet homme plein de santé, encore dans la force de l’âge, obligé de dire adieu à tant d'êtres chers, et cette femme, demain veuve, qui se séparait [page 226] pour toujours du père de ses enfants. Les grilles empêchaient le malheureux d'embrasser les siens. Mme du Bourg, avisant le tour des religieuses, eut l'idée d'y mettre une de ses petites filles, Joséphine : on la laissa faire. Mathias put presser dans ses bras un de ses enfants. Puis il disparut et Mme du Bourg rentra à l'hôtel Saintes-Scarbes défaillante de douleur.
Le 28 floréal, trois voitures emportaient vers Paris les magistrats destinés au supplice. Mathias était dans la première avec le conseiller de Miégeville, les présidents d'Aguin et de Fajac. Des gendarmes l'entouraient. Dès que le convoi eut quitté la ville par la porte Arnaud-Bernard, on vit un jeune garçon de quinze ans qui suivait dans la poussière, avec une obstination têtue de désespéré. C'était le fils de Mathias, Armand. Il courait, en nage, pleurant, résolu à venir jusqu'à Paris, et ne quittant pas des yeux la place où était son père. Les gendarmes eurent pitié. Ils le laissèrent monter : aux villes il descendait. Le voyage fut long. En route, les prisonniers auraient eu le moyen, la nuit, plusieurs fois, de se sauver. Ils refusèrent, comme les prisonniers de Quiberon, par un sentiment de point d'honneur délicat, un peu étroit et bien rigoureux.
Le 24 prairial, après un mois presque de route, au cours duquel Mathias avait été assez sérieusement malade à Orléans, le convoi pénétra dans Paris, et les magistrats furent écroués à la Conciergerie. Armand s'était réfugié chez un ancien domestique de la famille. L'attente n'allait pas se prolonger. Le 26 prairial, deux jours après, trente anciens parlementaires comparaissaient dans la salle de l'antique Grand'Chambre du Palais devenue le tribunal révolutionnaire sous le nom de « Salle de la Liberté ». Fouquier-Tinville déposait ses conclusions, demandant le dernier supplice contre les « ennemis du peuple ». Le jury opinait dans son sens et [page 227] le tribunal prononçait la peine capitale, exécutable, disait-il, dans les vingt-quatre heures. Séance tenante, la fournée fut conduite à la ci-devant place du Trône. La guillotine n'y était établie que depuis la veille. Ce fut un spectacle lugubre que celui de ces trente magistrats gravissant, chacun à leur tour, les fatals degrés. Mathias succomba à son rang, pendant qu'en bas, dans la foule, un enfant poussant un cri se trouvait mal. Le lendemain, Armand était conduit au coche par le vieux domestique dévoué, et rentrait à Toulouse afin de dire ce qui s'était passé. Le désespoir fut morne dans la demeure dénudée de la place Saintes-Scarbes. Les pauvres femmes au bout de leurs souffrances n'avaient plus de larmes. Les épreuves n'étaient pas finies pour elles.
Aux termes de la loi, toute condamnation à mort du genre de celle qui avait frappé Mathias entraînait la confiscation de ses biens. Le 30 prairial, les agents du fisc de Toulouse se présentèrent à l'hôtel Saintes-Scarbes afin de mettre la main sur l'immeuble et ce qu'il contenait, apposer les scellés, et disperser le tout aux enchères. Il ne restait à l'octogénaire présidente qu'à quitter le toit qui l'abritait encre, les derniers souvenirs de tant de morts déjà, les appartements où elle avait vécu heureuse. Où aller dans sa misère ? Touchés du sort lamentable de cette vieille femme presque impotente, les agents lui dirent qu'ils consentaient provisoirement à la laisser habiter le galetas. On la monta péniblement et on l'installa comme une pauvresse avec quelques débris de meubles, aidée de sa belle-fille. De tout le personnel domestique, une seule, dévouée, n'avait pas voulu quitter sa maîtresse et la soignait. C'était elle qui allait vendre dans les magasins les chaussons que la famille confectionnait afin de se procurer un peu de pain. Mais la mesure était comble. Douleurs, privations, misères, la présidente était à la [page 228] limite de ses forces. Doucement, comme une lampe qui s'éteint, quatre mois après, elle expirait, le matin du 4 novembre 1794, dans son galetas. Au-dessous, sur les murs du grand salon, le grand chancelier de François Ier demeurait impassible, et les gracieux portraits, sémillants, gais, des jolies aïeules, conservaient leur insouciant sourire.
Louis BATIFFOL.
![]() Source Gallica.bnf.fr / BnF : 1908 - Louis Une présidente de province au dix-huitième siecle, Louis Batifol
Source Gallica.bnf.fr / BnF : 1908 - Louis Une présidente de province au dix-huitième siecle, Louis Batifol