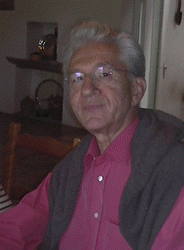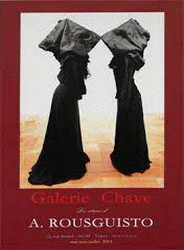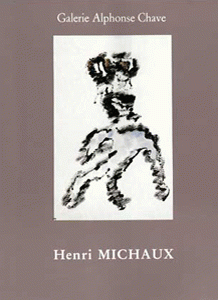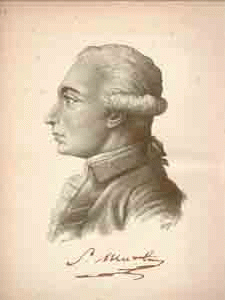Année 1901
Année 1901
La Fronde 4 août 1901
- Le « philosophe inconnu »
La Liberté, ANDRÉ GAUCHER
- Un chiffre fatidique
- Consultation du docteur Papus
- Le napoléonisme des tarots.
Les Partisans
- L'Œuvre Martiniste par R. SAINTE MARIE
La Nouvelle Revue
- AMOUR ASTRAL. Roman de Willy
La Révolution française
- Les loges maçonniques de Toulouse (de 1740 à 1870).
- Catherine Théot et le mysticisme chrétien révolutionnaire
Vte Charles de Spoelberch de Lovenjoul
- Sainte-Beuve Inconnu
L'Écho du merveilleux
- Les grands visionnaires : Claude de Saint-Martin par Emile Mariotte
La Fronde 4 août 1901 - Le « philosophe inconnu »
Courrier des lecteurs
J’ai entre les mains un volume portant ce titre : « Des erreurs et de la vérité, ou les hommes rappelés au principe universel de la science, » par un philosophe inconnu (à Edimbourg en 1775). Parmi les lecteurs de la Fronde, y a-t-il quelqu'un capable de me renseigner sur le nom de l’auteur ? Menko.
Réponse d'un Lecteur du Courrier
Le « philosophe inconnu » est Louis Claude de Saint-Martin, né le 18 janvier 1743 à Amboise, mort le 13 octobre 1803. Il fut élevé au collège de Pontlevoy ; mais il quitta le droit pour les armes. En garnison à Bordeaux, il fréquenta l'école secrète de Martinez Pasqualis, où l’on s'occupait d'opérations théurgiques. Plus tard il adopta la doctrine de Jacob Bœhm. En 1771 il quitta le service militaire pour s'adonner à la théosophie. Nommé professeur à l'École normale en 1794, il y attaqua les théories matérialistes de Garat.
L'ouvrage dont parle le correspondant de la Fronde, est celui où Saint-Martin a le plus complétement exposé ses idées
Dans le Tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l'homme et l'Univers le « philosophe inconnu » a essayé de découvrir l'ensemble des forces qui rattacheraient Dieu à l'homme, et l’homme à la nature.
Il a publié aussi un poème allégorique : le Crocodile, ou la guerre du bien et du mal, arrivé sous le règne de Louis XV, poème épico-magique en cent deux chants, par un amateur de choses cachées (Paris, 1799, in-8). Il y avait intercalé un mémoire de métaphysique où était traitée cette question mise au concours par l’Institut : « Quelle est l'influence des signes sur la formation des idées. » Saint-Martin concluait dans un sens opposé à la philosophie de Condillac.
Ses autres écrits sont : l'Homme de désir, (recueil d'élévation et de prières, 1790) ; Ecce homo (1792\ contre le charlatanisme du merveilleux ; le Nouvel homme (1792 ; Lettre à un ami sur la révolution française (1796), Eclair sur l'Association humaine (1797) ; l'Esprit des choses (1800); le cimetière d'Amboise, vers (1801) ; le Ministère de l’homme-esprit (1802) ; Œuvres posthumes (1807, 2 vol.)
UN LECTEUR DU COURRIER.
![]() Source gallica.bnf.fr / BnF : La Fronde 4 août 1901 - Le « philosophe inconnu »
Source gallica.bnf.fr / BnF : La Fronde 4 août 1901 - Le « philosophe inconnu »
 1901 - La Liberté
1901 - La Liberté
Auteur : André Gaucher
- Un chiffre fatidique
- Consultation du docteur Papus
- Le napoléonisme des tarots.
Un chiffre fatidique
Sous les mailles étroites du réseau des faits positifs, l'Isis apparaît quelquefois. L'Occulte veille. L'Invisible nous entoure et nous étreint. Sur des lignes obscures de journal, j'ai cru sentir passer, hier, le petit souffle de l'Esprit.
« Certains fidèles de l'Empire, prétend le Clairon du Drapeau, espèrent la restauration du régime de leurs rêves en 1907. Leur espoir repose sur ce faible raisonnement, qu'en additionnant 1907, on obtient le total 17, et que ce chiffre est fatidique dans la famille Bonaparte. En effet, l'ex-prince impérial, à la mort de son père, avait dix-sept ans et a été frappé en Afrique de 17 coups de zagaie ; les lettres qui forment le nom de Napoléon Bonaparte sont au nombre de 17 ; Napoléon III est né en 1808 (et 1808 additionné, égale 17) ; l'impératrice Eugénie est née en 1828 (et 1826 additionné, égale 17) ; de leur mariage (1853) à leur déchéance (1870) dix-sept années s'écoulent... Enfin, le prince Victor est né en 1862 et en additionnant vous aurez encore 17. »
![]() Lire la suite sur le site : 1901 - La Liberté. Auteur : André Gaucher
Lire la suite sur le site : 1901 - La Liberté. Auteur : André Gaucher
1901 - Les Partisans
Revue de combat, d'art, de littérature et de sociologie,
bi-mensuelle illustrée
Sous la direction de MM. Paul Ferniot et Paul-Redonnel
La Maison d'art
Paris
20 janvier 1901, n° 6, pages 274-276
L'Œuvre Martiniste par R. SAINTE MARIE
Voilà qu'en cette fin du dix-huitième siècle après que les philosophes, les encyclopédistes, les illuminés vengeurs du temple ont jeté les ferments qui feront la mort de la vieille société ; après que théistes, panthéistes et sceptiques ont posé les bases de cette Babel dont le septième degré sera matérialiste, voilà qu'un petit officier vient de Bordeaux pour renouveler le monde.
Pendant qu'il exerçait là-bas la nonchalance du métier où son rang l'avait mis, il a connu cet homme étrange, Martines de Pasqually. Qui dira les entretiens du maître et de l'élève ? Quelles secrètes conversations furent les leurs ? Et quelle extraordinaire vision, celui qui savait appeler les êtres de l'au-delà, déroula-t-il aux yeux éblouis du jeune Louis-Claude de Saint-Martin ? Héritier et adaptateur des doctrines Swedenborgiennes, Martines se reliait à l'immense chaîne d'ininterrompue tradition qui unit les noms de Ram et de Krishna, à ceux de Moïse et d'Orphée, pour, avec le rayon vital du Dieu Incarné, aboutir à l'initiation Christique, Saint-Paul et Saint-Jean, Valentin, les Voyants mystiques, puis les Rose-Croix, Boehme et Swedenborg. Et sur la parole de ce maître, ce jeune homme qui commandait à vingt-deux ans, jugea qu'il lui fallait servir sous un autre drapeau, une autre patrie plus grande que la France.
![]() Lire la suite sur le site : 1901 - Les Partisans, L'Œuvre Martiniste
Lire la suite sur le site : 1901 - Les Partisans, L'Œuvre Martiniste
 1901 – La nouvelle revue
1901 – La nouvelle revue
La Nouvelle revue
Vingt-deuxième année (Nouvelle série)
Tome VIII – Janvier – février 1901
Paris.
Administration et rédaction
26, rue Racine
1901
AMOUR ASTRAL. Roman de Willy. Chapitre VI - Extrait, page 387
Tout à fait exquis !
Dernière scène, enfin l'Humanité célèbre son salut par une grande fête qui se déroule à travers le Champ-de-Mars transformé en jardin fleuri. L'atmosphère cordiale et pompeuse d'autrefois renaît. Orphée culmine sur un trône, entouré des maîtres de l'occultisme. Dans les airs, les âmes des adeptes désincarnés forment des chœurs. Tout en haut, brille, comme un soleil ; le signe de l'absolu, le pantacle universel du martinisme.
Enogat déclara
Incomparable cher maître, ineffable Nicolas Flamel n'aurait pas mieux trouvé
Ça laisse bien loin en arrière les choses de James Tissot.
Certes, pour ne pas comprendre, après l'examen de ces fresques, qu'Orphée symbolise l'occultisme, il faudrait être…
M. Chincholle dit Neurocyme.
M. Bouguereau, dit Léonidas. Puis ils demeurèrent silencieux, un moment, et pensifs. Le soir venait, nuançant l'atelier de toute la gamme adorable du mauve. C'était l'heure où Sabas et les autres lions symbolistes vont boire. Et, soudain, levant sa main frêle et si blanche vers les ébauches Mon cher maître, prononça musicalement Neurocyme, la conception d'une telle œuvre vous fait nôtre. Oh ! désormais, vous nous appartenez. Il ne tient plus qu'à vous de recevoir l'initiation.
Alors, le flamine eut un mouvement de tète olympien. Et ils s'en furent dîner.
![]() Source gallica.bnf.fr / BnF : 1901 – La nouvelle revue - AMOUR ASTRAL. Roman de Willy
Source gallica.bnf.fr / BnF : 1901 – La nouvelle revue - AMOUR ASTRAL. Roman de Willy
 1901 - La Révolution française
1901 - La Révolution française
Revue d’histoire moderne et contemporaine
Publiée par la Société de l'histoire de la révolution
Directeur rédacteur en chef A. Aulard
Tome quarantième
Janvier-juin 1901
Paris, au siège de la Société, 3, rue de Furstenberg
1901
Les loges maçonniques de Toulouse (de 1740 à 1870). I. – Les loges toulousaines sous l’ancien régime. J. Gros.
Mars 1901. Extrait, page 249
Les vingt années qui précèdent la Révolution sont éminemment favorables à l'éclosion des sociétés secrètes. Le progrès des idées philosophiques dans les esprits, le malaise des âmes font rechercher avec avidité ces réunions de petits groupes fraternels. Sur douze loges toulousaines existant en 1789, neuf ont été fondées pendant cette période : la Saint-Jean d'Écosse, 1772 ; les Vrais Amis, 1773 ; les Élus de Chartres, 1774 ; les Cœurs réunis, 1774 ; la Parfaite Amitié (résurrection de l'Amitié), 1781 ; la Paix, 1781 ; les Sciences et les Arts libéraux, 1185 ; la Vérité reconnue, 1786 ; l'Encyclopédique, 1787.
Un moment, le souffle mystique passa sur elles. Un enchanteur, le Suédois Swedenborg, avait paru : par le travail et la bonté, enseignait-il, l'homme arrive à reconquérir peu à peu sa grandeur première ; son intelligence devient plus haute et pénètre les mystérieuses sciences hermétiques qui lui révèlent les secrets du monde et de la vie ; son âme s'épure, un souffle divin la soulève ; il est élu, il converse avec les esprits et entre insensiblement dans la nouvelle Jérusalem. Ce mysticisme fut précité par Saint-Martin, le Philosophe inconnu ; par dom Pernety, bénédictin, alchimiste et voyageur, qui fonda la secte des Illuminés d'Avignon ; et par le juif portugais Martinez Pasqualis, qui l'introduisit lui-même dans les loges de Toulouse vers 1760. La Sagesse et plusieurs autres loges devinrent de petites églises swedenborgiennes.
![]() Source gallica.bnf.fr / BnF : La Révolution française. Mars 1901 - Les loges maçonniques de Toulouse (de 1740 à 1870).
Source gallica.bnf.fr / BnF : La Révolution française. Mars 1901 - Les loges maçonniques de Toulouse (de 1740 à 1870).
Catherine Théot et le mysticisme chrétien révolutionnaire (1). A. Mathiez
Juin 1901. Extrait, page 481
Les années qui précédèrent la Révolution furent marquées par une crise de mysticisme qui, sous des formes un peu différentes, gagna toutes les classes de la société. Tandis que les gens du monde, qu'une duchesse de Bourbon, par exemple, demandaient les secrets de l'avenir et l'explication de l'univers aux rêveries de Swedenborg et de Saint-Martin ou aux pratiques magiques de Cagliostro et de Mesmer, les humbles, — artisans, laboureurs, domestiques, — se réunissaient autour de prophétesses de rencontre, d'une Suzette Labrousse ou d'une Catherine Théot, qui, les livres saints en mains, leur annonçaient de prochains cataclysmes d'où sortirait une humanité nouvelle, régénérée par la justice et par l'amour. Comme aux temps de la Réforme, le catholicisme ne suffisait plus à remplir l'âme populaire. Jusque dans les cerveaux les plus obscurs,
Note (de l’auteur de l’article)
(1) Nous reproduisons ici, en l'accompagnant de notes documentaires et de pièces justificatives, une étude publiée dans la Revue de Paris du 15 avril dernier [page 857 et suiv.] et dont nous avons lu quelques pages à la séance solennelle de notre Société.
![]() Source gallica.bnf.fr / BnF : La Révolution française, juin 1901 - A. Mathiez : Catherine Théot et le mysticisme chrétien révolutionnaire
Source gallica.bnf.fr / BnF : La Révolution française, juin 1901 - A. Mathiez : Catherine Théot et le mysticisme chrétien révolutionnaire
 1901 - Lovenjoul - Sainte-Beuve inconnu
1901 - Lovenjoul - Sainte-Beuve inconnu
Vicomte Charles de Spoelberch de Lovenjoul (1836-1907)
Sainte-Beuve Inconnu
Paris
Librairie Plon
Plon-Nourrit et Cie, Imprimeurs-Éditeurs
8, rue Garancière
1901
XXXII - Extrait, pages 129-132
Le manuscrit de Sainte-Beuve s’arrête malheureusement ici. Il ne contient donc ni l’analyse du développement de la dernière passion d’Arthur, ni le récit de la trahison d’Élyse, ni enfin celui de la conversion définitive du [130] héros, après tant d’années d’expériences diverses suivies d’amères déceptions.
Le fait est d'autant plus regrettable que l'Arthur publié par Guttinguer en 1836 sur le même sujet est fort différent des pages qu'on vient de lire. Parlant en réalité de lui-même, l'auteur glisse beaucoup plus rapidement sur tous les faits racontés, afin d'arriver sans retard à la conversion de son héros. En revanche, plusieurs épisodes du livre n'ont pu prendre place dans le début de l'ouvrage écrit par Sainte-Beuve. S'il l'eût terminé, sa version les eût probablement contenus aussi. Mais elle eût été sans doute traitée d'une façon infiniment plus romanesque, aussi bien par les détails recueillis que par la forme qu'il leur eût donnée.
Guttinguer avait du reste remis de nombreuses notes à son ami afin de le guider au milieu de toutes les liaisons qu'Arthur mène de front et déplore tour à tour. Ainsi, la lettre autographe écrite de Rouen à Guttinguer par [131] celle qui dans le roman s'appelle Élyse, mais dont le nom véritable était Rosalie, — lettre à peine paraphrasée par Sainte-Beuve aux dernières pages de son travail, — est jointe au manuscrit de ce fragment.
Malgré son style suranné et ses incessants dithyrambes, l'Arthur de Guttinguer n'en demeure pas moins un livre fort curieux. Aussi, sous ces réserves, le jugement porté sur lui par le célèbre critique est-il encore tout à fait juste.
Nous avons déjà rappelé que, par suite de son extrême impressionnabilité, Guttinguer n'a pas attaché son nom à tous ses volumes. C'est ainsi qu'outre son premier Arthur, il mit au jour, non moins anonymement, un petit livre qui lui tint pourtant fort à cœur. Nous voulons parler de l'opuscule dont Sainte-Beuve, sous le titre de : Pensées choisies, de Saint-Martin, a fait mention dans son étude sur le Philosophe inconnu, étude qui fait partie du tome dix des Causeries du Lundi. [132]
Or, chose rare chez Sainte-Beuve, le titre cité par lui est inexact, et ce n'est pas sans peine que nous avons réussi à retrouver l'ouvrage dont il s'agit. C'est une mince brochure, sans aucun nom d'auteur, intitulée : « Philosophie religieuse. Premier volume. Saint-Martin. » Imprimée à Rouen, chez le même imprimeur que l'Arthur de 1834, elle parut à Paris chez le libraire Toulouse, en avril 1835, et ne semble avoir eu d'ailleurs aucun succès, ni aucun retentissement (1).
Note
(1) Voir le numéro 1866, dans la Bibliographie de la France du 4 avril 1835.
![]() Source gallica.bnf.fr / BnF : 1901 - Vicomte Charles de Spoelberch de Lovenjoul (1836-1907) : Sainte-Beuve Inconnu
Source gallica.bnf.fr / BnF : 1901 - Vicomte Charles de Spoelberch de Lovenjoul (1836-1907) : Sainte-Beuve Inconnu
 1901 - L'Écho du merveilleux - n°118
1901 - L'Écho du merveilleux - n°118
L'Écho du merveilleux
Revue bi mensuelle
Cinquième année – n°118
1er décembre 1901
Directeur : Gaston Mery (1866-1909)
Paris.
Les grands visionnaires : Claude de Saint-Martin par Emile Mariotte
Si l’on considérait l'humanité comme une suite de générations se tenant par la main, et que chaque génération fût représentée par un homme ayant vécu une moyenne de cinquante ans, on pourrait dire, presque sans hyperbole, avec le comte de Saint-Germain : « Je suis âgé de plusieurs siècles ; j'ai vécu dans l'intimité de François Ier je suis contemporain de Jésus-Christ ».
Il ne faut pas plus, en effet, de six existences d'hommes pour remonter à l'époque de Charles-Quint et quarante seulement suffisent pour se dire contemporain de l'ère moderne.
C'est ainsi, du reste, qu'on pourrait rassembler, comme au fond des temples initiatiques, les grands hommes, qui ont pu, depuis l'antiquité la plus reculée, se passer, de maître à disciple, le flambeau de la Science Intégrale qui a brillé à l'aube des premières civilisations pour se conserver de plus en plus étincelant, dans les groupes occultistes et ésotériques de nos jours.
Le dénombrement même n'en serait pas excessif, car en cette assemblée fraternelle de hauts esprits, on y verrait — pour n'en citer que quelques-uns — Saint-Germain converser avec Paracelse, Cagliostro coudoyer Albert-le-Grand, Swedenborg s'entretenir avec Platon, Le Pic de la Mirandole calculer avec Pythagore, Eliphas Levi prophétiser avec saint Jean, et Claude de Saint-Martin soutenir la théorie de l'Unité avec Hermès.
Or, d'Hermès à Saint-Martin, le cycle semblait clos, mais Saint-Martin en rouvrit un nouveau, avec une science plus développée qu'au temps des mystères d'Isis et dans lequel on arrivera peut-être à résoudre le problème de l'Inconnu.
![]() Lire la suite sur le site : 1901 - L'Écho du merveilleux : Les grands visionnaires : Claude de Saint-Martin par Emile Mariotte
Lire la suite sur le site : 1901 - L'Écho du merveilleux : Les grands visionnaires : Claude de Saint-Martin par Emile Mariotte