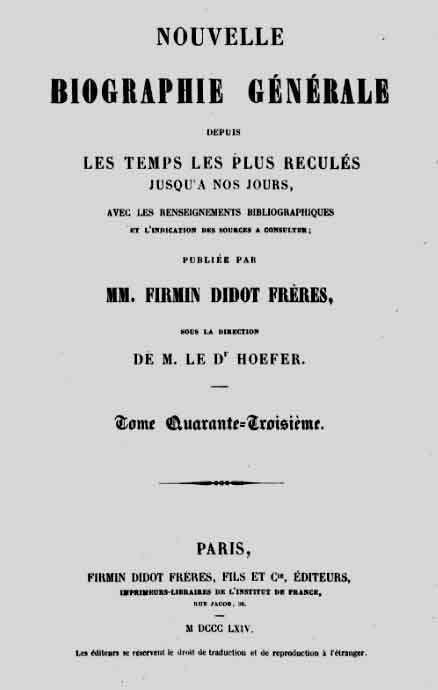 1864 - Hoefer – Didot – Nouvelle Biographie générale
1864 - Hoefer – Didot – Nouvelle Biographie générale
depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours avec les renseignements bibliographiques et l’indication des sources à consulter
Publiée par MM. Firmin Didot Frères
Sous la direction de M. Le Dr Hoefer
(Jean Chrétien Ferdinand Hoefer)
Tome 43
Paris
Firmin Didot Frères, Fils et Cie, Éditeurs
Imprimeurs libraires de l’Institut de France
Rue Jacob 36
1864
Article sur Saint-Martin
Louis-Claude de Saint-Martin, p. 62-70
SAINT-MARTIN (Louis-Claude de), dit le Philosophe inconnu, né le 18 janvier 1743, à Amboise, mort le 13 octobre 1803, à Aunay, près Paris. Ayant perdu sa mère au berceau, il dut à la tendresse éclairée de sa belle-mère cette éducation, grave et douce à la fois qui le fit, disait-il, aimer de Dieu et des hommes. De bonne heure il s’accoutuma à la méditation, et ce fut dans un livre ascétique, L’Art de se connaître soi-même, d’Abbadie, qu’il s’initia confusément au renoncement des choses de ce monde. Du collège de Pont-le-Voy il passa à l’école de droit : son père le destinait à la magistrature, et en fils respectueux il se fit recevoir avocat au présidial de Tours. Au bout de six mois de pratique il n’était pas capable de distinguer « qui, dans [page 63] une cause jugée, avait gagné ou perdu son procès », et il obtint, la permission d’embrasser le métier des armes ; il s’y décida, non par goût ou par ambition (il détestait la guerre et s’écartait du monde), mais pour continuer à loisir l’étude de la religion et de la connaissance. Le duc de Choiseul, pour obliger sa famille, lui avait accordé un brevet de lieutenant dans le régiment de Foix, alors en garnison à Bordeaux (1765). Ses aspirations enthousiastes trouvèrent dans cette ville un aliment plein de séductions. Il y rencontra un de ces hommes mystérieux comme ce siècle en a tant produits, charlatans de génie ou rêveurs chimériques, qui, empruntant des armes à l’arsenal du merveilleux, méprisaient la science, luttaient contre les philosophes, et revendiquaient hardiment au nom de leurs pratiques sécrètes l’empire du monde, qui passait à la raison : il s'appelait Martinez de Pasqualis, Portugais de race orientale et chrétien d’origine juive, qui depuis plus de dix ans tenait dans l’ombre école de théurgie. Il ne cherchait ni l’argent ni la renommée. Qu’enseignait-il ? La réintégration des êtres dans leurs premières propriétés spirituelles et divines, et à ses leçons il joignait un ensemble de formules, de rites, d’opérations propres à s’assurer l’assistance des puissances supérieures [1]. Bien peu d’adeptes connurent tout son secret ; Saint-Martin le pénétra ; et s’il demeura plein d’admiration et de respect pour le maître, il se détacha avec le temps d’un système qu’il jugeait trop compliqué. « Faut-il tant de choses pour prier Dieu ? » avait-il demandé à Martinez. En quittant la voie des manifestations sensibles, il se renferma plus en lui-même, au centre, comme il disait, au lieu de se répandre à la circonférence. Mais cette évolution de sa pensée, elle ne se produisit complètement que vers la fin de sa carrière, et pendant plus de vingt ans encore il subit l’influence de sa primitive initiation au spiritualisme mystique.
Après avoir tenu garnison à Lorient et à Longwy, Saint-Martin quitta le service (1771), résolu à ne plus dépendre que de lui-même, et aussi à propager ses principes, mission qu’il croyait avoir reçue d’en-haut. Il courut rejoindre à Paris son maître Martinez (1774), puis à Lyon. Sa première liaison intime fut avec le comte d’Hauterive, et date de Lyon, où pendant plusieurs années l’école martiniste avait trouvé dans les loges maçonniques de véritables sanctuaires de mysticité. Il prit une part active à leurs conférences, sans qu’on puisse trop démêler quel était l’objet de ses préférences d’alors des expériences mesmériennes ou des études [page 64] théurgiques. Ajoutons toutefois qu’il ne dut pas s’attarder longtemps aux premières, lui qui ne voyait dans Mesmer « qu’un matérialiste disposant d’une grande puissance ». A mesure que les idées de son maître se répandaient, il s’en écartait davantage, et il refusa de participer aux opérations des Grands Profès et des Philalèthes, sociétés parisiennes qui lui semblaient avoir abandonné le vrai but de la théurgie, la science des esprits. A cette époque il avait publié son premier livre. Des Erreurs et de la vérité (1775), réfutation des théories du matérialisme faite à l’aide de la théorie gnostique de l’émanation ou des agents spirituels émanés du Verbe, cause unique.[2] Dans le monde Saint-Martin ne menait pas la vie d’un sectaire ou d’un enthousiaste. Sa figure expressive, une extrême réserve, ses façons polies et douces, un vif désir de plaire le firent rechercher partout avec intérêt. Le Philosophe inconnu (ainsi se désignait-il lui-même) n’aspirait qu’être connu ; spirituel et gai, penseur original et homme de bonne compagnie, il fréquentait dans les meilleures maisons de Paris et les plus aristocratiques, comme les Lusignan, les Bouillon, les Choiseul, les Noailles, les Clermont-Tonnerre. Il recherchait les savants et les lettrés, mais il tenait le clergé à l’écart. Il admirait dans Voltaire « un monument de l’esprit humain » ; il aimait Rousseau, avec qui il se trouvait plus d’une ressemblance. En 1778, de passage à Toulouse, il faillit par deux fois s’engager dans le mariage ; ces velléités s’évanouirent, car mille expériences lui avaient appris « qu’il n’était né que pour une seule chose ». La société des femmes l’attirait pourtant, parce qu’elles l’aidaient « à se montrer » et « à sortir de lui-même » ; aussi ses plus fidèles amies comme ses plus ferventes adeptes furent-elles les marquises de la Croix, de Lusignan et de Chabanais, la duchesse de Bourbon, la maréchale de Noailles. C’est pour satisfaire à leurs demandes, encore plus qu’à celles des autres initiés, qu’il entreprit d’exposer avec plus de clarté sa doctrine, sous le titre de Tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l’homme et l’univers (1782). Partant de ce principe, que nos facultés internes sont les vraies causes de nos œuvres externes, il admet que dans l’univers entier les puissances cachées sont de même les vraies causes de tous les phénomènes ; que cette vérité est visible dans tout ce qui nous environne, mais que Dieu l’a imprimée plus clairement encore dans ce qui forme le caractère distinctif de l’homme ; et que par conséquent l’étude approfondie de la vraie [page 65] nature de l’homme doit nous mener par induction à la science de l’ensemble des choses. Or, les facultés intellectuelles de l’homme sont, d’après Saint-Martin, une preuve incontestable qu’il en existe hors de lui d’un ordre bien supérieur aux siennes, qui produisent en lui les pensées ; car les mobiles de sa pensée n’étant pas à lui, il ne peut trouver ces mobiles que dans une source intelligente qui ait des rapports avec son être, et sans lesquels le germe de sa pensée resterait inefficace. Cette théorie, qui passa inaperçue dans le monde, causa une vive sensation chez les martinistes, et en 1784 la Société des philalèthes de Paris engagea l’auteur à s’unir à elle. Saint-Martin, qui avait eu, quelques années auparavant, des entrevues avec les philalèthes à Versailles, où il s’était attaché M. Gence, les avait quittés, mécontent de ce qu’ils n’étaient initiés que par les cérémonies extérieures, par les formes ; il ne déféra pas à leur invitation, sous prétexte qu’ils s’adonnaient à la recherche de la pierre philosophale.
Vers 1786, Saint-Martin fit un voyage en Angleterre, où il se lia étroitement avec le théosophe William Law ; il se prit surtout d’affection pour les Russes, qui lui parurent plus portés au spiritualisme. Le prince Alexis Galitzin devint son élève et son ami, et l’emmena visiter l’Italie en 1787. Saint-Martin, qui dans une courte excursion en 1775, ne s’était arrêté qu’à Gênes, alla jusqu’à Rome, où il passa plusieurs mois, vivant, selon son habitude, dans la plus haute société. A son retour (juin 1788), il se fixa à Strasbourg, où il fut attiré probablement par le désir de connaître les ouvrages de Jacques Bœhme. Deux personnes, Rodolphe Salzmann et surtout Mme de Bœcklin, l’initièrent à l’étude de cet illuminé. Cette dame, née la même année que Saint-Martin, avait quarante-cinq ans lorsqu’elle le connut ; mère de plusieurs enfants et grand-mère, elle restait belle encore et unissait au charme de la douceur cet attrait de l’esprit qui est si puissant chez les femmes bien nées. Il se forma entre elle et Saint-Martin une de ces amitiés exaltées qui restent pures au milieu des tendresses mystiques, et que les esprits superficiels cherchent en vain, et sans preuves, à transformer en vulgaires passions [3]. Pendant trois ans ils se virent chaque jour, et depuis deux mois ils avaient exécuté leur projet de vivre sous le même toit, lorsque Saint-Martin fut rappelé par son [page 66] père, qui était malade (juillet 1791). Les années qu’il venait de passer dans l’étude l’avaient initié à une science théosophique supérieure aux doctrines de l’école de Bordeaux, et avaient agrandi ses vues sur l’histoire, la philosophie, la critique et la science en général. Cependant, les ouvrages qu’il écrivit à Strasbourg ne présentent presque pas la trace de l’influence de Bœhme. Le premier, L’Homme de désir (1790), est un recueil d’hymnes ou plutôt d’aspirations vers l’état primitif de l’âme, et se rattache par le langage et la pensée à l’école martinéziste. Le second, Le nouvel homme (1792), fut composé d’après les conseils du chevalier de Silferhielm, neveu de Svedenborg [sic.], avec lequel Saint-Martin eut des relations suivies au commencement du séjour qu’il fit à Strasbourg. Ce livre enseigne que l’homme, aujourd'hui vieilli, doit s’efforcer de revenir à sa jeunesse primitive, que son âme est une pensée de Dieu, que cette pensée est son renouvellement, sa gloire, sa puissance, qu’elle le rendra maître de l’univers. L’Ecce homo (1792) écrit pour la duchesse de Bourbon, n’est qu’une reproduction des doctrines du Nouvel homme, avec des détails qui font toucher au doigt l’infirmité du vieil homme, tels que son penchant au merveilleux d’un ordre inférieur, au somnambulisme, etc.
Saint-Martin, tombé de Strasbourg, son paradis, dans Amboise, son enfer [4], fit bien des tentatives pour rejoindre Mme de Bœcklin ; mais la maladie de son père se prolongea, et il fut obligé de rester auprès de lui. Toujours préoccupé du progrès de ses idées, il ne se mêla pas au mouvement politique, et ne fut pas troublé par les événements qui agitaient la France, il continuait à correspondre sur des sujets mystiques et abstraits avec sa chère B.., son ami Divonne, et le baron bernois Kirchberger de Liebisdorf, qu’il ne vit jamais, bien qu’ils aient échangé des lettres pendant sept ans. Vers le milieu de 1793, il fut obligé, pour ne pas se rendre suspect, de renoncer à sa correspondance avec Divonne, qui était émigré, et avec Mme de Bœcklin. Le père de Saint-Martin était mort au mois de janvier 1793 ; mais des raisons que nous ne connaissons pas l’empêchèrent de retourner auprès de son amie ; il continua à vivre à Amboise, faisant de rares séjours à Paris, ou dans la retraite de la duchesse de Bourbon à Petit-Bourg. Les excès de la révolution l’attristaient, il regardait sa « besogne comme une pitié » ; mais il reconnaissait la grandeur du mouvement et la beauté du but. Vivant dans un isolement presque complet, il [page 67] se concentrait dans ses théories mystiques et dans sa traduction de Bœhme. Le 16 mai 1794 il fut chargé de dresser le catalogue des livres et manuscrits tirés des maisons ecclésiastiques supprimées par la loi. Son district le choisit ensuite comme candidat à l’École normale. Malgré son âge, il accepta cette position d’élève professeur, par cette raison qu’il faut s’associer au travail « quand il ne s’agit ni de juger les humains ni de les tuer ». Il allait donc cesser d’être, selon son expression, le Robinson Crusoé de la spiritualité, et reprendre sa mission dans le monde. Nous le voyons s’installer à Paris rue de Tournon, monter sa garde au Temple et renouer avec ses anciens amis. L’École fut ouverte à la fin de janvier 1795. La manière dont on y comprit l’enseignement fut loin de satisfaire Saint-Martin ; il regarda surtout comme un danger l’idéologie sensualiste de Garat, et, dans deux de ces conférences où les auditeurs étaient invités à présenter leurs observations, il demanda que le sens moral fût reconnu d’une manière formelle, que la matière non pensante fût mise à sa véritable place, et qu’on affirmât la nécessité d’une parole première donnée à l’homme dès sa création. Garat répondit, et chacun des deux adversaires s’attribua la victoire. Ces discussions ne se renouvelèrent pas, l’École ayant été fermée le 9 mai 1795. Peu de temps après, Saint-Martin publia ses Considérations sur la révolution française (1795). « Pour mener la révolution, cette grande crise de la société, dit-il, à ses fins véritables, il faut en faire une régénération de l’humanité en son état primitif, en son point de départ. » Et confondant la religion avec la politique, il en arrive à un rêve de théocratie, que l’on regarde non sans raison comme le précurseur des idées théocratiques de Joseph de Maistre. Seulement, pour Saint-Martin la religion catholique, qui a été déshonorée par le trafic et l’imposture, n’est plus le salut de l’humanité, et la Providence saura bien en faire naître une autre du cœur de l’homme. Quant au fait même de la révolution française, il le regarde comme la révolution du genre humain, comme une miniature du Jugement dernier. « Les pays qui ne valent pas mieux que la France ne seront pas plus épargnés quand le temps de leur visite sera arrivé. » En 1797, Saint-Martin revit Petit-Bourg et la duchesse de Bourbon, rendue à la liberté, puis Champlâtreux et Mme Molé. L’année suivante il fit paraître Le Crocodile, poème allégorique, grotesque et bizarre, souvent lourd, obscur et même incompréhensible, et dans lequel il a intercalé un mémoire d’une métaphysique profonde sur la question, mise au concours par l’institut. De l’Influence des signes sur la formation des idées. En 1802 il donna son dernier ouvrage original, Le Ministère de l’homme-esprit ; il y démontrait comment l’homme, exerçant un ministère spirituel sur la terre, se [page 68] régénère lui-même et régénère les autres, c’est-à-dire répète dans sa personne l’œuvre que le Christ a remplie dans l’humanité, ou, suivant sa langue théosophique, rend le Logos (le Verbe) à l’homme et à la nature. L’influence de Jacques Bœhme est sensible dans tout le développement de cette grande pensée, et l’auteur ne garde presque plus rien de la théurgie de Martinez. Le style, plus clair que dans la plupart de ses autres écrits, présente encore des étrangetés qui l’empêchent d’être complètement accessible. Du reste cet ouvrage se perdit dans l’éclat qui entoura l’apparition du Génie du christianisme.[5] « Il est trop loin des idées humaines, dit Saint-Martin, pour que j’aie compté sur son succès. J’ai senti souvent en l’écrivant que je faisais là comme si j’allais jouer sur mon violon des valses et des contredanses dans le cimetière de Montmartre, où j’aurais beau faire aller mon archet, les cadavres qui sont là n’entendraient aucun de mes sons et ne danseraient point.» Mais si Saint-Martin s’expliquait facilement le peu d’attention et de sympathie que montraient pour ses idées les hommes de son temps, il ne désespérait pas de l’avenir, et il avait une haute idée du rôle qu’il remplissait, comme on peut en juger par les lignes suivantes, malgré la restriction de modestie qui en atténue la pensée ambitieuse : « Descartes a rendu un service essentiel aux sciences naturelles, en appliquant l’algèbre à la géométrie matérielle. Je ne sais si j’aurai rendu un ainsi grand service à la pensée, en appliquant l’homme, comme je l’ai fait dans tous mes écrits, à cette espèce de géométrie vive et divine qui embrasse tout, et dont je regarde l’homme-esprit comme étant la véritable algèbre et l’universel instrument analytique. Ce serait pour moi une satisfaction que je n’oserais pas espérer, quand même je me permettrais de la désirer. »
Des relations passagères avec Mme d’Albany et Mme de Krudener marquèrent la dernière année de sa vie. Il sentit, sans se troubler, approcher sa fin, et n’eut de regret qu’à une chose : c’était de ne rien laisser « d’un peu avancé sur les nombres ». Cette question le préoccupait beaucoup, et il en fit l’objet d'un long entretien avec M. de Rossel la veille même de sa mort. S’étant rendu le lendemain (13 octobre 1803) à Aulnay, chez Lenoir-Laroche, son ami, il y mourut, d’un coup d’apoplexie, [page 69] après avoir exhorté ceux qui l’entouraient à mettre leur confiance en Dieu et à vivre comme des frères, « Les ouvrages de Saint-Martin, dit Gence, ont pour but non seulement d’expliquer la nature par l’homme, mais de ramener toutes nos connaissances au principe dont l’esprit humain peut devenir le centre. La nature actuelle, déchue et divisée d’avec elle-même et d’avec l’homme, conserve néanmoins dans ses lois, comme l’homme dans plusieurs de ses facultés, une disposition à rentrer dans l’unité originelle. Par ce double rapport, la nature se met en harmonie avec l’homme, de même que l’homme se coordonne à son principe... Suivant Saint-Martin, l’homme pris pour sujet ne conçoit ni n’aperçoit pas simplement l’objet abstrait de sa pensée : il le reçoit, mais d’une autre source que celle des impressions sensibles. De plus, l’homme qui se recueille et qui fait abnégation, par sa volonté, de toutes les choses extérieures, opère et obtient la connaissance intime du principe même de la pensée ou de la parole, c’est-à-dire de son prototype ou du Verbe, dont il est originairement l’image et le type. L’Être divin se révèle ainsi à l’esprit de l’homme, et en même temps se manifestent les connaissances qui sont en rapport avec nous-mêmes et avec la nature des choses. »
Voici la liste complète des écrits de Saint-Martin : Des Erreurs et de la vérité ou les hommes rappelés au principe universel de la science, par un phil… inc… ; Édimbourg (Lyon), 1775, 2 part. in-8° ; trad. en allemand par Claudius (Breslau, 1782, in-8°) ; la prétendue Suite des Erreurs et de la vérité (Salomonopolis [Paris] 1784, in-8°) a été signalée par l’auteur comme frauduleuse ; il en est de même de la Clef des Erreurs et de la vérité, par un serrurier inconnu ; - Le Livre rouge ; opuscule presque introuvable, et dont Saint-Martin a lui-même revendiqué la paternité ; - Tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l’homme et l’univers, par un ph… inc… ; Edimb ; (Lyon), 2 part. in-8° ; trad. en allemand en 1783 et 1785 ; - L’Homme de désir ; Lyon, 1790, in-8° ; Metz, 1812, 2 vol. in-12 ; trad. en allemand en 1813 ; - Ecce homo ; Paris, 1792, in-8° ; trad. en allemand en 1819 ; - Le nouvel homme ; Paris, 1792, in-8° ; Lettre à un ami, ou considérations philosophiques et religieuses sur la révolution française ; Paris, 1796, in-8° ; trad. en 1818 en allemand par Varnhagen von Ense ; - Éclair sur l’association humaine ; Paris, 1797, in-8° ; - Réflexions d’un observateur sur la question proposée par l’Institut : Quelles sont les institutions les plus propres à fonder la morale d’un peuple ? Paris, 1798, in-8° ; - Essai relatif à cette question : Déterminer l’influence des signes sur la formation des idées ; Paris, 1799, in-8° ; - Le Crocodile ou la guerre du bien et du mal, [page 70] arrivés sous le règne de Louis XV, poème épico-magique en 102 chants, par un amateur de choses cachées ; Paris, 1799, in-8° de 460 p. ; - L’Esprit des choses, ou coup d’œil philosophique sur la nature des êtres et sur l’objet de leur existence ; Paris, 1800, 2 tom. in-8° ; trad. en allemand ; - Le cimetière d’Amboise, en vers ; Paris, 1801, in-8° ; - Discours sur l’existence d’un sens moral, en réponse à Garat, prononcé le 27 février 1795 et inséré dans le t. III de la collection des Écoles normales, 1801 ; - Le Ministère de l’homme-esprit ; Paris, 1802, in-8° ; trad. en 1845 en allemand ; - Œuvres posthumes ; Tours, 1807, 2 vol. in-8° : on y trouve un choix de pensées, un journal sous le titre de Portrait, des fragments de littérature et de philosophie, des poésies, des méditations, etc., - Traité des nombres ; Paris, 1843 in-4° ; - Correspondance avec Kirchberger ; Paris, 1862, in-8°. De Jacques Bœhme, Saint-Martin a traduit les ouvrages suivants : L’Aurore naissante (Paris, 1800, 2 tom. in-8+) : Les trois Principes de l’essence divine (ibid., 1802, 2 vol. in-8°), Quarante questions sur l’âme (ibid. 1807, in-8°), et De la triple vie de l’homme (ibid., 1809, in-8°). Il a laissé en manuscrit plusieurs traités sur l’astrologie, sur le magnétisme et le somnambulisme, sur le principe et l’origine des formes, sur la Bible, etc.
P. L.
– Gence, Notice biogr. sur L.-C. de Saint-Martin ; Paris, 1824, in-8°.
– Caro, Essai sur la vie et la doctrine de Saint-Martin ; Paris, 1852, in-8°.
– Matter, Saint-Martin, le philosophe inconnu ; Paris, 1862, in-8°.
– Dict. des sciences philosoph.



