 1863 - Compte-rendu du livre de Jacques Matter
1863 - Compte-rendu du livre de Jacques Matter
Adolphe Franck - Compte-rendu du livre de Jacques Matter
Séances et Travaux de l'Académie des Sciences Morales et Politiques (Institut impérial de France)
Compte rendu par M. Ch. Vergé, avocat, docteur en droit, sous la direction de M. Mignet, secrétaire perpétuel de l’Académie
1863 – Quatrième trimestre
22e année – Quatrième série
Tome seizième (LXVIe de la collection).
Paris. Auguste Durand, libraire, 7, rue des Grès Sorbonne
1863
Articles publiés par Adolphe Franck dans les Séances et Travaux de l'Académie des Sciences Morales et Politiques (1863, 1865)
1er article, pages 199-219
Il y a peu d'écrivains, et surtout d'écrivains, mystiques, qui aient moins de droits que Saint-Martin à ce nom de philosophe inconnu dont il se plaisait à signer tous ses ouvrages. Si obscures que soient pour nous ses doctrines (et nous pouvons affirmer qu'elles ne l'étaient pas moins pour ses contemporains), il les a vues de son vivant devenir un objet de graves méditations, et lui susciter, en France, en Allemagne, en Suisse, des disciples pleins de ferveur. Au moment où éclatait la Révolution française, son nom était si célèbre et si respecté, que l'Assemblée constituante, en 1791, le présentait avec Sieyès, Condorcet, Bernardin de Saint-Pierre et Berquin, comme un des hommes parmi lesquels devait être choisi le précepteur du jeune Dauphin. On se disputait sa personne dans les plus élégants salons ; ceux qui ne pouvaient le lire étaient jaloux de l'entendre, et le charme de sa conversation effaçait pour lui toutes les distances. Il a vécu dans la familiarité de la duchesse de Bourbon, de la maréchale de [page 200] Noailles, de la marquise de Coislin, du duc de Richelieu, du duc de Bouillon, du duc de Lauzun ; il était l'hôte et le commensal du prince de Galitzin, de lord Hereford, du cardinal de Bernis ; il a connu le chevalier de Boufflers, le duc d'Orléans, devenu plus tard Philippe-Égalité, Bailly, Lalande, Bernardin de Saint-Pierre. Il a soutenu, dans une assemblée de deux mille personnes, une discussion brillante contre Garat, l'ancien ministre de la Convention, nommé professeur d'analyse de l'entendement dans les écoles normales. Après s'être attiré, dans sa jeunesse, les sarcasmes de Voltaire, il n'a pu éviter, sur la fin de sa vie ceux de Chateaubriand, qu'il a aimé et admiré. Enfin, c'est dans ses écrits, et principalement dans ses écrits politiques, que l'auteur des Considérations sur la Révolution française et des Soirées de Saint-Pétersbourg a trouvé les fondements de son système.
Aussi les apologistes, les critiques et les biographes ne lui ont pas manqué, après sa mort. Sans parler de Gence, qui était un des siens, qui appartenait à sa famille spirituelle, et qui, ayant vécu dans son intimité, a pu nous laisser, dans la Biographie universelle, un récit exact de sa vie, Madame de Staël, en étudiant l'Allemagne, y a rencontré les traces encore vivantes de son influence. Par le coup mortel qu'il a porté, .longtemps avant Royer-Collard, à la domination de l'école de Condillac, et la lutte qu'il a soutenue toute sa vie contre le matérialisme du XVIIIe siècle, il a imposé à un illustre historien de la philosophie le souvenir de son nom et de ses écrits. II a forcé, sinon par la justice, du moins par la reconnaissance, le plus implacable ennemi de toute libre pensée, le comte Joseph de Maistre, à rendre hommage à son caractère et à son talent. M. de Sainte-Beuve lui a donné une place honorable dans sa galerie (1.Causeries du lundi, t. X, p. 190-225.). Sans se risquer avec [page 201] lui dans les voies souterraines qu'il aimait à parcourir, il a fait revivre à nos yeux, dans une fine peinture, la grâce de l'écrivain, les délicatesses de l'homme. Un critique religieux, chez qui l'ardeur de la foi sait toujours se concilier avec la bienveillance et la justice, M. Moreau, l'a considéré sous un autre point de vue. Tout en recueillant sur sa vie des renseignements jusque-là restés ignorés, et , sans négliger ses opinions purement philosophiques, il s'est proposé pour but de signaler les points sur lesquels son libre christianisme est souvent en désaccord et même en opposition avec l'orthodoxie catholique (2. Réflexions sur les idées de Louis de Saint-Martin le théosophe, par L. Moreau, un volume grand in-18, Paris, 1850.). Un philosophe, qui est en même temps un élégant écrivain, M. Caro, dans une thèse substantielle (3.Essai sur la vie et les doctrines de Saint-Martin, le philosophe inconnu, in -8°, Paris, 1852.), a voulu nous offrir la synthèse de ses idées tant philosophiques que religieuses, en les comparant avec les idées analogues des mystiques antérieurs ou contemporains. Enfin d'autres, par des extraits choisis avec art ou qui répondaient à leurs propres sentiments, se sont bornés à mettre sous nos yeux les éléments les plus précieux de sa doctrine et comme la fleur de ses pensées.
Quoiqu'il n'y ait pas plus de soixante ans que Saint-Martin est mort, et que, selon toute vraisemblance, il subsiste encore parmi nous, dans l'ombre de quelque loge, des débris vivants de son école, les différentes études dont il a été l'objet sont toutes, par un certain côté, plus ou moins incomplètes. Elles ont laissé subsister, dans sa vie et dans son système, un assez grand nombre de points obscurs, qui réclamaient depuis longtemps d'autres informations. Par exemple, que savions-nous de Martinez Pasqualis, ce mystérieux personnage [page 202] venu on ne sait d'où, qu'on rencontre partout et qu'on ne peut saisir nulle part, qui disparaît un jour subitement comme il était venu, allant chercher au loin une fin restée inexpliquée, comme sa vie, après avoir exercé, sur l'esprit de Saint-Martin, une décisive influence. Quelle fut au juste sa doctrine? A quelle source l'avait-il puisée? A quel point le philosophe inconnu y est-il demeuré fidèle? Quels rapports celui-ci a-t-il conservés avec ceux qui ont été nourris du même pain spirituel ? Par quel motif ou par l'intervention de quelle puissance a-t-il abandonné son premier maître pour se plonger, vers la fin de sa carrière, dans les sombres abîmes de Jacob Bœhm ?
Ces questions et plusieurs autres, qui ne manqueront pas de se présenter sur notre chemin, trouvent leur solution dans le nouveau travail que M. Matter vient de publier. « Une rare bonne fortune, dit-il (4.Préface, p. VIII et IX.), a fait tomber entre nos « mains, dans un voyage à l'étranger, les deux petits volumes manuscrits du traité de don Martinez, De la Réintégration, dont je ne connais que deux exemplaires, l'un en France, l'autre dans la Suisse française. » M. Matter a aussi mis à profit, avant qu'elle fût publiée par MM. Schauer et Chuquet la curieuse correspondance de Saint-Martin avec le baron de Liebisdorf, et une foule de lettres restées inédites de Divonne, de Maubach, de Madame de Bœcklin, tous les trois unis de cœur et d'intelligence avec l'illustre illuminé, surtout la dernière, objet d'une amitié passionnée, et qui a été pour lui, dans les voies du mysticisme germanique, ce que Béatrice a été pour Dante dans le troisième acte de la Divine Comédie. Ajoutons que M. Matter était préparé depuis longtemps à l'œuvre qu'il vient d'accomplir. Historien du [page203] gnosticisme et de l'école d'Alexandrie, c'est-à-dire du mysticisme ancien, profondément versé dans la connaissance des hérésies chrétiennes du moyen âge, il semblait naturellement désigné pour écrire l'histoire du mysticisme moderne. Cette étude sur Saint-Martin en est la première page, déjà suivie, à l'heure qu'il est, d'un volume sur Swedenborg (5. Emmanuel Swedenborg, sa vie ses écrits et sa doctrine, un volume in-8° ; librairie académique de Didier.). Cette page, quelle que soit la destinée de celles qu'elle nous annonce, fait le plus grand honneur à la vaillante vieillesse de M. Matter. Il a produit des ouvrages plus érudits et plus profonds ; il n'a rien écrit des plus complet, de plus clair, de plus attachant.
Pour se faire une idée du rôle que joue Saint-Martin dans l'histoire du mysticisme, il faut savoir quel est celui du mysticisme lui-même dans l'histoire de la religion et de la philosophie. On peut dire que la religion est au mysticisme ce que l'amour réglé par le mariage est à l'amour libre et passionné. Assurément le mariage a été calomnié par la comédie et la satire. Le mariage n'exclut pas l'amour; il le suppose au contraire, et ne peut se comprendre sans lui. Mais il lui impose des règles et des devoirs ; il le place sous l'autorité des lois, et ne lui permet pas de s'écarter des conditions sur lesquelles repose l'ordre social. Telle est précisément l'action de là religion sur l'amour divin, et, par suite, sur tous les actes et toutes les pensées dont se compose le commerce de l'âme et l'infini. Elle ne permet pas que dans les élans mêmes delà foi la plus exaltée, on s'éloigne de ses dogmes, de ses traditions, de sa discipline, ni qu'on les manifeste autrement que sous les formes qu'elle a consacrées. Elle est inséparable d'une société spirituelle qui a, comme la société civile, son [page 204] gouvernement, son organisation, sa législation. Le mysticisme n'admet rien de tout cela, quoiqu'il y ait nécessairement un fonds, mystique dans la religion même. Le mysticisme, comme la passion, comme l'amour humain quand il a envahi tout notre être, ne connaît ni règle, ni frein, ni limite. L'autorité est pour lui un vain mot; la tradition et les textes, quand il daigne les accepter, se changent, sous son regard, en symboles et en figures, comme certains corps, touchés par le feu, se changent en vapeur. Il va tout droit à l'objet aimé, c'est-à-dire à Dieu. C'est lui seul qu'il cherche, lui seul qu'il aperçoit dans la nature et dans l'âme, et il ne s'arrête qu'après avoir tout absorbé et quand il s'est lui-même abîmé en lui. De là l'affinité qu'on a toujours remarquée entre le mysticisme et le panthéisme.
Essentiellement différent de la religion, le mysticisme ne se distingue pas moins de la philosophie. La philosophie, c'est la raison dans la pleine possession d'elle-même. Elle ne se rend qu'à la lumière de l'évidence ou à la force irrésistible des démonstrations. Il lui faut des principes d'une autorité naturelle et universelle, des faits réfléchis par toutes les consciences, des raisonnements à l'abri de toute objection. Je n'affirme pas que ce but soit toujours atteint par la philosophie ; je dis que la philosophie le poursuit sans relâche, et qu'elle ne saurait y renoncer sans donner gain de cause à ceux qui prétendent qu'elle n'existe pas. Le mysticisme ne se propose rien de pareil. Le mysticisme, c'est la passion, et la passion a besoin de contempler, d'admirer, de croire à la perfection et à la possession de l'objet aimé ; elle ne raisonne pas. Elle observe, et quelquefois avec beaucoup de finesse, mais seulement ce qui la flatte ou la contrarie, ce qui, en l'exaltant par la résistance ou par la satisfaction, lui tient lieu d'aliment. Loin de chercher l’universalité dans les [page 205] principes et dans les faits, elle ramène tout à une expérience non seulement personnelle, mais exceptionnelle. « J'ai dit quelquefois, écrit Saint-Martin (6. « Portrait historique », n° 901, dans le t. Ier des Œuvres posthumes.), que Dieu était ma passion. J'aurais pu dire, avec plus de justice, que c'est moi qui étais la sienne, par les soins continus qu'il m'a prodigués et par ses opiniâtres bontés pour moi, malgré toutes mes ingratitudes ; car, s'il m'avait traité comme je le méritais, il ne m'aurait seulement pas regardé. » Presque tous les grands mystiques se sont bercés de cette illusion.
Le mysticisme n'est pas une effervescence passagère qu'on remarque seulement de loin en loin dans quelques natures privilégiées. Il a ses racines dans les profondeurs de l'âme humaine ; on le voit éclore dans toutes les races, sous l'empire des croyances et des civilisations les plus opposées, pourvu que le temps nécessaire à sa maturité ne leur manque point. Il appartient également à l'Inde brahmanique et bouddhiste, à la Chine convertie au culte de Fô et à la doctrine de Lao-tseu, à la Grèce païenne, lorsqu'elle mêle aux enseignements de Platon les inspirations de l'Orient, à la Judée attentive aux mystères de la kabbale et aux nations chrétiennes de l'Occident. Il sait se faire sa place dans la religion connue dans la philosophie, quoiqu'il diffère essentiellement de toutes deux. Les siècles de foi et d'incrédulité, de soumission et de libre examen, de ferveur catholique et de propagande protestante ne lui sont pas plus étrangers les uns que les autres. Mais c'est aux époques de décomposition et de révolution générale , quand l'âme ne sait plus où se reposer, quand toutes les idées et toutes les croyances sont mises en question, quand la philosophie, la religion et la [page 206] société elle-même ébranlées dans leurs fondements, remises au creuset pour être purifiées, n'offrent plus aucun abri aux cœurs timides et pacifiques, c'est dans les temps qui préparent la tourmente révolutionnaire, dans ceux qui précèdent et qui suivent la naissance du christianisme, qu'il se déploie avec une vigueur particulière, avec une variété de formes presque infinie, et que son action a le plus d'étendue.
On ne se figure pas tout ce que le XVIIIe siècle a vu s'élever en Europe de sanctuaires mystiques, dont chacun avait son grand prêtre et son culte séparé. On distinguait l'école de Lyon, fondée et gouvernée par Cagliostro ; celle d'Avignon, qui fut plus tard transportée à Rome ; celle de Zurich, suspendue aux lèvres éloquentes de Lavater ; celle de Copenhague ou du nord, qui ne jurait que par le nom de Swedenborg ; celle de Strasbourg, uniquement nourrie des écrits de Jacob Boehm ; celle de Bordeaux, attentive aux oracles de Martinez Pasqualis ; celle des Philalèthes de Paris, qui , cherchant sa voie entre Martinez et Swedenborg, empruntait également ses inspirations à l'un et à l'autre. Au sein même de la Terreur, était venue éclater l'aventure de dom Gerle et de Catherine Théot ; le mysticisme avait tissé sa toile autour de l'échafaud, et, quelques années auparavant le mesmérisme donnait le vertige à toute la France. De tous les chefs de secte que je viens de citer, Martinez Pasqualis n'est pas celui qui a jeté le plus d'éclat, mais c'est celui qui a laissé les traces les plus profondes ; c'est lui principalement qui a créé Saint-Martin.
Le nuage qui enveloppe sa vie n'est pas complètement dissipé par le livre de M. Matter, ni même par les documents inédits que M. Matter a eu la libéralité de mettre à ma disposition. Nous savons qu'il était le fils d'un Israélite portugais, qui est venu, on ignore à quelle date et pour quel [page 207] motif, s'établir à Grenoble. Je suis assez porté à supposer qu'à l'exemple de ses coreligionnaires, restés en Portugal après les édits de bannissement rendus contre eux, il professait extérieurement le catholicisme, tout en restant juif dans son intérieur. C'est ainsi qu'on s'explique l'isolement dans lequel il éleva son fils, et qui ne lui permit qu'à un âge assez avancé d'apprendre la langue de sa nouvelle patrie, et encore de l'apprendre d'une manière assez imparfaite. C'est ainsi qu'on peut également se rendre compte de la manière toute judaïque, toute kabbalistique, dont il entendait les dogmes du christianisme ; car, j'en demande pardon à M. Matter, il m'est impossible de ne pas reconnaître les éléments essentiels de la kabbale dans la doctrine enseignée plus tard par Martinez Pasqualis, et la forme même sous laquelle il l'a développée dans son traité de la réintégration ; ces discours placés dans la bouche des principaux personnages de l'Ancien Testament, ne sont qu'une imitation des midraschim ou commentaires allégoriques et mystiques de l'Écriture sainte, par les plus anciens docteurs de la synagogue. Il faut remarquer d'ailleurs que les principaux kabbalistes étaient d'origine espagnole, et que leurs traditions secrètes se prêtaient à merveille au mystère qui devait envelopper la vie et la pensée de ces tristes victimes de l'inquisition, obligées, pour sauver leurs têtes, de dissimuler leur foi.
Je ne puis donc partager l'opinion commune qui fait de Martinez Pasqualis un israélite converti au catholicisme ; on n'a jamais cité un seul fait qui démontre cette prétendue conversion ; il n'a jamais prononcé ni écrit un seul mot qu'on puisse interpréter comme une profession de foi catholique. Toute sa vie se passe à l'ombre des loges ou associations secrètes fondées dans l'intérêt d'un mysticisme libre. [page 208] Il s'y présente, non comme un disciple, mais comme un maître, qui a sa provision de vérités toute faite, et qui la tient de plus haut. Il y apporte des projets de conciliation, de fusion et sans doute aussi de domination personnelle. Telle est la cause de ses courtes et mystérieuses apparitions, tantôt à Paris, tantôt à Lyon, tantôt à Bordeaux. A ces tentatives générales, il joignait à l'occasion la propagande individuelle : car il avait son cénacle particulier, qui, sans être assez nombreux pour former une secte, était initié directement à sa pensée. L'abbé Fournié, un de ces élus, nous raconte de quelle manière il abordait ceux qu'il jugeait dignes de ses soins. Une fois assuré qu'il avait gagné leur confiance ou frappé leur imagination : « Vous devriez, leur disait-il, venir nous voir ; nous sommes de braves gens. Vous ouvrirez un livre, vous regarderez au premier feuillet, au centre et à la fin, lisant seulement quelques mots, et vous saurez tout ce qu'il contient. Vous voyez marcher toutes sortes de gens dans la rue ; eh bien ! ces gens-là ne savent pas pourquoi ils marchent; mais vous, vous le saurez. »
Martinez Pasqualis n'atteignit pas le but qu'il poursuivait. Au lieu de devenir, comme il l'avait rêvé, l'hiérophante suprême de toutes les sociétés mystiques de la France et peut-être de l'Europe, il ne vit jamais autour de lui qu'un petit nombre d'adeptes, qu'on a appelés à tort la secte des Martinézistes ; car ils n'ont jamais eu entre eux une assez grande conformité de pensées ni de relations assez suivies pour constituer une loge distincte. Découragé ou résigné, et n'aspirant plus qu'à l'obscurité et au repos, Martinez disparut un jour du milieu de ses amis, et l'on apprit qu'il était mort à Port-au-Prince, en 1779.
Pour exposer son système, il faudrait avoir sous les yeux [page 209] le document précieux dont M. Matter est l'heureux possesseur, le Traité sur la réintégration des êtres dans leurs premières propriétés, vertus et puissances spirituelles et divines. C'est le titre véritable de l'ouvrage de Martinez. J'espère bien que M. Matter le publiera quelque jour; je l'en conjure au nom de la philosophie et dans l'intérêt de sa propre renommée ; ce sera un des plus grands services qu'il aura rendus à l'histoire du mysticisme, qui lui en doit déjà tant d'autres, et particulièrement du mysticisme au XVIIIe siècle. Mais en attendant, l'analyse qu'il nous donne de ce singulier livre nous permet d'en reconnaître l'esprit et l'origine. Il découle tout entier du principe kabbalistique de l'émanation, conservé par Saint-Martin comme la partie la plus précieuse de l'enseignement de son premier maître, celle qui n'était communiquée qu'aux disciples les plus avancés et les plus pénétrants (7. Correspondance avec le baron de Liebisdorf, p. 15, de l'édition de M. Schauer. M. Matter, Saint-Martin, p. 25.). Au principe de l'émanation vient se rattacher le dogme de la chute, entendu dans un sens qui le distingue entièrement du dogme chrétien et le fait rentrer dans le système métaphysique du Zohar. Selon la doctrine de Martinez Pasqualis, l'homme n'est pas le seul être qui porte en lui les traces et qui subit les conséquences d'une défaillance première ; tous les êtres sont tombés comme lui ; ceux qui peuplent le ciel ou qui entourent le trône de l'éternité, comme ceux qui sont exilés sur cette terre ; tous sentent avec douleur le mal qui les tient éloignés de leur source divine, et attendent impatiemment le jour de la réintégration. Rien n'est plus facile à comprendre; car, avec le principe de l'émanation, la seule naissance des intelligences finies est une décadence, puisqu'elle les éloigne de [page 210] l'intelligence infinie, de l'existence souveraine et parfaite avec laquelle elles étaient primitivement confondues.
Le traité de Martinez, comme nous l'apprend M. Matter, s'étant arrêté précisément à la venue de Jésus-Christ, nous ne savons pas par lui-même de quelle manière il expliquait la réhabilitation ; mais nous pouvons nous en faire une idée d'après le témoignage de l'abbé Fournié, incapable de rien ajouter de son propre fonds à la doctrine qu'il avait reçue. Or, voici ce que l'abbé Fournié nous assure avoir entendu de la bouche de Pasqualis : « Chacun de nous, en marchant sur ses traces, peut s'élever au degré où est parvenu Jésus-Christ. C'est pour avoir fait la volonté de Dieu que Jésus-Christ, revêtu de la nature humaine, est devenu le fils de Dieu, Dieu lui-même. En imitant son exemple ou en lui conformant notre volonté à la volonté divine, nous entrerons comme dans l'union éternelle de Dieu. Nous nous viderons de l'esprit de Satan pour nous pénétrer de l'esprit divin : nous deviendrons un comme Dieu est un, et nous serons consommés en l'unité éternelle de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit, conséquemment consommés dans la jouissance des délices éternelles et divines (8. Voyez M. Matter, ouvrage cité, p. 35-37.). »
Tous les mystiques, sous une forme ou sous une autre, ont eu la même pensée; mais ici elle se présente comme une suite nécessaire des deux principes précédents. Certainement si toute existence renfermée dans ce monde est une émanation, et si toute émanation est une déchéance, c'est-à-dire un amoindrissement de la substance infinie, il faut chercher notre réhabilitation dans l'anéantissement des limites qui déterminent notre être, dans la destruction de notre [page 211] conscience et de notre volonté individuelle, dans le retour de notre âme au sein de l'esprit universel. La preuve que Martinez, en comprenant de cette façon la réparation de la première faute, ne cédait pas simplement à la pente générale du mysticisme, mais à une tradition positive, héréditaire dans sa race, c'est que la réintégration, selon lui, ne s'arrêtera pas à l'homme ; elle s'étendra à toute la nature et jusqu'au principe même du mal, à cette puissance indéfinie que nous appelons l'esprit des ténèbres : « Martinez Pasqualis, dit Saint-Martin (9. Correspondance inédite, édit. Schauer, p. 272.), avait la clef active de tout ce que notre cher Boehm expose dans ses théories ; mais il ne nous croyait pas en état de porter ces hautes vérités. Il avait aussi des points que notre ami Bœhm ou n'a pas connu ou n'a pas voulu montrer, tels que la résipiscence de l'être pervers, à laquelle le premier homme (10. Très certainement l'Adam Kadmon ; car telle est la traduction littérale de ces deux mots hébreux.) aurait été chargé de travailler. » La résipiscence de l'esprit pervers est à la fois un dogme persan et une idée kabbalistique. Mais si l'on songe que le Zend-Avesta n'a été publié qu'en 1771, à une époque où Martinez était retiré de la scène du monde, et que d'ailleurs, il est resté toute sa vie complètement étranger au mouvement scientifique de son temps, il faut bien admettre l'intervention de la kabbale.
Avec ces doctrines seules, Martinez n'aurait été qu'un métaphysicien ou un mystique spéculatif; mais nous savons qu’il était quelque chose de plus. A l'œuvre purement spirituelle de la parole, il joignait les actes matériels de la théurgie. Reconnaissant entre l'homme et le principe absolu des êtres une foule d'existences intermédiaires, spirituelles [page 212] comme notre âme, mais déchues comme elle, quoique restées en possession de facultés supérieures, il pensait qu'il y avait des moyens de les intéressera notre régénération, étroitement unie à la leur, et de les mettre en communication avec nous, de nous placer sous leur tutelle, d'en obtenir les secours ou les lumières indispensables à notre faiblesse. Ainsi s'explique les noms de majeur et de mineur appliqués, le premier aux esprits célestes, le second à l'âme humaine. Quant aux moyens employés par Martinez Pasqualis pour amener les relations qu'il désirait, et auxquelles, sans aucun doute, il croyait sincèrement, aucun de ses disciples ne s'est cru permis de les dévoiler ; mais une parole de Saint-Martin peut nous tenir lieu de tout autre renseignement. Comme il assistait un jour à ces opérations, probablement des actes d'évocation précédés de grands préparatifs, il lui arriva de s'écrier : « Comment maître, il faut tout cela pour le bon Dieu (11. Correspondance inédite, lettre IV, p. 15, de l'édition de M. Schauer. A ces paroles, dont l'authenticité ne peut guère être contestée, nous ne savons pas pourquoi M. Matter a substitué celles-ci : « Eh quoi, maître, faut-il tant de choses pour prier Dieu ? » Saint-Martin, p. 20.) ? » Et le maître répondait : « Il faut bien se contenter de ce que l'on a. » Cela voulait dire, si nous en croyons l'auteur de L'homme de désir, que ne pouvant atteindre directement, d'un premier élan de méditation et d'amour, jusqu'à la source de toute grâce et de toute réhabilitation, jusqu'au Réparateur, jusqu'au Verbe, jusqu'à l'Adam Kadmon, ou, comme Saint-Martin se plaît à l'appeler plus souvent, jusqu'à la Cause active et intelligente, nous devons nous adresser à des puissances inférieures et leur parler la langue qu'elles comprennent. Tout cet appareil extérieur n'était donc, pour parler comme Saint-Martin, que du remplacement, c'est-à-dire [page 213] une simple préparation à des voies plus hautes et plus pures que le mystérieux Portugais n'ouvrait qu'à demi à de rares adeptes.
Saint-Martin témoigne aussi de la puissance qu'il déployait dans cette œuvre étrange, ou des effets qu'il produisait sur l'imagination et les sens des assistants : « Je ne vous cacherai point, écrit le philosophe inconnu à son correspondant de Morat, je ne vous cacherai point que dans l'école où j'ai passé, il y a plus de vingt-cinq ans, les communications de tout genre étaient nombreuses et fréquentes, que j'en ai eu ma part comme tous les autres, et que, dans cette part, tous les signes indicatifs du Réparateur étaient compris (12. Correspondance inédite, lettre XIX, p. 62 de l'édition de M. Schauer.). »
Ces communications, il ne faut pas s'y tromper, c'étaient des apparitions, des manifestations sensibles, ce que Saint-Martin appelle ailleurs (13. Ibid., p. 75.), avec plus d'énergie, « du physique.» Les récits de l'abbé Fournié ne laissent subsister à ce sujet aucun doute. Il nous apprend, sur la foi de sa propre expérience, que Martinez avait le don de confirmer (c'est le mot consacré dans l'école), de confirmer ses enseignements par des lumières d'en haut, par des visions extérieures, d'abord vagues et rapides comme l'éclair, ensuite de plus en plus distinctes et prolongées (14. Voir le livre publié par l'abbé Fournié, sous ce titre : Ce que nous avons été ce que nous sommes et ce que nous deviendrons (Londres, 1801), et les extraits qu'en donne M. Matter, Saint-Martin, p. 42-53.). Cette puissance, il l'aurait conservée même après sa mort, si nous en croyons l'auteur que je [page 214] viens de citer : « Un jour, dit l'abbé Fournié, que j'étais prosterné dans ma chambre, criant à Dieu de me secourir, j'entendis tout à coup la voix de M. de Pasqualis, mon directeur, qui était corporellement mort depuis plus de deux ans, et qui parlait distinctement en dehors de ma chambre, dont la porte était fermée, ainsi que les fenêtres et les volets. Je regarde du côté d'où venait la voix, c'est-à-dire du côté d'un grand jardin attenant à la maison, et aussitôt je vois de mes yeux M. de Pasqualis, qui se met à me parler, et avec lui mon père et ma mère, qui étaient aussi tous les deux corporellement morts. Dieu sait qu'elle terrible nuit je passai ! Je fus entre autres choses, légèrement frappé sur mon âme par une main qui la frappa au travers de mon corps, me laissant une impression de douleur que le langage humain ne peut exprimer, et qui me parut moins tenir au temps qu'à l'éternité. O mon Dieu ! si c'est votre volonté, faites que je ne sois jamais plus frappé de la sorte ! car ce coup a été si terrible, que, quoique vingt-cinq ans se soient écoulés depuis, je donnerais de bon cœur tout l'univers, tous ses plaisirs et toute sa gloire, avec l'assurance d'en jouir pendant une vie de mille milliards d'années, pour éviter d'être ainsi frappé de nouveau seulement une seule fois (15. M. Matter, p. 43-44.). »
II y a, dans cette narration étrange, dont la bonne foi ne peut d'ailleurs être mise en question, des faits qui appartiennent plus à la physiologie et à la pathologie qu'à une étude philosophique du mysticisme ; mais il est impossible de n'y pas reconnaître les effets d'une âme fortement prévenue, les effets de la foi sur l'imagination, la sensibilité et la perception elle-même. Elle nous montre aussi ce que peut la [page 215] volonté, la conviction, l'autorité d'un homme supérieur sur ceux qui vivent habituellement dans son commerce. Elle nous fournit un nouvel argument contre cette critique superficielle et surannée qui n'admet dans l'histoire du mysticisme que des charlatans et des dupes.
L'abbé Fournié ne s'arrête pas là. Après les éclairs passagers et les visions qui représentent des créatures humaines, viennent des apparitions d'un ordre plus élevé : d'abord « un Être qui n'est pas du genre des hommes » (c'est l'abbé Fournié qui s'exprime ainsi) ; puis le Christ sous sa forme terrestre, crucifié sur l'arbre de la croix ou sortant plein de vie du sein de la tombe ; enfin, le Sauveur des hommes dans toute sa gloire, triomphant du monde, de Satan et de ses pompes. On n'aura pas de peine à reconnaître ici ces communications successives dont parle Saint-Martin, réparties suivant le rang ou suivant les forces de chaque initié, et dans lesquelles étaient toujours compris les signes indicatifs du Rédempteur. Ce n'est qu'après avoir parcouru la série entière des signes qu'on était admis en présence de la réalité ou du Réparateur lui-même, du Verbe, de la cause active et intelligente. Évidemment, cette initiation suprême devait être purement intellectuelle. Mais, une rumeur étrange circulait dans les loges. On attribuait à Martinez Pasqualis le pouvoir surnaturel de procurer à ses disciples les connaissances physiques, c'est-à-dire la vision du Verbe divin, et l'on citait comme exemple le comte d'Hauterive. Voici, en effet, ce qu'on racontait de ce personnage. Nous laissons la parole au correspondant de Saint-Martin, le baron de Liebisdorf, en priant le lecteur de se souvenir que c'est un Suisse qui écrit dans notre langue :
« L'école par laquelle vous avez passé pendant votre jeunesse me rappelle une conversation que j'ai eue, il y a deux [page 216] ans (16. La lettre de Kirchberger porte la date du 25 juillet 1792.) , avec une personne qui venait d'Angleterre et qui avait des relations avec un Français habitant ce pays, nommé M. d'Hauterive. Ce M. d'Hauterive, d'après ce qu'on me disait, jouissait de la connaissance physique de la cause active et intelligente ; qu'il y parvenait à la suite de plusieurs opérations préparatoires, et cela pendant les équinoxes, moyennant une espèce de désorganisation dans laquelle il voyait son propre corps sans mouvement, comme détaché de son âme ; mais, que cette désorganisation était dangereuse à cause des visions qui ont alors plus de pouvoir, sur l'âme séparée de son enveloppe, qui lui servait de bouclier contre leurs actions. Vous pourriez me dire, par les préceptes de votre ancien maître, si les procédés de M. d'Hauterive sont erreur ou vérité (17. Correspondance inédite, lettre V, p. 19 de l'édition de M. Schauer.). »
II est impossible, en lisant ces lignes, de ne pas se rappeler la légende qui circulait dans l'antiquité sur Hermotime de Clazomène. N'est-il pas extraordinaire qu'à vingt-quatre siècles de distance, et sans qu'on puisse accuser personne de plagiat, ni de mauvaise foi, le même don merveilleux ait été attribué par la Grèce païenne à un de ses plus anciens et plus obscurs philosophes, et par le mysticisme chrétien à un gentilhomme français de 1790 ? C'est que le mysticisme, qui est, comme nous l'avons déjà remarqué de tous les temps, de toutes les races, de toutes les religions, se trouve cependant renfermé comme dans un cercle infranchissable où il tourne constamment sur lui-même sans faire un seul pas en avant. Mais il faut que nous sachions ce que répond Saint-Martin à la question de son ami de Berne. Il connaissait d'Hauterive depuis de longues années, il était lié avec lui, ils s'étaient [page 217] livrés ensemble à une suite d'expériences magnétiques et théurgiques. Or, Saint-Martin, sans démentir complètement le fait sur lequel on le prie de s'expliquer, le ramène à des proportions moins fabuleuses.
«Votre question sur M. d'Hauterive, écrit-il (18. Correspondance inédite, édition citée, lettre X, p. 37.), me force à vous dire qu'il y a quelque chose d'exagéré dans les récits qu'on vous a faits. Il ne se dépouille pas de son enveloppe corporelle ; tous ceux qui, comme lui, ont joui plus ou moins des faveurs qu'on vous a rapportées de lui, n'en sont pas sortis non plus. L'âme ne sort du corps qu'à la mort; mais, pendant la vie, les facultés peuvent s'étendre hors de lui et communiquer à leurs correspondants extérieurs sans cesser d'être unies à leur centre, comme nos yeux corporels et tous nos organes correspondent à tous les objets qui nous environnent sans cesser d'être liés à leur principe animal, foyer de toutes nos opérations physiques. Il n'en est pas moins vrai que, si les faits de M, d'Hauterive sont de l'ordre secondaire, ils ne sont que figuratifs relativement au grand œuvre intérieur dont nous parlons ; et, s'ils sont de la classe supérieure, ils sont le grand œuvre lui-même. »
Pour ceux qui ont eu quelque commerce avec Saint-Martin, et qui savent quelle distance il établit entre les voies intérieures et les voies extérieures, le sens de ses dernières paroles ne peut donner lieu à aucun doute. Les faits de l'ordre secondaire, ce sont les apparitions ou les visions, qui, lorsqu'il s'agit du foyer de la volonté et de la conscience divine, ont une valeur purement symbolique. Les faits de la classe supérieure ou le grand œuvre, c'est l'union spirituelle de l'âme avec son principe suprême, c'est l'accomplissement de la fin à laquelle aspire tout mysticisme conséquent.
| Note 19 19. « Si l'énumération des puissances et la nécessité de les classer est un domaine pour vous, l'ami B. (Boehm) vous procurera de grands secours sur ces objets L'école par où j'ai passé nous a donné aussi en ce genre une bonne nomenclature. Il y en a des extraits dans mes ouvrages, et je me contente de résumer ici mes idées sur ces deux nomenclatures. Celle de B. est plus substantielle que la nôtre, et elle mène plus directement au but essentiel ; la nôtre est plus brillante et plus détaillée, mais je ne la crois pas aussi profitable, d'autant qu'elle n'est, pour ainsi dire, que la langue du pays qu'il faut conquérir, et que ce n'est pas de parler des langues qui doit être l'objet des guerriers, mais bien de soumettre les nations rebelles. Enfin, celle de B. est plus divine, la nôtre est plus spirituelle ; celle de B. peut tout faire pour nous , si nous savons nous identifier avec elle ; la nôtre demande une opération pratique et opérative qui en rend les fruits plus incertains et peut-être moins durables, c'est-à-dire que la nôtre est tournée vers les opérations dans lesquelles notre maître était fort, au lieu que celle de B. est entièrement tournée vers la plénitude de l'action divine, qui doit tenir en nous la place de l'autre.... » (Correspondance inédite, lettre VIII, p. 29 et 30 de l'édition citée.) Il y a sans doute bien des énigmes dans ce passage ; mais il nous montre clairement, dans Martinez Pasqualis, le côté théurgique, l'œuvre des évocations employée uniquement comme moyen d'initiation à un degré plus élevé; ou, comme Saint-Martin le dit un peu plus loin (page 30), comme moyen d'établir par des preuves sensibles, « le divin caractère de notre être. » Je me fais un devoir d'avertir le lecteur que je me suis cru obligé de faire un léger changement dans le texte publié par M. Schauer. A la place de ces mots, qui n'ont aucun sens : « Je présume que voici mes idées... » j'ai substitué ceux-ci, que semblent exiger à la fois la pensée de l'auteur et la construction de la phrase : « Je me contente de résumer ici… » Je signalerai, en passant, bien d'autres incorrections dans l'édition de MM. Schauer et Chuquet : Prodage pour Pordage (surtout dans les premières lettres), origine pour Origène (p. 147); et, dès le début, le 22 mai 1792 au lieu de 1791. La première de ces dates n'est pas admissible, puisque la réponse à cette prétendue lettre du 22 mai 1792 est du 8 février de la même année (lettre II, p. 7). |
[page 218] Nous possédons maintenant, dans ses éléments les plus essentiels, la doctrine de Martinez Pasqualis. Elle se composait de deux parties très distinctes: l'une intérieure, spéculative, spirituelle, à laquelle se rattachaient d'antiques traditions, si elle n'était tout entière dans ces traditions mêmes; l'autre extérieure, pratique, jusqu'à un certain point matérielle, ou du moins symbolique, qui dépendait, comme nous l'apprend Saint-Martin, de tout un système sur la hiérarchie des vertus et des puissances ou sur les degrés du monde spirituel interposés entre Dieu et l'homme (19). 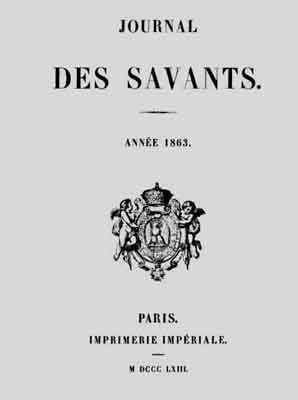 Ces deux parties de la doctrine de Martinez, qu'on rencontre aussi dans l'école d'Alexandrie, dans le gnosticisme et dans la kabbale, n'ont pas eu, et ne [page 219] pouvaient pas avoir, la même destinée. La dernière qui n'est pas autre chose que la théurgie, après avoir produit des visionnaires, tels que l'abbé Fournié, le comte d'Hauterive, le comte de Divonne, la marquise de Lacroix (20. On trouvera sur tous ces personnages d'abondants et précieux détails dans le livre de M. Matter.), a fini par se perdre dans l'école de Swedemborg [sic], détrônée à son tour par le somnambulisme et le spiritisme. La première, sous le nom de théosophie, c'est-à-dire la science qui a non seulement Dieu pour objet, mais qui émane de Dieu, a captivé surtout l'esprit de Saint-Martin et s'est rajeunie entre ses mains au souffle d'une belle âme et à la lumière d'une noble intelligence.
Ces deux parties de la doctrine de Martinez, qu'on rencontre aussi dans l'école d'Alexandrie, dans le gnosticisme et dans la kabbale, n'ont pas eu, et ne [page 219] pouvaient pas avoir, la même destinée. La dernière qui n'est pas autre chose que la théurgie, après avoir produit des visionnaires, tels que l'abbé Fournié, le comte d'Hauterive, le comte de Divonne, la marquise de Lacroix (20. On trouvera sur tous ces personnages d'abondants et précieux détails dans le livre de M. Matter.), a fini par se perdre dans l'école de Swedemborg [sic], détrônée à son tour par le somnambulisme et le spiritisme. La première, sous le nom de théosophie, c'est-à-dire la science qui a non seulement Dieu pour objet, mais qui émane de Dieu, a captivé surtout l'esprit de Saint-Martin et s'est rajeunie entre ses mains au souffle d'une belle âme et à la lumière d'une noble intelligence.
AD. FRANCE.
La suite à une prochaine livraison.
![]() Cet article a été également publié en 1863 dans le Journal des Savants (juin 1863, rubrique Livres nouveaux) par Adolphe Franck
Cet article a été également publié en 1863 dans le Journal des Savants (juin 1863, rubrique Livres nouveaux) par Adolphe Franck
2è article, pages 89-106 (1)
 Séances et Travaux de l'Académie des Sciences Morales et Politiques (Institut impérial de France)
Séances et Travaux de l'Académie des Sciences Morales et Politiques (Institut impérial de France)
Compte rendu par M. Ch. Vergé, avocat, docteur en droit, sous la direction de M. Mignet, secrétaire perpétuel de l’Académie
1865 – Quatrième trimestre
24e année – Cinquième série
Tome quatrième (LXXIVe de la collection).
Paris. Auguste Durand, libraire, 7, rue des Grès Sorbonne
1865
1. V. t. LXVI, p. 199.(ci-dessus, 1er article)
 Par sa naissance, son éducation, sa constitution même, autant que par la pente naturelle de son esprit, Saint-Martin était prédestiné à la tâche qu'il a remplie, et se trouvait armé contre les influences qui auraient pu l'en détourner. Né à Amboise, le 18 janvier 1743, d'une famille noble, mais pauvre et obscure (2. II était, comme il nous l'apprend lui-même dans son Portrait historique, le quatrième rejeton d'un soldat aux gardes), il se voyait en quelque sorte désintéressé dans le terrible conflit qui devait éclater à la fin du siècle et qui existait dès lors dans les esprits entre les deux classes inégales de la société. La faiblesse de son organisation le mettait à l'abri des entraînements qui sont, pendant un temps, le plus grand obstacle de la vie contemplative. Il était, quoique beau de visage et élégant dans ses proportions, d'une apparence si délicate, qu'il a pu dire (3. Portrait historique n° 5.) : « On ne m'a donné de corps qu'un [90] projet. » — « La divinité, écrit-il un peu plus loin (4. Portrait historique, n° 24.), ne m'a refusé tant d'astral (5. C'est le nom mystique par lequel il désigne les qualités de la matière.) que parce qu'elle voulait être mon mobile, mon élément et mon terme universel. » Doué d'une âme tendre et aimante, mais qui, selon son aveu (6. Portrait historique n° 36. « Dans l'ordre de la matière, j'ai été plutôt sensuel que sensible, et je crois que, si tous les hommes étaient de bonne foi, ils conviendraient que, dans cet ordre, il en est d'eux comme de moi. »), n'était pas étrangère à toute sensualité, il n'avait besoin que d'une première impulsion pour se trouver sur la pente qu'il a suivie toute sa vie. Cette direction décisive, il la reçut de sa belle-mère, car sa mère lui fut enlevée peu de temps après lui avoir donné le jour. C'est à cette femme qu'il se reconnaît redevable d'une grande partie des qualités qui l'ont fait aimer de Dieu et des hommes. Il se rappelle « avoir senti en sa présence une grande circoncision intérieure, qui lui a été fort instructive et fort salutaire. » II n'y a pas jusqu'à l'humeur sévère de son père qui, en le forçant de se contraindre et de refouler en lui-même les meilleurs mouvements de son cœur, ne contribuât à le pousser vers les solitaires contemplations. Elle servait à nourrir en lui ces dispositions mélancoliques qui étaient, comme il nous l'apprend lui-même, le fond de sa nature : « J'ai été gai, mais la gaieté n'a été qu'une nuance secondaire de mon caractère; ma couleur réelle a été la douleur et la tristesse (7. Ibid., n° 1.). [page 91]
Par sa naissance, son éducation, sa constitution même, autant que par la pente naturelle de son esprit, Saint-Martin était prédestiné à la tâche qu'il a remplie, et se trouvait armé contre les influences qui auraient pu l'en détourner. Né à Amboise, le 18 janvier 1743, d'une famille noble, mais pauvre et obscure (2. II était, comme il nous l'apprend lui-même dans son Portrait historique, le quatrième rejeton d'un soldat aux gardes), il se voyait en quelque sorte désintéressé dans le terrible conflit qui devait éclater à la fin du siècle et qui existait dès lors dans les esprits entre les deux classes inégales de la société. La faiblesse de son organisation le mettait à l'abri des entraînements qui sont, pendant un temps, le plus grand obstacle de la vie contemplative. Il était, quoique beau de visage et élégant dans ses proportions, d'une apparence si délicate, qu'il a pu dire (3. Portrait historique n° 5.) : « On ne m'a donné de corps qu'un [90] projet. » — « La divinité, écrit-il un peu plus loin (4. Portrait historique, n° 24.), ne m'a refusé tant d'astral (5. C'est le nom mystique par lequel il désigne les qualités de la matière.) que parce qu'elle voulait être mon mobile, mon élément et mon terme universel. » Doué d'une âme tendre et aimante, mais qui, selon son aveu (6. Portrait historique n° 36. « Dans l'ordre de la matière, j'ai été plutôt sensuel que sensible, et je crois que, si tous les hommes étaient de bonne foi, ils conviendraient que, dans cet ordre, il en est d'eux comme de moi. »), n'était pas étrangère à toute sensualité, il n'avait besoin que d'une première impulsion pour se trouver sur la pente qu'il a suivie toute sa vie. Cette direction décisive, il la reçut de sa belle-mère, car sa mère lui fut enlevée peu de temps après lui avoir donné le jour. C'est à cette femme qu'il se reconnaît redevable d'une grande partie des qualités qui l'ont fait aimer de Dieu et des hommes. Il se rappelle « avoir senti en sa présence une grande circoncision intérieure, qui lui a été fort instructive et fort salutaire. » II n'y a pas jusqu'à l'humeur sévère de son père qui, en le forçant de se contraindre et de refouler en lui-même les meilleurs mouvements de son cœur, ne contribuât à le pousser vers les solitaires contemplations. Elle servait à nourrir en lui ces dispositions mélancoliques qui étaient, comme il nous l'apprend lui-même, le fond de sa nature : « J'ai été gai, mais la gaieté n'a été qu'une nuance secondaire de mon caractère; ma couleur réelle a été la douleur et la tristesse (7. Ibid., n° 1.). [page 91]
Ainsi préparé, il entre au collège de Pontlevoi, où les lectures mystiques l'attirent déjà plus que les lectures classiques. Nous ne trouvons chez lui, à quelque âge de sa vie qu'on le considère, aucun souvenir des auteurs de l'antiquité grecque et latine, tandis que nous savons que, dans son enfance, il faisait ses délices de l'Art de se connaître soi-même d'Abadie (8. Portrait historique, n° 418.). A un ouvrage de ce genre, venait sans doute se joindre l'étude de la Bible, dont il est resté comme un parfum dans tous ses écrits, particulièrement dans ses pensées détachées. Conformément au précepte qu'il donne aux autres, il a dû, de bonne heure, « mettre son esprit en pension chez les Écritures saintes (9. Ibid., n* 319.) ! »
Du collège il passa à l'école de droit, probablement celle d'Orléans [SM a fait ses études de droit à Paris], qui le laissait en quelque sorte au sein de sa famille. On verra tout à l'heure qu'il n'y est pas devenu un grand jurisconsulte, et que le droit coutumier et le droit romain n'ont pas beaucoup occupé ses veilles. En revanche, il se prit d'une véritable passion pour le droit naturel. Le mal n'aurait pas été grand, si l'attrait qu'il trouvait à cette branche de la jurisprudence l'avait mis en communication avec Grotius ou avec Leibnitz; mais, soit ignorance, soit mauvais goût, il aima mieux s'adresser à un écrivain de second ordre. « C'est à Burlamaqui, dit-il (10. Ibid., n° 418.), que je dois mon goût pour les bases naturelles de la raison et de la justice de l'homme. » C'est lui qui lui a donné la force de combattre Rousseau. Aussi le compte-t-il parmi les trois [page 92] hommes qui ont exercé le plus d'empire sur sa destinée et qu'il reconnaît pour ses maîtres. Les deux autres sont Martinez Pasqualis et Jacob Bœhm.
A la même époque, c'est-à-dire à l'âge de dix-huit ans, il connaissait déjà presque tous les philosophes du XVIIIe siècle. Mais leurs écrits ne firent aucune brèche à ses croyances, parce que la foi était dans son cœur beaucoup plus que dans son esprit. Mais, pour lui, il y voyait une preuve de la grâce particulière dont il se figurait être l'objet et du rôle providentiel que lui attribuait son naïf orgueil. « Le passage de l'Évangile, voici à quels signes on les reconnaîtra ; les poissons ne leur feront pas de mal; ils toucheront des serpents, s'est vérifié sur moi dans l'ordre philosophique. J'ai lu, vu, écouté les philosophes de la matière et les docteurs qui ravagent le monde par leurs instructions, et il n'y a pas une goutte de leur venin qui ait percé en moi, ni un seul de ces serpents dont la morsure m'ait été préjudiciable. Mais tout cela s'est fait naturellement en moi et pour moi; car, lorsque j'ai fait ces salutaires expériences, j'étais trop jeune et trop ignorant pour pouvoir compter mes forces pour quelque chose (11. Portrait historique, n° 618, conf., n° 28.). »
Il avait un grand-oncle appelé M. Poucher, qui était conseiller d'État. Dans l'espérance que cette position pourrait un jour passer à lui par droit d'héritage, son père voulut qu'il entrât dans la magistrature, et le fit nommer avocat du roi au siège présidial de Tours. Saint-Martin se laissa faire avec cette obéissance filiale qu'il garda jusqu'au [page 93] déclin de sa vie. Le succès aurait dû couronner son sacrifice; mais il n'en fut rien. L'opinion qu'il donna de lui en prenant possession de sa charge fut si malheureuse, qu'il versa des larmes, nous dit-il lui-même, plein son chapeau. Il persista encore six mois ; mais, au bout de ce temps, l'épreuve lui parut décisive, et il obtint de son père de quitter une profession pour laquelle il n'avait pas plus d'aptitude que de goût. Il avait beau assisté, à ce qu'il nous assure, à toutes les plaidoiries, aux délibérations, aux voix et au prononcé du président, il n'a jamais su une seule fois qui est-ce qui gagnait, ou qui est-ce qui perdait le procès.
Que faire après cela? car on ne lui permettait pas de rester oisif, ou, ce qui était la même chose pour son père, de vivre dans la retraite et dans l'étude. Pour un jeune homme de noble extraction, qui venait de quitter la robe, il n'y avait que la carrière des armes. Ce fut celle qu'embrassa Saint-Martin, presque avec joie, bien qu'au fond elle ne s'accommodât pas mieux à son caractère que celle d'où il sortait : « J'abhorre la guerre, j'adore la mort, » écrit-il plus lard (12. Portrait historique, n° 952.), et ces paroles expriment les sentiments de sa plus tendre jeunesse. Mais il se flattait que le service militaire se prêterait beaucoup mieux que la magistrature à ses goûts contemplatifs. Grâce à la protection de M. de Choiseul, le jeune avocat du roi démissionnaire reçut un brevet d'officier au régiment de Foix, et Saint-Martin, sans autre préparation que ses souvenirs philosophiques de l'école de droit alla rejoindre son corps qui tenait garnison à Bordeaux. [page 94]
Ce fut un moment solennel dans son existence, et qui lui revient à chaque instant à la mémoire ; car Bordeaux fut pour lui le chemin de Damas; c'est à Bordeaux qu'il rencontra son premier précepteur spirituel, qu'il fut introduit par quelque camarade de régiment, déjà initiés dans la loge de Martinez : « C'est à Martinez de Pasqualis, dit-il (13. Portrait historique, n° 418 ; voyez aussi n° 73), que je dois mon entrée dans les vérités supérieures. C'est à Jacob Bœhm que je dois les pas les plus importants que j'ai faits dans ces vérités. » A l'exception de ces deux hommes, il n'a vu sur la terre que des gens qui voulaient être maîtres, et qui n'étaient pas même en état d'être disciples. Saint-Martin, à cette époque, n'avait encore que vingt-trois ans, mais son esprit fut irrévocablement fixé; il avait enfin trouvé sa carrière.
Cependant ce ne fut que cinq ans plus lard, en 1771, qu'il quitta le service pour se vouer tout entier à la cause qu'il avait épousée, ou, comme il a coutume de s'exprimer dans le langage qu'il s'est fait, pour s'occuper uniquement de ses objets. En considérant l'abandon où le laissaient ses idées au milieu du courant qui entraînait son siècle, il se comparait au héros de Daniel Foë, il se disait « le Robinson de la spiritualité (14. Ibid., n° 458.). » Mais, quand il songeait que les germes de vérité déposés dans son esprit étaient les semences de la vie éternelle, le seul aliment qui convînt aux âmes dévastées, alors il avait la conviction qu'il était revêtu d'un sacerdoce (15. C'est la véritable signification du titre de Cohen, donné par Martinez à ses adeptes) et qu'il se devait à l'avancement de ses [page 95] semblables comme au sien. Cette œuvre de propagande, il résolut de l'accomplir de deux manières: par ses livres et par sa conversation. C'est ce qui nous explique comment Saint-Martin, malgré les ouvertures qui lui furent faites à ce sujet, n'a jamais fondé ni dirigé aucune loge, aucune société secrète, et comment sa vocation intérieure ne l'empêchait pas d'être extrêmement répandu dans le monde. Il y cherchait, pour me servir de ses expressions, des terrains à défricher, c'est-à-dire des âmes à convertir, quelques petits poulets à qui il pût donner la becquée spirituelle (16. « II y a quelques petits poulets qui viennent de temps en temps me demander la becquée. » Corresp. inéd., p. 250.). Ajoutons que le monde ne lui déplaisait pas, en dépit des vices et des erreurs dont il le voyait rempli. « J'abhorre, dit-il (17. Portrait historique, n° 776.), l'esprit du monde, et cependant j'aime le monde et la société. »
Au reste, il avait tout ce qu'il faut pour y réussir : un esprit délicat et fin, que le XVIIIe siècle, à travers les nuages du mysticisme, avait marqué de son empreinte; une conversation vive, pénétrante, pleine de saillies ; des manières naturellement élégantes, parce qu'elles répondaient à la noblesse inférieure; une figure charmante et des yeux d'une telle douceur, qu'une de ses amies lui dit un jour qu'ils étaient doublés d'âme. Peut-être aussi, dans ce siècle d'incrédulité, s'amusait-on de sa foi et de la naïveté de ses sentiments ; car il est permis de supposer qu'il faisait un retour sur lui-même quand il écrivait ces paroles : « Le monde m'a donné une connaissance qui ne lui est pas avantageuse. [pages 96] J'ai vu que, comme il n'avait d'esprit que pour être méchant, il ne concevait pas que l'on pût être bon sans être une bête (18. Portrait historique, n° 24).» Aussi, ayant commencé par s'établir à Paris, il y trouva l'accueil le plus flatteur. Les salons les plus aristocratiques étaient jaloux de le posséder. J'ai déjà nommé, au début de cette étude, la plupart des personnages illustres qui l'admettaient dans leur intimité ; je n'y reviendrai point ici : je dirai seulement que ce n'est point auprès des hommes qu'il a eu le plus de succès. Il nous fait connaître lui-même la stérilité de ses efforts pour convertir à ses doctrines le vieux maréchal de Richelieu, Bailly, l'astronome Lalande. Nous ne savons pas quelle impression sa parole aurait produite sur Voltaire, à qui il devait être présenté par le maréchal de Richelieu ; mais nous connaissons le jugement que Voltaire a porté, quelques jours avant de mourir, sur son premier ouvrage : «.Votre doyen, écrit-il, le 22 octobre 1777 à d'Alembert (ce doyen, c'est le maréchal), votre doyen m'avait vanté un livre intitulé : Des erreurs et de la vérité. Je l'ai fait venir pour mon malheur. Je ne crois pas qu'on ait jamais rien imprimé de plus absurde, de plus obscur, de plus fou et de plus sot. Comment un tel ouvrage a-t-il pu réussir auprès de M. le doyen? » Déjà avant d'avoir reçu le livre, l'auteur de Candide le condamnait par ces mots : « S'il est bon, il doit contenir cinquante volumes in-folio sur la première partie et une demi-page sur la seconde. » N'ayant jamais vu Rousseau, avec qui il se trouve toute sorte de ressemblance (19. Ibid., n° 60), Saint-Martin se flatte qu'il aurait mieux réussi [page 97] près de lui (20. Portrait historique, n° 129). Mais pourquoi l'auteur de la Profession de foi du vicaire savoyard, l'admirateur passionné de la nature, se serait-il entendu avec un écrivain qui n'apercevait partout que symboles, mystères, révélations secrètes, et qui ne voyait dans la nature que les signes d'une antique déchéance ? Avec l'homme, cela est possible, si Rousseau avait pu s'entendre avec quelqu'un. Il était à craindre que Saint-Martin ne recueillît de ses rapports la même déception qui l'attendait près de Chateaubriand une année avant sa mort. Pénétré d'une vive admiration pour le chantre des Martyrs, il concerta avec un ami commun les moyens de le voir et de l'entendre, et il rapporta de cette réunion le plus doux souvenir (21. Ibid.,n°1095.). Mais il n'en fut pas de même, hélas ! du côté de Chateaubriand. Celui-ci, racontant la même entrevue (22. Mémoires d'outre-tombe, t. IV, p. 76), couvre de ridicule et crible de traits de satire son confiant interlocuteur.
L'ascendant de Saint-Martin, qu'il est d'ailleurs impossible de contester, s'est exercé principalement sur les femmes. Ce n'est pas la première fois qu'on remarque la prédilection, et il faut ajouter, pour être complètement juste, l'aptitude des femmes pour le mysticisme. Tout près de nous, madame de Krudner; au XVIIe siècle, madame Guyon, madame de Chantal, Antoinette Bourguignon ; au XVIe, sainte Thérèse; au XIVe, sainte Catherine de Sienne, en sont d'illustres exemples. Il n'est pas besoin de chercher longtemps l'explication de ce fait. Le mysticisme, n'est-ce point le degré le plus élevé de l'amour ? Le [page 98] mysticisme même indiscipliné et révolté contre toute loi, n'est-ce point l'excès du renoncement, l'amour divin poussé jusqu'aux égarements de la passion ? Il ne faut donc point s'étonner de voir tant de nobles dames choisir Saint-Martin, en quelque sorte, pour leur directeur : les marquises de Lusignan, de Coislin, de Chabanais, de Clermont-Tonnerre, la maréchale de Noailles, la duchesse de Bourbon et beaucoup d'autres, soit françaises ou étrangères, qu'il serait trop long de passer en revue. Parmi ces néophytes, les unes se contentaient de l'écouter en silence, les autres lui écrivaient, d'autres, comme la maréchale de Noailles, venaient le consulter jusqu'au milieu de ses repas, sur les endroits difficiles de ses ouvrages ; enfin la duchesse de Bourbon, afin de jouir de ses entretiens tout à son aise, le logeait dans son palais et le menait avec elle à la campagne.
C'est au milieu de ce cercle, dont il était l'idole, que se sont formées ses opinions sur la femme en général, les unes qui respirent l'esprit du monde, et même l'esprit satirique du XVIIIe siècle, les autres venues d'une source de respect et de tendresse plus pure que les passions humaines. Voici quelques échantillons des premières : « Il faut être bien sage pour aimer la femme qu'on épouse, et bien hardi pour épouser la femme que l'on aime (23. Pensées tirées d'un manuscrit de Saint-Martin, Œuvres posthumes, t. I, p. 215). » — « La femme a en elle un foyer d'affection qui la travaille et l'embarrasse; elle n'est à son aise que lorsque ce foyer-là trouve de l'aliment; n'importe ensuite ce que [page 99] deviendra la mesure et la raison. Les hommes sont qui ne sont pas plus loin que le noviciat sont aisément attirés par ce foyer, qu'ils ne soupçonnent pas être un gouffre. Ils croient traiter des vérités d'intelligence, tandis qu'ils ne traitent que des affections et des sentiments ; ils ne voient pas que la femme passe tout, pourvu qu'elle trouve l'harmonie de ses sentiments ; ils ne voient pas qu'elle sacrifie volontiers à cette harmonie de ses sentiments l'harmonie de ses opinions (24. Portrait historique, partie inédite). » Assurément ces observations se distinguent plus par la finesse que par la bienveillance. Mais Saint-Martin nous apprend que, dans son âge mûr, quand il eut acquis sur la nature de la femme des lumières plus profondes, il l'a aimée et honorée mieux que pendant les effervescences de sa jeunesse, quoiqu'il sache « que sa matière est encore plus dégénérée et plus redoutable que la matière de l'homme (25. Ibid., n°468). » Cela n'est guère d'accord avec cette pensée : « La femme m'a paru être meilleure que l'homme; mais l'homme m'a paru plus vrai que la femme. » Mais Saint-Martin ne se pique pas d'être conséquent ; il dit ce qu'il croit et ce qu'il sent, laissant à ses sentiments le soin de se concilier comme ils peuvent avec ses doctrines. C'est, sans aucun doute, dans sa maturité qu'il a écrit ces lignes : « L'homme est l'esprit de la femme et la femme est l'âme de l'homme (26. Pensées tirées d'un manuscrit, Œuvres posthumes, t. I, p. 210). » — « Si Dieu pouvait avoir une mesure dans son amour, [page 100] il devrait aimer la femme plus que l'homme. Quant à nous, nous ne pouvons nous dispenser de la chérir et l'estimer plus que nous-mêmes, car la femme la plus corrompue est plus facile à ramener qu'un homme qui n'aurait fait même qu'un pas dans le mal. Le fond du cœur de la femme est peut-être moins vigoureux que le cœur de l'homme, mais il est moins susceptible de se corrompre de la grande corruption (27. Œuvres posthumes, p. 260-261.). » Nous n'avons pas encore le dernier mot de Saint-Martin sur les femmes. Un peu plus loin, dans ce même écrit que nous venons de citer, son ton s'élève jusqu'à l'hymne : « Les femmes, par leur constitution, par leur douceur, démontrent bien qu'elles étaient destinées à une œuvre de miséricorde. Elles ne sont, il est vrai, ni prêtres, ni ministres de la justice, ni guerriers; mais elles semblent n'exister que pour fléchir la clémence de l'Être suprême, dont le prêtre est censé prononcer les arrêts, que pour adoucir la rigueur des sentences portées par la justice sur les coupables, et que pour panser les plaies que les guerriers se font dans les combats. L'homme paraît n'être que l'ange exterminateur de la divinité ; la femme en est l'ange de paix. Qu'elle ne se plaigne pas de son sort. Elle est le type de la plus belle faculté divine. Les facultés divines doivent se diviser ici-bas ; il n'y a que la divinité même où elles ne forment qu'une unité parfaite et une harmonie où toutes les voix vivantes et mélodieuses ne se font jamais entendre que pour former l'ensemble du plus mélodieux des concerts (28. Ibid., p. 282). » [page 101]
Lorsqu'un homme, fît-il profession de la plus haute spiritualité, parle ainsi des femmes en général, il est difficile de croire qu'il n'ait point l'esprit occupé par quelques souvenirs particuliers, si ce n'est même par une pensée unique, par une image adorée qu'il s'efforce de dissimuler sous un nom collectif. En effet, dans un passage resté inédit de son Portrait historique, et que M. Matter a eu l'heureuse idée de reproduire (29. Ouvrage cité, ch. VIII, p. 87), Saint-Martin nous apprend que, vers 1778, pendant qu'il était à Toulouse, son cœur s'est engagé deux fois au point de concevoir des projets de mariage. Mais, s'il était né pour les affections tendres, il ne l'était point pour le mariage ni pour un autre établissement, quel qu'il fût. Il ne se sentait propre qu'à une seule chose, et n'a jamais songé à se faire un autre revenu que des rentes en âmes. Puis l'homme qui reste libre n'a à résoudre, dit-il (30. Portrait historique, n° 195), que le problème de sa propre personne; celui qui se marie a un double problème à résoudre. Ce qui est vrai aussi, c'est que son âme, alors, n'était atteinte qu'à la surface; autrement il n'aurait pas écrit (31. Ibid., n° 468) : « Je sens au fond de mon être une voix qui me dit que je suis d'un pays où il n'y a point de femmes. » Il eut la preuve du contraire dans l'attachement singulier qu'il ressentit, à l'âge de près de cinquante ans, pour une personne qui revient fréquemment dans ses écrits, et qu'il, n'appelle jamais autrement que ma B..,, ma chérissime B...
M. Matter établit victorieusement, contre l'opinion commune, que cette désignation ne s'applique pas à la duchesse [page 102] de Bourbon, princesse excellente, mais d'une médiocre intelligence, plus superstitieuse encore que religieuse, plus occupée de pratiques magnétiques et somnambuliques que de mysticisme, à laquelle Saint-Martin était sincèrement dévoué et dont il possédait toute la confiance, mais qui n'a jamais pu exercer sur lui aucun ascendant. Un de ses livres a été écrit uniquement pour elle, pour l'arracher à la pente qui l'entraînait du côté de Mesmer et de Puységur, pour la détourner de ce merveilleux grossier qui couronne si dignement le matérialisme du XVIIIe siècle. Voici, au reste, le portrait qu'il en fait dans sa correspondance avec Kirchberger ; on y trouvera la confirmation de tout ce que nous venons de dire. « Vous avez raison, Monsieur, d'avoir très bonne opinion de l'hôtesse que je viens de quitter. On ne peut pas porter plus loin les vertus de la piété et le désir de tout ce qui est bien ; c'est vraiment un modèle, surtout pour une personne de son rang. Malgré cela, j'ai cru notre ami Bœhm une nourriture trop forte pour son esprit, surtout à cause du penchant qu'elle a pour tout le merveilleux de l'ordre inférieur, tel que les somnambules et les prophètes du jour. Aussi je l'ai laissée dans sa mesure, après avoir fait tout ce que j'ai cru de mon devoir pour l'avertir ; car l’Ecce homo l'a eue un peu en vue, ainsi que quelques autres personnes livrées au même entraînement (32. Lettre XI, p. 41 de l'édition Schauer et Chaquet). »
Mais Saint-Martin a rencontré sur son chemin une autre femme dont le nom commence par la même lettre, et qui a [page 103] exercé sur son esprit comme sur son cœur, sur ses idées comme sur ses sentiments, la plus décisive influence. C'est madame Charlotte de Bœcklin. Issue d'une noble famille de l'Alsace, elle vivait à Strasbourg, séparée de son mari, au moment où Saint-Martin y arriva, vers l'année 1788. Protestante convertie au catholicisme par des considérations de famille, elle n'avait en réalité pas d'autre foi que ce christianisme un peu flottant, ou, comme on dit aujourd'hui, ce christianisme libre qui se confond volontiers avec le mysticisme. C'est elle, avec le concours de son compatriote Rodolphe Salzmann, qui fit connaître à Saint-Martin les écrits de Jacob Bœhm, et lui aida plus tard à les traduire. Le Philosophe inconnu inclinait alors vers Swedenborg, il s'abandonnait à la direction du chevalier de Silferhielm, le neveu et le disciple exalté du voyant suédois ; c'est même de ce courant d'idées que sortit, au moins en partie, un de ses ouvrages, celui qui est intitulé le Nouvel homme. On peut donc se figurer ce qu'il dut éprouver de reconnaissance pour celle qui le tirait de ce mysticisme subalterne pour lui ouvrir les portes de la vraie sagesse, pour le conduire aux pieds du maître suprême ; car Bœhm est pour lui la plus grande lumière qui ait paru sur la terre après celui qui est la lumière même; il ne se croit pas digne, lui, de dénouer les cordons de ses souliers (33. Ouvrage cité, p. 164).
Avec une femme belle encore, distinguée par son esprit autant que par sa grâce extérieure, faisant l'office d'un messager céleste qui vient apporter la parole de vie, la reconnaissance, dans une âme comme celle de Saint-Martin, [page 104] se changea bientôt en un sentiment plus passionné et plus tendre. Madame de Bœcklin, à ce que nous assure M. Matter, avait alors quarante-huit ans, et de plus elle était grand-mère. Saint-Martin, comme je l'ai déjà dit, avait le même âge. Mais qu'importe ? Il y a des natures qui restent toujours jeunes, parce qu'elles voient les choses et les hommes à la lueur d'un idéal invisible. Il y a un amour qui ne craint point les ravages du temps, parce qu'il vient d'une source que le temps ne saurait tarir. Tel était celui que Saint-Martin éprouva pour madame de Bœcklin. Était-ce bien de l'amour qu'elle lui inspira? Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'amitié ne produit pas les mêmes effets et ne parle pas le même langage. Après trois ans de résidence à Strasbourg auprès de son amie, et quand il réussit enfin, après bien des obstacles, à habiter avec elle la même maison, il est obligé de la quitter, rappelé qu'il est par la maladie de son père. Or voici dans quels termes il se plaint de cette cruelle nécessité : « Il fallut quitter mon paradis pour aller soigner mon père. La bagarre de la fuite du roi me fit retourner de Lunéville à Strasbourg, où je passai encore quinze jours avec mon amie ; mais il fallut en venir à la séparation. Je me recommandais au magnifique Dieu de ma vie pour être dispensé de boire cette coupe ; mais je lus clairement que, quoique ce sacrifice fût horrible, il le fallait faire, et je le fis en versant un torrent de larmes (34. Portrait historique, partie inédite, citée par M. Matter, ubi supra, p. 163). » Ce n'est pas une fois, et au moment décisif, qu'il arrive à Saint-Martin d'exhaler ainsi sa douleur; il y revient à plusieurs reprises et à différents intervalles. [page 105]
« J'ai par le monde, écrit-il (35. Portrait historique, n°109), une amie comme il n'y en a point. Je ne connais qu'elle avec qui mon âme puisse s'épancher tout à son aise et s'entretenir des grands objets qui l'occupent, parce que je ne connais qu'elle qui se soit placée à la mesure où je désire que l'on soit pour m'être utile. Malgré les fruits que je ferais auprès d'elle, nous sommes séparés par les circonstances. Mon Dieu, qui connaissez les besoins que j'ai d'elle, faites-lui parvenir mes pensées et faites-moi parvenir les siennes, et abrégez, s'il est possible, le temps de notre séparation. »
Ce ne sont pas seulement des pensées qu'échangeait ce couple mystique lorsqu'il se trouvait réuni. De temps à autre quelques tendres paroles venaient se glisser au travers des plus sublimes entretiens ; mais elles ont un accent particulier, qu'on chercherait vainement ailleurs. Saint-Martin nous en donne une idée dans un passage de ses mémoires qui se rapporte évidemment à ses relations avec madame de Bœcklin. « Une personne dont je fais grand cas me disait quelquefois que mes yeux étaient doublés d'âme. Je lui disais, moi, que son âme était doublée de bon Dieu, et que c'est là ce qui faisait mon charme et mon entraînement auprès d'elle (36. Ibid., n° 760). »
Ce n'est qu'après avoir parcouru une grande partie de la France et de l'Europe, que Saint-Martin s'arrêta dans la capitale de l'Alsace. Toulouse, Versailles, Lyon, furent successivement le théâtre de son apostolat; car, tout en écrivant qu'il ne voulait d'autres prosélytes que lui-même (37. Ma secte est la Providence ; mes prosélytes, c’et moi; mon culte, c'est la justice. » (Ibid., n° 488.)), [page 106] il ne pouvait tenir en place ni garder pour lui les pensées dont son âme était obsédée. Ce n'était pas en vain que Dieu lui avait donné dispense pour venir habiter ce monde, auquel il restait étranger, et qui n'était pas, disait-il (38. Portrait historique, n° 763.), du même âge que lui. S'il n'avait pas reçu la puissance de le convertir, il voulait du moins lui faire honte de ses souillures et pleurer sur ses ruines; « il était le Jérémie de l'universalité. » II visita donc l'Angleterre, l'Italie, la Suisse, s'arrêtant principalement à Gênes, à Rome, à Londres, ne perdant pas de vue le but de ses voyages, répandant partout où il le peut, mais surtout dans les hautes régions de l'aristocratie, la semence spirituelle, entouré de princes et de princesses, ou bien recueillant lui-même les doctrines les mieux appropriées à l'état de son esprit. C'est ainsi qu'à Londres il se mit en rapport avec le traducteur anglais des œuvres de Jacob Bœhm, William Law, et avec le mystique Best, qui leva pour lui, à ce qu'il assure, les voiles de l'avenir. C'est à Londres aussi qu'il connut le prince Alexandre Galitzin, avec lequel il fit une seconde fois le voyage d'Italie, et un grand nombre de seigneurs russes qui voulurent l’emmener avec eux dans leur pays. Mais il avait hâte de retourner en France, et en France il y avait surtout trois villes entre lesquelles il partagea le reste de sa vie : Strasbourg, Amboise et Paris. Il appelle Strasbourg son paradis, Amboise son enfer, et Paris son purgatoire.
Ad. FRANCK.
(La suite à la prochaine livraison.).
3ème article, pages 203-226 (1)
 Séances et Travaux de l'Académie des Sciences Morales et Politiques (Institut impérial de France)
Séances et Travaux de l'Académie des Sciences Morales et Politiques (Institut impérial de France)
Compte rendu par M. Ch. Vergé, avocat, docteur en droit, sous la direction de M. Mignet, secrétaire perpétuel de l’Académie
1865 – Quatrième trimestre
24e année – Cinquième série
Tome quatrième (LXXIVe de la collection).
Paris. Auguste Durand, libraire, 7, rue des Grès Sorbonne
1865
1. V. t. LXVI, p. 199, et plus haut, p. 89
 Les portes du paradis venaient de se fermer sans retour sur le malheureux philosophe; il ne revit plus ni Strasbourg ni madame de Bœcklin, et c'est entre son purgatoire et son enfer qu'il est obligé de partager le reste de sa vie. Son enfer, hélas ! il est bien forcé de l'avouer, ce n'est pas seulement la petite ville d'Amboise, c'est la maison paternelle. Saint-Martin a écrit sur le respect filial une très belle page (2. Portrait historique, n° 67). Il a fait mieux encore : il n'a pas cessé un instant de pratiquer la vertu, dont il parle avec tant de grâce. Mais il n'a pas été en son pouvoir d'établir entre lui et son père cette harmonie des pensées et des sentiments qui rend facile l'accomplissement de tous les devoirs et donne du charme au sacrifice. Ce n'est pas assez de dire que l'esprit de son père était fermé aux idées dont il nourrissait le sien ; « tout ce qui tenait à l'esprit lui était [page 204] antipathique (3. Portrait historique, n° 282, passage inédit cité par M. Matter). » Et cependant cette sécheresse, si propre à le blesser, ne lui inspire qu’un regret d’une ineffable tendresse. « C'est dans l'effusion de mon cœur, dit-il (4. Ibid., n° 314), que j'ai demandé à Dieu de donner la vie spirituelle à celui par qui il a permis que j’aie reçu la vie temporelle, c'est-à-dire le moyen d'éviter la mort. Cette récompense en faveur de cet être que j'honore eût été une des plus douces jouissances qui pût m'être accordée, et aurait fait la balance de toutes les épreuves que j'ai subies par lui et à cause de lui. » En quelque lieu qu'il se trouve, à peine a-t il reçu les ordres du morose vieillard, qu'il accourt près de lui avec la soumission d'un enfant, et, quoiqu'il n'ait pas même la consolation de lui être utile, il consent à ne plus le quitter tant qu'il vivra. Mais il ne dissimule pas les souffrances que cette chaîne lui fait endurer. Dès les premiers moments, il aurait été anéanti sans la force qu'il puisait dans les écrits de Bœhm et dans les lettres de madame de Bœcklin. Ces appuis mêmes ne lui ont pas toujours suffi. Ils ne l'ont pas empêché d'éprouver des mouvements de désespoir, des secousses du néant, comme il les appelle, « qui lui ont fait connaître l'enfer de glace et de privation. »
Les portes du paradis venaient de se fermer sans retour sur le malheureux philosophe; il ne revit plus ni Strasbourg ni madame de Bœcklin, et c'est entre son purgatoire et son enfer qu'il est obligé de partager le reste de sa vie. Son enfer, hélas ! il est bien forcé de l'avouer, ce n'est pas seulement la petite ville d'Amboise, c'est la maison paternelle. Saint-Martin a écrit sur le respect filial une très belle page (2. Portrait historique, n° 67). Il a fait mieux encore : il n'a pas cessé un instant de pratiquer la vertu, dont il parle avec tant de grâce. Mais il n'a pas été en son pouvoir d'établir entre lui et son père cette harmonie des pensées et des sentiments qui rend facile l'accomplissement de tous les devoirs et donne du charme au sacrifice. Ce n'est pas assez de dire que l'esprit de son père était fermé aux idées dont il nourrissait le sien ; « tout ce qui tenait à l'esprit lui était [page 204] antipathique (3. Portrait historique, n° 282, passage inédit cité par M. Matter). » Et cependant cette sécheresse, si propre à le blesser, ne lui inspire qu’un regret d’une ineffable tendresse. « C'est dans l'effusion de mon cœur, dit-il (4. Ibid., n° 314), que j'ai demandé à Dieu de donner la vie spirituelle à celui par qui il a permis que j’aie reçu la vie temporelle, c'est-à-dire le moyen d'éviter la mort. Cette récompense en faveur de cet être que j'honore eût été une des plus douces jouissances qui pût m'être accordée, et aurait fait la balance de toutes les épreuves que j'ai subies par lui et à cause de lui. » En quelque lieu qu'il se trouve, à peine a-t il reçu les ordres du morose vieillard, qu'il accourt près de lui avec la soumission d'un enfant, et, quoiqu'il n'ait pas même la consolation de lui être utile, il consent à ne plus le quitter tant qu'il vivra. Mais il ne dissimule pas les souffrances que cette chaîne lui fait endurer. Dès les premiers moments, il aurait été anéanti sans la force qu'il puisait dans les écrits de Bœhm et dans les lettres de madame de Bœcklin. Ces appuis mêmes ne lui ont pas toujours suffi. Ils ne l'ont pas empêché d'éprouver des mouvements de désespoir, des secousses du néant, comme il les appelle, « qui lui ont fait connaître l'enfer de glace et de privation. »
Ni les peines de la solitude chez un homme qui savait trouver tant de ressources en lui-même, ni les douleurs d'une séparation qui remontait déjà à plus d'une année (5. C'est le 1" juillet 1791 que Saint-Martin quitta Mme de Bœcklin ; c'est au mois de septembre de l'année suivante que se rapporte le passage que je viens de citer), [page 205] ne suffisent pour expliquer ces sombres images. Elles trahissent encore une autre plaie que Saint-Martin ne découvre pas volontiers, mais qu'on aperçoit cependant sous les voiles et les réticences dont il cherche à l'envelopper. Déjà plusieurs fois, nous dit-il, il avait cru remarquer qu'il existait sur lui un décret de la Providence, qui lui permettait seulement d'approcher du but sans pouvoir le toucher; mais que, dans l'année 1792, précisément celle où il à tant souffert, il a connu, par une révélation expresse, cet acte de la volonté divine, sans lequel il aurait percé plus loin qu'il ne convient à une créature humaine, et aurait dévoilé à la terre des mystères destinés à lui rester cachés encore longtemps (6. Voir M. Matter, ouvrage cité, p. 192). N'est-ce pas nous faire entendre que ses yeux se sont ouverts sur la vanité de ses espérances, qu'il ne croit plus à la destinée qu'il s'était promise ici-bas, et que ses illusions perdues ne sont pas une des moindres causes de son abattement. Cette supposition se change en certitude quand on le voit, depuis ce moment, signaler lui-même le silence méprisant ou l'indifférence profonde qui accueillent tous ses ouvrages. Il se sent complètement isolé au milieu de ses contemporains, qui non seulement ne peuvent pas, mais ne veulent pas le comprendre. « Quelqu'un disait à Rousseau, qui voulait parler : ils ne l'entendront pas. On pourrait souvent me dire la même chose, et on pourrait ajouter : ils ne te voudront pas entendre; sans compter qu'il faudrait dire auparavant : ils ne te croiront pas (7. Portrait historique, n° 906). » Toute la génération [page 206] qui l'entoure ne lui paraît composée que de corps sans âmes, de véritables cadavres, que la vie a quittés sans retour. Aussi quand il songe que c'est pour de tels lecteurs qu'il rédige ses écrits, il se compare à un homme qui jouerait des valses et des contredanses dans le cimetière de Montmartre. Quelle que soit la puissance de son archet, il ne fera jamais danser les morts qui reposent dans cette funèbre enceinte.
Voilà certainement plus d'orgueil et d'amertume qu'on en aurait attendu de Saint-Martin. Mais il ne faut pas oublier que le mysticisme, tout en niant ou en compromettant le principe de la personnalité, est essentiellement personnel. Au reste, Saint-Martin se remet bien vite de ses défaillances passagères. Ce monde, comme il nous l'a déjà dit, lui est étranger; il ne lui appartient ni par son âge, ni par sa langue, ni par ses idées; pourquoi donc s'affligerait-il de n'en être pas compris? Toute sa mission est de se préparer par l'exil à d'autres destinées. Toute sa consolation est dans le commerce de quelques âmes privilégiées, étrangères comme lui à ce siècle aveugle et déshérité.
A la lecture des œuvres de Bœhm et aux lettres de son amie de Strasbourg il avait pu joindre récemment une nouvelle occupation pour son esprit découragé : c'est sa correspondance avec Kirchberger, baron de Liebisdorf. Ce Kirchberger est celui dont Rousseau eut la visite dans l'île de Saint-Pierre, et qui l'intéressa vivement par ses talents et ses principes (8. Confession, part. 2, liv. XII). C'était un personnage très important de la république de Berne, moitié magistrat, moitié [page 207] militaire (car il était colonel fédéral), membre du Conseil souverain et de toutes les commissions qui servaient d'organes au gouvernement de son pays. Ces grandeurs ne l'empêchaient pas d'être un des hommes les plus instruits de son temps. Il avait étudié dans sa jeunesse, et continua de cultiver jusqu'à la fin de sa vie à peu près toutes les sciences; mais elles n'avaient pour lui d'autre valeur que de servir d'introduction à la connaissance du monde surnaturel. Admirateur passionné des œuvres de Saint-Martin, épris de tous les genres de mysticisme, il appartenait surtout à l'école de Bœhm, dont il nous révèle, en les adoptant avec une merveilleuse crédulité, les extravagances et les chimères. On ne peut lire quelques-unes de ses lettres sans se croire transporté à l'époque du gnosticisme et de l'école d'Alexandrie. Telles sont particulièrement celles où l'enthousiaste Bernois raconte à son correspondant de Paris la biographie de Gichtel (9. Corresp. inédite, p. 153-177 de l'édit. Schauer et Chuquet). Jean-George Gichtel, plus souvent appelé le général Gichtel, quoiqu'il n'ait jamais commandé un peloton ni appartenu, même comme simple soldat, à aucune armée, a publié, en 1682, une édition des œuvres de Bœhm. Mais c'était plus qu'un éditeur, plus qu'un disciple du grand mystique de l'Allemagne. C'était un maître; que dis-je? un prophète, un voyant, un être surhumain, que la sagesse éternelle, la divine Sophie, devenue visible à ses yeux et revêtue pour lui d'un corps céleste éblouissant de beauté, choisit pour son époux. Afin qu'on ne s'y trompe pas et qu'on ne prenne pas ce mariage pour une métaphore, on nous indique le [page 208] jour où il a été célébré : ce fut le jour de Noël de l'année 1673; et, pour donner encore plus de précision au récit, l'on a soin d'ajouter que « les noces furent consommées avec des délices ineffables, » et que la mariée promit « en paroles distinctes la fidélité conjugale (10. Corresp. inédite, p. 159). » Elle a tenu parole non seulement pendant la vie de son époux terrestre, mais dans la liberté du veuvage; car nous apprenons qu'après la mort de Gichtel, elle est venue à différentes reprises dans sa demeure, pour mettre l'ordre dans ses papiers et compléter de sa propre main ou corriger ses manuscrits (11. Ibid., p. 177).
Hâtons-nous de dire que le général, puisque tel est le titre sous lequel on se plaît à le désigner, était parfaitement digne de cette faveur extraordinaire. Tout entier à l'amour que lui inspirait la Vierge céleste, il avait méprisé les dons de la fortune, les millions qu'on lui offrait de toute part avec les alliances les plus recherchées, le pouvoir que donne la science de soumettre la nature aux calculs de notre ambition, en un mot, la possession de la pierre philosophale; car c'est elle évidemment que Kirchberger veut indiquer par cette périphrase : la solution du grand problème physique. Gichtel avait méprisé tout cela, et plus encore, l'amour d'une femme belle, riche, ornée de toutes les grâces, qui, séduite par ses vertus, aurait voulu se consacrer à son bonheur. Les puissances mêmes du monde spirituel semblaient approuver cette union. « Un jour qu'il se promenait dans sa chambre, il vit, en plein midi, [page 209] descendre du ciel une main qui joignait la sienne dans celle de la veuve (j'ai oublié de dire que telle était la position de cette aimable personne). Il entendit en même temps, une voix forte et claire qui disait : Il faut que tu l'aies. » — « Quelqu'un d'autre à sa place, continue Kirchberger, aurait pris cette manifestation pour une direction divine; mais il vit bientôt que ce n'était que l'esprit de la veuve, qui, dans la ferveur de ses prières, avait percé jusqu'au ciel extérieur et pénétré l'esprit astral. Il se donna dès lors entièrement à Sophia, qui ne voulait pas un cœur partagé (12. Corresp. inédite, p. 159). » Elle se montra d'une telle jalousie, qu'elle lui défendit même de prier pour le repos des pauvres cœurs dont il était l'idole. Ces prières, au reste, n'avaient d'autre effet, selon l'énergique expression du narrateur, que de jeter de l'huile dans leurs feux (13. Ibid). Irrésistible en amour, le terrible général ne l'était pas moins à la guerre, car c'est lui qui a battu les armées de Louis XIV à Hochstett, à Oudenarde et à Malplaquet; c'est lui qui, en 1672, a forcé le grand roi, arrivé sous les portes d'Amsterdam, à rebrousser chemin et à épargner la ville habitée par le prophète. Mais ces prodiges militaires n'ont été accomplis que par des armes spirituelles. Les vaillantes troupes, commandées par Vendôme et Villars, ont été vaincues non par Malborough et Eugène, « mais par un général qui ne sortait pas de sa chambre (14. Ibid., p. 159 et 169). »
Je n'ai pas cru inutile de m'arrêter à ces récits, parce [page 210] qu'ils nous signalent l'écueil où vient échouer tôt ou lard le mysticisme, même s'il est aussi abstrait que celui de Plotin ou de Jacob Bœhm. Ils nous montrent comment les idées deviennent des personnages fabuleux, comment la légende se substitue à la métaphysique.
Croit-on que Saint-Martin, pour l'honneur même de sa foi, pour la gloire de son maître, dont quelques fanatiques ont à ce point défiguré les doctrines, va essayer de combattre ces folies ? Non ! il y applaudit, au contraire, et les autorise au nom de son expérience personnelle : « J'ai lu avec ravissement, écrit-il à son ami, les nouveaux détails que vous m'envoyez sur le général Gichtel. Tout y porte le cachet de la vérité. Si nous étions près l'un de l'autre, j'aurais aussi une histoire de mariage à vous conter, où la même morale a été suivie pour moi, quoique sous d'autres formes, et qui a fini par avoir le même résultat (15. Corresp. inédite, p. 167). » Répondant aux questions de Kirchberger, Saint-Martin, dans une autre lettre, revient sur ce sujet avec plus de détails. « Je crois bien, en effet, dit-il (16. Ibid., lettre LVII, p. 170.), avoir connu l'épouse du général Gichtel, dont vous me parlez dans votre lettre du 29 novembre, mais non pas aussi particulièrement que lui. Voici ce qui m'arriva lors du mariage dont je vous ai dit un mot dans ma dernière. Je priai un peu de suite pour cet objet, et il me fut dit intellectuellement, mais très clairement : Depuis que le Verbe s'est fait chair, nulle chair ne doit disposer d'elle-même sans qu'il en donne la permission. Ces [page 211] paroles me pénétrèrent profondément, et quoiqu'elles ne fussent pas une défense formelle, je me refusai à toute négociation ultérieure. » J'en demande pardon au philosophe inconnu, ces paroles, si elles sont réellement un décret du ciel, ont beaucoup plus de gravité que n'en offrirait une défense formelle adressée à un seul. Elles signifient que, depuis l'avènement du Christ, la virginité doit être la règle générale de la société et le mariage une rare exception, une dispense accordée par des moyens surnaturels. Voilà, il faut en convenir, une étrange manière de réformer le genre humain ! Mais je ne veux point discuter ; je me borne à raconter.
Ce qui rend cette correspondance particulièrement intéressante, c'est le temps auquel elle appartient. Comprend-on qu'entre les années 1792 et 1799, pendant les crises les plus terribles de la Révolution, pendant que la France et toute l'Europe étaient en feu, on ait pu agiter entre Paris et Berne des questions qui ne touchent qu'au monde des esprits ? C'est que, pour des hommes du tempérament de ceux que nous rencontrons ici, les événements extérieurs n'existent pas ; et, pour Saint-Martin, personnellement, le bouleversement dont il était témoin avait un sens mystique qui ne troublait pas le cours de ses pensées habituelles. C'est à lui que de Maistre a emprunté l'idée que la Révolution est un fait surnaturel, un miracle effrayant destiné tout à la fois à régénérer le monde et à l'instruire : « Un des grands objets de la Révolution française a été, dit-il (17. Portrait historique, n° 594), de montrer aux hommes ce qu'ils deviendraient si Dieu [page 212] les abandonnait entièrement à la fureur de sa justice, c'est-à-dire, à la fureur de leurs ténèbres. Il a voulu leur faire apercevoir la racine infecte sur laquelle repose le règne de la puissance humaine; il a voulu leur apprendre visiblement qu'il est la source d'une puissance bien plus aimable et plus salutaire pour eux.... Malheur! Malheur ! à ceux qui laisseront passer sans profit la grande leçon qu'on nous donne ! Elle tendait à nous rapprocher de Dieu, et les malheureux hommes ne font et ne feront que s'en éloigner davantage. » La Révolution, telle qu'il la comprend, lui paraît tantôt un sermon, « un des sermons les plus expressifs qui aient été prêchés en ce monde (18. Corresp. inédite, lettre LV, p. 150), » tantôt une miniature du jugement dernier et la révolution du genre humain (19. Ibid., lettre LXXII, p. 199).
Mais les conséquences que Saint-Martin fait sortir de cette conviction, sont tout autres et beaucoup plus logiques que celles de l'auteur des Soirées de Saint-Pétersbourg. Cet ordre social, qui a mérité d'être renversé par la justice divine, il ne sera pas rétabli et disparaîtra bientôt des lieux où il existe encore. Ces castes privilégiées, qui viennent d'expier si cruellement leur orgueil passé, elles ne retrouveront pas leurs titres et leur puissance. Une ère nouvelle va commencer où l'homme, ramené à son point de départ, ne reconnaîtra plus d'autre puissance que celle de Dieu, où la politique se confondra avec la religion, et où la religion elle-même sera renouvelée comme la société. « La Providence saura bien faire naître du cœur de l'homme une [page 213] religion qui ne sera plus susceptible d'être infectée par le trafic du prêtre et par l'haleine de l'imposture, comme celle que nous venons de voir s'éclipser avec les ministres qui l'avaient déshonorée (20. Lettre à un ami sur la Révolution française). »
Saint-Martin n'avait donc aucune raison d'être hostile à la Révolution ; et, en effet, il mérite plutôt d'être compté au nombre de ses amis. On vient de s'assurer par le dernier passage que j'ai cité, et qui n'est pas un des plus énergiques de ce genre, qu'il en partageait toutes les rancunes contre l'Église. Il n'est pas plus indulgent pour la noblesse, quoiqu'il en fasse partie et qu'il ait passé presque toute sa vie avec ses plus éminents représentants. Nous lisons dans ses Mémoires (21. Portrait historique, n° 965): « L'objet du fléau que la révolution fait tomber sur les nobles, est de purger ceux qui peuvent l'être des influences d'orgueil que ce titre leur avait communiquées, et de les rendre plus nets et plus présentables lorsqu'ils paraîtront dans les régions de la vérité. » Ailleurs (22.Ibid., n° 536 ) il s'exprime avec encore plus de dureté, mais il ne juge pas moins sévèrement la multitude et ceux qui gouvernent en son nom. « Dieu a voulu, dit-il (23. Ibid., n°973), que je visse tout sur la terre. J'y avais vu longtemps l'abus de la puissance des grands ; il fallait bien que j'y visse ensuite l'abus de la puissance des petits. »
La Révolution, pour lui, ne s'arrête pas au 18 brumaire; et il ne l'aurait pas crue même terminée par l'Empire, s'il [page 214] avait vécu assez longtemps pour voir le Consulat remplacé par ce nouveau régime. Voici ce qu'il écrit au lendemain de la signature de la paix d'Amiens : « Cette pacification externe et cet ordre apparent, produit par l'effet de la Révolution, ne sont pas le terme où la Providence ait eu exclusivement l'intention de nous conduire, et les agents et les instruments qui ont concouru à cette œuvre se tromperont s'ils se croient arrivés. Je les regarde, au contraire, comme des postillons qui ont fait leur poste; mais ils ne sont que des postillons de province ; il en faudra d'autres pour nous faire arriver au but du voyage, qui est de nous faire entrer dans la capitale de la vérité (24. Portrait historique, n° 1024). » Que nous entrions jamais dans la capitale de la vérité et que nous sachions même où elle est située, cela est extrêmement problématique ; mais il n'en reste pas moins à Saint-Martin le mérite d'avoir compris que la compression des esprits n'en est pas l'apaisement, et qu'une abdication momentanée imposée par la lassitude, autorisée par la gloire, n'est pas encore la conciliation et la paix. Au reste, il témoigne à plusieurs reprises la plus vive admiration pour la personne du Premier Consul. Il le regarde « comme un instrument temporel des plans de la Providence par rapport à notre nation (25. Ibid., n° 1000). »
En s'inclinant devant le principe et en partageant à bien des égards les passions de la Révolution française, Saint-Martin se fait un devoir d'en accepter les épreuves et les charges. De quel danger peut-elle d'ailleurs être pour lui ? [page 215] Ne nous a-t-il pas déjà appris que sa destinée n'a rien de commun avec celle de ce monde, et qu'aucune des tribulations réservées à celui-ci ne saurait l'atteindre (26. Portrait historique, n° 763.) ? « La « paix passe par moi, écrit-il à son ami Kirchberger, et je la trouve partout à côté de moi (27. Corresp. inédite, lettre LX, p. 167.). » Il en a eu, en mainte occasion, des preuves irrécusables, surtout pendant la journée du 10 août : car il était alors enfermé dans Paris, et il n'a cessé de le traverser tout le jour sans éprouver la plus légère crainte, sans rencontrer le moindre obstacle. Cela le frappe d'autant plus, qu'il n'y est absolument pour rien; il n'a par lui même aucune force physique qui puisse lui donner ce qu'il appelle le courage des sens. Mais qu'importé le courage des sens quand l'esprit, transporté dans les espaces imaginaires, n'a aucune idée du péril ? Veut-on savoir de quoi s'occupait Saint-Martin le lendemain de cette catastrophe du 10 août, qui venait de plonger la France et l'Europe dans la stupéfaction ? Il s'entretenait, avec son correspondant de Berne, de la lumière cachée dans les éléments et de la XLVII° épître de Bœhm (28. Ibid., lettre VI, p. 24). Devenu libre, au commencement de 1793, par la mort de son père, il résidait tantôt à Paris, tantôt à Petit-Bourg, près de son amie la duchesse de Bourbon, ou la citoyenne Bourbon, comme on disait dans ce temps-là. Il était à Paris, il venait de monter sa garde à la porte du Temple, devant la prison de ce même enfant royal dont l'Assemblée constituante l'avait jugé digne d'être le précepteur, quand parut, [page 216] le 27 germinal de l'an II, un décret de la Convention qui interdisait aux nobles le séjour de la capitale. Saint-Martin, obéissant sans murmurer, retourna dans sa ville natale, où la confiance et le respect de ses concitoyens adoucirent son exil. Lui, de son côté, soit par des dons patriotiques, soit par des services personnels, s'efforça, en toute circonstance, de prouver son attachement à la cause de la Révolution : « On doit s'estimer heureux, écrit-il, toutes les fois qu'on se trouve pour quelque chose dans ce grand mouvement, surtout quand il ne s'agit ni de juger les humains, ni de les tuer. »
Nommé commissaire pour la confection du catalogue des livres nationaux, il trouve dans l'accomplissement de cette tâche une jouissance inattendue pour son esprit; c'est celle que lui a procurée la découverte d'une légende de couvent, parfaitement ignorée hors de l'enceinte où elle prit naissance : La vie de la sœur Marguerite du Saint-Sacrement. Ici nous rentrons dan» les excès d'imagination dont nous avons déjà eu un exemple à l'occasion de la vie de Gichtel. Il s'agit d'une pauvre carmélite du XVIIe siècle, dont les perfections, les tortures et les souffrances surhumaines seraient une nouvelle confirmation des principes du mysticisme, ou, pour mieux dire, des principes de Bœhm et de Martinez. Inférieure à d'autres pour la science et la puissance, elle s'est élevée aussi haut que notre nature le permet « dans l'ordre de la régénération et des vertus de l'amour (29. Corresp. inédite, lettre LIII, p. 143). » Mais voici ce qu'il lui arriva. Pendant que la main divine la transportait dans ces sublimes régions, [page 217] l'action spirituelle de l'ennemi la tirait en sens contraire. Il en résultait pour elle des souffrances épouvantables, dont toute son organisation fut ébranlée, mais qui s'attaquaient surtout à la tête. On appela à son secours les hommes de l'art ; mais que pouvaient-ils dans leur ignorance, sinon la torturer en vain? Ils épuisèrent sur elle tous les remèdes de la pharmacie, ils lui appliquèrent sur le crâne un fer rouge, ils lui firent subir l'opération du trépan. La pauvre fille, quoique parfaitement sûre qu'il ne changerait rien à son état, supporta son martyre avec une héroïque résignation. Cette histoire, dont il ne conteste pas un instant la véracité, est pour Saint-Martin une magnifique occasion de montrer que la médecine, quand elle ne tient pas compte de l'ordre surnaturel, n'est pas une science plus fondée que la philosophie, et qu'elle n'aboutit qu'à tuer le corps, comme celle-ci à tuer l'âme ? « Je ne veux point, dit-il (30. Corresp. inédite, p. 144), scruter ici l'ordre scientifique. Si cette fille eût joui de ses droits, elle eût pu renverser ses médecins, comme Jésus-Christ renversa les archers qui vinrent le saisir au jardin des Olives. »
Un homme qui, sous le régime de la Terreur, se laissait absorber par de telles lectures, n'était certainement pas dangereux pour la république. Cependant, et malgré la prudence qu'il s'était imposée avec son ami Liebisdorf, même dans les controverses du mysticisme (31. Il écrit dans une lettre du 6 brumaire an III, à l'occasion du procès de dom Gerle et de Catherine Théot : « Dans ce moment-ci, il est peu prudent de s'étendre sur ces matières. Les papiers publics auront pu vous instruire des extravagances spirituelles que des fous et des imbéciles viennent d'exposer aux yeux de notre justice révolutionnaire. » Corresp. inédite, lettre LIX, p. 167.), Saint-Martin [page 218] fit ombrage aux autorités du moment. Un mandat d'amener fut lancé contre lui, et il était sur le point de comparaître devant le tribunal révolutionnaire, c'est-à-dire de monter sur l'échafaud, quand la chute de Robespierre et la réaction thermidorienne vinrent l'en sauver. Il ne connut le danger que lorsqu'il fut passé, et naturellement, il fut persuadé plus que jamais qu'une puissance surnaturelle veillait sur lui comme une mère sur son enfant.
Il était seul, à quelque distance d'Amboise, dans sa petite maison de campagne de Chaudon, quand il fut nommé par son district élève des écoles normales, récemment créées par la Convention. C'était au mois de frimaire de l'an III, c'est-à-dire à la fin de 1794. Saint-Martin venait d'atteindre sa cinquante -deuxième année. C'était un peu tard pour s'asseoir sur les bancs de l'école. De plus, s'il ne nageait pas dans l'abondance à Chaudon, il y trouvait au moins le nécessaire; tandis qu'à Paris, au milieu de la saison rigoureuse, il ne pourra éviter la gêne et les privations; il sera obligé, comme il dit, de se faire esprit pour ne manquer de rien. Enfin, il sera forcé de s'abaisser à des études de détail qui répugnent à son esprit et font violence à ses habitudes ; il lui faudra aussi prendre part à la discussion, s'exercer à la parole, lui qui n'en voudrait entendre ni proférer d'autre que la parole interne (32. Ibid., p. 166). Aucune de ces considérations ne l'arrête, parce qu'il y en a d'autres d'un ordre supérieur qui [page 219] lui font un devoir d'accepter, si humble qu'elle paraisse, la mission que lui ont confiée ses concitoyens. D'abord, il pense que tout est lié dans notre grande révolution ; dès lors, il n'y a plus rien de petit pour lui, et ne fût-il qu'un grain de sable dans le vaste édifice que Dieu prépare aux nations, il ne doit pas résister quand on l'appelle. Mais le principal motif de son acceptation , c'est l'espérance que, avec l'aide de Dieu, il arrêtera une partie des obstacles que l'ennemi de tout bien ne manquera pas de semer dans cette grande carrière qui va s'ouvrir et d'où peut dépendre le bonheur des générations (33. Portrait historique, p. 167).
Ainsi il ne faut pas se tromper : ce n'est point par des raisons purement humaines, par des raisons politiques, philosophiques ou morales, que Saint-Martin se décide à renoncer à son repos et à sa solitude; c'est aussi par des motifs tirés de l'ordre surnaturel, c'est pour combattre face à face l'ennemi de tout bien, celui qu'il appelle ailleurs (34. . Ibid.. n° 505 : « Il est certain que j'ai toujours appris quelque chose de grand à la suite de quelque grand écart, surtout à la bêtise de l'ennemi et l'amour du père. ») tout simplement l'ennemi : Je vous avoue, ajoute-t-il, que cette idée est consolante pour moi, et quand je ne détournerais qu'une goutte du poison que cet ennemi cherchera à jeter sur la racine même de cet arbre, qui doit couvrir de son ombre tout mon pays, je me croirais coupable de reculer et je m'honore même alors d'un pareil emploi. » Et comment ferait-il pour ne pas en être fier ? Cet emploi lui paraît être sans exemple dans l'histoire des peuples ; non pas que les peuples soient restés jusqu'aujourd'hui [page 220] absolument dépourvus d'instituteurs, mais parce qu'ils n'en ont jamais eu un tel que lui, « vu le caractère extérieur et intérieur qui fait tout son être », ou pour parler clairement, parce qu'il est d'une nature plus exquise que celle de ce monde. C'est ainsi que dans le mysticisme l'extrême humilité et l'extrême présomption se rencontrent presque toujours l'une à côté de l'autre. Le mystique s'abaisse devant Dieu, mais il se place sans scrupule au-dessus des hommes.
Les écoles normales ne s'ouvrirent qu'à la fin de janvier 1795. Saint-Martin n'est pas content de leur début et il prévoit, avec beaucoup de sagacité, qu'elles ne dureront pas longtemps. Maîtres et disciples lui sont également suspects. Il ne reconnaît en eux que le spiritus mundi, « et je vois bien, ajoute-t-il, qui est celui qui se cache sous ce manteau (35. Corresp. inédite, lettre LXIV, p. 174.). » Puis c'est beaucoup si, dans un mois, il peut parler cinq ou six minutes, et cela devant deux mille personnes à qui il faudrait auparavant refaire les oreilles. Cependant, cette institution, qu'il juge avec tant de sévérité, lui procura le plus grand, ou, pour parler exactement, l'unique succès qu'il ait eu de sa vie. Je rapporterai plus loin, avec un peu plus de précision qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, sa discussion avec Garât. Je me bornerai à dire ici que c'est à lui que revient l'honneur d'avoir le premier en France ébranlé dans les esprits et humilié par un échec public le triste système de !a sensation transformée. Aussi ne peut-on pas l'accuser d'exagérer son importance, lorsqu'il écrit à son ami de Berne : « J'ai jeté une pierre dans [page 221] le front d'un des Goliath de notre école normale, en pleine assemblée, et les rieurs n'ont pas été pour lui, tout professeur qu'il est. C'est un devoir que j'ai rempli pour défendre le règne de la vérité ; je n'attends pas d'autre récompense que celle de ma conscience (36. Corresp. inédite, lettre LXVI, p. 181.). » Il faut cependant remarquer, pour être juste, qu’il n’est pas le seul qui, dans cette occasion, ait élevé la voix contre la doctrine régnante. Nous voyons, dans les séances des écoles normales recueillies par les sténographes, que, dans la même séance où il prit la parole, celle du 9 ventôse de l'an III, un de ses condisciples, appelé Teyssèdre, défendit la méthode et la doctrine de Descartes, c'est-à-dire une des sources les plus fécondes du spiritualisme moderne. Ce même Teyssèdre attaque la toute puissance que Garât, à l'exemple de son maître Condillac, accordait aux signes sur les idées. C'était la question à laquelle s'attacha principalement Saint-Martin et sur laquelle il revint, en 1796, dans un mémoire adressé à l'Académie des sciences morales et politiques. Un autre, du nom de Duhamel, élève des objections pleines de force et de bon sens contre la fameuse hypothèse de l'homme statue. Mais Saint-Martin eut les honneurs de la journée.
Son pronostic sur les écoles normales ne tarda pas à se vérifier : elles ne vécurent pas au-delà de trois mois. En les quittant, il songeait un instant à devenir professeur d'histoire à l'école centrale de Tours; mais il s'aperçut bien vite que ces fonctions n'étaient pas faites pour lui. L'histoire et la nature, c'est-à-dire l'action et la vie, sont [page 222] une protestation permanente contre les principes du mysticisme, et ce n'est qu'en les réduisant à une ombre vaine, à une figure, à un symbole, que ces principes ont quelquefois essayé de les dominer. Nommé membre de l'assemblée électorale de son département, Saint-Martin, grâce à l'éclat qu'il venait d'ajouter à sa renommée, aurait pu comme un autre se pousser vers la vie publique. Mais il comprit que la politique active lui convenait encore moins que l'enseignement. Il se renferma donc tout entier dans les travaux de la pensée. Il publia sa Lettre à un ami sur la Révolution Française, bientôt suivie de l’Éclair sur l'association humaine (37.Publié par M. Schauer avec le traité Des Nombres, in-8°, Paris, 1861 ), où il complète sa doctrine sur l'ordre social. Il prend part à deux concours de l'Académie des sciences morales et politique (38. L'un, comme je l'ai déjà dit, sur les signes, en 1796, l'autre, en 1797, sur cette question : « Quelles sont les institutions les plus propres à fonder la morale d'un peuple? »), tout en raillant les académies dans son étrange poème du Crocodile (39. In-8°, Paris, an VII (1799).), et en se présentant devant elles dans l'attitude d'un juge plutôt que d'un justiciable. Il s'efforce de résumer ses idées et de les revêtir de leur forme définitive dans deux derniers ouvrages : De l'esprit des choses (40. Deux vol. in-8°, Paris, an VIII (1801).) et le Ministère de l'homme esprit (41. In-8°, Paris, an XI.). En même temps, il traduisait en français plusieurs œuvres de Bœhm (41bis. L'Aurore naissante ou la Racine de la philosophie, in-8°, 1800 ; les Trois principes de l'essence divine, 2 vol. in-8, 1802; De la triple vie de l'homme, in-8, 1809 ; Quarante questions sur l'âme, traduction revue et éditée par Gilbert, Paris, 1807.), quoiqu'il soit extrêment [page 223] douteux qu'il les ait jamais comprises, et il continuait sa correspondance avec Kirchberger, resté pour lui jusqu'à la fin de sa vie l'ami le plus tendre et le plus dévoué. Il le perdit en 1799, sans l'avoir jamais vu autrement qu'en peinture ; car les deux amis échangèrent leurs portraits, n'ayant pu, comme ils l'auraient voulu, échanger leurs bourses et se soutenir réciproquement dans les circonstances difficiles qu'ils eurent à traverser.
Nous ne voyons pas que Saint-Martin ait pleuré sur sa mort, ni celle d'aucune autre personne qui lui fût chère. Il a toujours regardé la mort comme un avancement, et il condamnait cette expression : l’autre vie, parce qu'il n'y en a qu'une, précisément celle-là : « C'est moins sur les morts que sur les vivants, dit-il (42. Portrait historique, n° 826), qu'il faudrait nous affliger. Comment le sage s'affligerait-il sur les morts, tandis que sa journalière et continuelle affliction est d'être en vie ou dans ce bas monde? » On ne peut pas lui appliquer cette maxime de La Rochefoucault : « On a toujours assez de courage pour supporter les maux d'autrui ; » car il mettait son principe en pratique sur lui-même. Il n'a jamais cessé de placer dans sa dernière heure le plus ardent de ses désirs et la plus douce de ses espérances (43. Ibid., n° 1050). Chaque pas qu'il fait dans la vieillesse est salué comme un acheminement, non pas vers la délivrance, mais vers le couronnement des joies qui l'ont toujours accompagné dans ce [page 224] monde (44. Portrait historique, n° 1092). La seule maladie que l'âge lui ait apportée, c'est celle qu'il appelle le spleen de l'homme; mais ce spleen est bien différent de celui des Anglais. « Car, dit-il, celui des Anglais les rend niais et tristes, et le mien me rend intérieurement et extérieurement tout couleur de rosé (45. Ibid., n°1105). » Je veux citer encore ces lignes où la même idée est exprimée sous une forme plus grave et plus poétique : « Quand je vois les admirations du grand nombre pour les beautés de la nature et les sites heureux, je rentre bientôt dans la classe des vieillards d'Israël qui, en voyant le nouveau temple, pleuraient sur la beauté de l'ancien (46. Ibid., n°1106). » C'est ici que Saint-Martin et Rousseau auraient pu se comprendre, parce que la beauté de la nature n'est pas diminuée par cette mélancolique comparaison. La nature est d'autant plus belle qu'elle élève davantage nos pensées et nos sentiments.
Cette vie donnée tout entière à l'esprit et cette jouissance anticipée du ciel ne le rendaient pas indifférent aux peines matérielles de ses semblables. Il y avait des entrailles humaines chez cet exilé d'un monde supérieur. En voici une preuve. Il n'était pas riche, comme on sait, et il aimait beaucoup le spectacle. Il l'aimait à un tel point que, lorsqu'il se dirigeait vers le théâtre, l'idée de la jouissance qui l'attendait lui donner [sic] des transports. Mais chemin faisant, il se disait : « Je vais payer le plaisir d'admirer une simple image ou plutôt une ombre de la vertu. Eh bien ! avec [page 225] la même somme, je puis atteindre la réalité de cette image; je peux faire une bonne action au lieu de la voir retracée dans une représentation fugitive. » Puis, il montait chez quelque malheureux de sa connaissance et y| laissait la valeur de son billet de parterre. Jamais il n'a manqué à ce virement d'une nouvelle espèce. Aussi ne peut-on s'empêcher de croire que lui, si orgueilleux à d'autres égards, il se calomnie lorsqu'il soutient que Rousseau valait mieux que lui, sous prétexte que Rousseau tendait au bien par le cœur et lui par l'esprit (47. Portrait historique, n° 423). L'esprit, chez Saint-Martin, ne se sépare point du cœur et, en même temps qu'il lui donne quelque chose de sa finesse, il lui emprunte sa grâce et son indulgence.
Cette double et aimable nature demeura jusqu'au dernier moment semblable à elle-même. Dans l'été de l'année 1803, Saint-Martin sentit sa fin approcher. Il eut, pour me servir de ses expressions (48. Ibid., n°1132), quelques avertissements d'un ennemi physique qui, selon toute apparence, devait l'emporter, comme il avait emporté son père. Il ne se trompait point. Le 23 octobre de la même année, il mourut à Aunay, dans la maison de campagne de son ami, le sénateur Lenoir-Laroche. La veille de sa mort, il s'entretenait avec M. de Rossel sur la vertu des nombres, qui lui avait fourni le sujet d'un de ses ouvrages (49. Des Nombres, œuvre posthume, publiée en 1843 par M. L. Ch. Une nouvelle édition de ce livre a été publiée par M. Schauer en 1861, Paris, iu-8°.), et il rendait grâce au ciel de lui avoir accordé cette dernière faveur. [page 226] Quelques instants avant d’expirer, il recommanda à ses amis de vivre dans l’union fraternelle et dans la confiance en Dieu. Il ne se faisait aucune illusion sur l’influence qu’il avait exercée de son vivant, sur la place qu’il avait tenue parmi ses contemporains, et sur la gloire qui allait entourer son nom. Mais il disait : « Ce n’est point à l’audience que les défenseurs officieux reçoivent le salaire des causes qu’ils plaident, c’est hors de l’audience et après qu’elle est fini. Telle est mon histoire et telle est aussi ma résignation de n’être pas payé dans ce bas monde (50. Portrait historique, n° 1099). »




