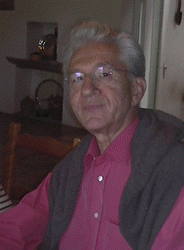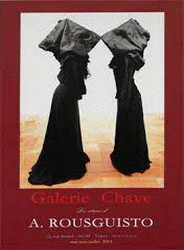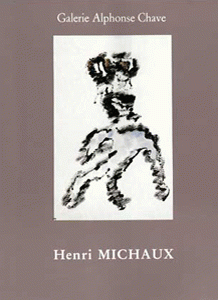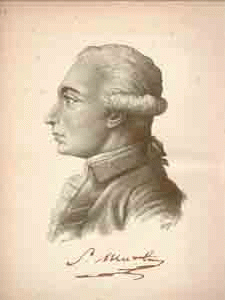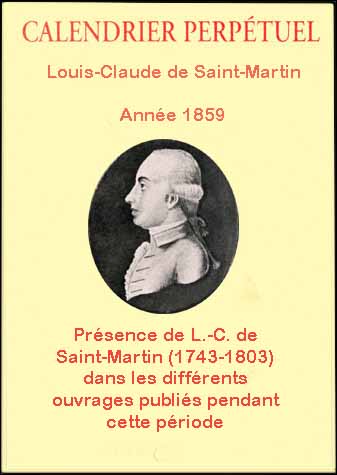 Année 1859
Année 1859
Joseph de Maistre - Quatre chapitre inédits sur la Russie
Catalogue la bibliothèque de la ville d’Amiens - Quatrième partie – Métaphysique
Faure − Journal d’un combattant de février - Appendice Fabre d’Olivet.
Naville – Étude sur l’œuvre de St Thomas d’Aquin
Bibliographie catholique - Compte-rendu du livre de Caro, Du mysticisme au XVIIIe siècle,
Mémoires de la Société impériale des sciences, de l'Agriculture et des Arts, de Lille. - Collège des Philalèthes de Lille
L'Observateur catholique - Extrait de la Revue de l’Instruction publique, F. Morin.
1859 - Joseph de Maistre - Quatre chapitre inédits sur la Russie
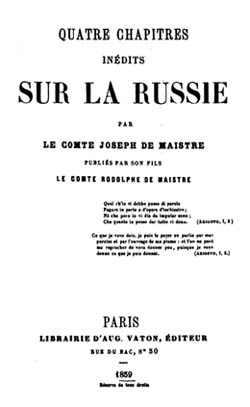 Quatre chapitres inédits sur la Russie, par le comte Joseph de Maistre
Quatre chapitres inédits sur la Russie, par le comte Joseph de Maistre
Publiés par son fils le comte Rodolphe de Maistre. Paris. Librairie d’Aug. Vaton, éditeur, rue du Bas, n° 50 - 1859
Chapitre quatrième. De l’illuminisme, pages 91-128
Ce mot d’illuminé trompe nécessairement une foule d’hommes, parce qu’il signifie, dans les conversations ordinaires, des choses absolument différentes. Un franc-maçon ordinaire, un martiniste, un piétiste, etc., etc., et un disciple de Weishaupt se nomment communément, dans le monde des illuminés. Il serait cependant difficile d'abuser davantage des termes et de confondre des choses plus disparates. Mais comme il est possible de renfermer sous ces trois dénominations tous ceux qu’on appelle vulgairement illuminés, elles serviront de division à ce chapitre.
I. L’origine de la franc-maçonnerie simple est un sujet difficile, sur lequel il n’est pas aisé de dire des choses certaines, ni peut-être même plausibles. Mais, pour ne s’occuper que de ce qu’elle est, sans examiner d’où elle vient, on peut assurer que cette franc-maçonnerie pure et simple, telle qu’elle existe encore en Angleterre, où les institutions quelconques sont moins sujettes à se corrompre, n’a rien de mauvais en soi, et qu’elle ne saurait alarmer ni la religion ni l’État. L’auteur de cet écrit l’a suivie très exactement et longtemps, il a joint à son expérience celle de ses amis : jamais il n’a vu rien de mauvais dans cette association, et il est bien remarquable que l’abbé Barruel, dans son Histoire du jacobinisme, où certainement il n’a voulu épargner aucune secte dangereuse, a cependant manifesté la même opinion.
![]() Lire la suite sur le site : Quatre chapitres inédits sur la Russie,
Lire la suite sur le site : Quatre chapitres inédits sur la Russie,
1859 - Catalogue la bibliothèque de la ville d’Amiens
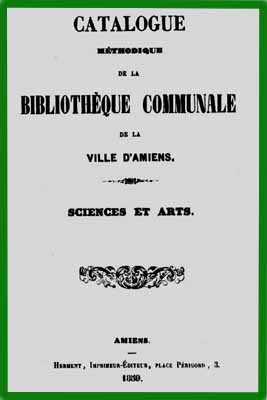 Catalogue méthodique de la bibliothèque communale de la ville d’Amiens
Catalogue méthodique de la bibliothèque communale de la ville d’Amiens
Vve Herment, imprimeur éditeur, place Périgord, 3 - 1859
Quatrième partie – Métaphysique –
a) Traité généraux et mélanges, page 56
338. — Tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l’homme et l’univers. (Par L. Cl. De Saint-Martin). Edimbourg. 1782. 2 en 1 vol. in-8°.
![]() 1859 - Catalogue la bibliothèque de la ville d’Amiens, p.56
1859 - Catalogue la bibliothèque de la ville d’Amiens, p.56
e) De l’intelligence et de ses opérations, page 69
424. — Des erreurs et de la vérité, ou les hommes rappellés [sic] au principe universel de la science. Par un ph… inc… (philosophe inconnu, L. Cl. DE SAINT-MARTIN). Edimbourg. 1782. 1 vol. in-8°.
![]() 1859 - Catalogue la bibliothèque de la ville d’Amiens, p.69
1859 - Catalogue la bibliothèque de la ville d’Amiens, p.69
1859 − Faure − Journal d’un combattant de février
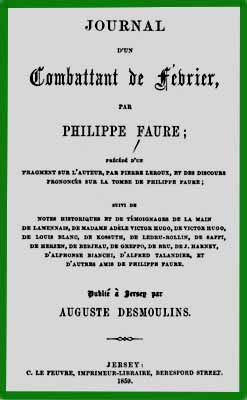 Journal d’un combattant de février Par Philippe Faure
Journal d’un combattant de février Par Philippe Faure
Précédé d’un fragment sur l’auteur, par Pierre Leroux, et des discours prononcés sur la tombe de Philippe Faure ; suivi de notes historiques et de témoignages de la main de Lamennais, de madame Adèle Victor Hugo, de Victor Hugo, de Louis Blanc, de Kossuth, de Ledru-Rollin, de Saffi, de Herzen, de Berjeau, de Greppo, de Bru, de J. Harney, d’Alphonse Bianchi, d’Alfred Talandier, et d’autres amis de Philippe Faure
Publié à Jersey par Auguste Desmoulin
Jersey : C. Le Feuvre, imprimeur libraire, Beresford Street. - 1859
Appendice Fabre d’Olivet. Extrait pages 179-180
Nous n’avons pas la prétention de faire connaître pas quelques extraits tronqués l’œuvre si importante de Fabre d’Olivet ; nous avons voulu seulement en marquer le caractère et la direction, et expliquer par là l’influence que cette œuvre exerça sur Philippe Faure. Si la postérité, appliquant la loi d’amitié qui inspira à Saint-Just ses Institutions, exigeait, avant de se prononcer sur les travaux de Fabre d’Olivet, qu’il se présentât au jugement avec ses amis intellectuels, il est probable qu’il ne demanderait ce suprême secours ni à Talma ni à Napoléon, + à qui les circonstances plutôt que l’amitié l’unirent un moment ; mais qu’il invoquerait l’appui de Court de Gébelin, et de celui qu’il appelle le Philosophe Inconnu, SAINT-MARTIN.
Saint-Martin avait résumé dans son livre sur Dieu l’Homme et l’Univers, la tradition mystique de Swedenborg, de Jacob Bœhme, et des extatiques français. On sait quelle action ces mystiques eurent, à la fin du Dix-Huitième Siècle, sur la Franc-Maçonnerie, et par suite sur la société européenne et sur la Révolution Française. Au milieu des orages de cette Révolution et des terribles guerres de l’Empire, le Philosophe [180] Inconnu avait tenté de conserver les principes et les institutions secrètes du Mysticisme.
De son côté, Court de Gébelin, cherchant dans la science cette unité que la Révolution n’avait su ni pu réaliser dans la politique, avait essayé de découvrir les origines de la race humaine, et commencé dans son Monde Primitif, ses recherches sur l’ethnographie et sur le langage, qui furent pour les philologues modernes la source de tant de beaux travaux et de si fécondes découvertes.
Enflammé de l’enthousiasme du premier, excité par la soif de connaître qui dévorait le second, un penseur unit en lui leurs deux tendances : il chercha à faire aboutir les spéculations du Mysticisme à des conclusions scientifiques et à des applications utiles ; il s’attacha aux sciences occultes, Mais pour y trouver la clef des mystères antiques, et pour pénétrer, à l’aide de cette clef, dans les plus profonds arcanes de la connaissance humaine ; ce savant en qui l’exaltation de Saint-Martin s’allia si puissamment à l’érudition de Court de Gébelin, ce fut Fabre d’Olivet.
1859 – Naville – Étude sur l’œuvre de St Thomas d’Aquin
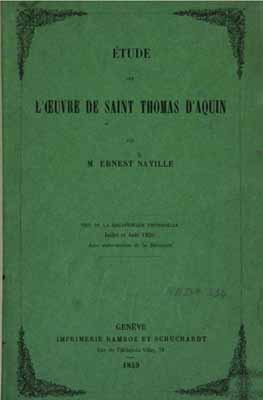 Étude sur l’œuvre de St Thomas d’Aquin, par M. Ernest Naville
Étude sur l’œuvre de St Thomas d’Aquin, par M. Ernest Naville
Tiré de la Bibliothèque universelle – Juillet et Août 1859, avec autorisation de la direction.
Genève. Imprimerie Ramboz et Schuchardt, rue de l’Hôtel de Ville, 78 - 1859
Étude sur l’œuvre de St Thomas d’Aquin
M. Jourdain vient d'enrichir nos bibliothèques d'un excellent livre sur la philosophie de saint Thomas (1). Ce livre est la reproduction quelque peu modifiée d'un mémoire couronné à la suite d'un concours ouvert par l'Académie des sciences morales et politiques. Comment la philosophie de nos jours en est-elle venue à se préoccuper, comme elle le fait, de Thomas d'Aquin, docteur du moyen âge ? La réponse à cette question demande un récit de quelque étendue, mais digne d'intérêt. Reprenons les choses d'un peu loin.
En 1794, la Convention, voulant donner au peuple français une instruction digne de ses nouvelles destinées, institua les cours de l'Ecole normale. Garat, qui venait d'être ministre de la révolution, et qui devait être plus tard sénateur et comte de l'empire de Bonaparte, fut désigné pour l'enseignement de la philosophie. Il donna des leçons brillantes sur l'analyse de l'entendement, exposant les thèses du sensualisme comme une doctrine universellement admise par tous les bons esprits, et parfaitement incontestable. Une fois par semaine, selon la règle de l'école, les auditeurs pouvaient prendre la parole pour discuter l'enseignement du maître. Un jour donc, usant de ce privilège, Saint-Martin (2), le philosophe inconnu, éleva la [2] voix du milieu de la foule, et présenta quelques objections à la théorie de la sensation transformée. Le dialogue suivant s'engagea :
Le professeur. «Vous paraissez vouloir qu'il y ait dans l'homme un organe d'intelligence, autre que nos sens extérieurs et notre sensibilité intérieure? Est-ce là votre pensée ?
Saint-Martin. « Oui, citoyen.
Le professeur. « Un organe d'intelligence ?
Saint-Martin. « Une faculté d'intelligence.
Le professeur. «Vous avez pour doctrine que sentir les choses et les connaître sont des choses différentes. C'est là ce que vous croyez vrai, n'est-ce pas ?
Saint-Martin. « J'en suis persuadé.
Le professeur. « Cependant, lorsque je reçois en présence du soleil les sensations que donne cet astre éclatant qui échauffe et qui éclaire la terre, est-ce que j'en connais autre chose que les sensations mêmes que j'en reçois ?
Saint-Martin. « Vous sentez les sensations, mais les réflexions que vous ferez sur l'existence du soleil »
Cette phrase qui, sans doute, devait renfermer d'autres mais, fut interrompue par Garat. Après une assez longue série d'affirmations du professeur, le philosophe inconnu ne se trouva pas satisfait.
Saint-Martin. « Citoyen professeur, la question actuelle est-elle plus éclairée ? Vous avez énoncé votre profession de foi....je vous réponds par une assertion.
Le professeur. « Si vous le permettez, je continuerai la conférence sur cet objet, il peut donner lieu à des considérations importantes. Ce qu'il importe d'abord de dire, c'est que, par cette doctrine dans laquelle on suppose que nos sensations et nos idées sont des choses différentes, c'est le platonisme, le cartésianisme et le malebranchisme que vous ressuscitez » Vient ensuite une allusion aux idoles métaphysiques dont Bacon a brisé les statues et les autels ; puis le [3] professeur conclut : «Ce serait un grand malheur si, à l'ouverture des Écoles normales et des Écoles centrales, ces idoles pouvaient y pénétrer. Toute bonne philosophie serait perdue, tous les progrès dans la connaissance de la nature seraient arrêtés, et c'est pour cela que je regarde comme un devoir sacré dans un professeur de l'analyse, de traiter ces idoles avec le mépris qu'elles méritent. » Saint-Martin n'eut qu'à se rasseoir bien dument convaincu de platonisme, de cartésianisme, de malebranchisme ; la majorité de l'auditoire était au professeur (3).
Ce dialogue est une des pages instructives de l'histoire de la philosophie ; il caractérise une époque. On y voit se produire avec une véritable naïveté la disposition d'esprits qui, tout en s'enivrant du sentiment de leur indépendance, s'étaient rangés docilement sous le joug d'une doctrine étroite, et poussaient de grands cris de liberté, lorsqu'ils prétendaient écraser du poids d'une petite autorité de la veille le passé séculaire de l'esprit humain. Nous commençons à l'oublier : au commencement du siècle, platonisme était un terme de dénigrement, et dire à un philosophe qu'il suivait les traces de Descartes ressemblait fort à une injure.
Ce n'est point le cas d'évoquer, dans une prosopopée oratoire, l'ombre du professeur d'analyse ; mais il est naturel de se représenter le profond étonnement de Garat, s'il eût prévu avec quelle promptitude se réaliseraient les pires malheurs qu'il pût redouter pour la philosophie. Par un mouvement rapide, Bacon (qui restera toujours un grand esprit et un remarquable écrivain) a perdu bien des fleurons de sa couronne de philosophe ; Locke et Condillac, rejetés sur le second plan, ont laissé Platon et Descartes reprendre le poste [4] d’honneur…
Notes
1 La philosophie de saint Thomas d'Aquin, par Charles Jourdain, agrégé des Facultés des lettres, chef de division au ministère de l'instruction publique et des cultes. 2 vol. in-8°. Paris, Hachette, 1858.
2 Saint-Martin, à cette époque, avait déjà publié la plupart des écrits qui ont fondé sa réputation de théosophe. Le livre des Erreurs et de la vérité est de 1775, l’Homme de désir de 1790.
3 Voir les Ecoles normales, livre national, Débats, tome III, pages 18 à 25, et l'Histoire de la philosophie allemande, par M. Barchou de Penhoën, tome I, pages 325 et suivantes, où ce dialogue a été transcrit avec quelques légères variantes.
![]() Étude sur l’œuvre de St Thomas d’Aquin
Étude sur l’œuvre de St Thomas d’Aquin
1859 - Collège des Philalèthes de Lille
 Mémoires de la Société impériale des sciences, de l'Agriculture et des Arts, de Lille.
Mémoires de la Société impériale des sciences, de l'Agriculture et des Arts, de Lille.
Année 1858, IIe série, 3e volume1859.
Lille, chez tous les libraires
Paris, chez Debache, rue du Bouloy, n°7
1859
Documents relatifs à l’histoire de la Société Collège des Philalètes de Lille (1789)
Monsieur le Président
Messieurs les membres de la Société Impériale des Sciences, de l’Agriculture et des Arts.
J'ai fait dernièrement une trouvaille qu'aussitôt j'ai désiré avoir l'honneur de vous communiquer. Plusieurs membres de votre société ont bien voulu m'encourager à le faire. Je ne cède, toutefois, à la tentation qu'en mettant ma lettre sous leur patronage, c'est la recommander à votre bienveillante attention.
Il s'agit des Philalèthes, dont le nom est resté en honneur parmi vous et auxquels vous avez emprunté votre devise [utile dulci].
Mais ce nom de Philalèthes ne désignait pas exclusivement la société dont le souvenir est toujours vivant dans cette enceinte. Il y avait en France, avant 89, plus de vingt loges maçonniques fondées sous le même nom, et celle de Lille n'avait formé un collège en dehors de la franc-maçonnerie, qu'afin de pouvoir compter dans ses rangs des religieux et des ecclésiastiques.
Je viens vous offrir un exemple de cette connexion dans une décoration maçonnique ayant appartenu à M. Armand Gaborria, membre des deux sociétés. Cette décoration fait connaître son grade dans la [page 208] loge ; déjà vous savez qu'il figure le troisième, en 1789, sur la liste des membres du collège, et qu'il avait présidé, par intérim, la séance publique du 20 novembre 1787.
![]() Lire la suite sur le site : 1859 - Collège des Philalèthes de Lille
Lire la suite sur le site : 1859 - Collège des Philalèthes de Lille
1859 - Bibliographie catholique - Compte-rendu du livre de Caro
 Bibliographie catholique
Bibliographie catholique
Revue critique des ouvrages de religion, de philosophie, d’histoire, de littérature, d’éducation etc. destinée aux ecclésiastiques, aux pères et aux mères de famille, aux chefs d’institution et de pension des deux sexes, aux bibliothèques paroissiales, aux cabinets de lecture chrétiens, et à toutes les personnes qui veulent connaître les bons livres et s’occuper de leur propagation.
Tome XXII - Juillet à décembre 1859 - Paris. Au bureau de la bibliothèque catholique, rue de Sèvres, 31. - 1859
Compte-rendu du livre de Caro, Du mysticisme au XVIIIe siècle, pages 312-315
120. DU MYSTICISME au XVIIIe siècle. — Essai sur la vie et la doctrine de Saint-Martin, le philosophe inconnu, par M. E. CARO, professeur agrégé de philosophie au lycée de Rennes. — 1 volume in-8° de VI-312 pages (1832 , chez L. Hachette et Cie ; — prix : 5 fr.
« Saint-Martin est un auteur plus cité qu'il n'est connu. On croit être quitte à son égard quand on l'a jugé d'un mot : c'était un illuminé. Tout illuminé qu'il soit (sic), nous ne croyons pas qu'il doive subir sans appel cette sentence du dédain ou du sarcasme. Il est digne, par certaines qualités éminentes, par les défauts mêmes de son esprit, l'excès d'originalité, et de hardiesse, que la critique sérieuse s'arrête à ses œuvres, sans défaveur anticipée, sans parti pris d'avance de raillerie ni de mépris (p. 1). » Ce n'est pas que M. Caro entreprenne une « apologie impossible ; » il ne veut pas, dans ce procès en révision, « absoudre Saint-Martin, » mais seulement « le relever d'un discrédit injuste. » A cet effet, il recueille un certain nombre de témoignages plus ou moins favorables, épars dans les ouvrages de Mme de Staël, de M. Joubert, de Chateaubriand, de Joseph de Maistre, etc., témoignages dont il tire, selon nous, trop d'avantages; puis il entre de plain-pied dans son sujet. — Saint- [313] Martin n'est pas isolé au milieu de ses contemporains : rien, au contraire, de plus commun, au XVIIIe siècle, que ces hommes connus sous le nom d'illuminés. Ils prennent place « entre la religion discréditée et la société sceptique (p. 11). » On attachait, en général, à ce mot illuminisme l'idée d'une inspiration immédiate, d'une communication directe avec les êtres purement intellectuels, et d'une association mystérieuse dans un but quelconque. L'association secrète et l'inspiration, c'est là le double caractère qui peut nous servir à définir presque toutes les sectes d'illuminés, (ibid.).
![]() Lire la suite sur le site : 1859 - Bibliographie catholique - Compte-rendu du livre de Caro
Lire la suite sur le site : 1859 - Bibliographie catholique - Compte-rendu du livre de Caro