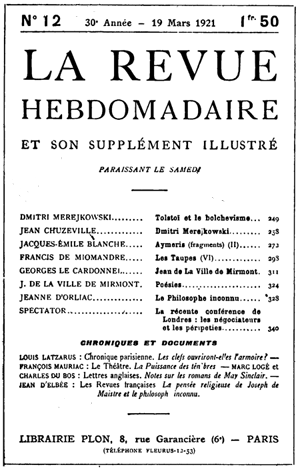
1921 - La Revue Hebdomadaire
Jeanne d’Orliac Le Philosophe inconnu
« Je vais souvent, en suivant le coteau qui domine la vallée de la Loire, dans un petit village qui se nomme Chandon. Je passe par le chemin des vignes pourpres, transparentes, vivantes, dans le soleil d'automne, comme si du sang vif et chaud circulait en leurs feuilles aux nervures saillantes… »
Article paru en 1921 dans la Revue hebdomadaire, pages 328-339
La Revue hebdomadaire et son supplément illustré, paraissant le samedi. N° 12 – 30e année – 19 mars 1921. Librairie. Plon, Nourrit et Cie (Paris), 8, rue Garancière (6e) – Paris (Téléphone Fleurus 13-53). Directeur de publication : Fernand Laudet (1860-1933). Éditeur scientifique : François Le Grix.
La maison des Tournyer en 1921![Robert Amadou, La Chaumière de Louis-Claude [de Saint-Martin] à Chandon. Revue L’Esprit des Choses, 1994, pages 98-110. La maison des Tournyer en 1921](/images/stories/lcsm/SM_Chandon.gif)

La photo publiée par la Revue Hebdomadaire dont la légende annonce « La maison du Philosophe inconnu à Chandon, près d’Amboise », est en fait, comme l’a si bien démontré Robert Amadou (1), la maison de la famille Tournyer. La maison de campagne de Saint-Martin qu’il tenait de son père est une autre maison, sise à Chandon également, la « chaumière (ou closerie) du Mont-Aimé (ou Montaimé) » qui a quitté la famille Saint-Martin en 1804, vendue par Louise-Françoise de l’Estanduère, sa sœur, qui l’avait héritée lors du décès de son frère dans la commune de Châtenay près Paris le 21 vendémiaire an douze (14 octobre1803).
(1) Robert Amadou, La Chaumière de Louis-Claude [de Saint-Martin] à Chandon. Revue L’Esprit des Choses, 1994, pages 98-110.
Le philosophe inconnu - Jehanne d'Orliac
Je vais souvent, en suivant le coteau qui domine la vallée de la Loire, dans un petit village qui se nomme Chandon. Je passe par le chemin des vignes pourpres, transparentes, vivantes, dans le soleil d'automne, comme si du sang vif et chaud circulait en leurs feuilles aux nervures saillantes. Sous ce ciel immense, on respire à pleine gorge un air chargé des essences de la forêt proche. Dans la coupe profonde de la vallée où le grand fleuve traîne, des vapeurs légères, roses et argentées se balancent comme une écharpe molle.
Le point final de cette course enivrante est une maison ancienne aux toits en mansardes, aux belles proportions du beau siècle, entourée d'un joli jardin dont un if pyramidal occupe le centre. Ce n'est pas une demeure seigneuriale, non plus une ferme. Elle impose je ne sais quel respect qui donne envie de la saluer comme une vieille personne au beau regard bienveillant.
Je sais maintenant à qui appartint cette demeure. Chère à mes yeux pour sa forme et sa situation, elle devient précieuse à mon esprit à cause de celui qui la marqua de sa grâce particulière.
C'est Claude de Saint-Martin, le « philosophe inconnu ». Nommé quelquefois, peu cité, rarement lu, il eût été digne pourtant d'enrichir le Trésor des Humbles à côté de Ruysbroek, de Novalis, de Swedenborg ? Nous aurions beaucoup appris, si Maurice Maeterlinck nous avait conduits vers lui de sa persuasive et savante parole. C'est [329] pourtant à une phrase de lui qu'il cite, que j'ai dû de le mieux connaître.
« Avons-nous fait un pas de plus sur la route instructive et lumineuse de la simplicité des êtres... »
Ces quelques mots suffisent à faire aimer celui qui les prononça. Ils expriment plus que l'âme, une voix et, plus qu'une âme et une voix, un regard posé avec tant d'indulgent amour sur le passant auquel il impose sa sympathie.
Claude de Saint-Martin naquit le 18 janvier 1743, à Amboise, d'une famille noble et pauvre. Il était le quatrième fils d'un soldat aux gardes. Son père, tenu en grande estime par ses concitoyens, fut élu maire en 1769. Sa mère mourut jeune, il fut élevé par sa belle-mère qui l'aima comme son enfant. Elle le baignait de douceur, tandis que son père, plus sévère, lui imprimait une forte discipline morale. Il fit ses études à Pont-Levoy, délicieux collège tourangeau, perdu au milieu des champs, où jadis une école musicale prit un certain renom.
Claude avait une figure charmante, des yeux grands et doux. Chétif et fluet, il dit de lui-même :
« On ne m'a donné de corps qu'en projet. »
Il voit de cette débilité, sa prédisposition aux choses spirituelles. « La divinité ne m'a donné tant d'astral que parce qu'elle voulait être mon mobile, mon élément et mon terme universel. » Il est musicien et joue parfaitement du violon. Son père lui fit faire ses études de droit à Tours où il fut reçu avocat au siège présidial. Mais il n'entendait rien à la chicane. Un ennui mortel l'accablait durant les insipides débats où il ne put jamais savoir qui avait gagné ou perdu. Nous imaginons aisément son trouble, si nous songeons à l'indépendance de sa pensée plus tard exprimée :
« J'aime beaucoup mieux les choses qui sont rejetées que celles qui sont reçues. »
« Des vérités qui ne reposeraient que sur des témoignages ne seraient plus des vérités. »
[330] « Il y a une vérité, mais je peux m'adresser mieux qu'à des hommes pour la connaître. »
Il quitte la carrière et, par la protection du duc de Choiseul, il entre avec un brevet d'officier au régiment de Foix. Ainsi est-il conduit à Bordeaux où l'attendait le « Quo vadis » des prédestinés. Il commence dès lors à s'adonner aux études secrètes qui firent la joie et le tourment de sa vie.
N'avait-il jamais été attiré, avant ce jour, par ce mysticisme séducteur, qui est à la religion ce que l'amour libre est au mariage ? Un homme à Amboise précéda son père dans les fonctions de maire ; c'était Jacques-Jérôme Coullon, qui publia en ce temps un ouvrage singulier intitulé : Clef du grand œuvre ou lettre de Sancelrien tourangeau. Dans la première, sera enseigné où trouver la matière des sages. Dans la seconde, les vertus et les merveilles de l'élixir blanc et rouge.
Jacques-Jérôme Coullon et Claude adolescent se rencontrèrent certainement et sympathisèrent. Quand il vit Martinez de Pasqualis à Bordeaux, le jeune officier était, si non initié, du moins averti, et il ne fut pas nécessaire de l'arrêter dans la rue, comme son condisciple Fournier, pour lui dire :
« Vous voyez marcher toutes sortes de gens. Eh bien ! ils ne savent pas pourquoi ils marchent, mais vous, vous le saurez. » Il flottait un air trouble au dix-huitième siècle. Les philosophes sapaient la religion, les mystiques réveillaient le merveilleux, les charlatans ranimaient la sorcellerie. Plus on perdait la foi, plus on devenait crédule. De tous côtés en Europe s'élevaient des sanctuaires dont les pontifes étaient souverains. A Lyon, gouvernait Cagliostro ; à Avignon, à Zurich, professait Lavater ; à Copenhague rayonnait Swedenborg ; à Strasbourg, Jacob Boehm, enfin Pasqualis tenait à Bordeaux son temple. Les convulsionnaires traversent les rues. Des sectes qui ont de grandes ressemblances avec celles de Raspou- [331] tine s'établissent en différentes provinces sous le nom de « multipliants » ou « condormants » qui, sous prétexte de rites, s'adonnent à des pratiques de la plus basse sensualité. La magie est à la mode et le sceptique Lauzun se fait une nuit rosser par le diable. Barbier parle avec effroi de cette chienne appelée Charmante, grande comme un chien de chasse, et qui, pareille aux chevaux D'Elbersberg compte, résout des problèmes, devine la pensée du spectateur qu'elle traduit au moyen de cartes, portant des lettres ou des chiffres.
Se détachant de ces associations secrètes et de ces pratiques puériles, Saint-Martin ne garde de son initiation que l'idée d'un univers sensible se mouvant en Dieu ; la certitude de ses manifestations constantes, invisibles aux profanes ; la foi en la survivance des âmes dont nous aidons le perfectionnement par nos œuvres ; enfin une foi absolue aux livres saints, somme des sciences humaines et des promesses divines.
Certes, je ne le nie pas, ils sont lourds et obscurs, ses livres, mais à chaque page éclatent une pensée, un mot, même une strophe, qui se détachent lumineux, troublants, avec l'éclat d'une période de Chateaubriand, ou la rectitude d'une maxime de Vauvenargues. Surtout ce qui émerveille dans son œuvre, c'est lui-même, sa passion de Dieu, sa soif de Dieu, sa foi dans le progrès des hommes revenant à Dieu. Il n'a aucune affectation de vertu, aucune pose de sainteté. Il vit comme tout le monde, mais mieux que tout le monde. Il est l'hôte des plus grandes maisons : les Bourbon, les Choiseul, les Suffren, les Lusignan. Il n'est ébloui par aucun et ne veut étonner personne. Ainsi que Vauvenargues, il n'est pas dupe.
« Quelques sots se sont dit à table : nous seuls, sommes de bonne compagnie, et on les croit », dit le Lys de Provence.
« A la manière dont les gens du monde passent leur temps, on dirait qu'ils ont peur de n'être pas assez bêtes, [332] dit le Cygne de Touraine. Mais le premier vit solitaire, le second se prodigue. C'est que l'un ne veut que dénoncer, l'autre veut secourir. Vauvenargues est un réaliste, un moraliste, Saint-Martin est un mystique, plus même, un hermétiste. Il ne prêche pas, il passe, il parle. Il sait le bien qu'on peut faire par sa seule présence bienfaisante et forte :
« Si en présence d'un honnête homme, les absents sont outragés, l'honnête homme devient de droit leur représentant. »
Il sait que toujours et enfin le bien triomphe. A travers les luttes, les oppositions, les sarcasmes, la flamme se fortifie et monte, avec le temps, avec l'aide du temps, son usure, et sa sélection.
« Fleuve des siècles, vous semblez ne rouler dans vos eaux troubles que l'erreur, le mensonge et la misère. Au milieu de ces torrents fangeux, à peine se trouve-t-il un filet d'eau pure, et c'est tout ce qui reste pour désaltérer les nations. »
Le philosophe inconnu est une de ces ondes fraîches et jasantes, à la suite de François d'Assise, dont il a parfois le génie souriant ; de François de Sales, dont il a la grâce mondaine ; après Fénelon et Mme Guyon, dont il a aussi les amoureuses divagations ; avant M. de Maistre, il fonde la théocratie contemporaine. Avec lui, il justifie les révolutions, les guerres, les sacrifices pour la libération de l'esprit, par l'effusion de sang. Il prélude au spiritualisme de Royer-Collard ; il crée la théorie du langage reprise avec gloire par de Bonald.
Je suis son ombre sur cette route qui passe devant ma maison. Je le sais, il fuyait la petite ville d'en bas, Amboise qui fut son horreur.
« Dans mon enfer, je ne pouvais ni en parler, ni en entendre parler, parce que tout ce qui tenait à l'esprit y était antipathique. » [333]
Là il connut les secousses du néant.
Dès le dix-huitième siècle, la population était marquée d'un caractère indélébile, d'incurable incompréhension spirituelle. Commerçants enrichis, ils se hâtaient d'acquérir des charges procurant la noblesse. L'ancien séjour des rois et le voisinage des châteaux communiquaient aux bourgeois et manants cette envie un peu niaise des titres et des blasons. Saint-Martin, inaccessible à toute vanité et que seules les vérités profondes émouvaient, n'en pouvait supporter le spectacle navrant.
Il s'évade, il monte par le petit chemin de la Loire, ou par celui de Saint-Denis, ou par celui de Bléré ; il gagne la forêt, il respire en plein ciel dans la paix des cultures et la sagesse des villages... Je le vois avec sa petite taille chétive, sa belle figure expressive, ses manières de gentilhomme et son sourire empreint du désir de vous plaire et de donner quelque chose. Il a « jeté le monde derrière lui », il s'est dégagé de la matière, il va, léger et délivré de tout métier, puisqu'il a donné sa démission de tout nom, puisqu'il est le philosophe inconnu, « demeuré victorieux de la bête et de son image, pour posséder les harpes de Dieu ».
Une harpe, oui, c'est cela qu'il tient, dont les notes s'égrènent sur nos âmes. Va-t-il nous apprendre quelque chose ? Il n'y prétend pas. Il fait mieux qu'apprendre, il réveille.
« Seigneur, fais approcher le ciel entier du cœur de l’homme et que ce foyer brûlant lui fasse éprouver ces tourments si salutaires. »
Rien n'est pur et haut comme sa parole aux instants de sa meilleure inspiration. Il sait le langage même de ce spleen que toute âme consciente de son exil porte en elle jusque dans ses joies.
« Homme; n'espère rien si tu n'as pas divinisé ton cœur. C'est pourquoi ne parle jamais de la sagesse qu'à ceux [334] qui l'ont déjà cherchée, ceux qui ont cru pouvoir s'en passer n'y sont pas propres. »
« Qu'étais-tu, homme, lorsque l'Éternel te donnait la naissance ? Tu procédais de lui. Tu étais l'acte vif de sa pensée, tu étais : un Dieu pensé, un Dieu voulu, un Dieu parlé. Tu n'étais rien tant qu'il ne laissait pas sortir de lui sa pensée, sa volonté, sa parole. » Dès que l'homme l'eut exprimée, l'homme devint le verbe vivant, le chiffre universel, le tableau d'un être infini. Il est la lampe sacrée suspendue au milieu des ténèbres du temps. Il est la fierté de la terre. Au lieu de demeurer dans sa primitive dignité, il est tombé pour n'avoir pas su manifester seulement la puissance de son créateur, mais avoir voulu l'usurper. Il est tombé et se débat dans l'obscurité et la confusion, enlisé de matière, ayant oublié son principe, sa fin et les moyens qu'il doit employer pour revenir à l'un et parvenir à l'autre.
« La douleur, l'ignorance et la crainte, voilà ce que nous rencontrons dans notre ténébreuse enceinte. Voilà quels sont les points du cercle étroit dans lequel une force que nous ne pouvons vaincre nous tient enfermés. Tous les éléments sont déchaînés contre nous. A peine ont-ils produit notre forme corporelle qu'ils travaillent à la dissoudre en rappelant continuellement à eux le principe de la vie qu'ils ont donné. Nous n'existons que pour nous défendre contre leurs assauts, nous sommes comme des infirmes abandonnés et réduits à panser continuellement [335] nos blessures. » C'est peu de dire que les éléments sont déchaînés contre nous, les frères de misère s'acharnent contre eux-mêmes. Ceux qui devraient s'aider se combattent :
« Parmi ce grand nombre d'hommes, à peine en est-il un qui se réveille pour autre chose que pour être la victime ou le bourreau de son frère. » Et cela encore serait peu si l'homme en butte aux éléments, en lutte avec ses pareils n'était encore acharné contre lui-même en s'attachant à des erreurs qu'à plaisir crée son intelligence dévoyée. « Ce serait un grand service à rendre aux hommes que de leur interdire universellement la parole, car c'est par cette voie que l'abomination les enivre et les engloutit tout vivants. »
Il est bien vrai que la confusion dont nous souffrons est toute verbale. Nous parlons tous le même langage, mais nous ne donnons pas aux mots le même sens. Il semble qu'en ces signes assemblés pour nous donner la clé du monde invisible réside cet esprit malicieux et fuyant qui dit :
« Tu voudrais avoir mon âme, mon manteau même t'échappera. »
C'est à un morceau de défroque que nous attachons notre vie. C'est en cette loque que nous enveloppons le plus précieux trésor. Nous confions nos intérêts, nos secrets, nous engageons nos serments, nous dédions nos orgueils et nos enthousiasmes à des mannequins, à des apparences, étonnés qu'ils nous déçoivent ou nous trompent, faute de savoir l'origine sainte des mots et leur hermétique signification.
Ainsi, tout ce qui fait l'objet de notre envie ou de notre respect n'est qu'une déplorable relativité. Défiants avec nous-mêmes, nous fixerons Dieu sans cesse pour que ses perfections servent de norme à nos sentiments ; nous jetterons continuellement les yeux sur sa science, pour que nous ne nous persuadions pas savoir quelque chose. [336] Sur sa justice, pour ne pas nous croire irréprochables ; sur ses vertus, pour ne pas penser que nous les possédons. Lui seul est, et tout ce que nous savons n'est qu'un reflet de sa loi inscrite en nos cœurs à la naissance des âges, et dont nous pouvons, aux meilleurs jours de grâce, entrevoir quelques lueurs vacillantes.
« Doctrine humaine, doctrine humaine, laisse aller mon peuple pour qu'il puisse m'offrir ses sacrifices. »
Abaissons-nous jusqu'à toucher le sol, c'est l'humilité qui fait notre force.
« ... C'est qu'alors tu laisses régner le principe et que toute ta force vient de lui. »
Respectons-nous pour ne pas encourir le châtiment qui n'est pas celui que les hommes enseignent, mais un autre plus terrible dont ils nous eussent menacés...
« ... S'ils eussent été assez sublimes pour dire aux hommes que ce principe, étant amour, ne punit les hommes que par l'amour, mais en même temps que, n'étant qu'amour, lorsqu'il leur ôte l'amour, il ne leur laisse plus rien. »
On croit lire les pages brûlantes des Torrents de Mme Guyon, tandis qu'on voit la source des attendrissements de certains rêveurs russes. Toute la théorie des passions bien conduites de Vauvenargues est là développée et magnifiée. Et n'est-ce pas encore un peu M. Bergson avec son retour à l'instinct auquel il n'a pas osé ou pas voulu donner son véritable nom?
Ici s'arrêtent les similitudes, .peut-être les influences. Le philosophe inconnu, qui a proclamé sa croyance aux lumières naturelles de l'homme, souvenir de son origine et aspiration vers son principe, reconnaît toutefois leur impuissance à agir seules. Il lui faut un secours. Il dit « l'amour », mais ajoute « la prière » de l'homme sont plus forts que sa destinée.
« A tous les moments de sa vie, l'homme a besoin de [337] se sauver. Aussi a-t-il vu entrer dans ses abîmes un libérateur universel et qui ne se reposera jamais. »
« Tu le pries, sois confiant dans le succès de ta prière quand même tu serais assez faible pour mal prier, n'y aurait-il pas l'amour qui prierait pour toi ? »
Si forte est sa foi dans la foi, si grande sa confiance aux puissances magnétiques de l'âme en état de prière et d'amour, qu'il a peur tout à coup de la mal diriger en défiance de son jugement imparfait, par scrupule de se voir usurper à son tour le pouvoir divin, en imprimant à l'avenir un mouvement contraire à son avancement spirituel.
« Si l'homme ne veille sur les désirs de son âme et sur sa prière même, il peut augmenter son infortune parce que les désirs de l'homme sont puissants et que leur force peut faire obtenir. »
Du fond de l'Inde sacrée, la voix de Siddartha s'était aussi faite impérative contre les souhaits et les supplications :
La douleur la plus précise
Vient du désir qu'on réalise.
Du fond de sa misère où tant d'orgueil l'avait fait descendre, Oscar Wilde a bien su marquer le même regret :
« L'avenir a deux façons de nous décevoir, en réalisant nos vœux et en ne les réalisant pas. »
Nous prions pour écarter la douleur, mais la douleur est le signe de notre perfectionnement. L'éviter par lâcheté, c'est nous frustrer de son bénéfice. Le philosophe inconnu, s'élevant de plus en plus sur les ailes de la foi, s'écrie donc :
« J'ai dit quelquefois à Dieu : combats contre moi comme l'ange contre Jacob, jusqu'à ce que je t'aie béni. »
La prière est un acte, et cet acte agit dans l'espace. Combien plus précise sera notre influence dans le [338] temps, sur ceux qui procèdent de nous : nos enfants?
« Tout acte de notre part qui n'a pas l'aveu de la nature et de l'ordre, augmente encore les maux et les souffrances attachés à la condition de notre malheureuse postérité. »
Il dit aux frères :
« Tous les hommes ressentent les maux de leurs semblables. Un homme qui fait le mal à un autre homme en fait à tous ceux qui le voient, à tous ceux qui le savent. Ainsi le droit naturel l'oblige à défendre, à secourir, à protéger le faible contre le fort. La douleur que nous cause la vue du faible opprimé est un ordre que la nature nous donne pour courir à son secours. »
« L'âme du malheureux est une espèce de centre où se réunissent en quelque sorte toutes les âmes des autres hommes, pour souffrir tout ce qu'il souffre. »
Sa sympathie va plus loin encore, elle dépasse les hommes, elle dépasse la terre, elle va jusqu'aux astres, à la ronde desquels il participe.
« Quelle surprise, dit-il avec certitude, pour ceux qui dans leur passage terrestre auront méconnu la gravitation universelle !
« ... L'univers est une grande fable, qui doit faire place à une grande moralité
« ... L'univers est un organisme dans lequel la terre occupe la place élue et expressive, comme les yeux dans un visage. Le regard de ces yeux, c'est l'homme, l'homme évolué, le héros, plus spécialement l'agent de la divinité et dépositaire de quelque vertu de l'unité ».
Et nous voilà bien près de la pensée de Carlyle, dont nous pourrons désormais admirer l'expression, mais non la nouveauté.
Pour nous élever de l'état de dégradation où nous gisons jusqu'à la perfection à laquelle il faudra nous confondre, notre éphémère vie ne suffit pas. Bien des cycles doivent être parcourus. Nous avons l'éternité pour nous mouvoir, dans laquelle la mort n'est qu'une promotion. [339]
Nous avons l'éternité pour nous mouvoir, nous avons l'exemple du Christ pour nous rassurer. Et nous avons encore quelque part autour de nous peut-être des âmes errantes qui nous protègent et gémissent dans le vent du soir sur notre ignorance et notre perversité.
Le philosophe inconnu n'y repose pas. Il est mort en 1803, le 13 mai, à Aulnay, dans cette vallée aux loups où vécut quelque temps Chateaubriand, et où Latouche fut aimé de Valmore. Il est mort et nous laisse ses livres sans confidences sur son cœur. Aussi bien n'a-t-il eu que la passion de Dieu. Sa vie chaste s'est satisfaite d'avoir pu deux fois l'adorer à travers ses créatures indignes.
« Il y a deux personnes en présence desquelles j'ai senti que Dieu m'aimait... »
O doux poète, faites, du lieu où vous attendez votre retour parmi nous, faites que nous n'en rencontrions qu'une, une seule et que ce soit pour la vie !...
JEANNE D'ORLIAC.
Qui était Jeanne d’Orliac
Jeanne d’Orliac (1883-1974), de son vrai nom Anne Marie Jeanne Laporte, est la fille de M. Laporte, officier supérieur et de Mme née Cécile d'Orliac. Femmes de lettres, elle a écrit plusieurs pièces de théâtre, diverses poésies et un grand nombre de romans historiques, dont elle fera sa spécialité.
En 1933-34, Ida Rubinstein qui a en tête la création d’un mystère médiéval sur le personnage de Jeanne d’Arc, la sollicite pour un projet d’écriture dont Arthur Honegger composerait la musique. Ce projet sera confié à Paul Claudel qui réalisera le livret et qui deviendra Jeanne d’Arc au bucher.
Habitant la Touraine, elle fera plusieurs conférences sur de nombreux sujets, notamment Ronsard et les disciplines françaises ou La reine de Sicile et les compagnons de Jeanne d'Arc (22 février 1938).
Elle a écrit dans de nombreuses revues ; citons : la Revue hebdomadaire, le Mercure de France…
Elle reçut la Légion d’Honneur, comme Officier (Dossier Jehanne d’Orliac, Bibliothèque Marguerite Durand, Paris).
Robert Amadou dans l’Esprit des Choses (1) cite cet article et parle en ces termes de « Jeanne d’Orliac, poétesse et historienne amateur, amie sincère, je l’atteste, de Louis-Claude de Saint-Martin ».
En 1946, elle est avec les « Amis de Saint-Martin » « venus visiter la maison de campagne du théosophe, dont celui-ci parle mainte fois, à Chandon près d’Amboise ».
Note: (1) Robert Amadou, La chaumière de Louis-Claude à Chandon, l’Esprit des Choses, page 98.
Voir également « Au Hameau de Chandon, sur les pas du Philosophe inconnu », Le Courrier d'Amboise, n° 82, mars 1978, p. 31-33.
Sources et références
Arthur Honegger, Bibliographie : www.arthur-honegger.com/francais/biographie.php, texte écrit par Pascal Lécroart avec l'appui de la biographie d'Harry Halbreich. Également, Maxime Kaprielian Jeanne d’Arc au bucher, une genèse mouvementée, www.resmusica.com/aff_articles.php3?num_art=1692]. - Paul Claudel et la rénovation du drame musical, par Pascal Lécroart. Editions Mardaga, 2004, page 89.
L’Université de Saint-Etienne Centre interdisciplinaire d'étude et de recherche sur l'expression contemporaine a publié en 1977 plusieurs pages sur Jehanne d’Orliac, et notamment pages 166-167. Extrait : « La personnalité de Jeanne d’Orliac est forte et singulière : forte parce qu’elle est directe, que sa parole est sobre et pertinente, singulière parce qu’elle échappe aux conformismes sociaux. Certains sont surpris et conquis ; d’autres, omnubilés [sic] et heurtés par la désinvolture extérieure du personnage, se montrent inaptes à une compréhension qui se situe au-delà de leurs moyens ». Page 167. - Publié par Le Centre, 1977.
Les archives départementales d'Indre-et-Loire présentent un fond Jehanne d’Orliac, répertoire numérique détaillé, sous la côte : Sous-série 75 J, de 45 pages, 1996, ISBN 2860370080, 9782860370080. L’auteur de ce fond est Régine Malveau.
Critiques de livres
- Au sujet du livre Îles au parfum de santal
« Le Nouvelle-Calédonie inspira un autre roman, ou plutôt un récit de voyage romancé, « Les Îles au parfum de santal » (81). Son auteur, Jehanne d'Orliac, fille d'un ancien directeur du service des affaires indigènes, retrouvant les lieux de son enfance, nous livrait ses impressions et ses sentiments pigmentés de jugements péremptoires quelque peu superficiels.
Pour Jehanne d’Orliac, les canaques « sont de grands enfants et doivent être pris pour tels » ; constituants « une race intermédiaire entre les quadrumanes et les hommes, ils ne peuvent acquérir qu’une expérience plus sensorielle que psychologique ». Dès lors, « les considérer comme des citoyens libres, aux droits égaux aux autres » serait « une utopie absurde ». (1)
Note 81 : Publié en 1929, aux éd. Baudinière, Jehanne d’Orliac avait déjà écrit cinq pièces de théâtre et six romans, dont un qui avait été couronné par l’Académie française. Sévère, le père O’Reilly qualifia ce livre de « récit puéril dont il n’y a rien à tirer » dans sa Bibliographie de la Nouvelle-Calédonie.
(1) Dauphiné Joël, Canaques de la Nouvelle-Calédonie à Paris en 1931 : de la case au zoo?. L’Harmattan, 1998, page 57-58.
- Au sujet du livre Diane de Poitiers, Grant’ Sénéchalle de Normandie
Normannia: revue trimestrielle bibliographique et critique d'histoire de Mormandie
Par L. Jouan, Publié par s.n., 1928-1930, page 656, au sujet du livre Diane de Poitiers, Grant’ Sénéchalle de Normandie. Critique : extrait : « Madame Jeanne d'Orliac s'est proposée un but évident: réhabiliter Diane de Poitiers. Pour Madame d'Orliac, Diane n'a jamais manqué de fidélité à son mari et elle… »
- Au sujet du livre Madeleine de Glapion, demoiselle de Saint-Cyr
Voir la Revue de Paris, 1919, juillet-août, page 225.
- Au sujet du livre Yolande d’Anjou
Voir l’Intermédiaire des chercheurs et curieux, 1940, page 448.
« A la thèse par trop originale Caze-Jacoby, je préfère l'explication tournée par Jehanne d'Orliac dans son tout récent volume Yolande d'Anjou, ... »
Critique du théâtre de Jehanne d’Orliac
- Les Annales du théâtre et de la musique - 1907
Les Annales du théâtre et de la musique. Edmond Stoullig. Trente-troisième année, 1907. Paris, Société d’éditions littéraires et artistiques. Librairie Paul Ollendorf, 50, chaussée d’Antin. 1908. Extrait, pages 202-205.
|
24 septembre. – Première représentation de Joujou tragique, pièce en quatre actes de Mlle Jehanne d’Orliac (1). – Dites-moi pourquoi M. Alphonse [203] Franck, qui passe pourtant pour avoir le flair d’un bon directeur, s’entête – galamment, je le veux bien – à mettre son théâtre à la disposition de femmes-auteurs dont les tentatives – nous n’osons dire les « entreprises » - sont d’avance condamnées… Sacha, de Mme Régine Martial, n’avait, l’année d’avant, que très péniblement obtenu une quinzaine de représentations. Trois soirées, y compris celle de la répétition générale : tel aura été le bref destin de Joujou tragique de Mlle Jehanne d’Orliac. Va pour ce « Place aux Jeunes » qui semble être la devise de la saison commençante. Mais comment ne point décourager une jeune fille qui possède peut-être tous les plus beaux dons du monde, mais qui n’a évidemment à aucun degré celui de la scène ? Mlle d’Orliac (vingt deux ans aux prunes) arbore un joli prénom, encore que légèrement prétentieux et atteste beaucoup de littérature… Elle aime sincèrement Maeterlinck, elle a lu passionnément tout Annunzio et se complaît à citer Ibsen, comme la malicieuse petite sous-préfète du Monde où l’on s’ennuie, « y allait » des pensées de Joubert et de Tocqueville… C’est très gentil sans doute d’être aussi « calée » à son âge, mais cela ne suffit pas, non seulement pour décrocher un succès, mais même pour intéresser, si peu que ce soit, une brillante salle de première. Que Mlle d’Orliac (Jehanne) veuille donc ne point trop s’étonner qu’on ait assez irrévérencieusement, [204] voir bruyamment, « souri » devant un essai aussi naïvement enfantin. Comment en eût-il été autrement, puisque Joujou tragique donnait aux spectateurs les mieux intentionnés l’impression d’une « pièce-bébé », bourrée d’inexpérience et bordée de puérilités… Je vous en dois tout au moins le sujet ? Le voici en quelques mots. L’imprudent Pierre de Cerlac a épousé une petite ouvrière, pauvre et abandonnée, de trente ans plus jeune que lui. Simone est une charmante poupée, rieuse et frêle, avide de joie, dont les grands yeux innocents répandent autour d’elle, en dépit qu’elle en ait, la douleur et l’amour. Et nous ne tardons pas à deviner que Jean – un neveu que Pierre chérit comme un fils – a subi plus que tous les autres le charme vainqueur des grands yeux de Simone. S’il n’aime pas Marguerite Berly, la fiancée qu’on lui destine, c’est que, sans se l’avouer, il aime sa jeune tante. Et celle-ci, qui voit clair en son cœur, supplie Pierre de l’emmener avec lui bien loi, bien loin… Il l’emmène en effet à Venise, mais Jean est du voyage !... On n’est pas « mari » à ce point… A Venise la Rouge – le décor sur le Grand Canal est du reste délicieux – comment, grisés par la magie d’une soirée divine et d’une enivrante musique, Simone et Jean résisteraient-ils, plus que Tristan et Yseult, à la puissance de la passion qui les entraîne l’un vers l’autre ? Le mari surgit et surprend leur baiser ; il ne veut pas en voir davantage et part discrètement… Il retourne tranquillement, savez-vous où ? – A la salle de jeu ! Le décor change (tant pis !) et nous voici dans la [205] pièce du palais de marbre où pierre reproche à sa femme sa trahison. Simone supplie son mari de lui pardonner un instant d’égarement, et passe dans sa chambre… Pierre, alors « se met la tête dans ses mains ». Jean traverse la pièce sans mot dire, et suit Simone. On entend un grand cri : il la ramène et la jette, inerte, dans les bras de son mari : il les a crevés, ces yeux dangereux, ces terribles yeux de Simone, qui n’ont été pour lui et ceux qu’il aimait que des sources de douleurs. Nous n’insisterons pas sur le manque absolu, et comme voulu, d’habileté théâtrale que marquent ces quatre actes farcis de concetti, qui veulent être poétiques, et dont l’écriture « recherchée » n’est pas le moindre défaut. Plaignons du moins les artistes, dont la tâche était si difficile, et même si périlleuse. Mlle Polaire a su, comme on dit « tiré son épingle du jeu ». Et nous avons constaté avec plaisir, chez cette comédienne dont le talent est en visible progrès, l’effort qu’elle a fait pour présenter au naturel le personnage de Simone. Le « naturel », c’est hélas ! ce qui manque toujours à Mlle Greuze, la factice ingénue des Bouffons. A M. Dauvillier, il fallait bien de l’autorité pour ne pas paraître absolument ridicule dans le rôle du mari ; à M. Roger Vincent, beaucoup de sang-froid pour ne point se laisser démonter, au milieu de la scène d’amour, par l’hilarité générale… Le surlendemain, le théâtre faisait relâche, et trois jours après, il reprenait Mademoiselle Josette, ma femme… |
|
Note 1.
Distribution. Simone de Cerlac, Mlle Polaire. – Suzanne de Bretal, Mlle Cath. Fonteney. – Marguerite Berly, Mlle Greuze. – Mme Grandvel, Mlle Marg. Meunier. – Mme Lorges, Mlle Cassiny. – Mme du Prat, Mlle Mad. Charny. – Louise, Mlle de Massol. – Pierre de Cerlac, M. Dauvillier. – Jean, M. Roger Vincent. – Berly, M. Arvel. – Marcel Tourneur, M. Pillot. – Henri de Bretal, M. Garat. – Roger Deluc, M. Deschamps. – André Deluc, M. Marchand. – Graudvel, M. Paul Edmond. – Franciz, M. Chambaz. – Bernard, M. Duval. – François, M. Demarzat.
- La revue hebdomadaire, 1909, article Critique de théâtre
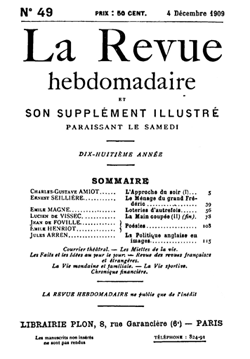 La Revue Hebdomadaire, 4 décembre 1909. Dix-huitième année
La Revue Hebdomadaire, 4 décembre 1909. Dix-huitième année
Mlle Jehanne d'Orliac, dont la première œuvre Joujou tragique avait été accueillie, au Gymnase, de façon ni courtoise, ni justifiée, vient de faire représenter au Théâtre des Arts une pièce qui n'est sans doute pas pour le gros public, mais qui est fort intéressante au point de vue littéraire.
Pulcinella est une pièce, a-t-on dit, nietzchéenne. Elle l'est parce qu'un jeune berger conseille à Pulcinella, jolie fille qu'une vieille sorcière tient prisonnière dans sa roulotte, d'étrangler cette vieille et de ravir à sa compagne, Colombine, le beau Scaramouche qu'elle convoite.
« — Fais n'importe quoi pour être heureux. »
Je le veux bien, mais — et Mlle d'Orliac ne me contredirait certainement pas — Nietzche n'est pour rien dans cette affaire. Sa morale n'est point du tout celle-là !
Cette petite parenthèse vite fermée, je dois dire que Pulcinella, pour n'être point un drame Nietzchéen, n'en est pas moins un essai tout à fait intéressant et original. La pièce contient des scènes extrêmement fortes et je reprocherai seulement à Mlle d'Orliac d'avoir parfois légèrement abusé des tirades. Les personnages devraient parler plus simplement : le drame y gagnerait en intensité et en vérité.
Bibliographie de Jehanne d’Orliac
- Le Cahier des charges. Paris, Sansot, 1909. Petit in 8° broché. 149 p.
- Pulcinella, pièce en 3 actes en vers, Jehanne d' Orliac, Louis Jou. Édition du Chariot, 1910, 79 pages.
- Un grand blessé. La captive de Gand. E. Flammarion, 1917
- Madeleine de Clapion, demoiselle de Saint-Cyr. Ce livre a reçu le prix Montyon en 1920.
- Un Cœur d'homme, roman. E. Flammarion, 1921
- Chanteloup, la duchesse de Choiseul et Chérubin. J. Ferenczi et fils, 1922. 218 pages.
- Une courtisane, Flammarion, 1922, 265 pages.
- Le drame de la Chavonnière, E. Flammarion, 1925, 245 pages
- Anne de Beaujeu, roi de France, avec trois gravures. Paris, librairie Plon, 1926
- Chanteloup du XIIIe au XXe siècle. Paris, Fourcade in-8°, broché, 1929. Ce livre a été couronné par l'Académie française en 1930.
- Diane de Poitiers Grant Sénéchalle de Normandie, Jehanne d’Orliac avec trois gravures hors texte Paris librairie Plon 1930.
- Les îles au parfum de santal : Nouvelle Calédonie, Nouvelles Hébrides, Éditions Baudinère, 1930, 249 pages
- La fleur d'or (Anacoana). Librairie Baudinière. 1927. Broché. 224 pages.
- Le cœur humain, inhumain, surhumain de Blaise Pascal. Paris. Baudiniere. 1931. 1 vol. in-8, broché. 253 pp.
- Chaînes de perles, Baudinière, 1932
- Yolande d'Anjou, la reine des quatre royaumes. Paris, Plon, 1933.
- Christine de Suède: La reine chaste et folle, Éditions des portiques, 1934, 251 pages
- Le deuxième mari de Lady Chatterley, A. Michel, 1934, 254 pages
- Suisses et Grisons. Soldats de France. Tours, Arrault, 1936 In-4° broché, 292 pages, avec 25 planches hors-texte.
- La légion d’Honneur, Tours, Arrault et Cie, 1937
- Les dames de la halle, 1181-1939, Éditions Francex, Société d'éditions extérieures et coloniales, collection Figures méconnues de l’histoire, 1946
- 165 pages
- La Duchesse de Choisel Arrault, Tours, 1947, in-8 br 142 p, avec un dessin de Gaston Bauvais.
- Jean des boucles brunes, illustrations d'André Galland - Collection Framboise - Editions de Marly, Librairie Plon 1947.
- Jeanne d’Orliac a écrit la préface du livre de Ferdinand Dubreuil, Amboise. Ville royale - Reflets d'histoire, 1959. Typographie Gilbert-Cla, 1959 in-4, frontispice, titre, 4 pp., 14 planches sous chemises, 1 feuillet, en feuilles, chemise et étui
- DUBREUIL (FERDINAND). Amboise. Ville royale - Reflets d'histoire. Préface de Jeanne d'Orliac
Poèmes de Jehanne d’Orliac
Mercure de France I-VII-1908, pages 58-60
- Émerveillement
Qui donc es-tu, toi que j'ai rencontré,
Venant à moi très doux, de ce pas assuré.
De quelqu'un qui se sait attendu... Que très bonne
Est ta voix... Et tu sais prier comme on ordonne ;
Ordonner comme on prie — Oh! laisse-moi passer ;
Las!... Ta main douce a pris ma main pour la presser ;Ta lèvre a la fraîcheur d'un feuillage d'érable,
D'où vient qu'en toi je trouve un charme délectable,
Et que je reste là, d'un silence éploré...
Qui donc es-tu, toi que, j'ai rencontré?... —— Oh ! petite, petite enfant, mets bien tes bras
Tout autour de ma tête ;
Il est pour toi des biens que tu ne connais pas,
Il est plus d'une fête.Écoute-moi : Tes yeux curieux et sans fards,
Beaux de leur pureté troublante,
Tes yeux, écoute-moi, j'y mettrai des regards ;
J'y mettrai la flamme démente ;Ta bouche, écoute-moi, belle de ses dessins,
Je la rendrai gourmande ;
Elle aura la saveur des baisers et des vins
Ta bouche qui quémande.[59]
Si ta taille est jolie, elle manque à mon gré
Des souplesses qui sont ma joie,
Je la rendrai flexible et ton corps bien cambré
Sur le bras qui le ploie.Et tout ton être, enfin, sans désirs ni soupçons
Que l'orgueil cuirasse et isole,
Il s'évanouira, secoué de frissons,
Au seul contact de ma parole. —— Oh ! laisse-moi passer !
Las ! Ta main douce a pris ma main pour la presser,
Ta lèvre a la fraicheur d'un feuillage d'érable,
D'où vient qu'en toi je trouve un charme délectable,
Et que je reste là, d'un silence éploré ;
Qui, donc es-tu, toi que j'ai rencontré ?A peine ai-je entendu ta voix... J'ai l'amertume
Qui voile mon réveil d'une montante brume ;
A peine t'ai-je vu... j'ai le naissant regret
Du cœur inasservi que nul joug ne soumet...
Mais vais-je vous chérir, regret et amertume !
A la docilité tout être s'accoutume....
Du plus profond de moi la voix va me sommer...
« Il faut aimer… il faut aimer »...— Oh! petite, petite enfant, mets bien tes bras
Tout autour de ma tête
Il est pour toi des biens que tu ne connais pas,
Il est plus d'une fête... —Et je te reste là, d'un silence éploré.
Qui donc es-tu ? toi que j'ai rencontré ?...
[60]
- Les Paupières
Elles ont la douceur, la fraîcheur des pétales,
Le regard radiant sous l'éventail des cils
Coule doucement de leurs abris puérils
Les ombrant de carmins et les faisant fatales.Lourdes et lasses des fatigues nuptiales,
Elles ont pour nos sens des attraits plus subtils ;
Curieux nous cherchons à voir sous les sourcils
Les secrets devinés des voluptés brutales.Paupières sur nos yeux, vous êtes gardiennes
Des irréalités où se perdent nos peines ;
Vous voilés nos horreurs, nos hontes et nos pleurs.Paupières sur ses yeux, oh ! délicates fleurs !...
Ma bouche aime à sentir palpiter sa prunelle,
Sous la chair, si peu chair, qui la cache et la scelle.
JEHANNE D'ORLIAC.




