 1836 – Barchou de Penhoën - Histoire de la Philosophie Allemande
1836 – Barchou de Penhoën - Histoire de la Philosophie Allemande
Depuis Leibnitz Jusqu'à Hegel
Le Baron Auguste-Théodore-Hilaire Barchou De Penhoën
Paris.
Charpentier, éditeur libraire, 31, rue de Seine
1836
Tome Ier - Livre Ier – Leibnitz - Livre III – Fitche
Tome II - Livre IV Schelling
Histoire de la Philosophie Allemande depuis Leibnitz Jusqu'à Hegel
1836 - Histoire de la Philosophie Allemande T1
Tome Ier - Livre Ier – Leibnitz – Extrait, pages 122-124
 [122]…Contemporain de Hobbes, le lord Edouard Herbert de Cherbury, suivant une direction opposée, s'efforçait, au contraire, de créer une philosophie toute religieuse, toute spiritualiste. Son enseignement n'eut que peu de retentissement.
[122]…Contemporain de Hobbes, le lord Edouard Herbert de Cherbury, suivant une direction opposée, s'efforçait, au contraire, de créer une philosophie toute religieuse, toute spiritualiste. Son enseignement n'eut que peu de retentissement.
A la même époque, un médecin, Jean-Baptiste Van-Helmont (1577-1644), alliait le mysticisme à l'étude des sciences naturelles ; il cherchait à faire une philosophie du grand tout. Selon Van-Helmont, toute science, toute connaissance de l'intuition immédiate de la Divinité ; la nature entière est animée; dans l'univers sont enfermées, emprisonnées des substances spirituelles qui se manifestent à nous sous la forme de puissances naturelles. Van-Helmont faisait sortir toutes choses de l'air et de l'eau. En Angleterre, les idées de Paracelse trouvaient un ardent sectateur dans le médecin Robert Fludd (1574-1637). En Allemagne apparaissait (1575-1624) le fameux [p.123] Jacob Bœhm. Bœhm cherchait dans la Bible l'explication du monde extérieur. Selon Bœhm, ce monde n'était autre chose que le relief, la mise en saillie d'un monde invisible caché dans son propre sein; la Bible, la tradition en étaient comme autant de révélations. La réputation de Bœhm fut immense dans son temps; le roi d'Angleterre envoya près de lui un savant, avec l'unique mission de le comprendre et de le traduire. De nos jours il a conservé de nombreux adeptes : le lecteur a déjà nommé le plus célèbre d'entre eux, le fameux Saint-Martin, le philosophe inconnu. Singulier spectacle, qui appelle tout à la fois admiration et sympathie. Voyez ce pauvre cordonnier; vous le croyez peut-être préoccupé des misères de son humble condition ; mais, sur les ailes de l'inspiration, il voyage avec Platon dans les sphères les plus élevées du monde des intelligibles.
A la suite de tous ces noms, célèbres à degrés et à titres différents, se présentent ceux de Descartes, de Malebranche, de Spinoza. C'est dans ce moment qu'il eût été opportun [p.124] d'en parler, si nous n'eussions consulté que le seul ordre chronologique.
Mais on l'a vu, avant ce rapide coup d'œil jeté sur le mouvement de l'esprit philosophique dans les XVe, XVIe et XVIIIe siècles, nous avons commencé par esquisser rapidement quelques uns des grands traits de leur système. Pour agir ainsi, nous n'avons pas manqué de motifs. La philosophie de Leibnitz, par conséquent la philosophie allemande tout entière, se trouvait en germe dans le cartésianisme ; et, par ce motif, nous avons d'abord dit en quoi consistait ce germe. L'examen des autres systèmes antérieurs au cartésianisme, et dont Leibnitz put avoir connaissance, ne devait venir qu'après ; ces systèmes, ces doctrines, ces opinions, sont seulement comme le terrain où a grandi ce germe, où il a développé, en s'en assimilant une portion, un mouvement progressif et continu que nous allons étudier dès à présent.
Tome Ier - Livre III – Fitche – Extrait, pages 318-329
Ce n’était pas assez pour nous de montrer la philosophie sensualiste dans son germe, nous devions la suivre encore dans ses derniers résultats, dans ses conséquences les plus éloignées.
Un autre philosophe professait à l'École [p.319] normale cette même philosophie que M. de Tracy s'efforçait de mettre à la portée de la première enfance : c'était Garat. L'École normale avait été instituée avec solennité ; la Convention, disait le décret de fondation, voulait donner au peuple français une instruction digne de ses nouvelles destinées : on avait voulu faire de cette école un centre de lumière, un foyer de haut enseignement. Les élèves qui en avaient suivi les cours étaient immédiatement appelés à professer ce qu'ils venaient d'étudier. Parmi les professeurs, beaucoup étaient au niveau de l'institution ; il suffit de nommer, pour les hautes mathématiques, Laplace, Monge, Lagrange ; pour la morale, Bernardin de Saint-Pierre; pour la grammaire générale, Sicard; pour l'histoire, Volney; pour la littérature, La Harpe sorti de la solitude où l'avait relégué la Terreur, pour continuer ses éloquentes leçons du lycée. Quant aux autres branches des connaissances humaines, elles étaient de même enseignées par ceux-là même qu'elles avaient le plus illustrés. Beau parleur à la Convention, ministre de la justice, chargé de lire à Louis XVI sa sentence, Garat, [p.320] au langage éclatant et facile, professait la philosophie, alors appelée analyse de l'entendement humain. Parmi les élèves siégeaient quelques hommes dont la célébrité ne le cédait en rien à celle des professeurs. L'attention était générale ; une sorte de recueillement religieuse présidait à l'ouverture de ces cours. Après avoir pris possession de l'ordre social, la Révolution s'annonçait pour venir en quelque sorte prendre possession de l’ordre scientifique et moral. Or, comme, en définitive, toutes les questions scientifiques, sociales ou morales ne peuvent manquer de se rattacher à la philosophie, c'était surtout par la philosophie que cet enseignement avait de l'importance.
Garat consacre sa première leçon à tracer brièvement l'histoire de la philosophie; mais il ne fait commencer cette histoire qu'à Bacon. L'Orient, l'antiquité, le moyen-âge, Aristote, Platon, Descartes, tout cela est comme non avenu pour Garat. Il ne saisit cependant qu'un des côtés, qu'une des faces du génie de Bacon; l'illustre chancelier lui apparaît seulement comme l'auteur de la méthode expérimentale [p.321] dans les sciences physiques. Tout le reste de ce génie encyclopédique lui échappe. C'est même Locke, bien plus encore que Bacon, qui est pour Garat le vrai père, le vrai fondateur de la philosophie moderne. Vient ensuite Condillac, qui non seulement résume toute la science, mais qui en atteint encore les dernières limites. Mais je le laisse parler : « J'arrive à Condillac, et je crois arriver au repos après une longue fatigue, je crois arriver à la lumière après avoir traversé des ténèbres ou des routes à demi éclairées. J'ignore si Condillac a eu moins, autant, ou plus de vues nouvelles sur l'entendement que les philosophes qui l'ont précédé dans la même carrière ; mais les vues des autres semblent lui devenir propres par la clarté nouvelle qu'il y répand, et celles que personne ne peut lui disputer semblent seules donner à l'analyse de l'entendement cette utilité qui devait devenir évidente et générale pour n'être pas toujours.... » Suit une longue énumération des travaux de Condillac sur la métaphysique la grammaire, la logique, l'histoire, l'économie politique, les sciences physiques même. Dans [322] toutes ces voies, la pensée de Condillac est indiquée comme la dernière borne à laquelle il soit donné à l'esprit humain de toucher. Il s'en faut de peu qu'aux yeux de Garat Condillac ne soit a lui seul l'intelligence, le génie de l'humanité.
Avec de telles dispositions, il eût été difficile à Garat de faire autre chose que continuer Condillac devant l'École normale ; suivant Garat, la sensation est aussi la source, le fondement de nos connaissances ; il se propose d'abord de l'analyser, de la décrire avec un soin tout spécial. « Ici, disait Garat, je traduirai, au tribunal de la philosophie de notre siècle et du bon sens du genre humain, l'opinion de ces philosophes anciens et modernes, qui, dans la recherche de la vérité, ont récusé le témoignage de tous les sens, qui ont tenté d'anéantir la raison humaine sous sa propre autorité , et d'arracher les sciences comme de leurs racines. Voilà ce qu'ont fait dans la Grèce Platon, en France Mallebranche, et, ce qu'il y a d'étonnant, en Angleterre, plusieurs disciples de Locke (1). » Garât se [p.323] propose de traiter des facultés de l'entendement, qu'il réduit, ainsi que Condillac, à la sensation transformée. Il s'élève fortement contre la supposition d'un sens moral. « Je prouverai, dit-il, que la douleur et le plaisir, qui nous apprennent à nous servir de nos sens et de nos facultés, nous apprennent encore à nous faire les notions du vice et de la vertu (2). » A propos de l'invention des langues, il blâme Rousseau d'avoir cru l'institution des langues impossible par l'homme. « Puisque tous les mots, avait dit Rousseau, sont établis par suite d'une convention, il paraît que l'usage de la parole a été une condition indispensable pour l'établissement de la parole. » Garat lui reproche aigrement et amèrement cette proposition ; il ne peut lui pardonner de rapporter l'enseignement de la parole à une révélation primitive; il lui reproche d'avoir recours au moyen favori des mauvais poètes, qui est de faire descendre la Divinité sur la terre pour amener le dénouement du drame. Le professeur devait ensuite traiter, dans sa cinquième [324] partie, de la méthode : « Dans cette partie, je n'aurai, ajoute-t-il, presque rien à dire de nouveau ; je me bornerai à recueillir les résultats que j'aurai exposés et développés dans les sections précédentes. Je ferai voir que bien sentir, bien se servir de ses facultés, bien former ses idées, bien parler, sous des points de vue et des termes divers, ne sont qu'une seule et même chose (3). » Toujours donc la sensation transformée, toujours l'intérêt bien entendu, toujours l'interjection, toujours, en un mot, la philosophie du XVIIIe siècle. Cette philosophie dominait alors avec une puissance qui en faisait comme une religion ; elle était non seulement la vérité, mais toute la vérité : ses nombreux disciples n'admettaient pas qu'il y eût possibilité à croire en quelque autre symbole philosophique.
Le spiritualisme essaya pourtant d'une timide récrimination. A cette école, les élèves avaient le droit d'interpeller les professeurs, soit pour les combattre, soit pour leur demander [p.325] de plus amples explications : un jour par semaine était réservé à ces débats. Or, parmi les auditeurs de Garat, se trouvait ce fameux Saint-Martin, auteur mystérieux de tant d'ouvrages mystiques, traducteur et commentateur de Jacob Bœhm, celui que M. de Maistre a nommé le plus élégant des théosophes modernes, et probablement seul alors à oser professer en France une autre philosophie que celle de Condillac. Saint-Martin eut d'abord quelque peine à se faire au langage du jour. La langue du matérialisme ne ressemblait en rien à celle parlée dans ces hautes sphères de la spéculation où l'emportait son génie. Enfin, le professeur ayant amèrement blâmé cette célèbre proposition de Jean-Jacques : « La parole semble avoir été fort nécessaire à l'institution de la parole, » Saint-Martin, de son banc, et du milieu de la foule, entreprit la défense de Rousseau. Profitant de l'occasion, il défendait de même, contre une autre attaque du professeur, la doctrine de Hutcheson sur le sens moral. Mais le débat ne tarda pas à devenir plus important, le dialogue suivant s'engagea entre l'élève et le : « Vous paraissez vouloir, [p.326] disait ce dernier, qu'il y ait dans l'homme un organe d'intelligence autre que nos sens extérieurs et notre sensibilité intérieure ? — Oui, citoyen. — Un organe d'intelligence ? — Oui, citoyen. — Vous avez pour doctrine que sentir les choses et les connaître sont des choses différentes ? — J'en suis persuadé. — Cependant, lorsque je reçois en présence du soleil les sensations que me donne cet astre éclatant qui échauffe et qui éclaire la terre, est-ce que j'en connais autre chose que les sensations mêmes que j'en reçois ? — Vous sentez les sensations; mais les réflexions que vous ferez sur le soleil, mais... (4). » Saint-Martin aurait eu sans doute bien d'autres mais à ajouter ; mais le professeur, prenant tout à coup un ton solennel : « Ce qu'il importe d'abord de dire, c'est que par cette doctrine dans laquelle on suppose que nos sensations et nos idées sont des choses différentes, c'est le platonisme, le cartésianisme, le malebranchisme que vous ressuscitez. Quand on a une foi, il est beau de la professer, il est beau de la [p.327] professer du haut des toits ; mais il n'est pas bon de porter une foi dans la métaphysique comme en physique. La philosophie observe les faits, elle les classe, elle les combine, mais elle ne s'écarte jamais des résultats immédiats, soit dans leur simplicité, soit dans leur combinaison. Ce n'est point là le procédé de Malebranche et de Platon : l'un et l'autre supposent dans l'homme des agents qui ne nous sont connus par aucun fait sensible, et des faits qui ne nous sont connus par aucune de nos sensations. De pareils agents sont précisément de ces idoles qui ont obtenu si longtemps un culte superstitieux de l'esprit humain, de ces idoles dont les écoles étaient les temples, et dont Bacon le premier a brisé les statues et les autels. Ce serait un grand malheur si, à l'ouverture des écoles normales et des écoles centrales, ces idoles pouvaient y pénétrer : toute bonne philosophie serait perdue, tous les progrès des connaissances seraient arrêtés, et c'est pour cela que je regarde comme un devoir sacré, dans un professeur de l'analyse, de traiter ces idoles avec le mépris qu'elles méritent (5). » [p.328]
Peu de minutes avant cette terrible conclusion, il s'en était fallu de fort peu que la question ne fût mise aux voix. « Nous sommes rassemblés ici en très grand nombre, disait le professeur, nous sommes deux ou trois mille personnes ; je vous invite donc, citoyens, à vous recueillir au fond de vos âmes, et à vous demander si les sensations que vous avez reçues et gardées de la chaleur, de l'éclat et du mouvement apparent du soleil, et la connaissance de cet éclat, de cette chaleur, de ce mouvement, sont pour vous deux choses différentes, ou si elles ne sont pas une seule et même chose sous deux points de vue et sous deux dénominations (6). » La majorité était, sans aucun doute, au professeur ; Saint-Martin, après avoir répété sa profession de foi, n'eut plus qu'à se rasseoir, bien dûment convaincu de platonisme, de cartésianisme, de malebranchisme. Ainsi condamné, Galilée, agenouillé pour confesser erreur ce qu'il savait vérité, se releva pour prononcer le fameux et pur si muove; « et pourtant, dit Saint-Martin [p.329] en se rasseyant, les sensations que je reçois du soleil et l'idée que j'ai de cet astre n'en sont pas moins deux choses éminemment différentes ; et pourtant il y a, outre les impressions éparses de chaleur, d'éclat, que je reçois, l'impression complexe où se trouvent confondues toutes ces impressions de détail par une faculté tout autre que la sensibilité qui a reçu celles-ci. » La question mise aux voix, et résolue dans le sens du professeur, n'eût pas été un des moins singuliers épisodes de l'histoire des assemblées délibérantes.
Notes
(1) Recueil des leçons de l'Ecole normale, 1er v., p. 7.
(2) Recueil des leçons de l’École normale. 2* ligne, page 25.
(3) Recueil des leçons de l'Ecole normale, 2e vol, page 39.
(4) Débats, t. 3, p. 18
(5) Débats, t. 3, p. 21.
(6) Débats, t. 3, p. 21.
Tome II - Livre IV : Schelling
(pages 101-103) - 1836 - Histoire de la Philosophie Allemande T2
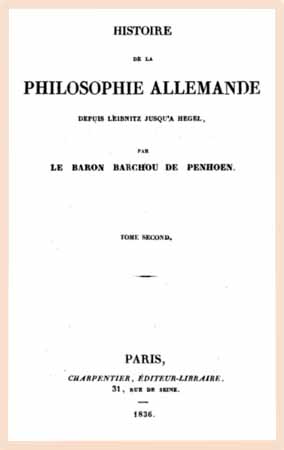 En France, la philosophie avait fait quelques efforts pour sortir des voies matérialistes du XVIIIe siècle. Déjà nous avons mentionné la noble protestation de Saint-Martin contre le matérialisme éloquemment professé par Garat. Sous le nom du philosophe inconnu, Saint-Martin avait publié, plusieurs années avant la Révolution, quelques uns de ses livres, où se trouve le système spiritualiste auquel il a donné son nom. Au milieu des orages révolutionnaires grondant autour de lui, sur le sol ensanglanté et couvert des débris de la patrie, il continua ses paisibles méditations. Ses ouvrages, demeurés inconnus de la foule, écrits même parfois dans une langue convenue, n'en agissaient que plus activement peut-être sur un petit nombre d'esprits, de fidèles disciples. On le sait : la doctrine de [p.102] Saint-Martin est un mysticisme chrétien. Saint-Martin croyait trouver dans la Bible, dans les Évangiles, des paroles mystérieuses, des sens inconnus de la foule, qui devaient dévoiler les lois de l'histoire et de la création. Saint-Martin, de même que ce Jacob Bœhm, dont il s'était fait le traducteur, considérait la terre, le monde comme une sorte d'emblème du christianisme. C'est le point de vue absolument opposé de celui du matérialisme, qui n'explique le monde, l'homme, la création, que par l'action des éléments. Moins mystiques, les idées d'un autre philosophe se trouvent pourtant, sur quelques points, en harmonie avec celles de Saint-Martin : nous voulons parler de M. de Bonald. M. de Bonald n'écrivit point sur la philosophie proprement dite; mais ses théories religieuses et sociales se trouvaient encore en opposition absolue avec celles de la philosophie du XVIIIe siècle. La Philosophie du XVIIIe siècle avait eu pour but principal la destruction de la monarchie française ; M. de Bonald se porta le défenseur de la vieille constitution française dans son intégrité. Le premier il prêcha parmi nous la [p.103] théorie d'une révélation primitive ; il soutint les idées innées, la révélation du langage à l'homme par un souffle divin. Sa théorie politique était toute chrétienne ; c'était la Bible que l'auteur de la législation primitive opposait au Contrat social. Il voyait dans la famille, non dans l'individu, l'élément de la société; il voyait dans la constitution de la famille le modèle idéal, le type de la constitution de l'État.
En France, la philosophie avait fait quelques efforts pour sortir des voies matérialistes du XVIIIe siècle. Déjà nous avons mentionné la noble protestation de Saint-Martin contre le matérialisme éloquemment professé par Garat. Sous le nom du philosophe inconnu, Saint-Martin avait publié, plusieurs années avant la Révolution, quelques uns de ses livres, où se trouve le système spiritualiste auquel il a donné son nom. Au milieu des orages révolutionnaires grondant autour de lui, sur le sol ensanglanté et couvert des débris de la patrie, il continua ses paisibles méditations. Ses ouvrages, demeurés inconnus de la foule, écrits même parfois dans une langue convenue, n'en agissaient que plus activement peut-être sur un petit nombre d'esprits, de fidèles disciples. On le sait : la doctrine de [p.102] Saint-Martin est un mysticisme chrétien. Saint-Martin croyait trouver dans la Bible, dans les Évangiles, des paroles mystérieuses, des sens inconnus de la foule, qui devaient dévoiler les lois de l'histoire et de la création. Saint-Martin, de même que ce Jacob Bœhm, dont il s'était fait le traducteur, considérait la terre, le monde comme une sorte d'emblème du christianisme. C'est le point de vue absolument opposé de celui du matérialisme, qui n'explique le monde, l'homme, la création, que par l'action des éléments. Moins mystiques, les idées d'un autre philosophe se trouvent pourtant, sur quelques points, en harmonie avec celles de Saint-Martin : nous voulons parler de M. de Bonald. M. de Bonald n'écrivit point sur la philosophie proprement dite; mais ses théories religieuses et sociales se trouvaient encore en opposition absolue avec celles de la philosophie du XVIIIe siècle. La Philosophie du XVIIIe siècle avait eu pour but principal la destruction de la monarchie française ; M. de Bonald se porta le défenseur de la vieille constitution française dans son intégrité. Le premier il prêcha parmi nous la [p.103] théorie d'une révélation primitive ; il soutint les idées innées, la révélation du langage à l'homme par un souffle divin. Sa théorie politique était toute chrétienne ; c'était la Bible que l'auteur de la législation primitive opposait au Contrat social. Il voyait dans la famille, non dans l'individu, l'élément de la société; il voyait dans la constitution de la famille le modèle idéal, le type de la constitution de l'État.
Par Saint-Martin et Bonald la philosophie française tendait donc à sortir du matérialisme du XVIIIe siècle, à la même époque où, par l'organe de Schelling, la philosophie allemande tendait à sortir de l'idéalisme exalté de Fichte. La philosophie de Fichte repoussait énergiquement le matérialisme français ; la philosophie de Schelling se trouvait en harmonie avec la nouvelle tendance spiritualiste de l'école française.



