1826 - Revue Le Lycée armoricain Tome 7
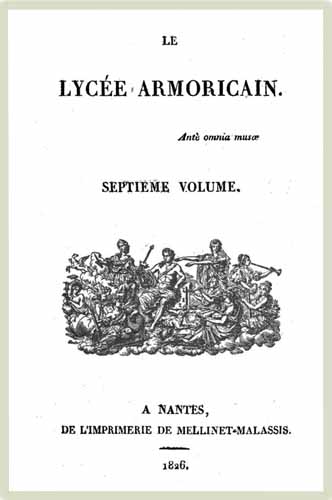 Le Lycée armoricain
Le Lycée armoricain
Septième volume
À Nantes, de l’Imprimerie de Mellinet-Malassis
1826. 7° volume. An 1826. 37° livraison. http://books.google.fr/books?id=qv2H_yFTalsC
De l’état actuel de l’esprit théosophique, Ed. Richer (pages 135-152)
Mens agitat molem et magno se corpore miscet. (Virg. Ænéide, lib. VI, v. 727. Traduction : L’esprit régit le monde ; il s’y mêle, il l’anime).
La philosophie du dernier siècle semble condamnée généralement aujourd’hui par les meilleurs esprits : on a compris le danger de la méthode expérimentale, et on est revenu à l’idéalisme des siècles antérieurs. Allant toujours de plus en plus avant dans cette science, on l’examine surtout dans ses rapports avec la religion. Avec elle a commencé une sorte de fermentation morale, qui tend à affranchir les hommes du joug de l’autorité en tout genre. Ce qui avait pour soi le suffrage d’une génération de philosophes incrédules s’écroule aussi bien que ce qui était avoué de tous les hommes pieux et sincères. Au milieu de cette effervescence, on se demande si l’esprit religieux n’est pas inspiré, comme l’esprit politique, par l’influence d’une secte ; on cherche à discerner ce qui vient de l’exemple de ce qui provient de la conviction ; on redoute de rencontrer l’influence des gouvernements ou de ceux qui sont disposés à en fronder les actes, dans ce qui doit prendre sa source dans les inspirations de la conscience ; et, en se laissant entraîner par les idées nouvelles, on hésite, comme si l’on craignait d’arriver à l’erreur, de ne suivre en philosophie, que des extravagances, et, en religion, que des sectaires. [p.136]
Ce mouvement imprimé aux esprits vient principalement des philosophes religieux, connus sous le nom de théosophes, et auxquels on donne, dans le monde, la désignation assez impropre d’illuminés. Chacun parle de ces auteurs sans les connaître ; chacun dit qu’ils s’égarent sans savoir quelle est la route qu’ils suivent et celle qu’il faudrait prendre. Il s’agit donc d’étudier les différentes doctrines théosophiques reçues aujourd’hui en Europe. Après cet examen, nous connaîtrons la part qu’elles ont dans la religion qu’elles expliquent, et dans la philosophie spiritualiste dont elles s’étaient.
Le siècle de Louis XIV avait déjà uni l’idéalisme à la religion ; mais il n’avait eu à combattre que des erreurs nées de l’esprit religieux. L’idéalisme de nos jours, au contraire, succède à toutes les opinions anti-religieuses, et il doit être nécessairement plus hardi dans sa marche. Fénelon et Pascal n’avaient pas besoin de défendre la religion contre les incrédules. La philosophie de Port-Royal ne combattait pas l’athéisme, mais l’excès de zèle religieux. Aujourd'hui, si l’on veut être à la fois philosophe et chrétien, il faut remonter aux bases mêmes du christianisme pour en prouver la vérité. On en explique le sens spirituel ; on appelle à son secours toute la science humaine pour raffermir l’édifice qu’elle avait ébranlé. Ce ne sont plus quelques points de controverse sur lesquels on dispute ; ce sont les trois énigmes de Dieu, de l’univers et de l’homme sur lesquels on arrête sa pensée. Politique, religion, morale, tout s’assied sur de nouvelles bases. Effrayées de ce mouvement inattendu, les âmes simples attendent le jugement général pour oser émettre le leur. Ceux qui sont chargés de diriger l’opinion publique, comme ces courtisans qui composent leur visage sur celui du prince, se taisent ou critiquent tour à tour selon que les gouvernements manifestent des inquiétudes ou de la confiance. L'homme indépendant trouve des lueurs de vérités, qu’il n’ose avouer, de peur d’être dupe lui-même de cet engouement irréfléchi et de cette ténacité ignorante qu’on doit surtout à l'isolement. C’est à la conscience éclairée par l’étude à prononcer dans cette crise. Pour porter un jugement sur cette matière importante, il ne faut pas [p.137] répéter des ouï-dire, il ne faut pas s’en rapporter à l’opinion commune, puisqu’elle attend elle-même quelqu'un qui la dirige ; il faut avoir lu, comparé et médité longtemps. Il est facile d’imposer, par un ton tranchant ; mais si ce ton est le garant de la franchise dans le commerce ordinaire de la vie, il inspire toujours de la méfiance en fait de science.
Les ouvrages des théosophes diffèrent les uns des autres sur quelques points de dogme ; mais ils s’accordent tous à placer la science de l’âme dans une sphère inaccessible à celle des sens. Nulle part, la démarcation qui existe entre les phénomènes de l’intelligence et ceux de la sensation, n’est plus sensible que là. Ce ne sont point des nuances, comme dans quelques-unes de ces doctrines mixtes, qui tâchent de découvrir la part de l’âme dans les sensations, et celle des sensations dans les sentiments secrets de l’âme. L’homme, disent-ils, est déchu ; cette assertion n’en point avancée gratuitement. Sans elle, on ne conçoit rien à l’origine du mal ; on ne conçoit pas pourquoi la vie est une épreuve pour l’être qui n’a pas mérité de la subir. Les animaux qui ne sont pas déchus sont doués de la lumière instinctive naturelle qui leur est propre, et l’homme tâtonne mille fois avant de rencontrer la vérité. Sa raison est moins sûre que l’instinct de l’animal, et cependant lui seul a l’idée d’un Dieu ; lui seul vient au monde nu, sans armes naturelles ; et, s’il ne trouvait pas dans l’instinct social la protection qu’il ne trouve plus dans la nature, il périrait cent fois de besoin avant d’avoir accompli sa destinée sur la terre. Un être abandonné de la nature, de la nature qui ne cesse pas de protéger ses autres enfants ! Quel sujet de réflexions pour le penseur non prévenu ?
De ce premier principe d’écoulent [sic] une foule de vérités de détails. Si l’on a donné au culte qui réunit l’homme à Dieu le nom de religion, c’est qu’on a voulu exprimer, par l’étymologie même du mot, l’action par laquelle l’être séparé de son principe s’y réunit encore. Si la philosophie antique a vu des souvenirs dans nos sensations mêmes, c’est parce que nous continuons ici-bas une vie commencée là-haut. Si tout ce qui existe porte avec soi le dégoût et l’amertume, [p.138] si l’idéal l’emporte sur la réalité, s’il n’y a de beau enfin, comme le dit Rousseau, que ce qui n’est pas, c’est parce que nous ne sommes plus à notre place sur la terre, et que chacune de nos jouissances terrestres est suivie d’un remords ou du moins d’un regret. Une nouvelle philosophie, comme une nouvelle poésie, jaillissent de ce dogme : avec lui tout change de face. Les physiologistes découvrent-ils un mode inconnu de perceptions dans l’homme ? On se rappelle que les sens n’étant pas la condition de notre existence première, tout ce qui nous dépouille de ceux-là nous rattache à celle-ci, et nous la fait reconquérir en quelque sorte.
On attaque ce dogme, le point fondamental de la théosophie, par différents arguments ; néanmoins, la religion positive n’a point à s’en effrayer. La chute de l’homme est la base du christianisme ; puisque si l’homme n’était pas tombé, il n’aurait pas été racheté. Pascal, dans ses Pensées sur la religion, a mieux démontré que personne la profondeur de ce dogme, qui explique tant de choses, et il faut y regarder à deux fois avant de rejeter, comme une erreur de l’illuminisme, un fait avancé dans les livres saints et démontré par Pascal, si vainement attaqué, sur ces matières, par Voltaire et Condorcet. Les sciences exactes peuvent s’alarmer, avec plus de fondement, d’une doctrine qui doit ramener à l’idéalisme quelques-uns de leurs adeptes ; mais, quand les preuves sont là, il n’y a plus que de l’obstination dans ceux qui la nient. Sans doute, il est du devoir de celui qui entend parler des merveilles du magnétisme animal, associées à l’esprit religieux, de suspendre son jugement. Le genre humain appartient de droit aux jongleurs, et il n’y a que quelques-uns qui suivent les sages. Néanmoins, si l’on suppose un état primitif dans l’homme, et si l’on découvre, dans l’exercice de nos sens, des altérations, des modifications, qui semblent rappeler ce mode primitif, il est difficile de ne pas regarder comme un fait ce qu’on avait avancé comme une supposition.
D’autres voudraient qu’on leur expliquât comment l’homme a pu déchoir et communiquer sa nature [p.139] déchue à ses descendants ; mais, ce qui embarrasse le plus l’écrivain, ce n’est pas de se faire entendre des philosophes, c’est de se mettre à la portée de l’ignorance. Celle-ci ne veut de mystère en rien. Aperçoit-on une lueur nouvelle quelque part, ce n’est rien à ses yeux, si ce n’est la lumière tout entière. Elle ne conçoit pas qu’il y ait des lacunes dans l’intelligence humaine. Si vous ne lui dites pas comment sont faits les habitants du ciel, vous n’avez rien fait encore de vous dire élevé, par la pensée, jusqu’à la pluralité des mondes. Les théosophes sourient de ces objections, et trouvent dans les clameurs de l’ignorance elles-mêmes des preuves merveilleuses de la chute. L’homme, disent-ils, veut deviner d’un coup d’œil le mot de tous les mystères, parce qu’il se souvient confusément qu’il y a eu un temps où il n’y en avait pas pour lui.
Une question comme celle-là n’infirme en rien le témoignage de la théosophie. Pour avoir le droit de détruire un fait, parce qu’on y trouve des mystères qu’on ne conçoit pas, il faut présenter soi-même un fait qui remplace celui-ci, et que tout le monde puisse comprendre. Peut-être, néanmoins, si on ne trouvait plus de mystère, serait-ce une preuve que ce n’est qu’un système. Dieu, l’homme et l’univers ne s’expliquent pas comme le carré de l’hypothénuse [sic] et c'est presque toujours une preuve de vérité dans un ouvrage aussi bien que de bonne foi de la part de l’auteur, d’y trouver l’aveu de quelque chose d’inexplicable. Les vrais savants n'ont pas besoin de tant d’explications, pour savoir à quoi s’en tenir sur ces objections populaires : ils savent qu’il n’est permis à l’homme de donner une explication des choses que quand elles en ont une.
Deux sentiers différents se présentent actuellement aux yeux de ceux qui ont admis le point fondamental de la théosophie. Dans l’un, se trouvent les .partisans de Saint Martin ; dans l’autre, ceux de Swedenborg. Je ne parle pas des disciples de Jacob Bœhme, le plus profond peut-être des philosophes religieux. Les écrits de ce dernier, traduits en français par Saint-Martin, ont été développés dans tous les ouvrages de celui-ci ; et il n’y a rien qui les différencie assez pour que [p.140] les partisans de l’un et de l’autre forment secte à part. Mais, les Martinistes en appellent sans cesse à l’âme humaine pour expliquer les prodiges de la religion ; les disciples de Swedenborg s’en rapportent aux visions de leur prophète. Les faits de l’âme humaine, les réalités des visions, attestées et combattues tour à tour, conduisent naturellement l’esprit humain dans une région où l’erreur peut se mêler aisément à la vérité ; mais où celle-ci aussi peut être niée uniquement, parce qu’elle n’a pour elle ni l’appui de l’autorité ni le témoignage de la science.
« Je ne dirai jamais à un homme; s’écrie Saint Martin, croyez en moi, mais croyez en vous, croyez en la grandeur de votre âme. » Ce peu de mots renferme tout son système. Cette âme, à laquelle il veut que l’on en appelle, tombée par la chute dans la prison des sens, ne reconquiert, pour ainsi dire, son existence première qu’en sortant de ses sens. Loin de s’en rapporter à l’expérience, elle ne consulte uniquement que le sentiment intime, et c’est lui qui lui révèle tout à la fois la grandeur de son origine et l’humiliation de son existence présente. Il donne à l’homme une autre patrie, non pas seulement dans sa croyance, mais encore dans ses sensations habituelles. Il donne à nos espérances la mélancolie des regrets ; il place le bonheur dans une sphère où la pure image du bon et du beau n’est jamais souillée par les sens. Avec lui, la poésie est grave comme la philosophie, et la philosophie entraînante comme la poésie. Les vagues espérances d’une félicité imaginaire, ne sont point avec lui des illusions passagères, ce sont des mouvements naturels au cœur humain, toujours porté vers un bonheur céleste, que la réalité ne peut offrir, et dont la conscience nous flatte toujours.
Il est impossible de trouver une mine plus riche de sentiments moraux et de réflexions profondes. La religion des gnostiques des premiers siècles de l'église, quelques-unes des idées platoniques de Saint Clément d’Alexandrie, le quiétisme de Fénelon se retrouvent à la fois dans cette théorie transcendante qui donne tant d’enthousiasme au cœur, et tant de lumières à la raison. Dans ces dernières années mêmes, l’auteur [p.141] des Soirées de Saint-Pétersbourg [Joseph de Maistre] ne doit la vogue qu’il a obtenue, qu’à l’étude approfondie qu’il avait faite des écrits de Saint-Martin. Quoique cet auteur n'y soit pas nommé souvent, ceux qui le connaissent l’y retrouvent partout. Cette observation nous fait voir à quel point on exagère quand on croit trouver dans les ouvrages de Saint-Martin la critique la plus dangereuse du catholicisme. Ce qui a fourni tant de lumières aux auteurs les plus profonds qui ont écrit sur la religion existante, ne peut être bien dangereux pour elle. Peut-être n’est-il pas possible de concevoir la religion avec profondeur, sans y joindre un peu de cette exaltation, de cette onction touchante dont Fénelon nous présente de si nobles modèles dans ses Œuvres Spirituelles. Dans tous les cas, l’église gallicane aurait-elle bien le droit de s’effrayer des idées philosophiques renfermées dans les ouvrages de Saint-Martin, quand ces idées ont satisfait la raison d’un auteur ultramontain. On s’étonne des explications allégoriques contenues dans les œuvres diverses de Saint-Martin, sans faire attention qu’il y en a peut-être davantage dans la plupart des commentateurs de la bible avoués par l’église. Je sais que Saint-Martin attaque les différentes sectes chrétiennes pour les ramener au christianisme primitif ; je sais qu’il inculpe la religion romaine elle-même à la fin du Tableau Naturel ; mais, sans chercher à excuser Saint-Martin, si tous les reproches que cet auteur adresse à l’église ont été faits par l’abbé Fleury, doit-on exiger d’un laïque [sic] plus de discrétion qu’on n’en demande d’un auteur catholique ?
Je ne fais pas ici un système ; je me livre seulement à un examen. Qu’on ne voie donc pas, dans ces réflexions, le désir de ramener le lecteur à telle ou telle opinion, mais seulement l’intention de chercher avec lui la vérité dans des opinions qui paraissent opposées. Tout est tranché aux yeux du peuple ; tout se réunit par des nuances aux yeux du philosophe ; et celui-ci prend autant de soin pour tout concilier, que celui-là se donne de peine pour tout diviser. L’un sait que c’est par ce que les opinion ont de semblable, qu’elles se rapprochent de la vérité ; [p.141] l’autre apprend, par son expérience, que c’est par les différences qu’il y a entre les choses, qu’il les classe distinctement dans son esprit, et qu’il parvient à s’en faire une idée précise.
Quelques-uns ont blâmé Saint-Martin du vague dans lequel il conduit la pensée humaine ; et ils ont cru que s’en rapporter à l’autorité, était le moyen d’éviter de se perdre dans une sphère où on ne peut placer de jallons [sic]. Le respect pour l’autorité ne doit, en aucune manière, paralyser les efforts de l’esprit, quand ces efforts ne conduisent à rien de positif et de contraire à l’ordre établi. Si l’homme se perd dans les nuages en suivant cette voie, il ne fait de tort qu’à lui seul ; et invoquer l’autorité pour arrêter ces excursions, ce serait la prendre pour juge dans des matières sur lesquelles elle ne doit exercer aucune juridiction. Il y a un asile où se réfugie tout l’homme : c’est sa conscience ; et celle-ci, interrogée diversement par tous les hommes, rend des oracles différents â chacun en particulier. A l’un, il est donné de s’élever plus qu’à l’autre ; et il n’y a point, dans les régions de l’âme, de lit de Procuste pour niveler les intelligences. Dans le temps où l’inquisition forçait d’abjurer un culte public pour en adopter un autre, elle n’a pas osé s’immiscer dans des matières qu’elle abandonnait à la subtilité des théologiens. Dans un siècle plus éclairé, condamnerons-nous donc tel auteur parce qu’il sent son âme autrement que tel autre ; et la publicité que nous accordons aux opinions de Platon et de Pythagore, ne l’accorderons-nous plus aux écrits d'un philosophe moderne, qui a souvent suivi leurs traces ?
Mais c’est en vain qu’on invoque l’autorité, celle-ci se tait : si c’est l’autorité civile, sûre de sa force, elle permet tous les cultes ; si c'est l’autorité religieuse, elle est patiente comme Dieu même, parce qu’elle est assurée de vivre toujours. C’est donc la philosophie des écoles qui s’alarme d'une philosophie nouvelle. Il ne faut pas toujours prendre pour ennemi celui qu’on dit tel, mais celui qui se cache dans l’ombre. Ce vague, dont la philosophie scolastique se plaint, est-il ou n’est-il pas dans la nature humaine ? c’est ce qu’il s’agit d’examiner. Or malgré tous nos efforts [p.143] pour régulariser les perceptions de l’âme comme celles de l’esprit, il nous est impossible d’en venir à bout. On n’explique pas ce qu’on sent comme on démontre ce qu’on voit. Analysez un sentiment quelconque, vous n’en donnez qu’une opinion ; mais cette opinion, toute en dehors de lui, ne suffit pas pour le faire connaître: Pour le faire comprendre, il faut le communiquer. On tourne autour d’une opinion comme autour d’un objet pour l’examiner sous toutes ses faces ; mais, si on tourne de la même manière autour d’un sentiment, c’est qu’on en est dehors. De quelque manière qu’on s’y prenne, sitôt qu’on arrive à un sentiment moral, on arrive à la vie ; et la vie ne s’explique pas, elle se sent. On ne sait ni comment, ni pourquoi elle est : elle est cause et effet à elle-même ; par conséquent, on ne peut raisonner sur son essence. Les perceptions de l’âme sont, comme la religion et l’amour, des choses qui sont par elles-mêmes. Il est clair que, si on demande à un amant passionné une description exacte de ce qu’il éprouve, on ne trouvera, dans ses définitions, que du vague. Sentez comme moi, vous dira-t-il, et vous me comprendrez après. Partout où l’âme se manifeste, il y a donc du vague pour la raison. La raison, en effet, examine les choses, et le sentiment se laisse entraîner par elles. Examiner une chose n’est pas l’éprouver. Se plaindre qu’il y ait du vague dans les sentiments moraux, c’est avouer qu’on ne les sent pas. Tout ce qu’on sent ne s’explique bien que quand on parle à quelqu’un qui sent comme soi. C’est donc une preuve manifeste d’ignorance dans notre philosophie scolastique, que de vouloir des sentiments qui ne soient pas vagues aux yeux de celui qui ne les sent pas : ce serait vouloir l’impossible ; ce serait vouloir juger avec l’œil des saveurs, ou avec l’oreille des couleurs.
Cependant, si la philosophie de Saint-Martin est complètement à l’abri des objections vulgaires, il y en a quelques-unes qui semblent la combattre avec quelque avantage. Dans un examen impartial, si on détruit les critiques fausses, on ne doit pas taire celles qui paraissent fondées. Saint-Martin admet que l’homme étant déchu, a communiqué sa nature déchue aux objets mêmes qui l’entourent ici-bas. La haute destination de l'homme, [p.144] dit-il était, de puiser la vie divine à sa source, et de la communiquer aux êtres de la nature destinés tous à, l’attendre de lui : quelques passages des livres saints semblent confirmer cette prodigieuse puissance de l’homme, en parlant des merveilles que peut opérer la foi. Si la foi, qui n’est autre chose que la vie divine réveillée en nous, est capable de produire les effets surprenants que lui attribue Jésus-Christ dans différents .passages de l’évangile ; si cette foi, comparée à la plus petite molécule matérielle, peut changer de place les masses des montagnes, ce quelle pourrait aujourd'hui, elle le pouvait donc jadis, et quand elle a cesse d’opérer dans la nature, la nature qui lui était soumise est donc devenue comme étrangère et en quelque sorte comme hostile à son égard. Cette explication, qui suppose des vues si profondes du lien mystérieux qui unit .Dieu, l’homme et l’univers, n’est pas à l’abri de quelques objections. Tant de traces de sagesse et de prévoyance se manifestent encore dans la nature, qu’on ne peut croire qu’elle ait souffert de la faute de l’homme.
Un écrivain supérieur, l’auteur des Etudes de la Nature, [Bernardin de Saint-Pierre] a deviné en quelque sorte la chute de l’homme, quand il essaie de se rendre compte des contradictions qu’il observe en lui ; mais toute son éloquence est employée à nous présenter comme une chose admirable cette même nature que Saint-Martin voudrait en quelque sorte nous faire considérer comme une œuvre altérée. Je sais que Mme de Staël, dans le chapitre de l’Allemagne, intitulé de la Contemplation de la Nature, considère l’univers sous le même point de vue que l’auteur de l’Homme de désir ; mais, quelque profond que soit ce système, la conscience y répugne: L’admiration, si aisément provoquée par l’aspect des merveilles de la création, ne sait plus à quoi se prendre, si on lui retire ses aliments. On aime à trouver Dieu non seulement dans son cœur, mais encore dans cette nature qu’il a offerte comme un texte à nos méditations, dans ces lis, qu’il a si magnifiquement parés, dans ce soleil qui est son plus bel ouvrage, et devant lequel se sont prosternés tant de peuples trompés par de si grandes merveilles. Considérer la nature comme une [p.145] œuvre altérée, c’est, il faut en convenir, remplir de tristesse le cœur de l’homme ; c’est tarir l’admiration qui est son plus noble besoin, la poésie qui est son plus beau langage.
Les martinistes insistent et nous disent que nous ne sommes pas assez pénétrés de la chute de l’homme, si nous croyons que la nature est digne d’occuper les regards d’un être créé pour des aliments plus nobles que ceux que l’admiration trouve sur cette terre ; ils ajoutent que nous ne sommes pas assez persuadé de l’immense pouvoir de l’homme, si nous doutons de l’influence qu’il a dû également avoir sur l’univers. Enfin, ils prétendent que cette théorie est la seule qu’on puisse raisonnablement substituer à celle des optimistes : elle seule explique le mal partiel, sans admettre avec Pope, que ce mal contribue l’harmonie générale ; aucune doctrine ne présente plus de profondeur, aucune n’est susceptible, de plus grands développements. Ça n’est pas par un sourire qu’on détroit ce qui exige tous les efforts de l’esprit humain et il est une chose à remarquer ici, et qu’on peut objecter aux incrédules qui taxent de rêveries ascétiques ces idées philosophiques, parce qu’elles s’associent à la religion ; c’est que Voltaire, dans son poème du Désastre de Lisbonne, a précisément attaqué la philosophie de .Pope avec les armes que lui fournissait celle de Saint-Martin. La chute y est même rappelée dans ces beaux vers :
«Platon dit qu’autrefois l’homme avait eu des ailes ;
Un corps impénétrable aux atteintes mortelles :
De cet état brillant qu’il diffère aujourd’hui».
[Voltaire, Œuvres poétiques, « Poème sur le désastre de Lisbonne ou Examen de cet axiome, Tout est bien ». Vol. 1, p.970]
Malgré tant de lumières, malgré l’autorité des livres saints, celle de Platon et de Voltaire, on ne peut guère se détacher assez de ses idées habituelles pour considérer la nature, sous ce point de vue. Saint-Martin s’est visiblement trompé sur les sciences physiques, dans l’ouvrage célèbre des Erreurs et de la Vérité : on craint involontairement que les erreurs qu’il a commises dans ces sciences l’aient empêché d’étudier la nature sous ses vrais rapports. Après la lecture de ses ouvrages, et au milieu de lueurs sublimes et nouvelles, il reste des nuages dans l’esprit, et on ne sait si ces nuages tiennent à la nature corrompue de l’homme qui ne peut [p.146] plus envisager la vérité sans voile, ou s’il faut les attribuer au guide dont on avait suivi les pas.
Swedenborg suit une voie tout opposée. Il nous révèle ce qu’il a vu, et ce n’est plus seulement à un philosophe que nous devons ici ajouter foi, mais à un prophète. À ce nom, la conscience se trouble. On croit sans peine les prophéties de l’Ancien Testament, mais comment s’imaginer que, dans nos temps modernes, où il n’y a plus de miracles, comme on le répète si souvent, il y ait encore des prophètes ! On se rappelle les noms de tous ceux qui ont abusé de la crédulité humaine pour les appliquer à Swedenborg. Nous ne nous adressons pas ici au théologien : nous ne sommes pas assez habile pour suivre l’action de la grâce en tel temps et en tel lieu ; mais celui qui reconnaît en philosophe la réalité des visions de Sainte-Thérèse, peut-il s’empêcher de croire à la possibilité de celles de Swedenborg. Celui-ci eut-il vécu hier, et à notre porte, cela ne fait rien, ce nous semble, une fois le principe établi.
Nous n’essaierons pas de convaincre le sceptique de la vérité des visions : notre but n’est de convaincre personne. Nous nous proposons seulement un examen impartial. Si une société savante, en Angleterre, entend parler des visions des montagnards de l’Ecosse, et qu’elle députe quelques-uns de ses membres pour étudier et constater ce fait, une société savante, en France, serait-elle bien conséquente si , en entendant parler des vision de Swedenborg, elle se contentait de lever les épaules ? L’attention qu’on accorde aux voyants de l’Ecosse, ne peut-on, ne doit-on pas même l’accorder au voyant de la Suède ? Est-ce parce que celui-ci parle de religion, qu’on n’ose émettre un jugement sur ses écrits ? Mais souvenons-nous, encore une fois, que nous ne nous proposons point d’établir un nouveau dogme, mais seulement d’étudier le mouvement extraordinaire qui agite l’Europe aujourd’hui. Ce n’est pas en se cantonnant dans une salle de collège qu’on restera spectateur : comme un homme qui s’endort dans le désert, et qui, au réveil, ne trouve plus la caravane qui est partie sans lui, on courrait les risques, dans un isolement complet, de ne plus rien connaître au siècle qu’on se flatte de suivre. En suivant le mouvement général, [p.147] au contraire, on arrive à un point où l’on sait si on doit l’accélérer ou l’empêcher. Celui qui est victorieux d’une erreur, après en avoir pris connaissance de cause, inspire toujours plus de confiance que celui qui la rejette sans l’avoir étudiée, et uniquement peut-être parce qu’il a en peur de la regarder en face.
Si nous étudions donc les visions de Swedenborg sans être prévenus, nous y trouvons une matière digne de toutes nos réflexions. Ouvrons le livre de Cicéron sur la divination, nous y voyons les visions attestées et combattues par deux interlocuteurs, dont l’un exprime assez bien l’opinion propre de l’auteur. Nous trouvons également, dans un traité de Plutarque, intitulé : le Démon de Socrate, des preuves évidentes de l’opinion des anciens à cet égard. Si des témoignages de l’histoire nous passons à ceux de la science, nous apprenons avec la saine philosophie, que le temps et l’espace, n’étant pas les conditions nécessaires de notre entendement, peuvent, selon certaines modifications de notre être, devenir pour nous comme s’ils n'étaient pas. La médecine a constaté certains états de l’homme, dans lesquels les modes de perceptions ordinaires sont totalement changés. Les médecins spiritualistes ont accordé une grande attention à cette sensibilité exquise, à ces impressions totalement immatérielles qui se manifestent quelquefois chez les mourants. On n’a pas du tout expliqué ces phénomènes, quand on a rangé, dans les maladies délirantes, les causes qui y donnent lieu. Si le délire était constant et universel, ne serait-il pas aussi naturel que l’état raisonnable ? Quelle différence y a-t-il, dans les impressions de l’homme, à l’état de veille et à l’état de sommeil ; et, si l’une ou l’autre de ces deux manières de prévoir était seule durable, comment prouverait-on qu’elle n’est pas vraie ?
Ce n’est pas assez d’avoir vu une chose tous les jours pour se l’expliquer. Ce qui paraît rarement n’existe pas moins que ce qui nous affecte réellement ; et, si nous admettons la chute de l’homme, nous voyons, au contraire, que ce qui est de tous les jours est de notre nature fausse, et que ce qui arrive accidentellement peut appartenir à notre vraie nature, pour ainsi dire ressuscitée en nous. Les visions, les songes, seraient [p.148] donc, en quelque sorte, le mode primitif, caché jusqu’alors, qui se développerait. On comprendrait alors pourquoi tant de personnes y ont ajouté foi, pourquoi, depuis les extases des brames jusqu’aux visions des héros d’Ossian, tout s’explique par une même théorie ; pourquoi, enfin, dans l’ancien testament, l’esprit de Dieu se répandait sur les prophètes, à l’état de veille, après que le corps avait subi certaines altérations, ou, à l’état de sommeil, dans les songes. Je ne veux point donner une explication philosophique de ce qui rentre dans un ordre de choses surnaturelles ; mais, parmi les philosophes, il en est qui ne veulent voir dans l’écriture que le témoignage historique, et, dans ce livre, dont ils ont rejeté l’esprit, il est bon de faire voir qu’il y a encore des vérités cachées sous la lettre.
Nous avons des preuves d’une autre nature à apporter à l’appui des visions. Les phénomènes du somnambulisme naturel peuvent-ils s’expliquer, si l’on n'admet pas que l’homme alors est plus ou moins affranchi du temps et de l’espace. Qu’on étudie donc le somnambulisme naturel, qu’on étudie celui qui provient quelquefois à la suite du magnétisme animal, et on sera convaincu que ce n’est que par la méditation la plus profonde et qu’avec l’esprit le moins prévenu qu’on pourra porter un jugement assuré sur cette matière. Je sais qu’on court les risques d’inspirer peu de confiance en parlant à la fois de magnétisme et de visions ; mais, si on a toujours peur des mots, on n'arrivera jamais aux choses. Les mots proscrits sont d’un merveilleux secours pour l’ignorance et la légèreté ; mais ils ne sont rien pour la réflexion et la bonne foi. Un jour, peut-être, quelqu’un fera l’histoire sincère de son âme, dira les pressentiments qui se sont trouvés vrais, les songes qui se sont vérifiés, l’action que sa volonté a exercée sur ses semblables ; et, dans cette histoire de magnétisme et de visions, on sera peut-être tout surpris de retrouver l’histoire de l’homme. (Voyez Lycée Armoricain, tom. 2, page 463, article sur le magnétisme animal.)
Ce n'est pas assez, pour suivre Swedenborg, d’admettre les visions, il faut admettre aussi qu’ayant été doué d’une vue différente de celle des yeux du corps [p.149] il a vu les objets dans l’autre monde tels qu’ils sont réellement. Ici, nous touchons à un point difficile, et nous ne devons pas taire que Saint-Martin, en parlant des révélations de Swedenborg, n’y a pas cru. « Si Swedenborg, dit-il, ne donne pas les plans exacts de la région intellectuelle, il donne à penser qu’elle existe, et c’est beaucoup pour l’homme dans l’état où l’ont jeté les systèmes ». Sans doute, c’est beaucoup de croire que l’autre monde existe ; mais le mot d’existence comporte avec lui une manière d’être particulière ; et, s’il est possible que la vie extérieure soit la manifestation de la vie intérieure, nous devons retrouver dans celle-ci le principe secret qui modifie celle-là. Bien qu’il n’y ait ni espace, ni temps pour l’âme, et, par conséquent, rien de matériel, elle doit avoir la faculté de se représenter les choses comme si elles existaient réellement, puisque ces choses n’ont d’autre valeur que celle que leur donne pour nous le désir ou la volonté. On entre ici dans le système des correspondances sur lequel roule toute la théorie des ouvrages de Swedenborg. Saint-Martin l’a nié ; mais qu’y a-t-il là de surprenant, si ce n’est que Saint-Martin, fidèle à son système d’expliquer les hommes par l’homme, n’a pu croire un mode de sensations qu’il n’a pas éprouvées. Il n’a pas cru à Swedenborg par la même raison, peut-être, que tel homme, qui n’a pas senti son âme à la manière de Saint- Martin n’a pu croire non plus en lui.
Saint-Martin ne veut point de forme dans l’invisible, Swedenborg établit, et en cela il est d’accord avec Jacob Bœhme, que les formes ici-bas ne sont que la représentation de ce qui existe là haut, que le monde sensible n’est que la manifestation du monde invisible. Ce système si profond ne tend point à matérialiser Dieu et l’âme comme on pourrait le croire au premier abord : il tend à prouver que rien n’existe sur la terre qui ne soit en germe dans l’autre monde. L’artiste qui imagine un tableau ou une statue n’imagine pas à proprement parler : il copie seulement sa pensée ; et, ce qu’il voit dans sa pensée existe aussi réellement pour son âme, que les objets matériels existent pour ses sens.
Il est difficile de trouver quelque chose de plus [p.150] profond ; mais que cette profondeur, en quelque sorte inaccessible à l’esprit humain, ne nous fasse pas rejeter la théorie des correspondances. En effet, nous mous trouverions dans la nécessité de combattre aussi Saint Paul, qui nous dit que l’univers est un système de choses invisibles manifestées visiblement. Nous nous trouverions également dans l’obligation de critiquer ce que nous admirons le plus dans la doctrine philosophique et poétique à la fois de Platon, basée exactement sur les mêmes suppositions. Que dire alors d’un homme qui s’extasierait sur les idées de Platon, qui ferait de longs commentaires pour en prouver la sublimité, et qui rejetterait ces mêmes idées parce qu’au lieu d’être publiées sous le nom d’un philosophe ancien, approuvé de tout le monde, elles le sont sous le nom d’un philosophe moderne qui ne l’est encore de personne. La chose la plus difficile en philosophie et en littérature, c’est d’avouer tout seul la beauté d’une chose qui n’est pas encore remarquée de la foule. Quand on en est rendu là, et qu’on s’en rapporte à sa conscience, on n’est pas longtemps à reconnaître la vérité.
Il y a dans les écrits de Swedenborg des passages susceptibles d’objections de détails ; mais ce n’est pas là qu’il faut conduire l’esprit humain. Le livre le plus parfait qui existe sur la terre, l’évangile, a bien aussi lui des nuages qu’il n’est pas donné peut-être à l’esprit de l’homme de dissiper complètement. Je ne ferai donc qu’une objection à la doctrine de Swedenborg, parce que cette objection tient à toute sa théorie. Celui qui étudie les ressorts qui poussent l’homme dans la vie, découvre que c’est toujours par l’ignorance que l’homme trouve du charme à l’étude. Quand il sait une chose par cœur, il n’y pense plus. Les choses mystérieuses ont toujours de l’attrait pour lui, parce qu’il ne peut se les expliquer. Qu’on lui dise le mot d’une énigme, l’énigme est oubliée. Si l’espérance, le doute ne nous agitaient pas quelquefois, il serait possible qu’à force de croire dans l’immortalité de notre âme nous ne la sentissions plus. Si Dieu n’était pas un mystère inaccessible, nous n’y reviendrions pas sans cesse. La vie future nous obsède, parce qu’elle n’est jamais pour nous qu’en espérance. Nous ne pensons, avec [p.151] tant de délices, à la patrie céleste, que parce que nous n’en avons pas les plans exacts. Si ces plans nous étaient une fois donnés, si tous les mystères étaient une fois éclaircis de manière à ce qu’il n’y eût plus moyen de douter, aucun ressort ne nous lancerait dans l’avenir, et l’instant qui découvrirait tous les mystères serait, comme l’instant de la mort, celui qui mettrait fin à l’existence terrestre.
Si les disciples de Swedenborg admettent sincèrement qu’il établit un nouveau règne spirituel, alors toutes les objections prises des conditions de notre existence actuelle sont détruites. L’éternité commence pour eux sur la terre, et, avec elle, tous les secrets nécessairement sont dévoilés. Mais le genre humain n’en est pas rendu à cette régénération ; et, en attendant que les communions chrétiennes décident si la Nouvelle Jérusalem, prédite par Saint-Jean dans l’Apocalypse, est bien réellement la nouvelle église annoncée par Swedenborg, c’est beaucoup d’avoir attiré l’attention des philosophes sur des matières qui excitent l’intérêt général des plus profonds métaphysiciens de l’Europe. Nous suivons avec attention les progrès faits depuis peu dans les sciences mécaniques, et nous paraissons en quelque sorte étrangers à ce mouvement intellectuel, bien plus important, qui se manifeste actuellement de toutes parts. Des sociétés, des congrégations religieuses se forment chez tous les peuples. Les catholiques rivalisent avec les protestants pour la publication des livres saints. Des sociétés spiritualistes, exégétiques dans le nord, des associations pour la conversion des Juifs en Angleterre, d’autres qui placent en France les moyens de prospérité publique sous la sauvegarde de la morale chrétienne, s’efforcent toutes de répandre cet esprit religieux mis en oubli dans le dernier siècle, et qu’on avait essayé de rappeler au commencement de celui-ci par des tableaux poétiques qui font sourire maintenant. Il semble voir l’accomplissement de cette prophétie de Joël : « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards seront instruits par des songes et vos jeunes gens auront des visions. » Il est possible que tout ceci paraisse exagéré, et qu’aux yeux de [p.152] certains hommes la Bible elle-même soit de l’illuminisme : toujours est-il vrai que toute critique qui ne prouve pas ce qu’elle a à substituer à ce qu’elle détruit est vaine. Ce n’est pas assez de dire à un homme, du haut de la chaire doctorale, qu’il se perd ; il faut avoir la charité de lui montrer la voie, de raisonner avec lui, et de le mettre à même d’apprécier ce qu’il y a de bon ou de nuisible dans le mouvement extérieur auquel il se laisse entraîner. Ce n’est pas en refusant d’entendre ou en refusant de voir qu’on échappe au danger qui nous menace, ou qu’on profite de l’instruction qui nous attend.
Edouard Richer (1792-1834)



