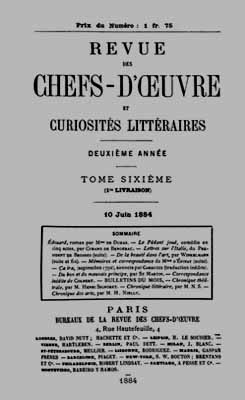 1884 - L.-Cl. de Saint-Martin - Du bon et du mauvais principe
1884 - L.-Cl. de Saint-Martin - Du bon et du mauvais principe
Revue des chefs-d’œuvre et des curiosités littéraires
Deuxième année
Tome sixième
(1ère livraison)
10 juin 1884
Paris
Bureaux de la Revue des chefs d'œuvre
4, rue Hautefeuille
1884
L.-Cl. de Saint-Martin - Du bon et du mauvais principe
Cet article présente :
- Une courte Notice sur Saint-Martin
- Un premier extrait du livre Des Erreurs et de la Vérité, pages 155-159
- Un deuxième extrait, à la suite, du même livre, pages 323-328
Notice sur Saint-Martin (1) [page 154]
Saint-Martin (Louis-Claude de), dit le « Philosophe Inconnu », naquit à Amboise, en 1743.
À l'âge de vingt-deux ans, ayant terminé ses études de droit, on le destinait au barreau. Il entra, grâce à la protection du duc de Choiseul, comme officier au régiment de Foix, alors en garnison à Bordeaux. Ce fut là qu'il connut Martinez Pasqualis, dont il fut le disciple.
Après avoir suivi son régiment à Lorient et à Longwy, Saint-Martin donna sa démission en 1771, revint à Paris et, deux ans après, se rendit à Lyon, où Martinez Pasqualis avait fondé un petit cénacle [voir l’encadré]. C'est dans cette ville qu'il publia son premier ouvrage : Des Erreurs et de la Vérité, « manifeste contre le matérialisme et le parti pris de déraciner dans les âmes toute croyance religieuse... et où il n'est pas difficile de reconnaître la théorie mystique de l'Émanation et du Verbe, sur laquelle reposait l'enseignement de Martinez Pasqualis ».
|
Saint-Martin donna sa démission d’officier au régiment de Foix Infanterie en 1771 pour devenir secrétaire de Martines de Pasqualis. Ce dernier partit à l’île de Saint Domingue en 1772, à l’époque île française, pour y recevoir un héritage. Il mourut dans cette île en 1774. Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824) était également un disciple de Martines de Pasqualis. Il avait créé un temple d'élus coën à Lyon où il hébergea chez lui pendant quelque temps son ami, Louis-Claude de Saint-Martin. « C'est à Lyon que j'ai écrit le livre Des erreurs et de la vérité. Je l'ai écrit par désœuvrement et par colère contre les philosophes. Je fus indigné de lire dans Boulanger que les religions n'avaient pris naissance que dans la frayeur occasionnée par les catastrophes de la nature. » Mon Portrait, n°168. |
Après un court séjour en Angleterre et, l'année suivante, en Italie, Saint-Martin, de retour en France, fut proposé comme candidat à l'École normale, en qualité d'élève professeur. Il accepta. Sa discussion avec Garat, professeur d'analyse d'entendement humain aux écoles normales, est demeurée célèbre. En 1795, l'École ferma.
Saint-Martin mourut à Aunay en 1803.
Ses ouvrages sont, outre « Des Erreurs et de la Vérité»: « Le Crocodile », poème allégorique (1797). « Le tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l'homme et l'univers » (1782). « L'homme de désir. L'Ecce homo et le Nouvel homme. L'aurore naissante. - Quarante questions sur l'âme. De la Triple vie de l'Homme.- Des nombres. » - Une traduction des écrits de Jacob Bœhm, que Charlotte Bœklin et Rodolphe Salzmann lui firent connaître à Strasbourg.
(1) Lire sur ce philosophe : La Philosophie mystique en France, à la fin du XVIIIe siècle (Saint-Martin et son maître Martinez Pasqualis), par A. FRANCK.
Du bon et du mauvais principe, par Saint-Martin
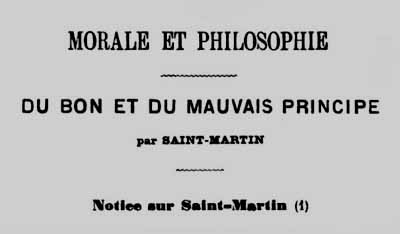 Pages 155-159
Pages 155-159
[Ce texte est extrait du livre de Saint-Martin, Des Erreurs et de la Vérité, pages 10 et suiv.]
Disons donc que le bien est pour chaque être l'accomplissement de sa propre loi, et le mal, ce qui s'y oppose. Disons que chacun des êtres n'ayant qu'une seule loi, comme tenant tous à une loi première qui est une, le bien, ou l'accomplissement de cette loi, doit être unique aussi, c'est-à-dire, être seul et exclusivement vrai, quoiqu'il embrasse l'infinité des êtres.
Au contraire, le mal ne peut avoir aucune convenance avec cette loi des êtres, puisqu'il la combat ; dès lors il ne peut plus être compris dans l'unité, puisqu'il tend à la dégrader, en voulant former une autre unité. En un mot, il est faux, puisqu'il ne peut pas exister seul ; puisque malgré lui la loi des êtres existe en même temps que lui, et puisqu'il ne peut jamais la détruire, lors même qu'il en gêne ou qu'il en dérange l'accomplissement.
J'ai dit, qu'en s'approchant du bon principe, l'homme était, en effet, comblé de délices, et par conséquent, au-dessus de tous les maux ; c'est qu'alors il est entier à sa jouissance, qu'il ne peut avoir ni le sentiment, ni l'idée d'aucun autre être ; et qu'ainsi, rien de ce qui vient du mauvais principe ne peut se mêler à sa joie, ce qui prouve que l'homme est là dans son élément, et que sa loi d'unité s'accomplit.
Mais s'il cherche un autre appui que celui de cette loi qui lui est propre, sa joie est d'abord inquiète et timide ; il ne jouit qu'en se reprochant sa jouissance ; et se partageant un moment entre le mal qui l'entraîne et le bien qu'il a quitté, il éprouve sensiblement l'effet de deux lois opposées, et il apprend par le mal-être qui en résulte, qu'il n'y a point alors d'unité pour lui, parce qu'il s'est écarté de sa loi. Bientôt, il est vrai, cette jouissance incertaine se fortifie, et même le domine entièrement ; mais loin d'en être plus une et plus vraie, elle produit dans les facultés de l'homme un désordre d'autant plus déplorable, que l'action du mal étant stérile et bornée, les transports de celui qui s'y livre, ne font que l'amener plus promptement à un vide et à un abattement inévitable. [page 156]
Voici donc la différence infinie qui se trouve entre les deux principes ; le bien tient de lui-même toute sa puissance et toute sa valeur ; le mal n'est rien, quand le bien règne. Le bien fait disparaître, par sa présence, jusqu'à l'idée et aux moindres traces du mal ; le mal, dans ses plus grands succès, est toujours combattu et importuné par la présence du bien. Le mal n'a par lui-même aucune force, ni aucuns pouvoirs ; le bien en a d'universels qui sont indépendants, et qui s'étendent jusque sur le mal même.
Ainsi, il est évident qu'on ne peut admettre aucune égalité de puissance, ni d'ancienneté entre ces deux principes : car un être ne peut en égaler un autre en puissance, qu'il ne l'égale aussi en ancienneté ; puisque ce serait toujours une marque de faiblesse et d'infériorité dans l'un des deux êtres de n'avoir pu exister aussitôt que l'autre. Or, si antérieurement, et dans tous les temps, le bien avait coexisté avec le mal, ils n'auraient jamais pu acquérir respectivement aucune supériorité, puisque, dans cette supposition, le mauvais principe étant indépendant du bon, et ayant par conséquent le même pouvoir, ou ils n'auraient eu aucune action l'un sur l'autre, ou ils se seraient mutuellement balancés et contenus ; ainsi, de cette égalité de puissance, il serait résulté une inaction et une stérilité absolue dans ces deux êtres, parce que leurs forces réciproques se trouvant sans cesse égales et opposées, il leur eût été impossible à l'un et à l'autre de rien produire.
On ne dira pas que pour faire cesser cette inaction, un principe, supérieur à tous les deux, aura augmenté les forces du bon principe, comme étant plus analogue à sa nature ; car alors ce principe supérieur serait lui-même le principe bon dont nous parlons. On sera donc forcé, par une évidence frappante, de reconnaître dans le principe bon, une supériorité sans mesure, une unité, une indivisibilité, avec lesquelles il a existé nécessairement avant tout ; ce qui suffit pour démontrer pleinement que le mal ne peut être venu qu'après le bien.
Fixer ainsi l'infériorité du mauvais principe, et faire voir son opposition au principe bon, c'est prouver qu'il n'y a jamais eu, et qu'il n'y aura jamais entre eux la moindre alliance, ni la [page 157] moindre affinité ; car pourrait-il entrer dans la pensée, que le mal eût jamais été compris dans l'essence et dans les facultés du bien, auquel il est si diamétralement opposé ?
Mais cette conclusion nous conduit nécessairement à une autre tout aussi importante, qui est de nous faire sentir que ce bien, quelque puissant qu'il soit, ne peut coopérer en rien à la naissance et aux effets du mal ; puisqu'il faudrait, ou qu'avant l'origine du mal, il y eût eu dans le principe bon quelque germe, ou faculté mauvaise ; et avancer cette opinion, ce serait renouveler la confusion que les jugements et les imprudences des hommes ont répandue sur ces matières ; ou il faudrait que, depuis la naissance du mal, le bien eût pu avoir avec lui quelque commerce et quelque rapport, ce qui est impossible et contradictoire. Quelle est donc l'inconséquence de ceux qui, craignant de borner les facultés du bon principe, s'obstinent à enseigner une doctrine si contraire à sa nature, que de lui attribuer généralement tout ce qui existe, même le mal et le désordre.
Il n'en faut pas davantage pour faire sentir la distance incommensurable qui se trouve entre les deux principes, et pour connaître celui auquel nous devons donner notre confiance. Puisque les idées que je viens d'exposer ne font que rappeler les hommes à des sentiments naturels, et à une science qui doit se trouver au fond de leur cœur, c'est, en même temps, faire naître en eux l'espérance de découvrir de nouvelles lumières sur l'objet qui nous occupe ; car l'homme étant le miroir de la vérité, il en doit voir réfléchir dans lui-même tous les rayons ; et en effet, si nous n'avions rien de plus à attendre que ce que nous promettent les systèmes des hommes, je n'aurais pas pris la plume pour les combattre.
Mais reconnaître l'existence de ce mauvais principe, considérer les effets de son pouvoir dans l'Univers et dans l'homme, ainsi que les fausses conséquences que les observateurs en ont tirées, ce n'est pas dévoiler son origine. Le mal existe, nous voyons tout autour de nous ses traces hideuses, quels que soient les efforts qu'on a faits pour nier sa difformité. Or, si ce mal ne vient point du bon principe, comment donc a-t-il pu naître ?
Certes, c'est bien là pour l'homme la question la plus importante, [page 158] et celle sur laquelle je désirerais de convaincre tous mes lecteurs. Mais je ne me suis point abusé sur le succès, et toutes certaines que soient les vérités que je vais annoncer, je ne serai point surpris de les voir rejetées ou mal entendues par le plus grand nombre.
Quand l'homme, s'étant élevé vers le bien, contracte l'habitude de s'y tenir invariablement attaché, il n'a pas même l'idée du mal ; c'est une vérité que nous avons établie, et que nul être intelligent ne pourra raisonnablement contester. S'il avait constamment le courage et la volonté de ne pas descendre de cette élévation pour laquelle il est né, le mal ne serait donc jamais rien pour lui ; et, en effet, il n'en ressent les dangereuses influences, qu'à proportion qu'il s'éloigne du bon principe ; en sorte qu'on doit conclure de cette punition, qu'il fait alors une action libre ; car s'il est impossible qu'un être non libre s'écarte par lui-même de la loi qui lui est imposée, il est aussi impossible qu'il se rende coupable et qu'il soit puni ; ce que nous ferons concevoir dans la suite, en parlant des souffrances des bêtes.
Enfin, la puissance et toutes les vertus, formant l'essence du bon principe, il est évident que la sagesse et la justice en sont la règle et la loi, et dès lors c'est reconnaître que si l'homme souffre, il doit avoir eu le pouvoir de ne pas souffrir.
Oui, si le principe bon est essentiellement juste et puissant, nos peines sont une preuve évidente de nos torts, et, par conséquent, de notre liberté ; lors donc que nous voyons l'homme soumis à l'action du mal, nous pouvons assurer que c'est librement qu'il s'y est exposé, et qu'il ne tenait qu'à lui de s'en défendre et de s'en tenir éloigné ; ainsi ne cherchons pas d'autre cause à ses malheurs que celle de s'être écarté volontairement du bon principe, avec lequel il aurait sans cesse goûté la paix et le bonheur.
Appliquons le même raisonnement au mauvais principe ; s'il s'oppose évidemment à l'accomplissement de la loi d'unité des êtres, soit dans le sensible, soit dans l'intellectuel, il faut qu'il soit lui-même dans une situation désordonnée. S'il n'entraîne après lui que l'amertume et la confusion, il en est sans doute, à [page 159] la fois, et l'objet et l'instrument ; ce qui nous fait dire qu'il doit être livré sans relâche au tourment et à l'horreur qu'il répand autour de lui.
Or, il ne souffre que parce qu'il est éloigné du bon principe ; car ce n'est que dès l'instant qu'ils en sont séparés, que les êtres sont malheureux. Les souffrances du mauvais principe ne peuvent donc être qu'une punition, parce que la justice, étant universelle, doit agir sur lui, comme elle agit sur l'homme ; mais, s'il subit une punition, c'est donc librement qu'il s'est écarté de la loi qui devait perpétuer son bonheur ; c'est donc volontairement qu'il s'est rendu mauvais. C'est ce qui nous engage à dire, que si l'auteur du mal eût fait un usage légitime de sa liberté, il ne se serait jamais séparé du bon principe, et le mal serait encore à naître ; par la même raison, si aujourd'hui il pouvait employer sa volonté à son avantage, et la diriger vers le bon principe, il cesserait d'être mauvais, et le mal n'existerait plus.
Ce ne sera jamais que par l'enchaînement simple et naturel de toutes ces observations, que l'homme pourra parvenir à fixer ses idées sur l'origine du mal ; car, si c'est en laissant dégénérer sa volonté, que l'être intelligent et libre acquiert la connaissance et le sentiment du mal, on doit être assuré que le mal n'a pas d'autre principe, ni d'autre existence que la volonté même de cet être libre ; que c'est par cette volonté seule, que le principe, devenu mauvais, a donné originairement la naissance au mal, et qu'il y persévère encore aujourd'hui : en un mot, que c'est par cette même volonté que l'homme a acquis et acquiert tous les jours cette science funeste du mal, par laquelle il s'enfonce dans les ténèbres, tandis qu'il n'était né que pour le bien et pour la lumière.
SAINT-MARTIN.
(À suivre.)
![]() L.-Cl. de Saint-Martin - Du bon et du mauvais principe
L.-Cl. de Saint-Martin - Du bon et du mauvais principe
Morale et philosophie - Du bon et du mauvais principe, par Saint-Martin (Suite et fin)
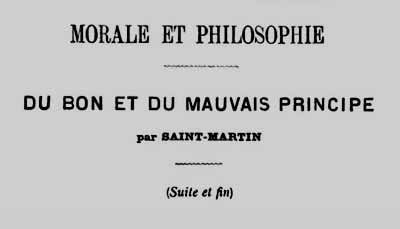 Pages 323-328.
Pages 323-328.
[Extrait du livre de Saint-Martin, Des Erreurs et de la Vérité, pages 18 et suiv.]
Si on a agité en vain tant de questions sur la liberté, et qu'on les ait si souvent terminées par décider vaguement que l'homme n'en est pas susceptible, c'est qu'on n'a pas observé la dépendance et les rapports de cette faculté de l'homme avec sa volonté, et qu'on n'a pas su voir que cette volonté était le seul agent qui pût conserver ou détruire la liberté, c'est-à-dire, qu'on cherche dans la liberté une faculté stable, invariable, qui se manifeste en nous universellement, sans cesse, et de la même manière ; qui ne puisse ni diminuer ni croître, et que nous retrouvions toujours à nos ordres, quel que soit l'usage que nous en ayions fait. Mais comment concevoir une faculté qui tienne à l'homme, et qui soit cependant indépendante de sa volonté, tandis que cette volonté constitue son essence fondamentale ? Et ne conviendra-t-on pas qu'il faut nécessairement, ou que la liberté n'appartienne pas à l'homme, ou qu'il puisse influer sur elle, par l'usage bon ou mauvais qu'il en fait, en réglant plus ou moins bien sa volonté ?
Et en effet, lorsque les observateurs veulent étudier la liberté, ils nous font bien voir qu'elle doit appartenir à l'homme, puisque c'est toujours dans l'homme, qu'ils sont obligés d'en suivre les traces et les caractères mais s'ils continuent à la considérer, sans avoir égard à sa volonté, n'est-ce pas exactement comme s'ils voulaient lui trouver une faculté qui fût en lui, mais qui lui fût étrangère; qui fût à lui, mais sur laquelle il n'eût aucune [page 324] influence, ni aucun pouvoir ? Est-il rien de plus absurde et de plus contradictoire ? Est-il étonnant qu'on ne trouve rien en observant de cette manière, et sera-ce jamais d'après des recherches aussi peu solides, qu'on pourra prononcer sur notre propre nature ?
Si la jouissance de la liberté dépendait en rien de l'usage de la volonté ; si l'homme ne pouvait jamais l'altérer par ses faiblesses et ses habitudes déréglées, je conviens qu'alors tous les actes en seraient fixes et uniformes, et qu'ainsi il n'y aurait point, comme il n'y aurait jamais eu, de liberté pour lui.
Mais si cette faculté ne peut être telle que les observateurs la conçoivent et voudraient l'exiger, si sa force peut varier à tout instant, si elle peut devenir nulle par l'inaction, de même que par un service soutenu et par une pratique trop constante des mêmes actes, alors on ne peut nier qu'elle ne soit à nous et dans nous, et que nous n'ayons, par conséquent, le pouvoir de la fortifier ou de l'affaiblir ; et cela, par les seuls droits de notre être et par le privilège de notre volonté, c'est-à-dire, selon l'emploi bon ou mauvais que nous faisons volontairement des lois qui nous sont imposées par notre nature.
Une autre erreur qui a fait proscrire la liberté par ces observateurs, c'est qu'ils auraient voulu se la prouver par l'action même qui en provient ; en sorte qu'il faudrait, pour les satisfaire, qu'un acte pût, à la fois, être et n'être pas, ce qui étant évidemment impossible, ils en ont conclu que tout ce qui arrive a dû nécessairement arriver, et par conséquent, qu'il n'y avait point de liberté. Mais ils auraient dû remarquer l'acte et la volonté qui l'a conçu, ne pouvant qu'être conformes et non pas opposés ; qu'une puissance qui a produit son acte ne peut en arrêter l'effet ; qu'enfin, la liberté, prise même dans l'acception vulgaire, ne consiste pas à pouvoir faire le pour et le contre à la fois, mais à pouvoir faire l'un et l'autre alternativement ; or, quand ce ne serait que dans ce sens, l'homme prouverait assez ce qu'on appelle communément sa liberté, puisqu'il fait visiblement le pour et le contre dans ses différentes actions successives, et qu'il est le seul être de la nature qui puisse ne pas marcher toujours par la même route. [page 325]
Mais ce serait s'égarer étrangement que de ne pas concevoir une autre idée de la liberté ; car cette contradiction dans les actions d'un être, prouve, il est vrai, qu'il y a du dérangement et de la confusion dans ses facultés, mais ne prouve point du tout qu'il soit libre, puisqu'il reste toujours à savoir, s'il se livre librement ou non, tant au mal qu'au bien ; et c'est en partie pour avoir mal défini la liberté, que ce point est encore couvert des plus épaisses ténèbres pour le commun des hommes.
Je dirai donc que la véritable faculté d'un être libre, est de pouvoir par lui-même se maintenir dans la loi qui est prescrite, et de conserver sa force et son indépendance, en résistant volontairement aux obstacles et aux objets qui tendent à l'empêcher d'agir conformément à cette loi ; ce qui entraîne nécessairement la faculté d'y succomber car il ne faut pour cela que cesser de vouloir s'y opposer. Alors on doit juger si, dans l'obscurité où nous sommes, nous pouvons nous flatter de toujours parvenir au but avec la même facilité ; si nous ne sentons pas, au contraire, que la moindre de nos négligences augmente infiniment cette tâche, en épaississant le voile qui nous couvre : ensuite, portant la vue pour un moment sur l'homme en général, nous découvrirons que si l'homme peut dégrader et affaiblir sa liberté à tous les instants, de même l'espèce humaine est moins libre actuellement qu'elle ne l'était dans ses premiers jours, et à plus forte raison qu'elle ne l'était avant de naître.
Ce n'est donc plus dans l'état actuel de l'homme, ni dans ses actes journaliers, que nous devons prendre des lumières pour décider de sa vraie liberté, puisque rien n'est plus rare que d'en voir aujourd'hui des effets purs et entièrement indépendants des causes qui lui sont étrangères ; mais ce serait être plus qu'insensé d'en conclure qu'elle ne fut jamais au nombre de nos droits. Les chaînes d'un esclave prouvent, je le sais, qu'il ne peut plus agir selon toute l'étendue de ses forces naturelles, mais non pas qu'il ne l'a jamais pu ; au contraire, elles annoncent qu'il le pourrait encore s'il n'eût pas mérité d'être dans la servitude ; car, s'il ne lui était pas possible de jamais recouvrer l'usage de ses forces, sa chaîne ne serait pour lui, ni une punition, ni une honte. [page 326]
En même temps, de ce que l'homme est si difficilement, si obscurément et si rarement libre aujourd'hui, on ne serait pas plus raisonnable d'en inférer que ses actions soient indifférentes, et qu'il ne soit pas obligé de remplir la mesure de bien qui lui est imposée même dans cet état de servitude ; car la privation de sa liberté consiste en effet à ne pouvoir, par ses propres forces, obtenir la jouissance entière des avantages renfermés dans le bien pour lequel il a été fait, mais non à pouvoir s'approcher du mal, sans se rendre encore plus coupable ; puisque l'on verra que son corps matériel ne lui a été prêté que pour faire continuellement la comparaison du faux avec le vrai, et que jamais l'insensibilité où le conduit chaque jour sa négligence sur ce point, ne pourra détruire son essence ; ainsi, il suffit qu'il se soit éloigné une fois de la lumière à laquelle il devait s'attacher, pour rendre la suite de ses écarts inexcusable, et pour qu'il n'ait aucun droit de murmurer de ses souffrances.
Mais, faut-il le dire ? si les observateurs ont tant balbutié sur la liberté de l'homme, c'est qu'ils n'ont pas encore pris la première notion de ce que c'est sa volonté ; rien ne le prouve mieux que leurs recherches continuelles pour savoir comment elle agit ne pouvant soupçonner que son principe dût être en elle-même, ils l'ont cherché dans des causes étrangères, et voyant, en effet, qu'elle était ici-bas si souvent entraînée par des motifs apparents ou réels, ils ont conclu qu'elle n'agissait point par elle-même, et qu'elle avait toujours besoin d'une raison pour se déterminer. Mais si cela était, pourrions-nous dire avoir une volonté, puisque, loin d'être à nous, elle serait toujours subordonnée aux différentes causes qui agissent sans cesse sur elles ? N'est-ce pas alors tourner dans le même cercle, et renouveler la même erreur que nous avons dissipée relativement à la liberté ? En un mot, dire qu'il n'y a point de volonté sans motifs, c'est dire que la liberté n'est plus une faculté qui dépende de nous, et que nous n'avons jamais été maîtres de la conserver. Or, raisonner ainsi, c'est ignorer ce que c'est que la volonté qui annonce précisément un être agissant par lui-même, et sans le secours d'aucun autre être.
Par conséquent, cette multitude d'objets et de motifs étrangers [page 327] qui nous séduisent et nous déterminent si souvent aujourd'hui, ne prouve pas que nous ne puissions vouloir sans eux, et que nous ne soyons pas susceptibles de liberté, mais seulement qu'ils peuvent prendre empire sur notre volonté, et l'entraîner quand nous ne nous y opposons pas. Car, avec de la bonne foi, on conviendra que ses causes extérieures nous gênent et nous tyrannisent ; or, comment pourrions-nous le sentir et l'apercevoir, si nous n'étions pas essentiellement faits pour agir par nous-mêmes, et non par l'attrait de ces illusions ?
Quant à la manière dont la volonté peut se déterminer indépendamment des motifs et des objets qui nous sont étrangers, autant cette vérité paraîtra certaine à quiconque voudra oublier tout ce qui l'entoure, et regarder en soi, autant l'explication en est-elle un abîme impénétrable pour l'homme et pour quelque être que ce soit, puisqu'il faudrait, pour la donner, corporiser l'incorporel ; ce serait de toutes les recherches la plus nuisible à l'homme, et la plus propre à le plonger dans l'ignorance et dans l'abrutissement, parce qu'elle porte à faux, et qu'elle use en vain toutes les facultés qui sont en lui. Aussi, le peu de succès qu'ont eu les observateurs sur cette matière, n'a servi qu'à jeter dans le découragement ceux qui ont eu l'imprudence de les suivre, et qui ont voulu chercher auprès d'eux des lumières que leur fausse marche avait éloignées. Le sage s'occupe à chercher la cause des choses qui en ont une ; mais il est trop prudent et trop éclairé pour en chercher à celles qui n'en ont point ; et la volonté naturelle à l'homme est de ce nombre; car elle est cause elle-même.
Par cette raison, dès qu'il lui reste toujours une volonté, et qu'elle ne peut se corrompre que par le mauvais usage qu'il en fait, je continuerai à le regarder comme libre, quoiqu'étant presque toujours asservi.
Ce n'est point pour l'homme aveugle, frivole et sans désir, que j'expose de pareilles idées ; comme il n'a que ses yeux pour guides, il juge les choses sur ce qu'elles sont, et non sur ce qu'elles ont été ; ce serait donc inutilement que je lui présenterais des vérités de cette nature, puisqu'en les comparant avec ses idées ténébreuses, et avec les jugements de ses sens, il n'y [page 328] trouverait que des contradictions choquantes, qui lui feraient nier également ce qu'il aurait déjà conçu, et ce qu'on lui ferait concevoir de nouveau, pour se livrer ensuite au désordre de ses affections, et suivre la loi morte et obscure de l'animal sans intelligence.
Mais l'homme, qui se sera assez estimé pour chercher à se connaître, qui aura veillé sur ses habitudes, et qui ayant déjà donné ses soins à écarter le voile épais qui l'enveloppe, pourrait tirer quelques fruits de ces réflexions ; celui-là, dis-je, peut ouvrir ce livre ; je le lui confie de bon cœur, dans la vue de fortifier l'amour qu'il a déjà pour le bien.
Cependant, quels que soient ceux entre les mains de qui cet écrit pourra tomber, je les exhorte à ne pas chercher l'origine du mal ailleurs que dans cette source que j'ai indiquée, c'est-à-dire, dans la dépravation de la volonté de l'être ou principe devenu mauvais. Je ne craindrai point d'affirmer qu'en vain ils feraient des efforts pour trouver au mal une autre cause ; car, s'il avait une base plus fixe et plus solide, il serait éternel et invincible, comme le bien ; si cet être dégradé pouvait produire autre chose que des actes de volonté, s'il pouvait former des êtres réels et existants, il aurait la même puissance que le principe bon ; c'est donc le néant de ses œuvres qui nous fait sentir sa faiblesse, et qui interdit absolument toute comparaison entre lui et le bon principe dont il s'est séparé.
Ce serait être encore bien plus insensé, de chercher l'origine du bien ailleurs que dans le bien même ; car après tout ce qu'on vient de voir, si des êtres dégradés, comme le mauvais principe et l'homme, ont encore le droit d'être la propre cause de leurs actions, comment pourrait-on refuser cette propriété au bien, qui, comme tel, est la source infinie de toutes propriétés, le germe même et l'agent essentiel de tout ce qui est parfait ? Il faudrait donc n'avoir pas le sens juste, pour aller rechercher la cause et l'origine du bien hors de lui, si elles ne sont et ne peuvent être que dans lui.
SAINT-MARTIN
![]() 1884 - L.-Cl. de Saint-Martin - Du bon et du mauvais principe (Suite et fin)
1884 - L.-Cl. de Saint-Martin - Du bon et du mauvais principe (Suite et fin)



