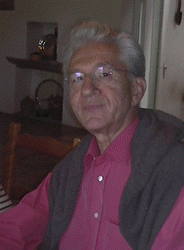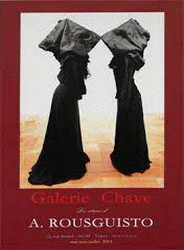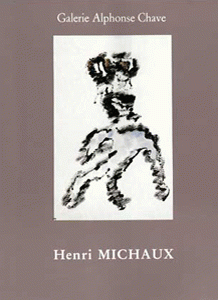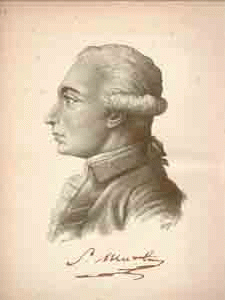Chapitre : L’éclectisme - Extraits, pages 236-241
Pour apprécier l'éclectisme, il est très important de distinguer ces deux choses : la valeur de pensées rencontrées dans les écrits d'un philosophe, et la valeur de son système. Il ne faut jamais conclure de la première de ces appréciations à la seconde. Cela dit, abordons l'examen de la doctrine de Victor Cousin.
Il reconnaissait quatre grands systèmes de philosophie : le sensualisme, l'idéalisme, le scepticisme et le mysticisme. Il affirmait, au nom de l'histoire, que l’esprit humain n'en avait pas produit d'autres, et, au nom de la psychologie, qu'il ne pouvait pas en produire d'autres (1). Ces [page 237] quatre systèmes étaient parvenus à leur plein développement et s'étaient épuisés dans les luttes qu'ils avaient soutenues les uns contre les autres. M. Jouffroy, rendant compte des travaux de M. Cousin, fixait la date de ce moment mémorable dans l'histoire de la pensée. C'est au commencement du XIXe siècle qu'il n'y avait plus de voies nouvelles à ouvrir, et qu'il fallait se borner à organiser scientifiquement les vérités découvertes, en les dégageant des erreurs auxquelles elles avaient été mêlées (2).
Pour comprendre l'importance des travaux de Victor Cousin, et le juste tribut de reconnaissance dû à sa mémoire, il faut se rappeler dans quel état se trouvait la philosophie française à l'issue des crises de la Révolution et des guerres qui avaient séparé la patrie de Descartes du mouvement intellectuel de l'Europe. Aux Écoles normales établies par la Convention, les auditeurs pouvaient, une fois par semaine, discuter l'enseignement du professeur Garat, qui venait d'être ministre de la Convention, et qui devait être plus tard sénateur et [page 238] comte de l'empire de Bonaparte, occupait la chaire de philosophie. Il enseignait la doctrine de Condillac, et faisait de la sensation la source unique de notre savoir. Saint-Martin prit la parole, comme je l'ai indiqué à propos du mysticisme, et soutint qu'il y a dans l'homme une faculté d'intelligence qui n'a pas la sensation pour origine. Le professeur répondit : « Ce qu'il m'importe d'abord de dire, c'est que, par cette doctrine dans laquelle on suppose que nos sensations et nos idées sont des choses différentes, c'est le platonisme, le cartésianisme et le malebranchisme que vous ressuscitez. Ce serait un grand malheur si, à l'ouverture des Écoles normales et des Écoles centrales, ces idoles (3) pouvaient y pénétrer. Toute bonne philosophie serait perdue ; tous les progrès dans la connaissance de la nature seraient arrêtés. C'est pour cela que je regarde comme un devoir sacré pour un professeur d'analyse de traiter ces idoles avec le mépris qu'elles méritent. » Saint-Martin n'eut qu'à se rasseoir, bien dûment convaincu de platonisme, de cartésianisme, de malebranchisme, pour avoir osé soutenir que la sensation n'est pas la source [page 239] unique de notre savoir ; la majorité de l'auditoire partageait les vues du professeur (4).
Le dialogue de Garat et du philosophe inconnu est une page instructive de l'histoire de la philosophie ; il caractérise une époque. Il est utile de se le rappeler : au commencement de notre siècle, en France, platonisme était un terme de dénigrement, et dire à un philosophe qu'il marchait sur les traces de Descartes était considéré comme une injure. Comment la France philosophique est-elle sortie de ce mépris du passé et de cette ignorance des travaux qui s'étaient accomplis hors de ses frontières ? Comment est-elle arrivée à comprendre que la doctrine de Condillac n'était pas le dernier mot de l'esprit humain ? Divers travaux avaient disposé les esprits à l'étude de l'histoire de la philosophie, et élargi leur horizon. Villers et Mme de Staël avaient ouvert les yeux sur l'Allemagne ; Royer-Collard avait fait connaître les travaux estimables des Ecossais ; de Gérando, malgré l'influence de Condillac qu'il subissait en partie, avait écrit l'histoire des systèmes avec des vues généreuses et une impartialité qui auraient scandalisé Garat. Mais de ce qui [page240] n'était qu'une simple tendance, Victor Cousin a fait un des caractères prononcés du mouvement intellectuel ; les connaissances historiques s'infiltraient dans la philosophie française, il les y a versées à flots ; à de simples lueurs, sa parole ardente a fait succéder une éclatante lumière. Cette lumière qu'il a répandue au dehors s'était, accrue dans son propre esprit, au cours de son travail. Il avait dit dans un de ses premiers cours : « Enfin voici deux hommes de génie (Bacon et Descartes). Depuis Platon et Aristote, l'espace intermédiaire est rempli par des beaux esprits ou par des moines. » Dans cette appréciation dédaigneuse de la fin de la civilisation grecque et de celle du moyen âge, on sent percer les préjugés du XVIIIe siècle. Cousin n'aurait pas pu parler ainsi après avoir édité Proclus et Abélard, et pris part à la décision de l'Académie ouvrant un concours sur saint Thomas qui nous a valu le bel ouvrage de M. Jourdain (5).
Il était réservé au dernier des grands historiens de la philosophie, l'allemand Henri Ritter, de mettre en bonne lumière l'influence de la prédication chrétienne sur la marche de la [page 241] pensée. Saint Augustin avait beaucoup d'esprit et saint Thomas était un moine ; mais il n'est maintenant aucun écrivain sérieux qui puisse faire l'histoire de la philosophie sans leur accorder une large place dans ses travaux.
Avec des vues toujours plus larges, Victor Cousin a donc été le restaurateur de l'histoire de la philosophie en France. Il a contribué plus que personne à donner aux esprits une impulsion qui a produit et produit encore en grand nombre des ouvrages de haute valeur éclairant d'un jour vif la marelle de la pensée dans l'histoire. C'est un service de premier ordre dont des préventions aveugles pourraient seules faire méconnaître l'importance.
Notes
1 [Guizot] Lettre aux éditeurs de l'Histoire de France racontée à mes petits enfants.
2 Article publié dans le journal le Globe, et reproduit par M. Damiron dans son Essai sur l'histoire de la philosophie en France au XIXe siècle. — Voir l'édition de Bruxelles., tome II, page 210.
3 Allusion aux idoles métaphysiques de Bacon dont le professeur venait de parler.
4 Voir les Écoles normales, livre national. — Débats, tome III, pages 8 à 25 et l'Histoire de la philosophie allemande, par Barchon de Penhoën, tome I, pages 325 et suivantes.
5 La philosophie de saint Thomas d'Aquin, par Charles Jourain, 2 vol. in-80, Paris, Hachette 1858.
![]() Source numelyo bibliothèque numérique de Lyon : Naville – Les philosophies négatives : L’éclectisme
Source numelyo bibliothèque numérique de Lyon : Naville – Les philosophies négatives : L’éclectisme