 1847 - Souvenirs de Gleichen
1847 - Souvenirs de Gleichen
- Biographie de Charles-Henri, baron de Gleichen (1733, Nemersdorf – 5 avril 1807 Ratisbonne)
- Chapitre II - Le duc de Choiseul.
- Saint-Martin :
Jugement de Saint-Martin sur Gleichen dans la lettre 50 (25 prairial – 14 juin 1794) à Kirchberger
Avertissement : Le texte de Gleichen sur Saint-Martin est à prendre avec quelques précautions dans la mesure où il affirme certains détails qui sont inexacts le plus souvent et parfois erronés.
- Souvenirs de Gleichen : Chapitre XIV - Saint-Martin
- Chapitre XV - Madame de La Croix.
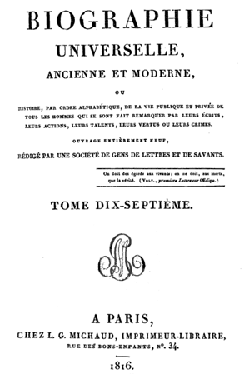 Charles-Henri, baron de Gleichen
Charles-Henri, baron de Gleichen
(1733, Nemersdorf – 5 avril 1807 Ratisbonne)
Tome dix-septième, publiée par Louis Michaud, Paris 1816, pages 504-506
![]() http://books.google.fr/books?id=xFScHkACiW8C
http://books.google.fr/books?id=xFScHkACiW8C
Chambellan de S. M. le roi de Danemark, chevalier de l’ordre de Danebrog et de l’Aigle rouge de Prusse, naquit à Nemersdorf, dans le pays de Bayreuth, en 1733. Après [505] avoir fait de très bonnes études à l'université de Leipzig, il entreprit, à l’âge de vingt ans, son premier voyage de Paris.
Il accompagna ensuite, en 1765, le margrave de Bayreuth en Italie, y resta un an, et s'y voua entièrement à l'étude de l'antiquité et des beaux-arts. Il y retourna encore chargé de différentes commissions d'achats pour le margrave, parcourut toute l'Italie depuis 1756 jusqu'à 1768, revint par Avignon, et se rendit à Bayreuth, où la protection du duc de Choiseul, dont il s'était acquis l'amitié à Rome, lui obtint la place de ministre de Bayreuth à Paris. Il ne conserva ce poste que le temps nécessaire pour se faire connaître, demanda sa démission au bout de neuf mois, et se rendit alors, d'après les conseils du duc de Choiseul, à Copenhague.
 En 1759, le roi de Danemark le nomma son envoyé à la cour de Madrid: il y résida trois ans, et fut envoyé de là à Paris en juin 1765, après le rappel du comte de Wedel - Frys. Cette mission était l'objet de ses souhaits les plus ardents. L'époque à laquelle le baron de Gleichen vint à Paris, était très intéressante pour le Danemark. Les vue ambitieuses de Catherine II sur le Nord alarmaient le roi, qui chercha à resserrer plus étroitement les nœuds de son influence avec la France. La liberté du Nord, le rétablissement de l'équilibre dans cette partie de l'Europe, la diminution de l'influence du cabinet de St-Pétersbourg, devenu si impérieux et si entreprenant; la protection de la France en faveur des nations navigantes et commerçantes contre le système d'asservissement et de monopole des Anglais et des Hollandais sur mer, l'observation des anciens traités, le paiement des subsides arriérés et dus par suite des traites de 1749 et 53: tels furent les objets principaux de la mission du baron de Gleichen.
En 1759, le roi de Danemark le nomma son envoyé à la cour de Madrid: il y résida trois ans, et fut envoyé de là à Paris en juin 1765, après le rappel du comte de Wedel - Frys. Cette mission était l'objet de ses souhaits les plus ardents. L'époque à laquelle le baron de Gleichen vint à Paris, était très intéressante pour le Danemark. Les vue ambitieuses de Catherine II sur le Nord alarmaient le roi, qui chercha à resserrer plus étroitement les nœuds de son influence avec la France. La liberté du Nord, le rétablissement de l'équilibre dans cette partie de l'Europe, la diminution de l'influence du cabinet de St-Pétersbourg, devenu si impérieux et si entreprenant; la protection de la France en faveur des nations navigantes et commerçantes contre le système d'asservissement et de monopole des Anglais et des Hollandais sur mer, l'observation des anciens traités, le paiement des subsides arriérés et dus par suite des traites de 1749 et 53: tels furent les objets principaux de la mission du baron de Gleichen.
Il conserva sa mission de Paris sept ans, et reçut, en 1768, l'ordre de Danebrog comme un témoignage de la satisfaction de son maître. Le roi de Danemark vint, dans les derniers mois de la même année, à Paris: il eut tout lieu d'être content du séjour qu'il y fit; et c'est M. de Gleichen qui l'y reçut et l'accompagna partout.
Ce fut cependant à cette époque que le comte de Bernstorf prit de l'humeur contre de Gleichen, et lui fit perdre son poste : il reconnut ses torts par la suite, et s'occupa de les réparer en lui procurant celui de Naples. La nouvelle mission fut intéressante sous tous les rapports; les relations établies entre les deux cours étaient très agréables : les affaires n'étaient nullement difficiles ; elles se réduisaient à protéger le commerce danois, et à lui procurer tout le développement possible.
C'est dans cette vue que la cour de Danemark avait proposé, quelques années auparavant, à celle de Naples, un traité de commerce qu'il s'agissait de conclure. Gleichen fut envoyé à Naples en 1770 pour cet objet; il y remplaça le comte d'Oslein, qui, peu de temps après, succéda au comte de Bernstorf dans le ministère. Le nouveau ministre n'eut rien de si pressé que de supprimer entièrement le poste de Naples.
Le rescrit du roi qui énonce cette disposition est du 15 août 1771. Le baron de Gleichen quitta alors la carrière diplomatique ; il passa quelques années à voyager, et finit par se fixer à Ratisbonne en 1779. Il avait l'esprit d'analyse et d'observation au plus haut degré, et la tête meublée des meilleurs auteurs anciens et moderne. Ayant vécu avec les personnes les plus instruites et les [506] plus spirituelles de son temps, ayant beaucoup vu, beaucoup comparé, il avait une conversation agréable, instructive, riche de faits anecdotiques et d'observations piquantes. A tant de connaissances et de moyens, il ajoutait un caractère excellent et d'une indulgence extrême.
Ce fut depuis sa retraite des affaires, qu'il se livra plus particulièrement à l'étude de la philosophie et de la métaphysique. A cette époque, il publia différents ouvrages en allemand, dont les deux principaux sont les Hérésies métaphysiques (Metaphysische kelzereien), en 2 vol., imprimés d'abord en 1791, et augmentés en 1796, et les Pensées sur divers sujets de la politique et des arts libéraux, en 1797.
Une partie du premier ouvrage fut traduite en français, sous le litre d'Essais théosophiques, en 1792. M. de Gleichen mourut à Ratisbonne le 5 avril 1807, âgé de plus de soixante-treize ans. Il a laissé en manuscrit des Mémoires de sa Vie, qui présentent un grand intérêt: son ami intime, le comte de Westerholz, à Ratisbonne, en est le dépositaire; il en sera probablement l'éditeur.
Ustéri.
 Chapitre II - Le duc de Choiseul.
Chapitre II - Le duc de Choiseul.
Souvenirs de Charles-Henri, baron de Gleichen (1735-1807)
Source de l'image : Wikipédia
Denkwürdigkeiten, pages 61-78
Souvenirs de Gleichen, pages 19-42 [Grimblot]
Voir l'avertissement aux Souvenirs de Gleichen et l'opinion de Saint-Martin
Le duc de Choiseul était d'une taille assez petite, plus robuste que svelte, et d'une laideur fort agréable; ses petits yeux brillaient d'esprit, son nez au vent lui donnait un air plaisant, et ses grosses lèvres riantes annonçaient la gaieté de ses propos.
Bon, noble, franc, généreux, galant, magnifique, libéral, fier, audacieux, bouillant et emporté même, il rappelait l'idée des anciens chevaliers français : mais il joignait aussi à ces qualités plusieurs défauts de sa nation ; il était léger, indiscret, présomptueux, libertin, prodigue, pétulant et avantageux.
Lorsqu'il était ambassadeur à Rome, Benoît XIV le définissait un fou, qui avait bien de l'esprit. On dit que le parlement et la noblesse le regrettent et le comparent à Richelieu : en revanche ses ennemis disent que c'était un boutefeu, qui aurait embrasé l'Europe.
Jamais je n'ai connu un homme, qui ait su répandre autour de lui la joie et le contentement autant que lui ; quand il entrait dans une chambre, il fouillait dans ses poches, et semblait en tirer une abondance intarissable de plaisanteries [62] et de gaieté. Il ne résistait pas à l'envie de rendre heureux ceux qui savaient lui peindre le bonheur dont il pourrait les combler. Il puisait dans les trésors du crédit pour les obliger, pourvu que cela ne lui coûtât pas trop de peine. Au contraire, l'image du malheur lui était insupportable, et je lui ai entendu faire des plaisanteries, qui me paraissaient affreuses, sur les pleurs de la famille de son cousin Choiseul le Marin, qu'il avait été obligé de faire exiler pour se mettre à l'abri de ses menées enragées. Et voilà comme il s'armait par une feinte dureté contre la facilité et la faiblesse, qui lui étaient naturelles. Je lui ai entendu répondre à Mde de Choiseul qui l'appelait un tyran : dites, un tyran de coton ! Aussi, un moyen sûr d'obtenir de lui ce qu'on voulait, était de l'irriter auparavant sur un autre objet ; cette colère passée, le lion devenait un mouton. J'ai employé deux fois contre lui ce secret que je n'ai communiqué à personne, et sans jamais en avoir abusé.
Une des plus belles qualités de Mr. de Choiseul était d'être ennemi généreux et ami excellent. Le Duc d'Aiguillon, dénoncé au parlement et sauvé par des réticences favorables, que le duc de Choiseul mit dans les témoignages qu'il fut appelé à rendre contre son ancien ennemi, est une des grandes preuves qu'il n'était point haineux. L'attachement constant de ce grand nombre de gens de la cour, qui l'ont suivi dans sa disgrâce à Chanteloup, et qui lui ont été fidèles jusqu'à la mort, prouve combien il avait été leur ami. Le Bailli de Solar, ambassadeur de Sardaigne, a éprouvé de lui les effets les plus recherchés et les plus tendres d'une amitié presque filiale.
Il est le seul homme que le duc de Choiseul ait traité avec une sorte de respect, peut-être parce qu'il avait été à [63] Rome son instituteur en politique. Le duc lui fit avoir l'ambassade de Paris, la médiation de la paix en 1762, des gratifications immenses, et une abbaye de 50 000 livres de rente. Tous les devoirs pieux, qu’un fils peut rendre à son père, lui ont été prodigués par Mr. de Choiseul et sa famille dans sa longue et cruelle maladie, [étant mort d'un cancer à Paris, ajout de Grimblot], peu de temps après les avantages dont son ami l'avait comblé.
Pour moi qui suis payé plus que personne pour vanter, et pour me vanter de son amitié, je dois ajouter que, durant les trente années que j'ai vécu avec lui dans une certaine intimité, il ne m'a jamais perdu de vue un seul instant, et que je n'ai jamais pu m'attirer de sa part aucun refroidissement essentiel, malgré différents torts que j'ai eus envers lui. Il aimait l'audace, et c'est par un propos presque offensant, et que j'avais soutenu avec toute la folie romanesque d'un jeune homme de vingt-deux ans, que j'ai trouvé le chemin de son cœur. Venant d'arriver en 1756 à Frascati pour y passer les deux derniers mois de l'été dans sa maison, il parla peu respectueusement de la Margrave de Bayreuth, sœur aînée du roi de Prusse, qui m'avait élevé et envoyé pour remercier le pape de tout ce qu'il avait fait pour elle pendant son séjour à Rome ; je répliquai à Mr. de Choiseul d'une manière si fière et si piquante en présence de beaucoup de convives, qu'il jeta sa serviette sur la table et se leva avec un air fort échauffé ; mes chevaux n'étant pas parus, je les fis remettre, je voulus me retirer. Mde de Choiseul me retint, et je ne restai qu'à condition que Mr. l'ambassadeur me promettrait de ne jamais rien dire en ma présence de la Margrave, que je ne pusse écouter décemment. Il le fit, me traita depuis ce moment avec la plus [64] grande affection, et le roi de Prusse ayant levé le mois d'après le bouclier contre la France, par son entrée en Saxe, dont j'appris la première nouvelle, Mr. de Choiseul n'a depuis jamais tenu aucun propos désobligeant contre la Margrave et son frère, sans m'en demander plaisamment la permission.
Sa pétulance audacieuse a été mise au jour dès le premier carnaval de son ambassade à Rome. Cette histoire, qui a fait tant de bruit, a été estropiée et trop mal jugée, pour que je ne la rapporte pas, d'autant plus que je la tiens de source. On avait donné au gouverneur de Rome la loge que les ambassadeurs de France avaient eue au théâtre d'Aliberti, et, par mégarde ou par malice, on oublia de la rendre à Mr. de Choiseul, qui voulut absolument la ravoir, quoiqu'il n'aimât pas la musique italienne. Le gouverneur prétendit que, représentant la personne du pape, sa présence était nécessaire au spectacle, et qu'il ne céderait pas. A la première représentation, Mr. de Choiseul arma ses gens, ayant appris que le gouverneur voulait arriver avec main forte, et lui fit dire que, s'il osait entreprendre la moindre violence pour entrer dans cette loge, il le ferait jeter dans le parterre. Tout Rome fut pétrifié. Le pape ne sachant que dire, chargea le cardinal Valenti de faire une mercuriale à l'ambassadeur. Ce prélat, qui avait beaucoup de dignité et d'éloquence, composa une harangue très énergique, qu'il débita avec l'assurance de terrasser le jeune ambassadeur. Savez-vous ce qu'il me répondit ? me dit le cardinal, qui m'a raconté toute l'histoire l'année d'après : « il claqua des doigts (c'était son geste favori d'insouciance) presque sous mon nez, et me dit : vous vous moquez de moi, Monseigneur, voilà trop de bruit pour un petit prestolet, quand il s'agit d'un [65] ambassadeur de France ; ensuite il fit une pirouette sur le talon et sortit ». Ces incartades qui contrastaient avec la gravité romaine et celle des ambassadeurs, qu'ils avaient vus jusque-là, devaient naturellement faire un mauvais effet contre Mr. de Choiseul, et lui donner la réputation d'un jeune étourdi peu fait pour sa place. Mais, après les premiers propos, on ne vit en lui qu'un homme d'esprit soutenu par sa cour, et capable de tout dans de plus grandes entreprises, ayant tout osé pour si peu de chose. Il fut craint, respecté et bientôt courtisé, aimé et admiré par les Romains, éblouis de sa magnificence et des grâces de la cour qu'il procurait à ses clients. Il fut chéri par Benoît XIV à cause de la gaieté de son esprit, et la morgue romaine resta déconcertée pour toujours devant son maintien dégagé et burlesque. Voilà comme les objets dont la puissance sacrée ne repose que sur l'opinion, perdent leur valeur par un peu de courage, de dédain et de ridicule.
Mr. de Choiseul avait mené une vie dissipée et libertine dans sa première jeunesse ; nommé ambassadeur à Rome, il était encore fort ignorant, il lisait peu, mais n'oubliait jamais rien de ce qu'il avait lu ; son esprit prompt, adroit, pénétrant et juste, entendait à demi-mot, devançait les explications et cachait son ignorance en éblouissant par sa perspicacité. Aussi se contentait-il de savoir l'essentiel des choses, abandonnant les détails aux secrétaires et à ses commis. Il écrivait de sa main les dépêches les plus secrètes sans faire un brouillon, il n'en gardait pas de copies, et les envoyait par des courriers. Son écriture était si illisible, qu'un ministre fut obligé un jour de renvoyer la dépêche, en alléguant l'impossibilité de la déchiffrer. Il travaillait peu et faisait beaucoup. Ses intrigues et ses plaisirs lui [66] enlevaient un temps considérable, mais il le regagnait par la promptitude de son génie et la facilité de son travail. Il avait imaginé différents moyens de l'abréger et de le simplifier; entr'autres, une manière de réduire un grand nombre de lectures et de signatures à une seule. La voici : Chaque courier lui apportait une corbeille pleine de lettres et de placets, que lui, comme ministre de la guerre, aurait dû lire ; il n'en faisait rien : premièrement, parce que c'était presque impossible, et puis, parce qu'il avait bien autre chose à faire. Un commis les lisait pour lui, et formait une colonne à mi-marge, des numéros et des précis de ces lettres. Il en faisait la lecture au ministre qui lui dictait la substance de ses résolutions, et qui était écrite vis-à-vis, à la marge. Cela fait, le ministre parcourait le tout, et signait. Ensuite cette feuille se remettait à un autre commis, qui en faisait les réponses, lesquelles ne se signaient qu'avec la griffe, et partaient sans être revues par le ministre ; mais l'original de toutes ces expéditions, déposé aux archives, était un document permanent qui obviait à tous les abus de l'estampille. ? Jamais il n'y a eu un ministre aussi indiscret dans ses propos que Mr. de Choiseul ; c'était son défaut principal. Sa légèreté, la fougue de son esprit, son goût pour les plaisanteries, et souvent l'effervescence de sa bile, en étaient les causes naturelles. Cependant il y en avait encore d'autres plus nobles dans le fond de son cœur, qui font presque honneur à son indiscrétion : la sincérité de son âme haïssait, autant que la justesse de son esprit, tout ce qui était faux; et l’élévation de son caractère dédaignait les réserves timides et le pédantisme minutieux de la politique. L'expérience l’ayant amené enfin à reconnaître son défaut, il a mieux aimé s'en faire un jeu, que de s'en [67] corriger. Il inventait des indiscrétions pour donner le change, et il se consolait d'un embarras par le plaisir de s'en tirer ; car la prérogative la plus éminente de son génie était l'art de trouver remède à tout. Il était l'homme du moment pour jouir, faillir, et réparer, vraiment prodigieux pour trouver des expédients ; et, s'il avait vécu jusqu'à la révolution, lui seul peut-être aurait été capable d'imaginer un moyen pour l'arrêter.
De tant de bons mots qu'il a dits, je n'en rapporterai qu'un, le meilleur à mon gré, et qui prouve que, même dans la colère, la promptitude de son esprit et la gaieté supérieure de son humeur, ne l'abandonnaient pas pour se tirer d'affaire.
Un officier qui l'importunait sans relâche à toutes ses audiences, pour obtenir la croix de Saint-Louis, se mit enfin entre lui et la porte, par laquelle ce ministre voulait s'échapper, pour le forcer à l'écouter. Outré de cette impertinence, il s'emporta au point de lui dire: Allez-vous faire ... mais la réflexion que c'était un militaire et un gentilhomme, l'arrêta, et voici comme il se reprit pour achever la phrase : « Allez vous faire protestant, et le roi vous donnera la croix de mérite ».
Il n'aimait les honneurs, la richesse et la puissance que pour en jouir et en faire jouir ceux qui l'entouraient.
Le duc de Choiseul était beaucoup moins fier de sa place que de sa personne. Quand il pensait à sa naissance, il se rappelait qu'anciennement un homme de qualité aurait cru se dégrader en acceptant une charge de secrétaire d'Etat, et que tous avant lui, hormis l'abbé de Bernis, avaient été gens de robe, et d’après cela il croyait faire beaucoup d'honneur à Louis XV de vouloir bien être son ministre. [68] Quoique tout le monde sût que la France, jadis si redoutable, n'était plus à craindre, que Louis XV était décidé à tout prix de n'avoir plus de guerre, et que la mauvaise opinion qu'on avait de ses finances, surpassant la réalité, était confirmée par lui-même, qui disait souvent à ses gens : « ne mettez pas sur le Roi, cela ne vaut rien ! » le duc de Choiseul néanmoins soutenait encore la dignité de cette couronne et le respect qu'on lui portait. L'Europe avait une terreur panique de son audace incalculable. Cependant on se trompait : il se faisait plus méchant qu'il n'était ; il n'aurait jamais osé compromettre son maître au delà des bornes qu'il lui avait absolument prescrites.
On raconte que le duc de Choiseul, étant à Rome, avait eu du général des Jésuites l'aveu d'avoir été noté par eux comme ennemi de leur ordre sur un propos inconsidéré, qu'il avait tenu dans sa première jeunesse, et l'on prétend que l'horreur que lui avait inspirée une inquisition si recherchée, était la cause de tout ce qu'il a fait depuis contre eux. On se trompe : c'est une succession de torts de leur part et d'autres circonstances qui en ont fait leur ennemi ; indigné de la persécution affreuse, que le parti moliniste en France avait suscitée aux mourants par le fameux régime des billets de confession, l'ambassadeur travailla de bon cœur, et d'après ses instructions, à les contrecarrer auprès de Benoît XIV, qui ne les aimait pas. Alors ce furent les jésuites qui se déclarèrent ses ennemis, et ne cessèrent de le persécuter par le parti des dévots. Dans les premières années de son ministère, ils se servirent du duc de la Vauguyon, pour engager Mr. le Dauphin à remettre au roi un mémoire plein de calomnies contre Mr. de Choiseul qui, s'étant justifié, obtint la permission de s'en expliquer [69] vis-à-vis de Mr. le Dauphin, auquel son père avait fait une vive semonce. Ce prince malgré cela n'ayant pas reçu convenablement Mr. de Choiseul, celui-ci eut la hardiesse de lui dire : « Monseigneur, j'aurai peut-être le malheur d'être un jour votre sujet, mais je ne serai jamais votre serviteur ! »
Madame de Pompadour, amie et protectrice de M. de Choiseul, était encore plus que lui en butte à la haine de Mr. le Dauphin, de Mde la Dauphine, et de tout le parti dévot.
Voilà les intérêts communs que les cours de Madrid et de Lisbonne, auteurs principaux de la ruine des jésuites, employèrent pour favoriser leurs desseins. Mr. de Choiseul qui, dès lors, avait l'idée du pacte de famille en tête, crut avoir trouvé un moyen de s'ancrer dans l'esprit de Charles III, en se vouant à lui pour perdre les Jésuites en France. Les parlements les avaient proscrits, mais il fallait le consentement du roi pour les expulser, et le roi avait une secrète inclination pour cette société, qui avait pour elle toute la famille royale et un grand parti au conseil et à la cour. Le duc de Choiseul nous a dit depuis, dans sa retraite de Chanteloup, qu'il s'était bien gardé de paraître son ennemi aux yeux de son maître, mais qu'il avait constamment dicté au roi d'Espagne ce qu'il fallait dire à celui de France, avec lequel il correspondait de main propre. Au reste, il me paraît que ce ne sont ni les cours ni les Ministres, mais les Jésuites eux-mêmes, qui se sont perdus ; ce sont leurs trafics d'argent en France, leurs imprudences en Espagne, et surtout l'orgueil, l'opiniâtreté, et la sotte témérité de leur général, qui ont ourdi et consommé leur ruine. Quand on manda à ce dernier que le P. Malagrida était arrêté comme complice de l'assassinat du Roi de Portugal, [70] beaucoup d'amis des jésuites se trouvaient rassemblés à un dîner chez le cardinal Negroni avec le P. Ricci ; tous lui conseillèrent d'écrire sur-le-champ au Roi de Portugal, que quoique persuadé de l'innocence de Malagrida, son ordre implorait provisoirement pour lui la clémence de S. M. T. F. ; mais le général fut inflexible : il écrivit une lettre folle, pour soutenir qu'un Jésuite ne pouvait être jugé que par la société, et la société fut chassée du Portugal. C'est le P. Adami, ci-devant général des Servites et un des convives de ce dîner, qui m'a conté cette anecdote. Une autre, que je tiens de Mr. de Choiseul, est une preuve encore plus grande de l'imprudente témérité du P. Ricci. On avait mis sous les yeux de Louis XV la thèse, que les Jésuites ont soutenue de tout temps, et avaient osé agiter de nos jours à Montpellier, qu'il était permis de tuer un tyran ou un roi qui était contraire à la religion catholique. Le prince se rappelant sans doute la tentative de son assassinat, parut frappé ; le maréchal de Soubise, organe principal du parti dévot au conseil, dit qu'il suffisait de demander au général de condamner et de prohiber pour jamais une thèse, qui datait de très loin, et qui, de nos jours, était monstrueuse. Alors le Roi ordonna à Mr. de Choiseul d'écrire à Rome pour cet effet, et ce Ministre crut l'occasion manquée pour longtemps, d'arracher le consentement du Roi, nécessaire à l'exécution de l'arrêt du parlement ; mais le général Ricci refusa avec une arrogance incroyable de faire ce qu'on lui demandait, disant que la condamnation de cette thèse, qui n'avait jamais été qu'un exercice d'esprit, impliquerait l'idée d'une doctrine, et aurait l'air de désavouer une opinion, dont le simple soupçon serait déshonorant pour son ordre, et c'est alors qu'il prononça cette fameuse sottise : sint ut sunt, [70] aut non sint [Qu'ils soient comme ils sont, ou qu'ils ne soient pas]. Une telle effronterie décida le sort des Jésuites en France et prépara la possibilité de leur extinction. Clément XIV qui les craignait encore plus qu'il ne les haïssait, les a défendus encore longtemps, et le Cardinal de Bernis m'a dit qu'on n'a pu forcer ce pape à lâcher la bulle, que par la menace positive de publier la promesse, écrite de sa main, d'abolir l'ordre des Jésuites pour obtenir la tiare, et par conséquent le crime honteux d'une Simonie. On croit presque généralement, que Clément XIV a été empoisonné par les Jésuites : pour moi je n'en crois rien. Ils n'étaient pas gens à commettre des crimes inutiles, ce poison aurait été moutarde après dîner. Le marquis de Pombal, Charles III et le duc de Choiseul sont morts fort naturellement, voilà les preuves de mon opinion. Clément XIV est mort de la peur de mourir; son idée fixe était le poison, et la putréfaction subite de son cadavre n'a été que l'effet de l'angoisse horrible qui l'a tué. Je suis persuadé que les Jésuites existeraient encore, s'ils avaient été aussi méchants qu'on les a supposés.
L'on a reproché à Mr. de Choiseul d'avoir dilapidé les finances. J'ai été témoin, qu'après la mort de Mde de Pompadour, il s'est donné beaucoup de peine pour s'instruire sur cet objet, et pour chercher des remèdes : il a consulté surtout Forbonnais et Mr. de Mirabeau, qui tous deux m'ont dit avoir été étonné [sic] de la perspicacité, avec laquelle il approfondissait des matières si difficiles : mais réfléchissant sur l'impossibilité de remédier à des désordres fondés sur la faiblesse du roi, sur de longs abus, et sur l'avidité insatiable des gens de la cour, il a désespéré de pouvoir combiner des projets d'économie avec le maintien de son crédit et de la faveur. Il ne s'est plus occupé qu'à faire nommer [72] des contrôleurs-généraux, qui lui fussent dévoués, à se procurer tous les fonds nécessaires au succès des départements dont il était chargé, et à être le distributeur des grâces du roi. Toutefois, on ne peut lui reprocher la prodigalité relativement à lui-même, et le compte qu'il a rendu des épargnes faites dans ses départements, a prouvé également son honnêteté et ses talents pour l’économie.
Mr. de Choiseul, qui a toujours visé à se rendre indépendant et inamovible, aurait bien voulu obtenir la charge de surintendant des finances ; la comptabilité rigoureuse, imposée à cette place, lui aurait donné le droit de refuser toutes les demandes indiscrètes, même celles du Roi, et fourni l'excuse bien légitime de dire : Sire, il y va de ma tête Mais Louis XV pressentait bien un tel inconvénient, et avait de plus une répugnance invincible à faire revivre aucune de ces anciennes grandes charges de la couronne. Au reste, si l'on compare la dette de Louis XV à celle de Louis XVI, et le déficit sous ce dernier règne aux ressources que la révolution a découvertes et dilapidées, on trouvera qu'il n'y avait pas de quoi tant crier contre Louis XV, ni qu’il ait été nécessaire de convoquer les états généraux, pour peu qu'on eût voulu employer une petite partie de ces ressources. ? Si Mr. de Choiseul avait eu autant d'attachement et de déférence pour sa femme que pour sa sœur, il s'en serait bien mieux trouvé ; il aurait eu des amis moins nombreux, moins gais et moins flatteurs, mais plus vertueux, plus sages et plus désintéressés que n'étaient ceux, dont Mde de Grammont, et l'espoir de tout obtenir par elle, l’avaient environné. Il n'aurait pas eu les ennemis, qu'elle lui attirait par son arrogance, ses préventions, et les abus qu'elle faisait de son crédit ; et le cœur excellent de son [73] frère aurait été préservé contre l'écorce qui se forme autour de celui des Ministres.
Mde de Choiseul a été l'être le plus moralement parfait que j'aie connu : elle était épouse incomparable, aime fidèle et prudente, et femme sans reproche. C'était une sainte, quoiqu'elle n'eût d'autres croyances que celles que prescrit la vertu ; mais sa mauvaise santé, la délicatesse de ses nerfs, la mélancolie de son humeur, et la subtilité de son esprit, la rendaient sérieuse, sévère, minutieuse, dissertatrice, métaphysicienne, et presque prude. Voilà du moins comme elle était représentée à son mari par sa sœur, et le cercle joyeux qui se divertissait chez elle. Malgré cela, il était pénétré d'estime, de reconnaissance, et de respect pour une femme qui l'adorait, qui lui conciliait les ennemis de sa sœur, et à qui son cœur rendait la justice d'avoir une vertu plus pure, plus solide, et plus méritoire que n'était la sienne.
La duchesse de Grammont était plus homme que femme ; elle avait une grosse voix, le maintien hardi et hautain, des manières libres et brusques : tout cela lui donnait un air tant soit peu hermaphrodite. Elle possédait les qualités de son frère, mais plus prononcées, ce qui leur donnait une teinte rude, et choquante dans une femme. Cette ressemblance avec Mr. de Choiseul, jointe à l'art de savoir l'amuser, lui avait donné un empire sur lui, qu'elle affichait avec une insolence essentiellement nuisible à la réputation et même à la fortune de son frère ; car cette femme impérieuse et tranchante a beaucoup accéléré la chute de Mr. de Choiseul, tandis qu'elle aurait été au moins retardée par l’intérêt extrême que Mde de Choiseul inspirait au roi, à toute la cour, et même aux ennemis de son mari. [74]
Tout le monde a su que Louis XV exilant ce Ministre à Chanteloup, dit qu'il l'aurait traité bien plus durement, sans sa considération pour Mde de Choiseul, et qu'il ne lui sut aucun mauvais gré de la lettre pleine de fierté qu'elle lui avait adressée, en refusant une pension de 50 000 francs que le roi lui offrait. Après avoir sacrifié à son mari tous ses biens disponibles, jusqu'à ses diamants, elle a encore consacré après lui toutes les rentes dont elle avait l'usufruit à sa mémoire, s'est réduite avec un laquais et une cuisinière à la dixième partie de son revenu, pour acquitter les dettes de Mr. de Choiseul, et a payé jusqu'à la révolution plus de 300.000 écus par an, pour achever de les éteindre. Aussi sa personne a-t-elle été respectée, même par les monstres de cette révolution, tandis que sa belle-sœur a été traînée par eux au supplice, sans démentir son caractère plein de courage et d'orgueil, traitant ses bourreaux comme des valets.
On a débité, surtout en Angleterre, que Mr. de Choiseul, pour se soutenir un peu plus longtemps, avait tâché d'impliquer la France dans une guerre, qui était sur le point d'éclater entre l'Espagne et l'Angleterre, au sujet des îles Falkland. Cela est faux. J'ai su par le Prince de Masseran, alors ambassadeur d'Espagne à Londres, et vingt ans après par un commis des affaires étrangères, que le duc de Choiseul a fait en cette occasion deux démarches trop longues à rapporter ici, aussi hardies que désintéressées, pour maintenir la paix. Au reste, ce ministre ne tenait déjà plus à sa place. Sa santé était altérée ; enfant gâté de la fortune et de la faveur, il ne pouvait supporter aucun dégoût ; fatigué des bonheurs de la cour, il souhaitait être heureux d'une autre manière et il bâtissait des châteaux en Espagne sur Chanteloup. [75]
Il lui aurait été bien facile de s'arranger avec Mde du Barry, qui ne demandait pas mieux que d'être tirée des griffes rapaces et tyranniques de son beau-frère, de ses protecteurs, et de tous les roués dont elle était l'instrument ; elle était d'ailleurs une bonne créature, fâchée d'être employée à faire du mal, et dont l'humeur joyeuse eût raffolé de Mr. de Choiseul, dès qu'elle l'aurait connu. Le Roi aurait certainement fait l'impossible pour favoriser et consolider l'union de sa favorite avec son ministre, qu'il était très fâché de perdre ; rien ne le prouve mieux qu'un billet qu'il lui écrivit dans les derniers temps, où ils s'écrivaient plus qu'ils ne se voyaient. Mr. de Choiseul se plaignant à son maître d'une horrible tracasserie, dont il était menacé, celui-ci lui répondit : « Ce que vous imaginez est faux, on vous trompe ; défiez- vous de vos alentours que je n'aime pas. Vous ne connaissez pas Mde du Barry, toute la France serait à ses pieds, si… » signé Louis.
Ce billet que j'ai vu, n'exprimait-il pas le vœu d'un accommodement, la prière de s'y prêter, et l'aveu bien étrange pour un Roi, que le simple suffrage de son ministre ferait plus que tout ce qui était en la puissance royale ? Il est étonnant que le cœur sensible de M. de Choiseul ait résisté à tant de bonté, à l'envie de jouer tous ses ennemis, et à la certitude de régner plus commodément à l'aide d'une femme, qui aurait été entièrement à ses ordres : mais il est encore plus surprenant que, répugnant à s’avilir par la moindre démarche honteuse, sachant qu'il serait exilé, il n'ait pas donné sa démission, surtout avec ces dispositions à la retraite, dont j'ai parlé plus haut. Mais il ne prévoyait pas, qu'en l'exilant, on le traiterait avec tant de rigueur, qu'on le forcerait à se démettre de sa charge de colonel général des Suisses, dans [76] laquelle il se croyait inamovible, et ne savait rien des moyens aussi singuliers que noirs, qui furent mis en œuvre par le chancelier, dans les derniers moments, pour irriter le roi, et le disposer à des actes de violence. On employa des billets que le duc de Choiseul avait écrits anciennement à Mr. de Maupeou, lorsqu'il était encore premier président, dans un temps de dissension entre le parlement et la cour, et où il convenait au bien public que le premier ne se rendît pas d'abord aux volontés du conseil d'État ; ces billets contenaient des exhortations à résister, des conseils pour se conduire, et des promesses de le seconder ; ces billets, qui n'étaient pas datés, furent montrés au Roi, comme venant d'être adressés au premier président actuellement, au lieu d'obvier aux troubles, qui ont éclaté depuis avec tant de violence. Mr. de Choiseul fut par là sourdement convaincu d'avoir des liaisons criminelles avec le parlement, qu'on savait lui être fort dévoué, et d'avoir voulu attenter à la puissance royale, qu'il n'aimait pas trop. Ne prévoyant aucune de ces menées, on dirait qu'il ait voulu ne rien déranger à la belle porte qu'on lui construisait pour sa sortie triomphale ; aussi sa chute et son existence à Chanteloup ont-elles été plus brillantes que les plus beaux jours de sa faveur. La moitié de la cour a déserté Versailles, pour se rendre à Chanteloup ; et le peuple de Paris bordait les rues, depuis son hôtel jusqu'à la barrière d'Enfer, le comblant d'acclamations honorables, ce qui fit à ce Ministre, qui n'avait jamais été populaire, une impression si sensible, qu'il dit les larmes aux yeux : «voilà ce que je n'ai pas mérité. »
Mr. de Choiseul a eu le malheur de s'attirer une calomnie, aussi horrible que dénuée de preuves et de vraisemblance, par un propos le plus étrange et le plus inconsidéré [77] qu'il ait jamais tenu. J'y étais et j'en ai frémi. Mde la Dauphine se mourait. Tronchin avait été appelé, et se disputait violemment avec les médecins de la cour. Le roi se trouvait à Choisy, et Mr. de Choiseul revenant à Paris pour souper, conta d'un air fort échauffé, que le roi avait reçu un billet de Tronchin, dans lequel il disait, que l'état de Mde la Dauphine manifestait des symptômes si extraordinaires, qu'il n'osait pas les confier au papier, et qu'il se réservait d'en informer Sa Majesté de bouche, à son retour : « Que veut dire ce coquin de charlatan ? prétend-il insinuer, que j'ai empoisonné Mde la Dauphine ? Si ce n'était le respect que j'ai pour Mr. le duc d'Orléans, je le ferais mourir sous le bâton. ? C'est un propos inconcevable, qui a germé longtemps et qui lui a valu l'accusation affreuse, non seulement d'avoir empoisonné Mde la Dauphine, mais même le Dauphin.
Je m'en vais me permettre de rapporter un de mes bons mots, non parce qu'il est de moi, et qu'il a le mérite de n'être qu'un seul mot, mais parce qu'il a été raconté comme une réplique, adressée à une petite maîtresse étourdie, pour lui faire sentir son inconvenance, tandis que je l'ai dit à la femme la plus prudente, la plus respectable et la plus discrète que j'aie connue.
Je revenais en 1768 à Compiègne, de Calais, où j'avais embarqué le roi de Danemark, qui se rendait de Dunkerque à Londres. Je jouais aux échecs avec la duchesse de Choiseul. Le monde qui avait rempli le salon s'étant écoulé, et Mde de Choiseul croyant que nous étions tout seuls, me [78] dit : « On dit que votre Roi est une tête », et moi voyant un homme qui était derrière elle, je répondis en baissant les yeux : « couronnée ». Elle s'avisa tout de suite que quelqu'un nous écoutait : « Pardon, me dit-elle, vous ne m'avez pas laissé achever, je voulais dire, que votre Roi est une tête qui annonce les plus belles espérances ».

Souvenirs de Charles-Henri, baron de Gleichen
Chapitre XIV - SAINT-MARTIN. pages 151-165 [Grimblot]
Denkwürdigkeiten, pages 137-148
Souvenirs de Gleichen,
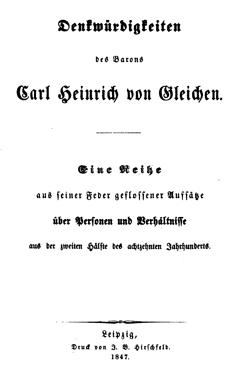
Denkwürdigkeiten
Par C. H. von Gleichen
Leipzig, 1847
http://books.google.fr/books?id=lLEKAAAAQAAJ
Souvenirs de Charles-Henri, baron de Gleichen
Précédés d’une notice par M. Paul Grimblot
Paris. Léon Techener fils, libraire, rue de l’Arbre sec, 52
M DCCC LXVIII
Ce texte sur Saint-Martin a été reproduit dans Les Cahiers de Saint-Martin, vol. IV, p. 61-77. La présentation en a été faite par Nicole Jacques-Chaquin [Lefèvre].
Jugement de Saint-Martin sur Gleichen
Dans la lettre 50 (25 prairial – 14 juin 1794), Kirchberger demande à Saint-Martin :
Comme, peut-être, ce M. de Gleichen viendra me voir en passant à M[orat], veuillez me dire ce que vous en pensez, s'il est de votre connaissance, et le plus vite que votre jugement arrivera, le plus il me fera plaisir.»
La réponse de Saint-Martin se trouve dans la lettre 51 d’Amboise (5 messidor – 23 juin) :
Je connais beaucoup la personne qui l'a vu et dont vous me parlez ; c'est un homme qui a beaucoup d'esprit, surtout de l'esprit de cœur et de l'esprit du monde ; il a frappé à toutes les portes, il a entendu parler de tout, il a tout lu. Avec cela je ne pourrais pas vous dire encore ce en quoi il est entré. Je le crois encore trop dans l'historique de la chose pour qu'il vous soit grandement utile, et j'ignore s'il ira jamais plus loin dans ce bas monde. Je ne veux point me permettre de juger votre force; mais je crains que vous ne reculiez l'un pour l'autre. Enfin, s'il faut vous le dire, c'est un homme tellement habitué à voir du faux et de l'erreur, qu'il me faisait dire dans le temps que c'était un homme qui donnerait trente vérités pour un mensonge. Peut-être a-t-il changé depuis; je le souhaite.
Correspondance inédite de L.-C de Saint-Martin dit le philosophe inconnu et Kirchberger, baron de Liebisdorf, Membre du Conseil souverain de la République de Berne, du 22 mai 1792 jusqu’au 7 novembre 1797. Ouvrage recueilli et publié par L. Schauer et Alp. Chuquet, éditeurs-propriétaires des Nombres et de l’Éclair sur l’Association humaine. Paris Dentu 1862, pages 135-137.
Avertissement
Le texte de Gleichen sur Saint-Martin est à prendre avec quelques précautions dans la mesure où il affirme certains détails qui sont inexacts le plus souvent et parfois erronés. Ainsi :
- L’ordre mystique des Martinistes
Martinez de Pasqually n’a pas fondé « l’ordre mystiques des Martinistes » mais l’Ordre des Chevaliers Maçons Élus Coën de l’Univers. Les termes de martinistes, martinisme, de martinésisme apparaîtront plus tard et viennent d’une confusion entre Martinez et Saint-Martin : on prendra parfois l’un pour l’autre… comme lors du décès de Saint-Martin dans la notice nécrologique du Journal des Débats du 6 novembre 1803 (14 brumaire) qui annonce : « M. de Saint-Martin, qui avait fondé en Allemagne une secte religieuse connue sous le nom de martiniste… »
- Bacon de la Chevalerie (1731-1821)
Bacon de La Chevalerie a été nommé par Martines substitut général du Tribunal souverain de l’Ordre des Élus Coën. On retrouve l’information des « sept maîtres » donnée par Gleichen dans une lettre du prince Chrétien de Hesse-Darmstadt au Grand Profès Metzler, sénateur de Francfort sur le Main :
« Dans une conférence que j'eus avec le Marquis de Chef de Bien d'Armissan, eques a capite galeato 1753- 1814, à Strasbourg, au mois de janvier 1782, j'appris que Don Martines Pasqualis était le Chef de cette secte ; qu'elle avait un tout autre but que la Franche Maçonnerie et qu'elle y avait été entée par l'inconsidération d'un des chefs de cette secte. Pasqualis prétendait que ses connaissances venaient d'Orient, mais il était à présumer qu'il les avait reçues de l'Afrique. Avant de quitter la France, Pasqualis institua pour son successeur Bacon de La Chevalerie et sous lui cinq supérieurs : Saint-Martin, Willermoz, De Serre, Du Roi d’Hauterive, de Lusignan. »
-> Source : http://hautsgrades.over-blog.com/article-21964513.html
- L’écriture du livre Des Erreurs et de la Vérité
Gleichen dit à ce propos :
« Il s'était proposé de ne rien demander à son père, et réduit au pain et à l'eau, c'est en se chauffant au feu d'une cuisine de gargote, qu'il a composé son traité des Erreurs et de la Vérité. »
Or cette anecdote a été arrangée par Gleichen en s’inspirant de Saint-Martin lui-même qui explique dans Mon portrait historique et philosophique, 165 :
« C’est à Lyon que j’ai écrit le livre intitulé : Des Erreurs et de la vérité […] J’écrivis d'abord une 30aine de pages que je montrai au cercle que j’instruisais chez Mr Willermoz, et l’on m’engagea à continuer. Il a été composé vers la fin de 1773 et le commencement de 1774, en quatre mois de temps, et auprès du feu de la cuisine, n’ayant pas de chambre où je pusse me chauffer. Un jour même le pot à la soupe se renversa sur mon pied, et le brula assez fortement. »
- Willermoz
Selon Gleichen, Willermoz serait mort « dans les massacres de Lyon ». Or non seulement Jean-Baptiste Willermoz a survécu à ces massacres mais il a poursuivi son existence lyonnaise plusieurs années puisqu’il n’est mort qu’en 1824 !Quant à la date de la mort de Saint-Martin, c’est le 14 octobre 1803,la Révolution était terminée depuis quelque temps déjà.
- La notice biographique de Saint-Martin
Gleichen publie une « notice biographique de Saint-Martin, écrite par lui-même ». En fait il s’agit de quelques extraits de Mon portrait historique et philosophique et nous avons ajouté le numéro de chaque article reproduit ici, certains n’étant pas mis en entier d’ailleurs
Chapitre XIV - Saint-Martin
Nous avons mis entre crochets […] la numérotation des pages de l’édition originale de 1847 et ajouté de même quelques sous-titres pour permettre une lecture plus aisée.
[Martines de Pasqually]
Martinez Pasqualis a été le fondateur de l'ordre mystique des Martinistes, nommés ainsi à cause de la considération, [138] que Saint-Martin, l'un des sept maîtres, que leur chef avait désignés pour propager sa doctrine après lui, avait obtenue au-dessus de ses collègues par son mérite personnel et par son livre fameux des Erreurs et de la Vérité.
Pasqualis était originairement Espagnol, peut-être de race juive, puisque ses disciples ont hérité de lui un grand nombre de manuscrits judaïques. Sa science était beaucoup moins théorique que celle de ses apôtres ; il pratiquait tout franchement la Magie, tandis qu'eux s'en cachaient et la défendaient soigneusement. J'ai été fort lié avec un certain La Chevalerie qui avait été son aide de camp favori, lequel m'a montré quelques tapis de leurs opérations magiques, et raconté plusieurs faits merveilleux, s'ils étaient vrais. Je n'en citerai qu'un : Les travaux magiques de ces Messieurs ont pour objet surtout de combattre les démons et leurs satellites sans cesse occupés à répandre des maux physiques et spirituels sur toute la nature par leur magie noire.
Les combats se font particulièrement aux solstices et aux équinoxes de part et d’autre. Ils travaillent sur des tapis crayonnés, sur lesquels ils établissent leurs citadelles, qui consistent en un grand cercle au milieu, pour le grand maître, et deux ou trois plus petits pour ses assistants. Le [139] chef, quoique absent, voit toutes les opérations de ses disciples, quand ils travaillent seuls, et les soutient.
Un jour, me dit La Chevalerie, que je n'étais pas parfaitement pur, je combattais tout seul dans mon petit cercle et je sentais que la force supérieure d'un de mes adversaires m'accablait et que j'allais être terrassé. Un froid glacial, qui montait de mes pieds vers le cœur, m'étouffait, et prêt à être anéanti, je m'élançai dans le grand cercle poussé par une détermination obscure et irrésistible.
Il me sembla en y entrant, que je me plongeais dans un bain chaud délicieux, qui remit mes esprits, et répara mes forces dans l'instant. J'en sortis victorieux, et par une lettre de Pasqualis, j'appris qu'il m'avait vu dans ma défaillance, et que c'était lui qui m'avait inspiré la pensée de me jeter dans le grand cercle de la puissance suprême.
Voilà ce que La Chevalerie m'a raconté, pénétré de la conviction la plus intime.
Il se trompait peut-être, mais son intention n'était certainement pas de me tromper.
Loin de vouloir faire de moi un prosélyte, il faisait son possible pour me détourner de cette doctrine qui, disait-il, l'avait rendu fort malheureux. On l'avait excommunié à tout jamais, pour un péché sans rémission, et il ne cessait de médire de Pasqualis et de ses successeurs. Il dépeignait le premier comme un homme plein de vices et de vertus, qui se permettait tout, malgré sa sévérité pour les autres, qui prenait de l'argent de ses disciples, les escroquait au jeu, et donnait ensuite leur argent au premier venu, quelquefois à un passant, qu'il ne connaissait pas ; il disait à ceux qui lui en témoignaient leur étonnement : « j'agis comme la Providence, ne m'en demandez pas davantage. » [140]
[Saint-Martin]
Passons au héros du présent article, à M. de St. Martin. Jeune, aimable, d'une belle figure, doux, modeste, simple, complaisant, se mettant au niveau de tout le monde, et ne parlant jamais des sciences, encore moins de la sienne, il ne ressemblait nullement à un Philosophe, plutôt à un petit saint ; car sa dévotion, son extrême réserve et la pureté de ses mœurs paraissaient quelquefois extraordinaires dans un homme de son âge ; il était fort instruit, quoique dans son livre il ait parlé de plusieurs sciences d'une manière fort baroque ; il s'énonçait avec beaucoup de clarté et d'éloquence, et sa conversation était fort agréable, excepté quand il parlait de son affaire, alors il devenait pédant, mystérieux, bavard ou taciturne ; crainte d'avoir trop dit, il niait le lendemain ce dont il était convenu la veille.
Il avait des réticences insupportables, s'arrêtant tout court au moment où l'on espérait tirer de lui un de ses secrets ; car il croyait à une voix intérieure, qui lui défendait ou lui permettait de parler. Son grand principe était, que, dans la route spirituelle on ne devait point troubler la marche de l'homme, qu'il suffisait de le préparer à deviner les secrets qu'il était destiné à savoir. Aussi, se donnait-il plus de peine pour éloigner ses disciples de sa science, que pour les y appeler, se croyant responsable des abus qu'ils pourraient en faire. Son père, qui était Maire d'Amboise, l'avait mis dans le service militaire, où par sa bonne conduite, ou par le crédit de Mr. de Choiseul, Seigneur d'Amboise, il s'était avancé, en très peu de tems [sic], au grade de Capitaine ; mais, entraîné par la doctrine de Pasqualis et une vocation, qui lui semblait irrésistible, il quitta brusquement le service, malgré les exhortations de ses parents, de ses amis et de son protecteur, se brouilla avec son père [141] et se voua aux œuvres de sa science mystique et à la pauvreté.
[des Erreurs et de la Vérité]
Il s'était proposé de ne rien demander à son père, et réduit au pain et à l'eau, c'est en se chauffant au feu d'une cuisine de gargote, qu'il a composé son traité des Erreurs et de la Vérité.
Le débit de ce livre, le premier et le meilleur qu'il a écrit, l'a aidé à subsister, jusqu'à ce que Mde de la Croix, qui courait une carrière approchante de la sienne, l'ait recueilli chez elle. Mais bientôt ils se brouillèrent, voulant s'endoctriner l'un l'autre, et St. Martin, ayant hérité d'une tante cinquante Louis de rente, se trouva fort riche, et publia quelques nouveaux ouvrages, qui augmentèrent son aisance ; c'est alors qu'il ouvrit une petite école, et que je devins son disciple.
Tout ce qu'il m'a appris est si peu important, et je l'ai si parfaitement oublié, que je ne crains pas d'être indiscret, en parlant de sa doctrine : le peu que j'en dirai m'appartient ; je le dois à l'application avec laquelle je n'ai cessé de relire son livre, à l'attention avec laquelle j'ai saisi chaque mot échappé à mon harpocrate, et peut-être à mon talent pour la dévination de tous les livres, qui traitent de sciences occultes.
Celui des Erreurs et de la Vérité est le seul, dont le style soit agréable et qu'on puisse lire sans dégoût. Les trois quarts de cet ouvrage sont intelligibles ; et les pages qu'on ne comprend pas, présentent des objets si neufs et si bizarres, qu'ils amusent l'attention et piquent la curiosité.
Bien des gens ont crû, que cet ouvrage n'avait été composé que pour ramener le monde à des idées religieuses par l'appât du merveilleux. Il est certain qu'il a produit cet [142] effet sur plusieurs personnes de ma connaissance et sur moi-même, mais j'ai lieu d'assurer, que c'est une introduction très savante et très détaillée à la science de la Magie, et qu'il renferme beaucoup de choses, dont l'auteur s'abstenait de parler dans ses leçons.
[La science des nombres]
La science des nombres, qu'il a représentée sous l'emblème d'un livre à dix feuilles, était de toutes ses connaissances celle à laquelle il attachait le plus haut prix. Il disait l'avoir volée à son maître et qu'il ne la communiquerait jamais à personne. C'est grand dommage, car c'est sous ce voile mystérieux qu'il a enveloppé les plus rares secrets de son ouvrage.
Tout ce qu'il avouait était, que les nombres donnaient la clef de l'essence de toutes les choses matérielles, pourvu qu'on en connût les véritables noms dans la langue primitive ; que par les nombres on éprouvait les esprits de même que par les paroles de puissance, pour s'assurer si les uns et les autres étaient bons ou mauvais ; et que tout cela s'obtenait par l'analyse cabalistique de ces noms et de ces paroles dont les lettres hébraïques produisaient les dix nombres, qui manifestaient des vérités si importantes.
Il ajoutait, que l'alphabet hébreux [sic] n'était juste que jusqu'à la 10ème lettre inclusivement, que le reste avait été brouillé, mais qu'il en connaissait l'ordre véritable. Voilà déjà une confession assez claire que ces Messieurs s'occupaient de magie.
Un autre aveu, que je lui ai arraché, est la description des figures hiérogliphiques [sic] écrites en traits de feu qui lui apparaissaient dans ses travaux, et dont il lui était ordonné de conserver les dessins, qu'il m'a montrés. Ces figures ne sont autre chose que ce qu'on appelle les sceaux des esprits, [143] qu'on voit sur les talismans, sur les pentacles, et autour des cercles magiques.
Mais ce n'est qu'en tremblant que St. Martin parlait de toutes ces choses-là ; il assurait que la magie avait occasionné la chute des esprits et celle de l'homme, que la seule pensée analogue à ces crimes, pouvait nous perdre pour toujours, que sa conscience était chargée de l'âme de ses disciples, et que par toutes ces raisons, il se trouvait obligé à toutes les précautions, que prescrivait sa doctrine pour les mener au bien à petits pas, et pour éloigner de cette route ceux, que la Providence n'a point destinés au grand œuvre des Elus, choisis par elle pour combattre le mal sur la terre.
Au reste, je conseille à tous ceux qui veulent étudier le livre des Erreurs et de la Vérité, de lire préalablement l'histoire du Manichéisme de Beausobre, qui leur ouvrira l'intelligence sur les matières fondamentales du livre de St. Martin, et où ils trouveront de grands rapports avec sa doctrine.
[Hauterive et Willermoz]
J'ai connu deux collègues de M. de St. Martin moins difficiles que lui, mais qui ne le valaient pas, l'un se nommait Hauterive, qui tenait boutique de la science à tous venans [sic], et dont mon maître était fort mécontent ; l'autre Villermoze [sic] ; il avait fondé son cercle à Lyon ; il avait moins de savoir que St. Martin, mais beaucoup plus d'onction, d'aménité et de franchise, au moins apparente. Il parlait au cœur beaucoup plus qu'à l'esprit ; il était estimé de tout le monde pour ses qualités et adoré de ses disciples, à cause de ses manières cordiales, amicales et séduisantes.
Il a joué un rôle distingué dans la maçonnerie et a fini par s'adonner entièrement au magnétisme spirituel. [144]
Il a péri dans les massacres de Lyon, et St. Martin est mort tranquillement pendant la révolution, qui avait un peu dérangé la fréquentation de son école.
[Bibliographie]
Pour se faire une idée complète de la doctrine de St. Martin qui, de toutes les doctrines mystiques est la plus merveilleuse, la plus intéressante et la plus attachante, il faut lire les ouvrages suivants :
- Des Erreurs et de la Vérité,
- Des rapports entre Dieu, l'homme et la nature,
- Ecce homo,
- De l’Esprit des choses,
- L'homme de désir,
- Le crocodile,
- Le nouvel homme,
- Lettre à un ami sur la révolution française,
- Eclair sur l'association humaine,
- Œuvres posthumes,
- Le ministère de F homme esprit.
- Différentes traductions de Jacob Bœhme et un ouvrage allemand qui a pour titre :Magicon.
[Mon portrait historique et philosophique]
Je crois faire plaisir à mes lecteurs en terminant cet article par une notice biographique de Saint-Martin, écrite par lui-même.
[Extrait des Œuvres posthumes : Mon portrait historique et philosophique] :
« J'ai été gai, mais la gaieté n'a été qu'une nuance secondaire de mon caractère; ma couleur réelle a été la douleur et la tristesse, à cause de l'énormité du mal (Bœhme 3, 18) [Barruch. 2:18] et de mon profond désir pour la renaissance de l'homme [Portrait, 1].
« On ne m'a donné de corps qu'un projet [Portrait, 1]. J'ai été moins l'ami de Dieu, que l'ennemi de ses ennemis, et c'est ce mouvement d'indignation contre les ennemis de Dieu, qui m'a fait faire mon premier ouvrage [Portrait, 8]. [145]
« La nature de mon âme a été d'être extrêmement sensible, et peut-être plus susceptible de l'amitié que de l'amour ; cependant cet amour même ne m'a pas été étranger, mais je n'ai pu m'y livrer librement, comme les autres hommes, parce que je n'ai été que trop attiré par de grands objets, et que je n'aurais pu jouir réellement de la douceur de ce sentiment, qu'autant que le sublime appétit, qui m'a toujours dévoré, aurait eu la permission de se satisfaire ; or c'est une permission que des maîtres sacrés m'ont toujours refusée [Portrait, 15].
« Enfin, je n'aurais voulu me livrer au sensible, qu'autant que mon spirituel n'aurait pas paru crime et folie [Portrait, 15].
« Oh, si ce spirituel eût été à son aise, quel cœur j'aurais eu à donner ! [Portrait, 15]. J'ai changé sept fois de peau étant en nourrice [Portrait, 165] ; à l'âge de dix- huit ans, il m'est arrivé de dire au milieu des confessions politiques, que les livres m'offraient: Il y a un Dieu, j'ai une âme, il ne me faut rien de plus pour être sage, et c'est sur cette base qu'a été élevé ensuite tout mon édifice. » [Portrait, 28].
(Il disait en entrant dans sa carrière : ou j'aurai la chose en grand, ou je ne l'aurai pas).
« Depuis que l'inexprimable miséricorde divine a permis que l'aurore des régions vraies se découvrît pour moi, je n'ai pu regarder les livres, que comme des objets de lamentations, car ils ne sont que des preuves de notre ignorance et une sorte de défense faite à la vérité, tant elle s'élève au-dessus d'eux. Les livres morts nous empêchent aussi de connaître le livre de vie, et voilà pourquoi ils font tant de mal au monde, et nous reculent tout en paraissant nous avancer [Portrait, 40].
« Bœhme, cher Bœhme, tu es le seul que j'excepte, car tu es le seul qui nous mène réellement au livre de la vie. [146] Encore faut-il bien qu'on puisse y entrer sans toi [Portrait, 40]. Les livres que j'ai faits n'ont pour but, que d'engager les lecteurs à laisser là tous les livres, sans en excepter les miens [Portrait, 45].
« Dans l'initiation que j'ai reçue et à laquelle j'ai dû dans la suite toutes les bénédictions, dont j'ai été comblé, il m'arriva de laisser tomber mon Bouclier par terre, ce qui fit de la peine au maître ; cela m'en fit aussi à moi, en ce que cela ne m'annonçait pas pour l'avenir beaucoup de succès [Portrait, 58].
« J'ai reconnu, que c'était une chose honorable pour un homme, que d'être, pendant son passage ici-bas, un peu balayeur de la terre [Portrait, 66]. De tous les états de la vie temporelle, les deux seuls que j'aurais aimé à exercer, eussent été celui d'évêque et celui de médecin, parce que, soit pour l'âme, soit pour le corps, ce sont les seuls où l'on puisse faire le bien pur et sans nuire à personne, ce qui n'est pas possible dans l'ordre militaire, dans l'ordre judiciaire, dans l'ordre des traitants ; et je n'aurais pas aimé à n'être que curé, non par orgueil, mais parce qu'un curé n'est pas aussi libre dans son instruction, que peut l'être un évêque [Portrait, 70]. Le duc de Choiseul a été, sans le savoir, l'instrument de mon bonheur, lorsque, voulant entrer au service, non par goût, mais pour cacher à une personne chère mes inclinations studieuses, il me plaça dans le seul régiment où je pouvais trouver le trésor qui m'était destiné [Portrait, 82]. L'espérance de la mort fait la consolation de mes jours: aussi voudrais-je qu'on ne dise jamais : l'autre vie, car il n'y en a qu'une [Portrait, 109].
« La ville de Strasbourg est la seconde après Bordeaux, à qui j'ai des obligations inappréciables, parce que c'est là où j'ai fait connaissance avec des vérités précieuses dont Bordeaux m'avait déjà procuré les germes. Et les vérités précieuses, c'est par l'organe de mon amie intime qu'elles [147] me sont parvenues, puisqu'elle m'a fait connaître mon cher Bœhme [Portrait, 118]. Mon premier séjour à Lyon en 1773,1774, l775, ne m'a pas été beaucoup plus réellement profitable, que celui de 1785. J'y éprouvai un repoussement très marqué dans l'ordre spirituel [Portrait, 145]. Mon père n'ayant pas pu éteindre dans moi le goût que j'avais pour les objets profonds, essaya vers ma trentième année de me donner des scrupules sur les recherches dans les vérités religieuses, qui doivent être toutes de foi. Il m'engagea à lire un sermon du P. Bourdaloue, dans lequel le prédicateur prouvait qu'il ne fallait pas raisonner ; je lus le sermon, et puis je répondis à mon père : « C'est en raisonnant que le P. Bourdaloue a voulu prouver qu'il ne fallait pas raisonner » [Portrait, 162].
« Mon père garda le silence; il n'est pas revenu depuis à la charge. [Portrait, 162]. C'est à Lyon, que j'ai écrit le livre intitulé : Des Erreurs et de la Vérité; je l'ai écrit par désœuvrement et par colère contre les philosophes. […] J'écrivis d'abord une trentaine de pages, que je montrai au cercle, que j'instruisais chez M. de Villermas [sic], et l'on m'engagea à continuer.
« Il a été composé vers la fin de 1773 et le commencement de 1774, en quatre mois de temps, et auprès du feu de la cuisine, n'ayant pas de chambre où je pusse me chauffer.
« Un jour même, le pot de la soupe se renversa sur mon pied, et le brûla assez fortement. C'est à Paris, en partie chez madame de la Croix, que j'ai écrit le Tableau naturel, à l'instigation de quelques amis.
« C'est à Londres et à Strasbourg, que j'ai écrit l'Homme de désir, à l'instigation de Tieman. C'est à Paris que j'ai écrit Ecce homo d'après une notion vive que j'avais eue à Strasbourg. C'est à Strasbourg que j'ai écrit le Nouvel homme, à l'instigation d'un gentilhomme suédois [Portrait, 165]. [148]
« En 1768, étant en garnison à Lorient, j'eus un songe qui me frappa. J'étais dans les premières années de mes grands objets, et c'est à Lorient même que j'en avais eu les premières preuves personnelles, en lisant un livre de mathématiques. La nuit, je vis un gros animal renversé par terre du haut des airs par un grand coup de fouet ; je vis ensuite un autel, que je pris pour être chrétien, et sur lequel je vis quantité de personnes passer et repasser avec précipitation et comme voulant le fouler aux pieds. Je me réveillai avec beaucoup d'affliction, de ce que je venais de voir. […] C'était l'annonce du renversement de l'Eglise [Portrait, 172].
« Mes ouvrages et particulièrement les derniers [premiers] ont été le fruit de mon tendre attachement pour l'homme, mais en même temps du peu de connaissance, que j'avais de sa manière d'être, et du peu d'impression que lui font ces vérités dans cet état de ténèbres et d'insouciance, dans lequel il se laisse croupir… Ce ne sont pas mes propres ouvrages qui me font le plus gémir sur cette insouciance, ce sont ceux d'un homme, dont je ne suis pas digne de dénouer les cordons de ses souliers, mon chérissime Bœhme.
« Il faut que l'homme soit devenu entièrement sot [roc] ou démon pour n'avoir pas profité plus qu'il ne l'a fait de ce trésor envoyé au monde il y a 180 ans. Les apôtres, qui n'en savaient pas tant que lui, ont infiniment plus que lui avancé l'œuvre.
« C'est que pour les hommes encroûtés, comme ils le sont, les faits sont plus efficaces que les livres » [Portrait, 334].
Chapitre XV - Madame de La Croix.
 Souvenirs de Charles-Henri, baron de Gleichen (1735-1807)
Souvenirs de Charles-Henri, baron de Gleichen (1735-1807)
- Denkwürdigkeiten, pages 149-158
- Souvenirs de Gleichen, pages 166-178 [Grimblot]
Voir l'avertissement aux Souvenirs de Gleichen et l'opinion de Saint-Martin
Parmi les livres mystiques qu'elle lisait alors, celui des Erreurs et de la Vérité l'avait charmée davantage, et c'est à lui qu'elle attribuait principalement sa conversion. Aussi rechercha-t-elle l'auteur, dès qu'elle fut arrivée à Paris, le recueillit chez elle, et se composa, toujours disputant avec lui, un petit système théosophique particulier, qui n'avait pas le sens commun.
Je n'en citerai qu'un exemple : elle appliquait le fameux quaternaire du livre de Saint- Martin à la divinité, en qui elle prétendait qu'il y avait quatre personnes engendrées successivement : le fils du père, le Saint-Esprit du fils, et Melchisedec du St. Esprit.
Mais Mde de la Croix était bien plus forte pour la pratique que pour la théorie. Son affaire principale était de combattre le diable et de guérir les maladies. Elle croyait comme le P. Gassner, dont elle faisait grand cas, que le diable était cause de presque toutes les maladies, lesquelles avaient toujours leur source dans quelque péché, qui avait soumis la partie malade aux influences du démon. Elle opérait par des prières et par l'imposition de ses mains arrosées d'eau bénite et de St. Chrême; mais quand elle rencontrait un possédé, et elle en nourrissait toujours quelques-uns à la brochette, c'était alors qu'elle se croyait à sa véritable place ; exorcisant et chassant ce diable du corps de ce pauvre malheureux, qui pour avoir fait un pacte avec lui, serait perdu à jamais, sans la puissance qu'elle avait reçue de Dieu de le délivrer. Ces cures de possédés étaient les plus difficiles, car pour les obsédés, lesquels par des pratiques de fausse magie n'avaient le diable que sur eux ou autour d'eux, il lui en coûtait beaucoup moins de peine de les en débarrasser, elle avait même le pouvoir de le montrer [151] à la compagnie avant qu'il s'en allât, sous une forme qui n'effrayait personne. Je me souviendrai toujours d'une description charmante qu'elle m'a faite de l'apparition d'un de ces diablotins, dont elle avait délivré un certain consul de France à Salé, homme de lettres, que j'avais rencontré souvent chez les encyclopédistes. « Quand le mauvais esprit, me dit-elle, fut sorti de son corps, je lui ordonnai de nous apparaître sous la forme d'une petite Pagode chinoise. Il nous fit la galanterie de prendre une figure vraiment délicieuse ; il était habillé en couleurs de feu et or, son visage était très joli, il remuait des petites mains avec beaucoup de grâce, et fut se sauver sous ce rideau de taffetas vert que vous voyez là, dont il s'enveloppa, et d'où il fit toutes sortes de grimaces à son ancien hôte ; mais ce dernier, ayant sans doute commis de nouvelles fautes, resta obsédé ; car, rentrant un soir au logis, il trouva la petite Pagode sur son bureau, et je fus obligée de me transporter chez lui pour la chasser de sa chambre. » Nous avions été fort étonnés, M. le consul et moi, de nous rencontrer ensemble chez Mde de la Croix, mais je le fus bien plus que lui, lorsqu'elle l'obligea à convenir en ma présence de la vérité de ce récit, et, par bien des raisons, j'ai lieu de croire qu'ils ne pouvaient pas être d'accord.
J'ai vu chez elle plusieurs personnages, qui se faisaient traiter de l'incarnation diabolique et qui m'ont surpris bien plus que le consul ; entre autres, le maréchal de Richelieu, le chevalier de Monbarrey, le marquis, la marquise et le chevalier de Cossé. Mde de la Croix prétendait que bien du monde, et même des personnes de ma connaissance étaient obsédées, et avaient des apparitions, mais qu'elles n'osaient pas en parler de peur de se donner un ridicule. [152] Elle me citait nommément le comte de Schomberg, qui occupait une place distinguée parmi les philosophes mécréants, et que je voyais beaucoup chez le Baron d'Holbach. Cette dernière assertion me paraissait une absurdité vraiment choquante ; mais, l'année d'après, me trouvant chez Mde Necker, celte dame produisit une lettre de Mr. de Buffon, qui lui écrivait de Bourgogne et lui parlait de certaines visions, qui régnaient dans cette province, et que c'étaient toujours de vieilles femmes qui apparaissaient. Quelques gens de lettres qui n'aimaient pas Mr. de Buffon, parce qu'il était trop religieux, faisant quelques mauvaises plaisanteries sur son penchant à croire des choses incroyables, voici ce que Mr. de Schomberg nous dit à mon grand étonnement : « Vous me connaissez assez, messieurs, pour être persuadés que je ne crois pas aux revenants, cela n'empêche pas, que je ne voye et que je n'aye vu depuis longtemps, et presque chaque semaine, la figure de trois vieilles femmes, qui s'élèvent du pied de mon lit, et qui, se recourbant contre moi, me font des grimaces épouvantables. »
Ceci me rappelle un de mes amis, Mr. Tieman, qui voyait presqu'à chaque place qu'il regardait fixement, pendant quelques minutes, une tête, dont les yeux et les traits étaient si animés, qu'elle lui paraissait vivante. Sur la tache de sang, qu'on montre dans la chambre du château d'Edimbourg, où David Rizzio fut poignardé, il dit avoir vu une tête, qui exprimait les convulsions de la mort d'une manière effrayante ; il retourna à différentes reprises à la même place et il revit toujours cette tête plus horrible qu'auparavant. Mr. Tieman, quoiqu’entiché de la passion des sciences occultes, était un homme très véridique, incapable de tromper qui que ce soit, et toujours en garde de se tromper [153] lui-même. Quoi qu'il en soit, j'ai lieu de croire, qu'il voyait réellement ce qu'il disait voir. Eh, qui n'a pas rencontré bien des honnêtes gens, qui assuraient avoir eu des apparitions avec des circonstances et des protestations si persuasives, qu'on devait être fâché de les révoquer en doute ? Mais ne pourrait-on pas, pour se mettre le cœur et l'esprit en repos, admettre qu'une conformation particulière de l'œil, ou une concrétion compacte, qui se serait formée dans le cristallin ou dans l'humeur vitrée, pourraient produire la représentation d'un spectre ? Cette concrétion opaque, qui aurait pris une forme déterminée, analogue à celle d'une figure humaine et interceptant les rayons de la lumière, me paraît surtout propre à produire ces sortes d'illusions. Ce spectre serait sans doute noir et mal dessiné, mais l'imagination, ce peintre rapide et habile, colorerait et achèverait bien vite l'ébauche d'une telle grisaille.
Mde de la Croix a été dans sa jeunesse ce qu'on nomme une beauté romaine, mais si parfaite comme on n'en a jamais vu une pareille. Elle avait une figure pleine de grâces et de caractère, l'œil perçant, le nez aquilin, la tête altière, un port superbe, une démarche majestueuse, en un mot, c'était l'idéal d'une belle impératrice. De tant de charmes, il ne lui restait dans sa vieillesse qu'une physionomie spirituelle et animée, une taille bien faite, un beau pied, un air impérieux, et beaucoup d'éloquence. Ces restes imposants et distingués convenaient merveilleusement au rôle qu'elle jouait, quand elle parlait au diable ; son geste menaçant et l'accent de sa voix faisaient trembler, et il y avait tant de noblesse dans son maintien, tant d'élévation dans sa dévotion exaltée, et une expression si sublime de foi et d'assurance dans toute sa personne, qu'on croyait voir une Sainte, [154] qui allait faire un miracle. Mais malheureusement je n'en ai vu aucun, quoique j'aye passé bien des journées chez elle, à attendre .que le diable sortît du corps d'un possédé. Cependant j'ai été témoin de plusieurs guérisons de maux de tête et de dents, de coliques et de douleurs rhumatiques [sic], opérées sur des personnes qui venaient chez elle en visite et qu'elle connaissait même très peu. Je pense que ces sortes de guérisons peuvent s'expliquer assez naturellement par l'action du magnétisme animal secondé par l'imagination, cette fée puissante qui commande au génie et préside aux ressorts de notre organisme. Toutefois, si l'on considère combien l’amour propre doit être flatté de l'honneur d'être un instrument de la divinité, on peut pardonner à Mde de la Croix et compagnie de ne pas croire à des causes naturelles, quand il s'agit de miracles.
Mde de la Croix racontait avec une naïveté, une grâce et un art pittoresque, qui lui étaient propres, les particularités des visites qu'elle recevait des mauvais esprits, quand elle était seule. On voyait tout ce qu'elle disait, tant ses descriptions étaient vives et naturelles. Toutes les fois que je venais chez elle, je trouvais des nouvelles de sa société. Tantôt c'étaient des niches fort drôles qu'on lui avait jouées, et tantôt des persécutions effrayantes qu'elle avait essuyées.
Souvent des processions entières de pénitents en grandes robes couleur de rose, ou de capucins fort puants, vêtus en bleu céleste, ou d'autres personnages ecclésiastiques ridiculement fagotés arrivaient chez elle de nuit et traversaient son lit, les capucins lui offraient des baisers et les pénitents flagellaient ses couvertures. Quelquefois on lui donnait un bal, où elle voyait les ajustements les plus curieux et les modes de tous les siècles ; une autre fois, c'étaient un feu [155] d'artifice magnifique, des pyramides de diamants et de bijouteries, des illuminations superbes où des palais enchantés qu'on lui montrait. Elle dépeignait tout cela si vivement, avec tant de goût, de gaieté et d'éloquence, que ses récits valaient mieux que la plupart des descriptions d'une fête, ou de l'assemblée la plus brillante.
Je ris encore toutes les fois que je pense à une dispute théologique, qu'elle eut avec un de ses esprits familiers, masqué en docteur de Sorbonne, qui la traitait d'hérétique, en soutenant les opinions de l'Eglise romaine de la manière la plus orthodoxe : « Mais, lorsqu'il finit par y mêler des blasphèmes, je lui fermai la bouche avec un cadenas, me dit-elle, qu'il portera jusqu'au jour du jugement. — Et où avez-vous pris ce cadenas ? » lui répliquai-je. « Ah ! mon cher baron, que vous êtes peu instruit de la différence entre la réalité spirituelle et la matérielle ; c'est un cadenas bien véritable que je lui ai appliqué: les nôtres n'en ont que la figure. »
Je ne m'ennuyais donc pas chez elle en attendant la chose principale, qui était le diable, qu'elle avait promis de montrer, d'autant plus que nous ne parlions pas toujours de ces choses-là, et que son esprit orné et fécond rendait la conversation aussi instructive qu'agréable ; mais tout le monde n'était pas aussi bénévole que moi, et l'on se permettait de la donner en spectacle, en l'engageant à faire ses conjurations dans les maisons, où on lui faisait accroire qu'il revenait des esprits. Ces facéties se faisaient même si grossièrement, qu'elle s'en apercevait ; mais elle mettait ces humiliations au pied de la croix, et m'en parlait avec une grande ouverture de cœur et beaucoup de bon sens. « Vous qui m'avez connue, disait-elle, si jalouse de ma gloire et de ma supériorité, qui savez que je me prive [156] du moindre superflu pour le donner aux pauvres, qui voyez que le métier que je fais ne me rapporte que de la honte et du mépris dans un pays où, par mon rang et ma parenté, je pourrais jouer un tout autre rôle, ne sentez-vous pas, qu'une force très supérieure doit m'imposer l'œuvre que j'exerce ? Dites-moi franchement, si mon esprit a baissé ; trouvez-vous que je suis devenue folle ? » Il était bien difficile de répondre à ces questions, d'autant plus que je trouvais son esprit plus brillant que jamais ; mais, après lui avoir fait compliment, je ne pouvais pas me défendre de penser à part, qu'une idée fixe peut fort bien exister, sans troubler les autres, et qu'on peut être raisonnable avec un coin de folie.
Au reste Mde de la Croix avait une charité si active, une piété si édifiante, une bonté d'âme si touchante, tant d'onction, de génie et de noblesse de caractère, qu'elle méritait les plus grands égards, et qu'on ne pouvait pas se défendre de l'aimer et de la respecter. Pour moi, je ne saurais penser à elle sans l'admirer et la regretter sincèrement. Je l'ai vue pour la dernière fois en 1791 à Pierry en Champagne chez M. Cazotte, ce charmant auteur du Diable amoureux qui, de maître qu'il avait été chez les Martinistes, s'était fait disciple de Mde de la Croix, et qui a péri dans les massacres du mois de Septembre. Je crains fort que Mde de la Croix, dont je n'ai pu avoir aucune nouvelle, n'ait péri de même ; car elle avait tout ce qu'il fallait pour occuper une place parmi les martyrs, et elle travaillait de toutes ses forces contre la révolution, qu'elle regardait comme l'œuvre du diable.
Une prouesse, dont elle se vantait particulièrement, était d'avoir détruit un talisman de lapis-lazuli, que le Duc [157] d'Orléans avait reçu en Angleterre du célèbre Falk Scheck, premier rabbin des Juifs. « Ce talisman, qui devait conduire le prince au trône, me disait-elle, fut brisé, par la vertu de mes prières, sur sa poitrine dans ce moment mémorable, où il lui prit un évanouissement au milieu de l'assemblée nationale. »
Je finirai cet article par une scène, que je ne puis ni oublier ni m'expliquer.
Mde de la Croix avait un possédé qui, induit par un meunier son voisin, avait formé un pacte avec le diable sans le savoir, et qui par conséquent pouvait être délivré. Toutes les fois qu'il venait chez elle, il se jetait à genoux, et sanglotait en racontant les tourments horribles qu'il souffrait sans cesse. Elle le couchait sur un canapé, lui découvrait le ventre, y appliquait des reliques et de l'eau bénite. Alors on entendait un gargouillement affreux dans le ventre, et le patient jetait des cris effroyables ; mais le diable tenait ferme, et nos espérances de le voir sortir, furent toujours trompées.
Un jour, ce possédé devint furieux, sauta à bas du canapé et fit mine de se jeter sur nous. Mde de la Croix se mit entre lui et nous, et d'un air menaçant le remit à sa place ; alors il grinçait des dents avec une force si extraordinaire, que les passants dans la rue auraient pu l'entendre, et proférait en écumant des blasphèmes si horribles et si nouveaux, qu'ils nous faisaient dresser les cheveux sur la tête ; de là il passa aux invectives les plus atroces contre Mde de la Croix, et finit par l'énumération la plus scandaleuse de tous les péchés, que cette pauvre dame pouvait avoir commis dans toute sa vie, avec des détails, dont plusieurs m'étaient connus, et encore beaucoup d'autres capables [158] de la faire mourir de confusion. Elle écoutait tout cela les yeux tournés vers le ciel et les mains croisées sur la poitrine, et pleurant amèrement. A la jeunesse près, elle ressemblait à Ste. Madeleine. Quand le patient eut terminé son discours, elle se mit à genoux et nous dit: « Messieurs, voilà un châtiment de mes péchés bien juste, que Dieu accorde à ma pénitence ; je mérite ces humiliations, que j'ai éprouvées devant vous, et je voudrais les essuyer devant tout Paris, si je pouvais expier par là toutes mes fautes. »
Qu'on réfléchisse sur tout ceci, et qu'on me dise, s'il est croyable qu'une pareille scène ait pu être concertée et jouée, s'il est croyable qu'une femme telle que je l'ai dépeinte ait voulu violer à ce point tous les égards les plus sacrés dus à Dieu, à la pudeur et à sa réputation, pour nous tromper? Mais peut-on être trompé et se tromper soi-même quand il s'agit de surmonter l'horreur, que doivent exciter de pareilles épreuves et de sacrifier tout ce qu'on a de plus cher, avec une abnégation de raison et d'amour propre si révoltante et si épouvantable ?



