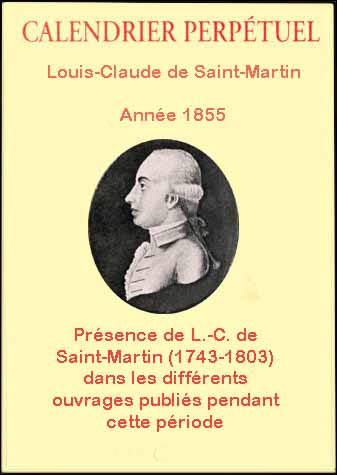 1855 - Histoire critique des doctrines religieuses
1855 - Histoire critique des doctrines religieuses
Par Christian Jean Buillaume Bartholmess, membre correspondant de l’Institut, de l’Académie des sciences de Berlin, de celle de Turin, etc.
Paris. Ch. Meyrueis et Compagnie, éditeurs, rue Tronchet, 2 - 1855
Tome I, extrait de l'Introduction
Tome II, Livre VII – Hamann, Herder et Jacobi ; Livre X. Ecole de Schelling. – Chap. II. Schubert, Steffens et Baader ; Livre XIV – Réaction religieuse du Midi – Chap. II. Lamennais - Saint-Martin
1855 – Bartholmess - Histoire critique des doctrines religieuses – T I
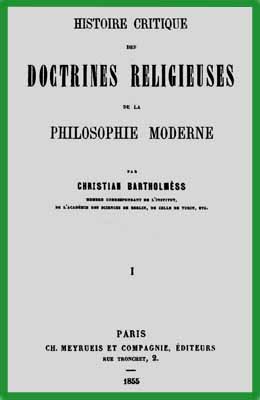 Introduction, extrait, page XXIX
Introduction, extrait, page XXIX
Que si les traits distinctifs du mouvement germanique, celui surtout qui consiste dans une aversion constante pour le matérialisme athée, sont rapprochés des essais tentés autour de nous, en France et en Italie, sous l'impulsion d'une résistance entreprise par des organes dissemblables, on trouvera que la philosophie de notre temps n'est pas indigne de succéder à celle des deux derniers siècles. Saint-Martin et Lamennais, Joseph de Maistre et Louis de Bonald, Frayssinous et Affre, diffèrent sur mille points de l'école dont les chefs sont Maine de Biran et Royer-Collard, MM. Cousin et Jouffroy ; et même de cette école méridionale qui s'honore de suivre Galuppi, Gioberli, Rosmini, qui a pour anneaux extrêmes, à droite Balmès et le P. Ventura, à gauche le comte Térence Mamiani, le fondateur populaire de l'Académie de philosophie italienne, un des ornements durables du courageux et solide Piémont. Mais ce qu'ils ont en commun, n'est-ce pas le spiritualisme même ?
![]() 1855 – Bartholmess - Histoire critique des doctrines religieuses – T I
1855 – Bartholmess - Histoire critique des doctrines religieuses – T I
1855 – Bartholmess - Histoire critique des doctrines religieuses T 2
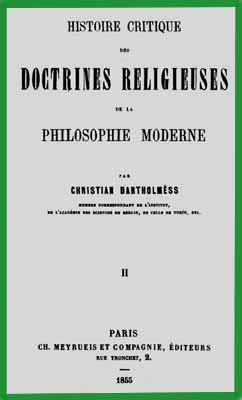 Livre VII – Hamann, Herder et Jacobi. Extrait, pages 3-4
Livre VII – Hamann, Herder et Jacobi. Extrait, pages 3-4
Quoiqu'ils s'appuient sur le même terrain et qu'ils tendent au même but, Hamann, Herder et Jacobi diffèrent en effet beaucoup par leurs facultés, par le tour de leur esprit. A quelques égards Herder était l'opposé de Hamann, tandis que Jacobi tenait une sorte de milieu entre la profondeur confuse de celui-ci et la trop brillante habileté de l'autre. On se souvient des surnoms qui furent donnés au voyant de Kœnigsberg : le mage du Nord, le Jacob Bœhme du XIXe siècle, le Vico, le Lavater, le Saint-Martin de la Prusse. Ces surnoms, que peuvent-ils caractériser, si ce n'est une âme pleine de nobles pressentiments, d'élans prophétiques et dithyrambiques, de sombres éclairs et d'échos mystérieux, d'aperçus énergiques et concis, de sentences d'une sagesse silencieuse ou concentrée ? Hamann était travaillé par une fermentation singulière et continuelle, par je ne sais quel laconisme grandiose, mêlé à une ardeur caustique, à une ironie paradoxale, où l'ivresse des choses divines et le dégoût des hommes tournaient en satiété de science et en avarice de paroles. C'était un théosophe railleur, exempt de prosélytisme, un devin aussi dédaigneux qu'impétueux et sincère. Herder, au contraire, se faisait remarquer par une fluidité d'élocution, par une élasticité de réflexion, qui contrastait fort avec une condensation si intense, si abrupte. Rien de plus agréable, de plus beau que son imagination et son langage. Nul n'était plus [page 4] susceptible de s'ouvrir, avec une souplesse presque féminine, aux influences, aux impressions les plus variées; nul n'était capable de les peindre avec une touche plus attrayante. Orateur lumineux et persuasif, poète éblouissant, plume entraînante, mais parfois voisine d'une rhétorique magnifiquement stérile, Herder gâtait tant de dons par un amour-propre irritable, et laissait trop voir qu'il n'avait de la Bible ou de l'Orient que la richesse de couleurs et le pathétique. Si chez Hamann l'âme même était inspirée, Herder n'était enthousiaste que dans la région de la fantaisie et de l'art. Pour Jacobi, en qui une chaleur saine s'alliait à une élégante netteté, qui avait également goûté Voltaire et Rousseau, qui aimait la vérité aussi passionnément que Hamann, et qui fuyait avec autant de soin que Herder le pédantisme et l'intolérance d'école, il devait former le véritable centre de ce groupe. La doctrine qu'il enseignait n'était plus mystique, comme celle de Hamann, ni expérimentale, comme celle de Herder : elle était réfléchie et critique tout ensemble (1).
Note
(1) Hamann mourut en 1788, Herder en 1803, Jacobi en 1819.
![]() Livre VII – Hamann, Herder et Jacobi. Extrait, pages 3-4
Livre VII – Hamann, Herder et Jacobi. Extrait, pages 3-4
Livre X. Ecole de Schelling. – Chap. II. Schubert, extrait, pages 141-144
Henri de Schubert, né en 1780, formé dans le commerce de Herder, avant d'embrasser la pensée de Schelling, compléta ses vastes recherches au milieu des trésors minéralogiques de Freiberg, puis au milieu des trésors d'art que possède Dresde. Pendant qu'il s'enrichissait ainsi lui-même, il donna au public diverses sortes d'ouvrages, dont nous ne citerons que les suivants : Esquisses d'une histoire universelle de la vie (1806); Vues sur le côté nocturne de l'histoire naturelle (1808). Entre 1809 et 1816 il dirigea une école industrielle à Nuremberg. De là il se rendit à Ludwigslust, pour présider à l'éducation des enfants du grand-duc héréditaire de Mecklembourg-Schwérin. En quittant ce poste élevé vers 1820, il alla enseigner l'histoire naturelle à Erlangen, et faire paraître ses écrits les plus distingués, concernant la nature matérielle. [page 142] Plus tard il changea la chaire d'Erlangen contre une semblable à Munich, et contre un fauteuil à l'Académie des sciences, où son savoir si varié et son noble caractère furent toujours mieux appréciés. Aux nombreux travaux physiques de Schubert, il faut ajouter des études psychologiques et même des récits de voyage, si l'on veut comprendre toute l'étendue de son heureuse influence. Le mélange piquant, et parfois bizarre, d'inductions scientifiques et de vues poétiques, ou d'émotions édifiantes, mélange qu'offrent toutes ses productions, devait attirer le public placé hors des écoles, autant qu'exciter la contradiction fréquente des penseurs sévères et des juges spéciaux.
Ce qui ne servit pas moins à étendre le cercle de ses lecteurs, c'est la tentative que Schubert fit de bonne heure de dépasser la philosophie de l'identité, en mettant l'idéal, non en face, mais au-dessus du réel. De même qu'Eschenmayer s'était refusé à « chercher soit dans la nature, soit dans l'esprit fini, Celui qui créa et la nature et l'esprit fini, de peur de confondre l'auteur avec son ouvrage librement fait ; » de même Schubert répugnait à renfermer Dieu dans la nature et dans l'histoire. Dieu, pensait-il, surpasse l'une et l'autre ; le plus parfait est supérieur au moins parfait ; et si la création est le miroir du créateur, elle n'est pas sa face même. Aussi s'attachait-il particulièrement à celle des théories schellingiennes qui représente la nature comme un élément négatif, comme une apostasie. Cette théorie lui permettait de reconstruire avec talent les traditions des peuples primitifs, dépositaires [page 143] d'une civilisation accomplie et d'un bonheur inaltérable. La nature elle-même, dit-il, goûtait alors un âge d'or, un paradis, dont elle n'a cessé de s'éloigner. Depuis l'époque de cette chute universelle, mélange de lumière et de ténèbres, alternative de jour et de nuit. Cet état à jamais regrettable, Schubert pressent que nous le retrouverons un jour au delà de ce monde. Le passé primordial sera notre avenir éternel. Les réminiscences éparses de cette perfection originelle sont les germes, les gages, les présages de la perfection qui nous est réservée. Comment peut-on entrevoir ces germes, ces débris ? En étudiant les phénomènes mystérieux, ceux surtout que la science ordinaire traite de dispositions à demi malades. La mort et le cortège des faits qui la précèdent ou l'accompagnent, le magnétisme animal, le somnambulisme, les domaines du rêve, des songes, de la rêverie, de l'inspiration prophétique, voilà les principaux éléments de cette connaissance de la nature primitive ; voilà les données qui annoncent la fin de la nature actuelle, l'avènement de la nature à venir. Une induction commune ressort pour Schubert de ces faits de pathologie, qui lui sont les caractères de la santé véritable, perdue, mais à recouvrer : c'est que notre constitution a été et sera capable d'actes aussi différents des effets mutuels de la présente nature, que les mouvements de fermentation et de corruption sont dissemblables des procédés de la vie organique. Grâce au principe supérieur qui dominait dans notre constitution, l'unité, l'harmonie régnait alors entre chacun et le tout ; tandis qu'aujourd'hui [page 144] chacun croit sa vie intéressée à se séparer du tout. Revenir à cette unité, expression de la raison universelle et de la volonté absolue ; renaître, se retremper, se régénérer dans cette harmonie, tel est notre moyen de salut et de santé, tel le chemin qui ramène la vie à sa source. Une magie naturelle rétablira notre véritable lien avec le centre vivifiant de la nature. Cette magie, nous la voyons déjà s'accomplir silencieusement par une création incessante, qui nous donne l'espoir que notre existence individuelle sera elle-même renouvelée. L'esprit pressent tout cela d'une manière d'autant plus vive, que sa propre rénovation lui semble inséparablement attachée à la manifestation future et continue de la gloire de Dieu.
Au surplus, Schubert ne se borne pas à montrer, par la peinture du côté obscur des forces naturelles, quel est le rapport primitif de l'homme avec Dieu. Il admet dans le domaine psychique une faculté suprême, consacrée par plus d'un auteur chrétien, l'esprit. C'est l'esprit qui transforme l'âme, en la dégageant, dès cette vie, des entraves de la nature déchue et mourante. C'est par l'esprit que l'âme entre en communion immédiate avec son principe parfait, et goûte par intervalles la béatitude infinie. C'est par lui que l'âme développe le germe d'immortalité qu'elle a conservé, ce germe qui possède une puissance de reproduction capable de former en son temps un corps nouveau, assorti à une destinée plus haute.
Au traducteur de Saint-Martin qui, par ces derniers traits, rappelle Charles Bonnet, et qui entraînera un jour Schelling lui-même, à Schubert nous pouvons unir Steffens, par plus d'un motif…
![]() Livre X. Ecole de Schelling. – Chap. II. Schubert, extrait, pages 141-144
Livre X. Ecole de Schelling. – Chap. II. Schubert, extrait, pages 141-144
Baader, extrait, pages 150-152
Le chevalier François de Baader, fils d'un médecin distingué, étant né à Munich en 1765, avait dix ans de plus que M. de Schelling. Après avoir étudié la médecine, il reconnut que sa vocation l'appelait ailleurs : il alla, sous la direction de Werner, s'initier aux profondeurs de la minéralogie. Entre 1791 et 1796 il visita la France et l'Angleterre. L'état moral et politique de ces deux nations l'occupa fortement. Le matérialisme français et le déisme anglais l'irritèrent également. L'ouvrage partial de Godwin, « La justice politique et son influence sur la morale et le bonheur, » lui fit chercher un refuge dans les doctrines de Kant. Mais un stoïcisme si sobre ne pouvait le contenter. Il reprit plus ardemment que jamais la lecture de la Bible, et y joignit les livres de Saint-Martin. Celui-ci le conduisit au théosophe du XVIe siècle, que l'écrivain français appelait son éducateur, à Jacob Bœhme. A son retour en Allemagne, il connut la philosophie, ensuite la personne de Schelling. A Munich, qu'ils habitèrent longtemps ensemble, leur commerce fut tellement intime, que certains disciples de Baader n'hésitent pas à représenter leur maître comme ayant donné à Schelling bien plus qu'il n'en avait reçu. L'activité littéraire de Baader était des plus diligentes, [page 151] des plus variées, mais aussi des plus vagabondes. Sa vaste correspondance explique en partie cette quantité innombrable d'écrits de circonstance dont plusieurs furent composés en français. Des morceaux de critique, des articles de Journaux, de Revues, des épisodes de tout genre, mais point de monument complet et considérable. Son style, d'ailleurs, abonde en défauts, en tours emphatiques, en parenthèses illimitées, en images et en expressions obscures ou creuses. Un de ses ouvrages les moins imparfaits est intitulé Fermenta cognitionis. C'est une œuvre dirigée contre l'irréligion du temps, rappelant parfois les travaux analogues de MM. de Bonald et de Lamennais, et indiquant assez, par son titre même, l'ardeur confuse et féconde, la fermentation, qui distingue la pensée et les livres de Baader. Depuis sa mort, arrivée en mai 1841, ses élèves se sont consacrés, sous la conduite de M. Fr. Hoffmann (note 1 : MM. Lutterbeck, de Schaden, Schlüter, etc.), à mieux rédiger, à commenter, à publier avec soin ses écrits spécialement philosophiques, ou simplement posthumes.
Aussi bizarre qu'original, Baader est l'opposé des philosophes à système ou à méthode. Par la liberté de ses allures, comme par le feu et l'habileté de sa polémique, il ressemble le plus à Jacobi et à Hamann, qu'il surpasse tantôt par la profondeur ou la suite de ses spéculations, tantôt par la hardiesse de ses rêves. Son indépendance se montre même dans ses opinions religieuses. Baader est, parmi les penseurs modernes, celui peut-être qui connaît le mieux, qui du moins [page 152] aime le plus les saintes lumières du moyen âge. Augustin, Scot Erigène, Anselme, Thomas d'Aquin, sont ses autorités favorites, ou rivalisent dans son admiration avec Paracelse, Jacob Bœhme et Saint-Martin. « Les penseurs du moyen âge n'ont pas la longueur et la largeur des philosophes modernes, disait-il, mais ils ont la dimension qui importe. » Et cependant, tout admirateur qu'il est de l'Église, il critique le catholicisme actuel, rejette la suprématie du pape, et invite l'aristocratie du clergé à se constituer sur des fondements démocratiques, à se régir par les conciles. Il n'hésite pas à préférer la forme de la communauté grecque à celle de la communauté latine. Baader devait donc être traité d'hétérodoxe par ceux qui travaillaient autrement que lui à la restauration du moyen âge. Les philosophes, de leur côté, devaient refuser le titre de penseur à celui qui leur reprochait de s'être attachés à Spinosa, plutôt qu'à maître Eckart, plutôt qu'à ce Jacob Bœhme, « qui avait commencé et achevé la réforme scientifique (Note 2 : Fermenta cognitionis, I.). »
dominante et son besoin le plus impérieux. Et voilà pourquoi l'on pouvait aussi donner à sa philosophie l'épithète de théocentrique. « Quiconque ne commence pas par Dieu, nie Dieu. »
![]() Baader, extrait, pages 150-152
Baader, extrait, pages 150-152
Livre XIV – Réaction religieuse du Midi – Chap. II. En France – Extrait, pages 493-494
En France
« La véritable religion n'a pas besoin de supposer dans ses adversaires, ou dans ses émules, des défauts qui n'y sont pas. » D'Aguesseau.
« Souvenez-vous que de tous les attributs de Dieu, bien qu'ils soient égaux, sa miséricorde l'emporte ». Cervantès.
L'intelligent et laborieux Piémont est, en philosophie aussi, un médiateur entre l'Italie et la France : témoin, au dernier siècle, le cardinal Gerdil ; plus récemment, Joseph de Maistre. Ce qui distingue les théologiens pensants de la France, la précision du langage et un tour d'esprit plus pratique ou moins contemplatif, se peut déjà remarquer chez les écrivains de la Savoie. En comparant Vico, Rosmini, Gioberti avec MM, de Maistre, de Bonald, de Lamennais, la différence est plus sensible encore, à cause même de la communauté des desseins. L'élan spéculatif, le vol platonique naturel aux trois Italiens, ne manque-t-il pas trop aux trois Français ? Ceux-ci sont infiniment plus politiques, c'est-à-dire, plus théocrates. Si leurs émules d'Italie le sont moins, c'est peut-être pour avoir vu de plus près les inconvénients qu'entraîne après elle toute théocratie. [page 494]
La passion de la théocratie, voilà ce qui caractérise les noms illustres qui, entre 1800 et 1830, poussèrent si vivement les esprits à la restauration du catholicisme (1). A côté d'eux, avant eux, après la chute du clergé comme Ordre de l'Etat, après l'éclipse passagère du christianisme officiel, d'autres talents s'étaient dévoués à la renaissance du sentiment religieux, et même au réveil de la foi chrétienne. A plusieurs égards, imitateurs de Rousseau et de Bernardin de Saint-Pierre, tous deux si habiles à montrer l'intention divine dans les harmonies de la nature, à attirer, par les charmes de l'imagination, les âmes jeunes ou tendres au créateur bienfaisant de l'univers, au père affectueux des hommes, Chateaubriand et Madame de Staël, et plus tard Benjamin de Constant, firent servir les beaux-arts, l'histoire, la morale, la philosophie même, au rétablissement du culte, au retour d'une piété sincère et lumineuse. Mais ce furent des artistes, des moralistes, des critiques de génie. D'autres voix encore avaient essayé de féconder les germes de mysticité qui dorment dans toute intelligence. L'illuminisme du cœur avait parlé, avec une suavité onctueuse, par la bouche élégante du doux et profond Saint-Martin. Mais ce fut un théosophe, qui avait la tête dans le ciel, et dans un ciel quelque peu nébuleux (2). Ce n'étaient pas des théocrates non plus, ces [495] prêtres modérés et instruits, oui, à l'exemple de l'évêque d'Hermopolis et du cardinal de Bausset, cherchaient à réconcilier le raisonnement libre avec les dogmes et les usages de l'Eglise, défendaient tour, à tour la philosophie contre les proscriptions, ultramontaines et la religion contre ses contempteurs, désiraient enfin éviter toute injustice, en faisant droit à tous les nobles tendances de l'esprit humain.
Notes
1. Il est inutile de recommander ici les chapitres où l'exact et intègre M. Damiron traite de l'Ecole théologique, dans son Essai sur l'histoire de la philos. en France au XIXe siècle, T. I.
2. Mot de M. Joubert sur Saint-Martin.
![]() Livre XIV – Réaction religieuse du Midi – Chap. II. En France – Extrait, pages 493-494
Livre XIV – Réaction religieuse du Midi – Chap. II. En France – Extrait, pages 493-494
Lamennais, extrait, pages 525-528
C'est aussi une réminiscence de la première période, que l'habitude de représenter les formules de la foi officielle comme la source voilée des vérités spéculatives. Une réserve importante, cependant, doit être faite à cet égard. Ces formules traditionnelles, Lamennais a cessé de les prendre dans le sens de l'orthodoxie ; il les interprète avec la liberté des mystiques, à la façon [page 526] du néoplatonisme chrétien. C'est à la Somme de Thomas d'Aquin qu'il emprunte encore l'organisation de son système, commençant par Dieu et l'essence divine, pour passer à l'univers et à ses lois, puis à l'homme et à sa constitution individuelle, et pour traiter enfin de l'ordre dans la science et dans la société. Mais c'est d'un alexandrin du XVIe siècle qu'il tient ses vues sur cette trinité qui, suivant Campanella, compose d'abord les trois propriétés premières de l'Etre, ses primalités ; ensuite, les trois éléments de la création. Autant Lamennais avait lu jadis et même cité Montaigne, Charron et Sanchez, autant il consulte pour l'Esquisse, mais sans l'y citer, le panthéiste de la Calabre. Ce dominicain savant et pieux, dont le cardinal de Richelieu avait favorisé l'évasion de Rome, et qui avait toujours rêvé l'intime alliance du dogme romain avec une philosophie indépendante, était pour le penseur breton ce qu'un autre dominicain de Naples, moins respectueux envers l'Eglise, avait été pour Schelling. Au surplus, Schelling lui-même pouvait, aussi bien que le P. Ventura, avoir fait goûter Campanella à Lamennais, pendant le séjour que celui-ci avait fait à Munich, après son retour de Rome, en 1832 (1).
La trinité néoplatonicienne, qu'avait aussi adoptée [page 527] partiellement Saint-Martin, est le fond ou la clef de ce nouveau système, auquel elle donne, sinon une haute probabilité, du moins un air remarquable de simplicité et de cohésion, analogue aux apparences dont Hegel avait su revêtir ses triplicités et sa trichotomie. L'être dont part Lamennais, après Schelling et Hegel, après Rosmini et Gioberti, la substance unique et infinie, renferme trois qualités essentielles et trois manifestations distinctes : la puissance, l'intelligence et l'amour. Puisqu'il est, l'être doit pouvoir être : puissante. Mais rien ne peut subsister sans cette forme déterminante, c'est-à-dire intelligible : intelligence. La puissance et l'intelligence se développant ensemble, l'une par l'autre, sont nécessairement unies : amour. Or, la puissance, l'intelligence et l'amour, conçus individuellement, constituent trois personnes distinctes à la fois et identiques, distinctes dans leur essence, identiques dans l'unité suprême de la substance infinie. Le Père, grâce à la conscience qu'il a de son être propre, conçoit tout ce qu'il est, et engendre ainsi le Fils, qui est donc égal et coéternel au Père. Du lien mutuel, aussi effectif qu'indissoluble, qui unit le Père au Fils, procède l'Amour ou l'Esprit (2). Ce n'est pas encore tout. Cette triade éternelle a librement voulu réaliser, ou produire au dehors, ce qui n'existe primitivement que dans l'entendement divin, ou dans le Verbe. Là résident, avec une splendeur indicible et inimitable, les [page 528] idées accomplies, les types éternels des êtres finis. Trois ordres réfléchissent la trinité dans les mondes peuplés par ces êtres. Le premier, où la puissance domine, où la force se transforme en mouvement, c'est le règne inorganique, spécialement soumis aux lois mathématiques. Le second ordre, le règne organique, asservi principalement aux lois physiologiques, est la sphère de l'intelligence, de la sagesse qui se convertit en forme et en lumière. L'amour ou la bonté, source de la chaleur et de la vie, doit être le principe et la règle du règne véritablement humain, des êtres spirituels et libres. Dans la société humaine enfin, la puissance se manifeste par l'industrie, l'intelligence par les sciences et la philosophie, l'amour par les arts et la religion.
Notes
1. Les analogies de la Philosophia universalis de Campanella avec l'Esquisse de Lamennais sont si nombreuses et si frappantes, qu'il faut bien considérer celui-ci comme un disciple de celui-là. Voy. part. la IIIe partie de la Philosophia universalis; et comparez tout ce qu'ont dit d'exact et de fin, sur l'Esquisse, M. Ter. Mamiani, dans l'écrit Dell' Qntologia e del metodo; et M. Jules Simon, dans la Revue des Deux-Mondes (15 février 1841).
2. Nous n'avons besoin ni d'indiquer les ressemblances de cette théorie avec celles des Hegel, des E.-H. Fichte, des Weisse; ni de rappeler combien ces sortes d'interprétations sont capricieuses et illusoires.
![]() Lamennais, extrait, pages 525-528
Lamennais, extrait, pages 525-528
Saint-Martin, extrait, pages 546-559
Les étrangers, rendons-leur cette justice, se montrent plus équitables envers les noms qui honorent la pensée française. N'avons-nous pas vu plusieurs fois d'illustres Allemands devenir les disciples de Saint- Martin, ses traducteurs ou ses commentateurs (1) ?
Le théosophe d'Amboise méritait-il les honneurs que lui ont rendus François Baader, Claudius, Hoffmann, Schubert, Varnhagen d'Ense ? « Il est juste de reconnaître, répond M. Cousin, que jamais le mysticisme n'a eu en France un représentant plus complet, un interprète plus profond et plus éloquent, et [page 547] qui ait exercé plus d'influence que Saint-Martin (2). » « C'est plutôt du côté de Fénelon, dit à son tour M. de Rémusat, qu'il faut placer Saint-Martin, qui a, dans sa foi naïve et simple, tenté de remplacer l'esprit philosophique et la tradition ecclésiastique par une révélation dont il ne trouvait le titre que dans sa pensée. De tous les mystiques hétérodoxes, c'est peut-être le plus chrétien ; c'est assurément le plus intéressant. Il est de ces hommes dont on ne parle que pour en dire du bien... C'était un libéral nullement révolutionnaire, un chrétien de cœur, sinon d'esprit, un philosophe par l'intention, et non par la méthode (3). »
Aussi la France a-t-elle suivi l'exemple de l'Allemagne, à laquelle madame de Staël avait d'abord signalé les lueurs sublimes de M. de Saint-Martin. Le surnom de Philosophe inconnu n'est plus exact parmi nous, depuis que la critique littéraire s'est ingénieusement unie à l'analyse des théories, pour éclairer , pour faire aimer même la vie presque ascétique, le langage élégant et les doctrines profondes ou bizarres du courageux adversaire de Condillac, du gracieux sectateur de Jacob Bœhme (4).
L'intérêt, éveillé partant de bons juges, doit en effet s'accroître pour quiconque a reconnu que [page 548] Saint-Martin, loin d'être un phénomène isolé, et comme un accident hétéroclite, dans le XVIIIe siècle, fut à la fois un des plus fermes contradicteurs du matérialisme et le plus pur représentant du mysticisme contemporain. Le matérialisme d'alors a trop fait oublier un mysticisme, que ses hardiesses avaient provoqué et encouragé. Partout, au Midi comme au Nord, les extases de l'illuminisme avaient répondu aux abus de l'analyse physique et logique, de la physiologie ou de l'idéologie. Peut-être n'y a-t-il pas une seule variété du mysticisme, qui n'ait été renouvelée entre 1750 et 1800. Depuis la théosophie contemplative et silencieuse, pratiquée par les continuateurs de Bœhme et de Poiret, de madame Guyon et de Muralt, l'auteur de l'Institut divin ; depuis l'enthousiasme prophétique d'une théurgie systématique ou ascétique, d'une opération parfois magique pour s'asservir les puissances, partiellement essayée dans les pays Scandinaves par Swedenborg et l'Ecole du Nord, en Suisse par Dutoit, Kirchberger, Lavater, à Berlin et à Avignon par l'abbé Pernetty ; jusqu'à cette thaumaturgie bruyante des véritables chercheurs du grand œuvre et des sciences occultes, des devins et des nécromants, des magnétiseurs et des somnambules, des sorciers et des charlatans, d'un comte de Saint-Germain, d'un Mesmer, d'un Cagliostro, et de ces sociétés d'harmonie, dont les adeptes disposaient à leur gré des merveilleux mobiles de l'agent universel, de la sympathie et de la volonté: toutes les idoles de la crédulité, toutes les ivresses du vertige reparurent, comme autant de protestations de [page 549] la fantaisie ou du sentiment contre la négation du monde spirituel et surnaturel. De tous ces gnostiques du XVIIIe siècle, celui qui influa le plus directement sur Saint-Martin fut le fondateur d'une secte nombreuse en France, à laquelle Saint-Martin s'affilia jeune à Bordeaux, les Martinistes. Juif portugais et versé dans la Kabbale, Martinez Pasqualis avait créé, dans les principales villes de France, un enseignement secret, tiré d'une tradition occulte, accompagné d'initiations mystérieuses à plusieurs degrés, et ayant pour principal objet de mettre les adeptes en rapport avec une hiérarchie d'agents surnaturels et de puissances célestes.
Lorsque Pasqualis mourut à Saint-Domingue en 1779 [en 1774], Louis-Claude de Saint-Martin avait trente-six ans [31 ans]. Il était né, d'une famille ancienne, à Amboise, le 18 janvier 1743, et s'était assez distingué dans la carrière des armes pour être en 1789 chevalier de Saint- Louis. Deux philosophes très différents modifièrent sa pensée, après Pasqualis : J.-J. Rousseau et Jacob Bœhme. Il embrassa les idées les plus généreuses du premier, et emprunta au second, avec grand nombre de conceptions profondes, un nombre plus considérable de ces mystères qui, selon Leibniz, ne sont que spectra imaginationis et mirabiles nugœ, quand ils ne sont pas de « belles allégories ou images. » Non seulement il traduisit trois ouvrages de « notre ami Bœhme, » mais il s'en rapprocha dans la plupart de ses écrits, singulièrement dans son Esprit des choses, où la recherche de la secrète raison de chaque être correspond à [page 550] ce que le philosophe tectonique avait appelé la signature des choses. A quarante-deux ans Saint-Martin publia son ouvrage le plus connu : Des erreurs et de la vérité. Depuis lors une série variée de productions originales devait servir à rappeler la philosophie à l'étude de l'homme, de l'homme-esprit, de l'homme formé à l'image de Dieu, tel qu'il fut dans sa primitive pureté, qu'il cessa d'être par la chute originelle et qu'il peut redevenir par l'entretien avec Dieu. L'Homme de désir (1790) est un répertoire de ces prières régénératrices, de ces élévations qui aboutissent à la réintégration en Dieu. Le Nouvel homme (1792) devait encore mieux dessiner notre vraie destination : conception de Dieu, chacun est appelé à faire en sorte que son existence soit le simple développement de cette conception, un emploi divin de la puissance spirituelle dont chacun est dépositaire et qui a pour but la double délivrance de l'humanité et de la nature. Le bien général, tel fut en effet la préoccupation dominante du théosophe. Aussi ne fut-il pas, comme les théocrates de son temps, un ennemi de la Révolution ; il sut l'observer avec impartialité, la juger avec équité. Il y vit l'accomplissement des desseins que la Providence a formés pour le salut des hommes. Il pensa d'ailleurs que les inégalités sociales, étant le résultat de la chute primitive, disparaîtraient à mesure que les hommes se relèveraient par l'usage des moyens spirituels. Une supériorité visible de vertu et de lumières deviendrait le signe distinctif de l'autorité religieuse et politique, et en ferait l'expression de la justice accomplie. [page 551] Rousseau, qui avait si bien distingué entre sentir et juger, l'aidait aussi à combattre le matérialisme à la mode. On sait avec quel talent Saint-Martin réfuta, en plein amphithéâtre, la doctrine que le « citoyen Garat » exposait aux Ecoles normales, comme « professeur d'analyse de l'entendement humain. » Un des premiers il rétablit l'autorité du sens moral, puis la distinction entre la sensibilité, commune aux hommes et aux animaux, et l'intelligence, faculté innée et exclusivement réservée à l'homme. Il ne détruisit pas avec moins de succès une hypothèse chère à Condillac, reproduite avec originalité par Donald, savoir, que la science est le résultat d'une langue bien faite. Mais, répliquait Saint- Martin, l'idée précède le signe, et une langue bien faite serait le produit, le reflet d'une science déjà parfaite. L'admiration que lui inspirait le Premier Consul le remplissait de hautes espérances pour la France et le monde, lorsqu'une attaque d'apoplexie l'enleva le 13 octobre 1803.
La plupart de ses ouvrages nous donnent, sur ses tendances religieuses, la conviction que l'on puise particulièrement dans son Tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l'homme et l'univers (1782). Malgré les réticences et les voiles dont il couvre souvent sa pensée intime, ou plutôt celle de ses amis, et malgré la différence qu'il met, dans ses propres théories comme dans les doctrines chrétiennes, entre une conception ésotérique ou secrète et une exposition exotérique ou publique, il est aisé de s'apercevoir que le panthéisme est l'âme de son système. L'homme lui est une [page 552] émanation de Dieu, et, après s'être détaché de son principe par une sorte de révolte, l'homme peut et doit, au moyen d'une transformation qu'opère l'extase, rentrer en Dieu et redevenir divin. Toutes les essences, spirituelles ou corporelles, dérivent de la substance divine, de cette substance unique et universelle, qui circule à travers la matière et au fond des esprits. Les différences ne tiennent qu'aux intermédiaires, où, du reste, la vie est également une, dans son origine et dans sa fin. L'unité de fin, poursuivie au milieu de l'infinie variété des moyens, ne saurait être que l'ouvrage même de Dieu. Toutes choses se trouvent ainsi rattachées ou ramenées à Dieu, et la philosophie est, non plus seulement une théosophie, mais une théogonie : c'est l'histoire des formes que revêt la Divinité au travers des substances célestes, des puissances merveilleuses sans nombre, qui composent l'ensemble des êtres et de leurs rapports.
Que l'on cesse, au surplus, de dire que ce système ne renferme rien de durable, rien d'utile. Saint-Martin savait réfléchir et discuter, et non uniquement rêver et conjecturer. Ses remarques sur les preuves de l'existence de Dieu méritent d'être examinées attentivement. On le voit, non sans un vif intérêt, dans son Ministère de l'Homme-Esprit et son Esprit des choses, et même dans sa Lettre sur la Révolution, débattre les démonstrations tirées de l'ordre du monde et des causes finales, de la même manière à peu près dont Kant les discutait dans la Critique de la raison pure (5). [page 553] Toutes ces preuves sont impuissantes, dit-il, quand il s'agit de combattre les naturalistes. Ceux-ci admettent aussi une cause créatrice, qu'ils placent dans la nature, tandis que les spiritualistes la mettent hors de la nature. Elles sont insuffisantes en général, en ce qu'elles ne peuvent nous faire comprendre la nature de Dieu qui est esprit, c'est-à-dire perfection spirituelle et morale, amour et intelligence, bonté et sainteté, liberté et justice. Pour établir la réalité du vrai Dieu, il faut s'appuyer sur un fondement qui correspond à la nature vraiment divine, sur les facultés aimantes et intelligentes, sur cette âme de l'homme qui, réduite à ses éléments, se trouve être de la région de Dieu même et être prise par lui pour son témoin. La véritable nature de l'âme n'est-elle pas tout désir et tout amour, amour de l'invisible, désir de l'infini, besoin d'admiration constante ? Or, la nature, qui est une tendre mère, ne peut avoir mis en nous, uniquement pour le tromper, cet instinct qui nous élève sans cesse à ce qui est au-dessus de nous. Non, cet instinct a un objet certain ; et cet objet, c'est Dieu même. « Cette source permanente et éternelle, ce nécessaire admirable, nous ne courons aucun risque de l'appeler Dieu, puisque chez tous les peuples ce nom a présenté l'idée d'un être qui est plus que nous, et qui excite en nous tous les genres d'admiration : l'admiration de la puissance, par les œuvres merveilleuses qui se développent à nos yeux; l'admiration de la sagesse, par les profondeurs de la pensée; l'admiration de l'amour, par le sentiment des inépuisables trésors dont cette source [page 554] enrichit notre âme (6)... » Combien cette démonstration platonicienne trouvait peu d'échos en Europe, alors qu'on jugeait aventureuses déjà les tentatives analogues de Hemsterhuys et de Jacobi (7) !
Elle est importante aussi, en ce qu'elle montre de quels éléments Saint-Martin composait la nature de Dieu. Dieu lui est l'absolue perfection, l'unique source de l'être, la plénitude de la vie et de l'esprit. Voilà pourquoi il lui répugne de décomposer la nature divine en facultés, en attributs, en manifestations différentes. Dieu est entièrement simple et un, l'Unité même; toutes ses puissances se confondent, s'absorbent les unes dans les autres ; toutes s'identifient ensemble dans l'unité de l'amour, principe de l'être divin. Intelligence, beauté, sainteté sont des subdivisions, des distinctions que l'homme fait seulement parce qu'il est trop faible pour concevoir l'unité de la perfection suprême, et parce qu'il a besoin d'accommoder l'ordre divin à l'ordre créaturel. « Attributs divins, s'écrie Saint-Martin, vous prenez des noms selon les œuvres que Dieu se propose, et selon les êtres sur lesquels il doit agir ; mais toutes nos langues sont passagères, et il ne restera à jamais que la langue divine, cette langue qui n'est composée que de deux mots : Amour et Bonheur (8). »
Toutefois, à l'exemple de tant d'autres mystiques chrétiens, le théosophe français consent à diviser [page 555] l'Univers en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité lui parait un Ternaire éternel et sacré, type d'un ternaire universel et temporaire, qui se reproduit et domine même dans toutes les sphères de la création, dans les dimensions du corps et les figures de la géométrie, aussi bien que dans les facultés de l'âme et les' degrés de l'expiation humaine. De même que l'Unité se ramifie en trois personnes, elle se multiplie à l'infini, en épanchant sans cesse de son sein inépuisable des légions d'êtres et de forces, par cela seul qu'elle conçoit à tout instant des myriades de pensées. « Sa pensée ne connaît point d'intervalles, et toutes ses pensées sont des créations... Ces légions d'êtres se succèdent comme les vagues de la mer, ou comme les nuages nombreux poussés dans les airs par l'impétuosité des vents... Rien n'est doux comme cette génération éternelle. Tous les êtres s'y succèdent en paix et d'une manière insensible, comme les heureuses pensées qui naissent en nous, et dont la formation ne nous coûte aucun effort (9). » Générateur direct de toutes choses, plutôt que créateur, Dieu fait sortir du fond de son amour et de son intelligence, non seulement les êtres individuellement distincts, mais aussi cette multitude d'attributs et de puissances qui deviennent à leur tour des agents producteurs. Ces puissances, ces vertus créatrices constituent tout un monde d'essences inférieures, monde infini en ce que la fécondité divine, sa source, n'a point de limites. Quel que soit le plan de cet univers, intermédiaire entre [page 556] l'Unité suprême et les êtres individuels, rien n'y existe que par un certain épanchement du Verbe, par la bénédiction du Fils. Il y a autant d'ordres de bénédictions qu'il y a de membres dans le Ternaire : les bénédictions sont éternelles, spirituelles et corporelles. Celui qui dispense ces bénédictions, ces forces, le Fils, est le médiateur des différentes classes d'êtres et le lien des substances et des mondes, comme il est l'expansion même de la substance universelle et l'union vivante du premier principe avec les substances secondaires qui remplissent l'immensité. En même temps qu'il manifeste Dieu, le Verbe constitue l'invisible essence des créatures visibles. Il est cette cause active et intelligente qui habite dans chaque être, qui s'incarne dans tous ces verbes inférieurs, c'est-à-dire dans les hommes et dans la nature... Combien pareil christianisme diffère du christianisme évangélique, Saint-Martin ne l'ignore pas : aussi le qualifie-t-il de futur et d'idéal, en l'opposant au catholicisme. Celui-ci lui semble une servitude d'esprit, comprimant nos facultés sous le joug des épreuves, des mystères et des commandements ' positifs ; tandis que l'autre dilate les intelligences par l'évidence de la foi et la liberté de la prière...
La logique exigeait que ce panthéisme mystique niât la différence du bien et du mal. Saint-Martin, cependant, l'établit avec énergie. « Le mal existe dans vous, dit-il aux optimistes, autour de vous, dans tout l'univers, et vous n'êtes occupés qu'à être aux prises avec lui (9). » Sans craindre de se démentir, il place l'origine [page 557] du mal dans une déviation de la volonté humaine. Se détournant de l'Unité, Satan et l'homme sont tombés, quoique inégalement, l'un par orgueil, l'autre grâce à la séduction. Pendant que Satan se consume dans une impuissance furibonde, l'homme languit après une délivrance qui lui a été promise. Au reste, ni l'enfer ni le ciel ne sont des espaces déterminés ; ce sont des états intérieurs. Le ciel est la situation propre à un cœur pur, l'enfer est la disposition d'un cœur souillé, et se confond avec le mal même, puisqu'il en est l'effet nécessaire. S'il y a pour l'homme une réintégration finale, ne faut-il pas que le démon aussi puisse en espérer une ? La résipiscence de l'être pervers et la réhabilitation de l'enfer semblent des conséquences immanquables de l'unité de l'amour, laquelle doit exclure un éternel éloignement de Dieu.
Par quelle voie Saint-Martin avait-il pu s'élever si haut, pénétrer si avant ? Par l'extase. Il se contentait, en effet, d'une communication passive et docile avec ce Dieu, qu'il appelle l'intérieur, le centre, l'unité ; c'est-à-dire, d'une communication qui consistait à dépouiller toute volonté propre, toute réflexion, toute personnalité, et à contempler alors ce dont Dieu daignait rendre témoin celui qu'il visitait. Une certaine humilité de cœur remplissait Saint-Martin de défiance pour la théurgie, qui veut agir sur Dieu, obérer sur les puissances, et les forcer à lui livrer leurs secrets. L'emploi des moyens sensibles et externes, pour approcher les êtres surnaturels, lui faisait craindre de devenir la dupe de mauvais esprits, de l'ennemi. S'il accorde [page 558] que les puissances secondaires sont en état d'apparaître à l'homme, il est convaincu que nul homme n'a vu Dieu, quoique Dieu se fasse sentir à nous, en descendant dans nos âmes, pour y prier (10). Sa connaissance intuitive est tellement intérieure et individuelle, qu'il évite même les moyens collectifs des initiés, et toutes les pratiques mystérieuses de ce qu'il nomme la chapelle.
Faut-il poursuivre l'application de ce pieux illuminisme à travers les problèmes que soulèvent l'origine et la destination de la nature, ou l'essence de cette matière, qui n'est qu'une vaine apparence, créée pour molester le démon, en le séparant des pures essences ? Il suffit, ce semble, d'avoir montré que le philosophe inconnu fut, par son enthousiasme autant que par sa hardiesse, l'organe de la plus importante réclamation de la théosophie contre l'irréligion du dernier siècle ; et d'avoir fait voir en même temps qu'il ne pouvait guère produire sur ce siècle d'impressions profondes. Pareilles impressions pouvaient-elles être l'œuvre d'autres écrivains religieux, tenant une sorte de milieu flottant entre un christianisme plus ou moins orthodoxe et un mysticisme plus ou moins indépendant ? Ni l'érudition du baron d'Eckstein, ni l'élévation du généreux auteur de la Palingénésie sociale, si gracieusement caractérisé par M. d'Eckstein même (11), le candide et aimable Ballanche, ni tel autre mérite propre à d'autres défenseurs de la Providence, n'étaient en état d'arrêter tous les égarements de la fausse philosophie.
Cette mission était réservée à un spiritualisme plus [page 559] libre et sévèrement scientifique, mais dont l'histoire ne peut pas encore s'écrire. Sa carrière est loin d'être accomplie ; c'est à peine si sa première phase, toute militante, est entièrement achevée. Nous voulons parler de ces efforts critiques et polémiques, plutôt que dogmatiques et abstraitement spéculatifs, que firent Laromiguière et de Gérando, Maine de Biran et Royer Collard, pour vaincre le sensualisme du XVIIIe siècle, encore soutenu vers 1800 par des esprits fort élevés, par de très nobles caractères, avec lesquels ils s'entendirent si bien sur d'autres points essentiels. Les principes consacrés en 1789, que ces spiritualistes avaient adoptés en commun avec Garat et Volney, avec Cabanis et Destutt de Tracy, excluaient au fond les doctrines du matérialisme ; et c'est ce qu'il fallait montrer alors avec l'autorité de l'évidence. La contradiction, l'inconséquence était visible pour le spectateur impartial, mais l'empire exercé par Locke et ses disciples avait été si vaste et si pénétrant, qu'il était rare en France de rencontrer un spectateur pareil. L'étonnement fut général, lorsqu'on entendit quelques enfants du XVIIIe siècle même avancer qu'une politique libérale et généreuse était incompatible avec une philosophie fataliste, nécessairement égoïste ; et qu'on chercherait vainement à affranchir le citoyen, si l'ou n'avait d'abord affranchi l'homme, c'est-à-dire, si l'on n'avait remplacé la toute-présence des sens et du monde physique par la souveraineté de la raison et du monde moral (12).
Notes
1. Voyez, ci-dessus, T. II, p. 144,150.
2. M. V. Cousin, Hist. de la philos, mod., Sér. II, T. III, p. 9.
3. M. Ch. de Rémusat, à propos du savant et vigoureux ouvrage de M. E. Caro, Essai sur la vie et la doctrine de Saint-Martin (1852).
4. Malgré les mérites divers du livre de M. Caro, il y a autant de plaisir que d'avantage à relire les morceaux de MM. Damiron, Bouchitté, Gence, E. Stourm, et surtout les pages si délicatement pénétrantes du tome X des Causeries du lundi.
5. Voyez la monographie de M. E. Caro, p. 170 sqq
6. Saint-Martin, Œuvres posthumes, II, p. 360.
7. Voyez, ci-dessus, T. II, p. 27 sq.
8. Saint-Martin, Homme de Désir, II, p. 92.
9. Homme de Désir, II, p. 65, 202.
10. Homme de Désir, I, p. 162.
11. Homme de désir, II, p. 118, — Voyez le Catholique, 1828, février.
12. Voyez les Notices historiques sur Cabanis, sur MM. de Gérando et de Tracy, par M. Mignet.



