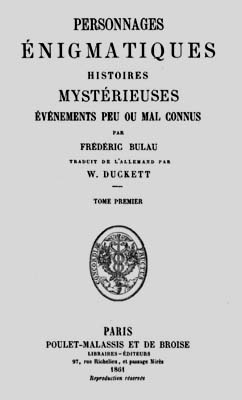 1861 - Personnages énigmatiques – Histoires mystérieuses – Évènements peu ou mal connus
1861 - Personnages énigmatiques – Histoires mystérieuses – Évènements peu ou mal connus
Par Frédéric Bülau
Traduit de l’allemand par W. Duckett
Tome premier
Paris. Poulet-Malassis et De Broise, libraires éditeurs, 97, rue Richelieu, et passage Mirès.
1861
Table des matières (extrait)
La superstition au XVIIIe siècle.
La comtesse de Cosel
Cagliostro
Duchanteau et Clavières
Le comte de Saint-Germain
MM. de Hund et Alten-Grotkau. Les Templiers
Schrepfer
Jacques-Hermann Obereit
Madame de La Croix
La Condamine et les Convulsionnaires
Cazotte
La comtesse de Cosel. Extrait, pages 287-291
… Par une semblable direction des idées, certains contrastes que présentaient à la même époque les mêmes classes de la société n'en frappent que davantage l'observateur. C'est ainsi qu'en pratique, l'esprit de scepticisme dont nous parlons continuait de faire un très large usage de choses qu'il rejetait en théorie, notamment dans les affaires politiques et ecclésiastiques. Il est facile de reconnaître qu'ici l'égoïsme était le mobile dirigeant. La haute société ne croyait plus vraies ni licites beaucoup de choses qu'elle considérait cependant comme grandement utiles pour tenir en bride les classes inférieures. Nous ne parlerons que sommairement ici des minorités, qui, loin de pactiser avec de semblables tendances, se jetaient dans une direction tout opposée et cherchaient surtout une satisfaction à ce besoin d'idées religieuses qui est inné chez l'homme, dans les aspirations qu'on désigne d'ordinaire par les qualifications de mystiques ou de piétistes. C'est ainsi, par exemple, que dans l'église protestante on voit apparaître alors les hernhutes et les disciples de Spener, de même que dans l'église catholique les disciples de Port-Royal et ceux de Saint-Martin. On ne saurait précisément dire que [page 288] ces tendances-là aient été une réaction contre le scepticisme. Toutes deux furent bien plutôt des protestations contre la stérilité de la foi qui s'attache seulement à la lettre, contre la stérilité des œuvres purement extérieures et de tout ce qui dans les anciennes églises n'est qu'affaire de forme ; protestations qui, pour être différemment formulées, n'en eurent pas moins le même point de départ. Enfin, nous ne voulons pas attacher autrement d'importance aux inconséquences qui, comme il arrive partout où le préjugé se trouve en jeu, apparaissent dans des caractères pris isolément, alors par exemple qu'on voit un athée avoir peur des revenants, ou bien encore un sceptique déterminé se faire tirer les cartes par quelque vieille femme, ou employer tel autre moyen superstitieux tout aussi ridicule pour attraper un bon numéro à la loterie. Un fait que nous nous bornerons à signaler encore ici en passant, c'est que les mêmes sphères sociales qui s'affranchissaient des liens des vieilles croyances, qui proclamaient bien haut la venue du règne des lumières, du scepticisme et de la raison, étaient cependant toutes disposées à adopter comme autant de vérités les extravagances et les illusions les plus absurdes, pour peu qu'elles se présentassent à elles sous des formes nouvelles ; ce qui explique comment dans tous les pays de l'Europe il arriva alors à la société élégante et polie d'être si souvent dupe de quelques fripons ou songe-creux dont on eût pu découvrir les tours de passe-passe ou les folies avec bien moins de sagacité qu'il n'en fallait pour combattre l'ancien système. Le siècle des Voltaire et des Diderot fut aussi celui des Cagliostro, des Gassner, des Schrepfner; il évoqua les esprits, rechercha la pierre philosophale, [page 289] se complut dans des associations mystérieuses et fantastiques, qui l'attiraient à elles en lui promettant la révélation d'importants secrets − mais, il va sans dire, sans jamais tenir leurs promesses, − et s'éprit tantôt de telle idée, tantôt de telle autre, avec le même fanatisme, la même absence de critique et de réflexion, qui avaient porté le moyen âge à admettre pour vrais tant de miracles absurdes. Une foule de Parisiens, qui pour tout au monde n'auraient pas voulu entendre parler des miracles, des reliques et des saints de la vieille église catholique, accouraient au tombeau de François Paris, ou bien allaient se faire étouffer dans des assemblées consacrées et sanctifiées uniquement par un peu de terre recueillie près de ce tombeau ; et cela, par le seul motif qu'il s'agissait ici d'un saint janséniste, d'un saint de nouvelle invention, d'un saint de l'opposition !
Ce phénomène est incontestable, et à première vue peut paraître étrange ; mais pourtant il s'explique facilement. On se trouvait alors à une époque de transition où le vieil ordre de choses s'écroulait en ruines, et où le nouvel édifice social n'était pas encore construit. La grande masse de ce qu'on appelle les classes éclairées avait emprunté à la nouvelle science ses doutes à l'endroit des autorités acceptées jusqu'alors, et comme un vague pressentiment de grandes et prochaines vérités, ainsi que des triomphes réservés au génie de l'homme ; mais cela sans bases sûres et approfondies. Elle avait renoncé aux anciens mystères, mais son imagination en demandait d'autres. Rien ne pouvait mieux donner satisfaction aux désirs effrénés de jouissance dont elle était tourmentée, que la perspective de trésors inépuisables et augmentables à [page 290] volonté; or, pour cela, les principes formulés par l'économie politique étaient ce dont on se préoccupait le moins. Si on niait la vie future, ou si on chassait bien loin de soi tout ce qui pouvait la rappeler, il y avait cependant impossibilité de nier la vieillesse et la mort, et on se serait estimé heureux de trouver un moyen pour se mettre à l'abri de l'une et de l'autre. De même que dans les sentiers de l'ancienne foi, ils n'étaient que trop nombreux ceux qui se croyaient quittes de toute responsabilité moyennant certaines prières, certaines cérémonies ou certaines pratiques. Sans se pénétrer du véritable esprit religieux, qui seul peut donner à de telles choses de la valeur et de la force, les nouveaux disciples de la sagesse et de la vertu crurent que pour les posséder il suffisait de quelques courtes maximes faciles à retenir par cœur; puis, à l'aide de cérémonies bizarres de diverses espèces, et en vertu d'une sentence prononcée par d'autres hommes, ils s'imaginèrent pouvoir parvenir à une sphère intellectuelle et morale plus haute, sans avoir rien fait qui pût les élever intellectuellement et moralement. Les premières découvertes faites dans le domaine de la chimie et de la physique, découvertes qui devaient conduire à la complète transformation de ces deux sciences, surexcitèrent l'attente du public et fournirent aussi à quelques charlatans l'occasion de pratiquer une foule de mystifications que facilitait singulièrement l'ignorance où étaient demeurées les masses relativement aux progrès récemment accomplis. Le dix-septième siècle avait d'ailleurs transmis au dix-huitième beaucoup de souvenirs et de traditions, héritage des générations antérieures, qui s'étaient conservés dans quelques cercles restreints, et [page 291] qui prirent alors de nouvelles formes en même temps qu'ils s'armaient de nouveaux moyens d'action. Parmi ces souvenirs et ces traditions il faut ranger le désir de ramener l'origine de la nouvelle sagesse secrète aux pyramides d'Égypte et à leurs prétendus prêtres, de même que l'idée déjà maintes fois émise et acceptée qu'il fallait être juif pour parvenir à quelque chose de grand dans la kabbale.
C'est là ce qui nous engage à parler à ce propos de la comtesse de Cosel, que l'on est habitué à ne considérer que comme la prodigue maîtresse d'un prince qui était passionné pour le luxe et la magnificence. Si nous la faisons figurer la première dans cette espèce de galerie, c'est, d'une part, que son nom nous ramène aux premières années du dix-huitième siècle, et, de l'autre, que ce qui la concerne offre peu de rapports avec les autres figures que nous nous proposons de faire défiler ensuite sous les yeux du lecteur, tandis que celles-ci ont entre elles beaucoup d'analogie.
MM. de Hund et Alten-Groteau. – Les Templiers. Extrait, pages 351-362
La famille de Hund et Alten-Grotkau est une des plus anciennes de la Silésie. Dès 1480, les chroniques mentionnent un burgrave de Glatz du nom de Hund et Alten-Grotkau, qu'on trouve encore dans des chartes remontant à l'an 1300. A l'époque de la guerre de Trente ans, on voit un Wenceslas de Hund et Alten-Grotkau remplir les fonctions de président du tribunal de Liegnitz. Les effroyables ravages causés par cette guerre, et la peste qui en fut la suite, le forcèrent à déserter la demeure qu'il occupait à Liegnitz et à chercher un refuge à Fraustadt. Pendant cette émigration, il perdit femme et enfants, et quand il put enfin rentrer à Liegnitz, il trouva toutes les portes et fenêtres de sa maison condamnées extérieurement à l'aide de planches que l'autorité locale y avait fait clouer d'office, afin que des malfaiteurs ne pussent pas s'y établir en attendant le retour du propriétaire. Ses terres, ses fermes, étaient complètement dévastées et ruinées ; les champs étaient depuis longtemps restés sans culture. Au moment où il croyait pouvoir se mettre à l'œuvre pour effacer peu à peu les traces de tant de désastres, la Silésie devint encore une fois le théâtre de toutes les horreurs qui accompagnèrent cette guerre terrible entre toutes ; et il dut s'estimer heureux de pouvoir, en fuyant précipitamment en Pologne, échapper aux maraudeurs qui infestaient toutes les routes, où ils détroussaient et égorgeaient sans [page 352] pitié tous ceux qui leur tombaient entre les mains. Il mourut de misère en 1637 ; mais son fils aîné, à force de courage, d'intelligence et de travail, parvint à rétablir la fortune paternelle consistant en terres immenses qui, après être restées plus de vingt ans incultes, furent enfin rendues à l'agriculture. Ce fils aîné mourut à l'âge de 33 ans, sans avoir été marié; mais ses trois frères cadets fondèrent trois nouvelles branches dans la famille ; et c'est à l'aînée de ces lignes qu'appartenait l'individu dont nous avons à nous occuper ici.
Charles Gotthelf de Hund, né en 1722, se trouvait encore mineur quand il perdit son père. Sa mère et son tuteur ne négligèrent aucune précaution pour conserver ce dernier représentant de la race. Afin de lui donner une constitution plus robuste, on le laissa téter jusqu'à l'âge de neuf ans, et plus tard encore sa mère, quand elle rencontrait quelque part une nourrice vigoureuse et saine, lui faisait donner le sein par cette femme. En 1737, on l'envoya suivre les cours de l'université de Leipzig, et deux ans plus tard on le fit voyager sous la tutelle d'un certain colonel de Schœnberg. Il paraît qu'il s'amouracha de la fille de son Mentor, et que la mort prématurée de cette jeune personne influa puissamment sur sa destinée, car il prit dès lors la résolution de ne jamais se marier. En 1741, il arriva à Paris, où, par suite de ses relations intimes avec une grande dame, il se décida à embrasser le catholicisme; mais il tint cette conversion secrète pendant longtemps encore. En 1742, il vint à Francfort assister au couronnement de l'Empereur Charles VI, et l'Électeur de Cologne le nomma l'un de ses chambellans. Les mémoires [page 353] du temps le qualifient ordinairement de baron ; mais c'est là un titre auquel il n'avait aucun droit. A Francfort il se fit recevoir, le 20 mars 1742, dans la loge maçonnique de cette ville ; loge qui appartenait au système de Clermont, et où il ne devait pas tarder à jouer un rôle si important. Expliquons ici tout de suite que le rite maçonnique désigné sous le nom de Système de Clermont tire cette dénomination de l'hôtel de Clermont, situé dans les quartiers perdus de Paris, par delà la place Saint-Michel, hôtel qui fut habité pendant quelque temps par les Stuarts après leur expulsion d'Angleterre. Le rite maçonnique particulier inventé à l'hôtel de Clermont avait à l'origine pour but de favoriser la réussite de certaines intrigues jacobites et jésuitiques: Puis, quand tout espoir de réussite dut être considéré comme irrémissiblement perdu; quand l'Église, dont les chefs rompirent ouvertement en visière au jésuitisme pendant une bonne partie du XVIIIe siècle, eut interdit aux ecclésiastiques l'accès de toute loge maçonnique, celles du système de Clermont, qui avaient la prétention de n'être que la continuation de l'ordre du Temple, ne furent plus hantées que par des fripons ou des dupes.
C'est à cette dernière catégorie qu'appartenait notre M. de Hund, qu'il ne fut pas difficile d'amorcer en flattant sa vanité et en nourrissant l'humeur inquiète qu'il ressentait de voir que, dans le monde des affaires pratiques, on n'appréciait pas suffisamment en lui l'homme appelé, à ce qu'il croyait, par la nature de son esprit et de son caractère, à jouer un rôle important. Dès 1743, il s'était fait recevoir templier; il [page 354] avait été présenté alors au Prétendant, et à Maëstricht on l'avait nommé grand maître de l'Ordre pour la province de Basse-Allemagne. Hund fit aussi embrasser le Système de Clermont à Henri Marschall, grand maître de l'Ordre pour la province de la Haute-Saxe (1), et il organisa alors entre les diverses loges une confédération, qu'on désigna sous la dénomination de loges de la stricte obéissance, non pas parce qu'on y observait plus rigoureusement qu'ailleurs les véritables règles de l'Ordre, mais parce que leurs membres devaient prêter serment d'aveugle soumission envers des chefs qui demeuraient inconnus (2), et qui, suivant toute apparence, appartenaient à la société de Jésus. Hund fonda un grand nombre de loges de cette espèce, et réussit même à y rattacher la loge mère des Trois Boules du Monde. Dès leur fondation, les loges saxonnes avaient témoigné quelque sympathie pour le Système français, mais seulement pour certaines de ses pratiques et sous la réserve d'en éliminer tout ce qui pouvait être contraire à l'esprit national. La première loge saxonne, celle des Trois Aigles Blancs, avait été fondée à Dresde en 1738 par le comte Rutowski, dont l'admission dans l'Ordre datait de 1735; et le secrétaire de la légation française à Dresde, d'Escombes, y avait aussi pris une très grande part. La qualité de grand maître, prise par Hund, fut également reconnue par les loges fondées à Wittemberg et Leipzig. Hund et Marschall imprimèrent les mêmes [page 355] tendances aux autres loges successivement fondées à Dresde, à Leipzig, à Altembourg (3), à Sachsenfeld (4) et à Naumbourg (5). Les membres en étaient peu nombreux, mais appartenant en général aux classes élevées et influentes.
C'était là, entre les mains de Hund, un badinage à peu près inoffensif. Il s'y livrait sans avoir de but arrêté, et ne se préoccupait guère que de noms et de formes ; d'ailleurs, les meneurs secrets n'avaient pas alors grand chose à espérer de l'Allemagne pour les vues particulières qui leur servaient de mobiles. Mais l'existence de ces associations mystérieuses fournit à bon nombre d'aventuriers et de fripons l'occasion d'exploiter fructueusement la crédulité et la sottise de ceux des frères qui avaient de la fortune. Sous ce rapport, on peut citer notamment le Système Rosaïque, propagé de 1755 à 1761 en Allemagne et en Suède par un certain Rosa, ancien surintendant dans le pays d'Anhalt ; système dont les fidèles avaient la prétention de s'occuper d'alchimie, de théosophie, de cosmosophie et de mécanique. Puis, la loge des Architectes Africains, fondée à Berlin en 1756 par Kippen, et qui s'occupait de l'histoire des sociétés [page 356] secrètes, mais qui ne subsista que jusqu'en 1787 (6) ; la fameuse loge des Illuminés ; la loge des nouveaux Rose-croix, à laquelle appartenaient, dit-on, Schrepfer et Wœllner ; la loge des Frères Asiatiques, créée en 1780 en Autriche, ayant de nombreuses affinités avec les précédentes, qui fut plus particulièrement le théâtre d'une foule de fraudes et impostures, et qui eut pour principaux représentants à Stockholm le baron Ecker d'Eckhofen et le secrétaire de la cour Bohemann (7) ; la loge des Frères de la Croix, fondée en 1777 en Silésie, au sein de laquelle régnait un mysticisme basé sur une piété beaucoup plus sincère et plus ardente, mais qui fut fermée bientôt après. Un mysticisme encore plus profond prévalait dans la loge des Martinistes, ainsi dénommée soit d'après Louis Claude de Saint-Martin (né en 1743, mort en 1803), soit d'après son maître Martinez Pasquali (8). En France, les ramifications de l'Ordre ne furent pas moins nombreuses ; on peut citer par exemple la Maçonnerie Égyptienne, fondée par Cagliostro, la loge des Élu-Cohens, la Maçonnerie hermétique, la loge des Philalètes, etc. Mais ce fut précisément de France que toute cette confusion s'introduisit en Allemagne, à la suite des armées françaises, pendant la guerre de Sept ans. Une réaction salutaire ne tarda pas d'ailleurs à s'y [page 357] manifester contre ces tendances. Hund, qui, dans l'Ordre, se faisait appeler Eques ab ense, cédant aux suggestions d'un intrigant appelé Becker ou Leucht, et qui n'était autre qu'un comptable forcé d'émigrer à la suite de déficits beaucoup trop considérables trouvés dans sa caisse, mais qui prenait le nom de Johnson a Fuhnen, et prétendait avoir été envoyé en Allemagne par les chefs suprêmes d'Écosse, avec le titre de grand prieur, à l'effet d'y réformer la franc-maçonnerie ; Hund, disons-nous, cédant aux suggestions de cet intrigant, s'était laissé aller à convoquer, en 1764, à Altenberg près Kahla, un congrès où se réunirent un grand nombre d'initiés. On y exécuta des tours de passe-passe et des impostures de tous les genres. Johnson prétendit qu'il était poursuivi par le roi de Prusse, lequel voulait à toute force le faire arrêter en plein congrès. Pour faire échouer les perfides desseins de ce sournois de Frédéric II, Johnson plaça en vedette à tous les abords du local des réunions, divers frères de l'ordre des Templiers, tout bardés de fer et en grand costume, tandis que d'autres parcouraient en patrouilles les environs. Le dénouement très prosaïque de la farce, c'est qu'un beau jour notre homme délogea sans tambours ni trompettes, mais en emportant la caisse avec lui (9). Cette aventure excita parmi les membres du congrès de vraies défiances contre Hund, qui se vit bientôt l'objet de vives attaques, et qu'on mit en demeure d'avoir à faire enfin connaître les secrets supérieurs dont il se disait dépositaire. Il affirma alors sur son honneur et [page 358] sur son épée qu'il avait réellement été nommé à Maestricht grand maître de la septième province (10), et que jusque dans ces derniers temps il avait constamment correspondu avec un chef suprême inconnu, à Old-Aberdeen. La majorité voulut bien se contenter de cette déclaration; mais une minorité factieuse, ayant à sa tête le chirurgien-major Ellermann, et dont fit partie Zinnendorf, prétendit que cette déclaration ne lui apprenait en définitive rien de plus que ce que chacun savait déjà depuis longtemps; et Ellermann fonda alors, en 1766, avec les dissidents qui adoptèrent les formes du rite suédois, un système très sévère, quoiqu'on lui ait donné le nom de loge de l'Observance relâchée ; système d'après lequel fonctionnent encore de nos jours un grand nombre de loges maçonniques en Prusse et dans le Mecklembourg. A leur tour, les frères de la stricte Observance ne tardèrent pas à entreprendre, eux aussi, une réforme de leur loge, dans une assemblée générale tenue à Kohlo, où Hund réussit encore à se faire accepter en qualité de grand maître de la Basse-Allemagne, rien qu'en affirmant sur son honneur et son épée que telle était réellement sa qualité, mais où l'on élut le duc Charles de Brunswick (mort en 1780) pour grand maître, en même temps que les pouvoirs de Hund étaient restreints à la haute et à la basse [page 359] Saxe. Cela n'empêcha pas un aventurier du nom de Gugumos, qui se faisait appeler Eques a cygno triumphante, et qui se donnait pour un ancien envoyé du Saint-Siège dans l'île de Chypre, de grouper encore autour de lui un grand nombre de fidèles ; et à la suite de ce schisme, il fallut convoquer encore à Wiesbaden un congrès dans lequel on parvint à le démasquer. Schubart (11), Eques a struthione, qui avait su fort habilement mettre à profit les relations que lui avait values sa participation aux intrigues et aux menées de ces diverses loges et associations pour faire son chemin dans le monde, qui d'ailleurs était vraiment passionné pour le progrès et tout ce qui peut contribuer au bonheur de l'humanité, Schubart reconnut les jongleries du Système, et déposa le tablier et la truelle, insignes du maçon, dans la loge des Trois Boules du monde. Les assemblées tenues à Brunswick (1775) et à Wolfenbuttel (1778) jetèrent encore plus de lumière sur ces jongleries. L'affaire Schrepfer, dont nous parlerons ci-après, ouvrit les yeux à un grand nombre de dupes. Le grand aumônier Stark, de Darmstadt, Eques ab aquila fulva, se mit à combattre le système de Clermont dès qu'il eut échoué dans ses efforts pour faire adopter le Système clérical qu'il avait inventé. Tout cela détermina le [page 360] duc Charles-Guillaume-Ferdinand de Brunswick (12), qui avait succédé en 1783 à son père en qualité de grand maître, à convoquer la même année une assemblée générale de l'Ordre à Wilhemsbad, où on renonça à continuer l'œuvre des Templiers, et où on fonda le Système de Wilhemsbad ou Rectifié, que suivent encore aujourd'hui bon nombre de loges allemandes.
Cette réforme, consistant à expulser de l'Ordre l'esprit de fanatisme, ne fut peut-être pas peu favorisée par cette circonstance que, pendant ce temps-là, Hund était mort, et que le nouveau grand maître, Vernez, élu à Turin, ne réussit point à faire reconnaître son autorité en Allemagne.
Hund avait été nommé en 1753 chambellan de l'Électeur de Saxe, et en 1755 administrateur du cercle de Budissin; il obtint aussi du gouvernement russe la croix de Sainte-Anne. A l'époque de la guerre de Sept ans, il s'était prononcé de la manière la plus énergique contre la Prusse et en faveur de l'Autriche ; aussi lui fallait-il toujours se faire escorter par quelques hussards autrichiens, et dut-il bien souvent se réfugier en Bohême. Avant de se laisser surprendre à Hochkirch, le feld-maréchal Daun avait établi son quartier général à Kittlitz, domaine appartenant à Hund. En 1762, il fut nommé conseiller intime, et, au rétablissement de la paix générale, il fut chargé d'aller apaiser quelques troubles qui avaient éclaté parmi les tisserands de Lauban, puis en même temps de mettre un terme aux désordres dont le couvent de [page 361] cette ville était le théâtre; mission dont il s'acquitta, dit-on, avec autant de prudence que d'habileté. Dès la guerre de Sept ans, il avait constamment eu auprès de lui pour confesseur un capucin du couvent de Romburg. Peu de temps après le rétablissement de la paix, il donna sa démission des fonctions d'administrateur du cercle de Budissin, et se déclara alors publiquement catholique romain ; religion à laquelle il appartenait en secret depuis plus de vingt ans. Il paraît que cette révélation inattendue ne lui nuisit pas d'abord dans l'Ordre des francs-maçons, car à cette époque-là on y faisait preuve à cet égard de bien plus de tolérance et d'indifférence que ce ne fut le cas plus tard.
On ne l'accuse pas d'avoir été un libertin vulgaire; mais on convient qu'il avait beaucoup de passions et d'habitudes ruineuses. Ses menées maçonniques ne lui coûtèrent pas moins de 500,000 thalers, sans compter les frais considérables qu'entraînaient pour lui des habitudes de large hospitalité, dont trop de gens réclamaient incessamment le bénéfice. Il dépensait aussi beaucoup en chevaux. Il en avait de fort beaux, les faisait peindre, et plaçait dans ses écuries leurs portraits surmontés de leurs noms. Il reconstruisit entièrement diverses églises dans ses domaines, profitant toujours de la circonstance pour y introduire divers détails symboliques relatifs à la franc-maçonnerie, et pour en conserver le souvenir au moyen de plaques gravées, enfouies en terre lors de la pose de la première pierre. Il fut victime d'une foule d'escroqueries ; et, comme il n'était pas marié, il régnait dans sa maison le désordre le plus complet. On comprend dès lors qu'il ait été réduit à [page 362] vendre ses terres les unes après les autres. Il avait fini par vendre la dernière au comte de Rœder de Kœnigsbruck moyennant une rente viagère.
En 1776, malgré son état de souffrance, il s'était encore rendu à Meiningen pour certaines affaires relatives à la franc-maçonnerie. Il dut, en arrivant, se mettre au lit, et ne s'en releva plus. Quoique mourant, il faisait monter chez lui toutes les bandes de musiciens ambulants qui passaient par là, et leur faisait exécuter leur répertoire dans sa chambre. Il rendit l'âme le 8 novembre 1776, après avoir reçu les derniers sacrements de son église. Son corps fut transporté à Melrichstadt, petite ville située à environ six lieues de Meiningen, et dépendant alors de l'évêché de Wurtzbourg. On l'y enterra en grand costume de templier, devant le maître-autel, dans l'église paroissiale (13). Sa succession fut déclarée en état de faillite, et la vente de ses effets mobiliers ne produisit pas de quoi payer les frais de ses funérailles. En entrant dans le monde, il était propriétaire des terres de Mœnau, Kittlitz, Rauden, Metzdorf, Beerwalde. Ober-Gebelzig, Klein-Fœrstchen, Jerchwitz, Lieska et Nieder-Gebelzig. Il en avait mangé le fonds et le tréfonds en menées maçonniques et à jouer le rôle de grand maître de l'ordre des Templiers.
Notes
(1) Le diplôme lui en avait été donné par lord Darnley, grand maître de la province d’Angleterre.
(2) Le chef suprême était qualifié de Eques a penna rubra.
(3) La loge d'Archimède aux Trois Tables à dessiner, fondée en 1742 par Marschall. Elle s'est maintenue comme loge isolée, et plus tard contribua beaucoup à la purification de l'ordre.
(4) La loge des Trois Roses, fondée en 1743 par le loyal comte Solms-Sachsenfeld, que sa bienfaisance et sa probité avaient rendu si populaire dans l'Erzgebirge, et qui, né en 1708, mourut en 1789.
(5) La loge des Trois Marteaux, fondée d'abord par Marschall, puis fermée, et rétablie en 1754 par Hund.
(6) Consultez : Révélations sur l'ordre des Architectes africains (en allemand, Constantinople [Berlin], 1806).
(7) Consultez : Les Frères de Saint Jean l’Evangéliste d'Asie (en allemand, Berlin, 1830).
(8) Voyez Varnhagen von Ense, Mémoires et Mélanges (en allemand, Berlin, 1843).
(9) Arrêté à Magdebourg, il fut mit en prison pour d'autres escroqueries, et mourut sous les verrous en 1775.
(10) Le système de Clermont comprenait neuf provinces, qui étaient d'abord l'Aragon , l'Auvergne, le Languedoc, le Léon, la Bourgogne , la Bretagne, la Basse-Allemagne (comprenant aussi la Pologne, la Livonie et la Courlande), l'Italie et la Grèce, mais qui plus tard furent la Basse-Allemagne, l'Auvergne . le Languedoc, l'Italie, la Grèce, l'Autriche, la Lombardie, la Russie et la Suède.
(11) Jean-Chrétien Schubart, né à Zeitz en 1734, fut d'abord tisserand, puis expéditionnaire. Il devint ensuite le secrétaire de divers généraux prussiens et de plusieurs grands propriétaires. Après avoir rendu de nombreux services à l'agriculture, aussi bien par des ouvrages théoriques que par l'exemple d'une culture rationnelle, il fut anobli sous le nom d'Edler de Kleefeld, et mourut conseiller intime du duc de Saxe-Cobourg en 1787.
(12) L'illustre général mort le 10 novembre 1806 des blessures qu'il avait reçues sur le champ de bataille d'Auerstaedt.
(13) Voyez l’Anti-Saint-Nicaise, par Kessler (Leipzig, 1786). Ce Kessler avait d'abord été arpenteur, et c'est en cette qualité qu'il avait connu Hund. Il se fit ensuite herrnhute; puis, renonçant à sa vocation mystique, il s'engagea dans un corps franc levé en Silésie pour le compte de l'Autriche, et dans lequel il obtint les épaulettes de lieutenant. Les hasards de la guerre le mirent en rapport avec un homonyme d'origine noble, qui, n'ayant pas d'héritiers, l'adopta et lui transmit en mourant ses biens et ses armes.
![]() MM. de Hund et Alten-Groteau. – Les Templiers
MM. de Hund et Alten-Groteau. – Les Templiers
Madame de La Croix – pages 388-396
Cet article, extrait des Personnages énigmatiques, par Frédéric Bulau, Poulet-Malassis 1861. Tome I, p. 388-396) a paru la 1ère fois dans l'Écho du Merveilleux, du 1er octobre 1905, n° 210 revue bimensuelle, directeur : Gaston Mery (1866-1909). Paris, pages 371-374.
Mademoiselle de Jarente, fille du marquis de Sénas et nièce d’un évêque d’Orléans qui jouit d’une grande influence pendant le règne de madame de Pompadour et sous le ministère de M. de Choiseul, avait été mariée fort jeune encore au marquis de la Croix, respectable général au service d’Espagne. Elle vécut pendant quelque temps séparée de son mari, à Avignon, et elle gouvernait le Comtat au moyen du vice-légat Aquaviva, qui était extrêmement épris d’elle. Son mari ayant été appelé aux fonctions de vice-roi de la Galice, elle vint l’y rejoindre et essaya maintenant de gouverner à sa guise cette province d’Espagne. Mais son mari mourut, et elle éprouva alors tant de désagréments, d’injustices et de mortifications de toutes espèces, qu’elle arriva à peu près sans ressources à Lyon, où elle fut prise d’une maladie dangereuse, pendant laquelle elle eut des visions ; et d’incrédule déterminée qu’elle avait été jusqu’alors, elle se trouva maintenant, par un effet de la grâce, disposée à tout croire aveuglément. Les ouvrages de Saint-Martin, notamment celui qui a pour titre Des erreurs de la vérité, produisirent sur elle la plus vive impression. Elle rechercha l’auteur à Paris, l’invita à la venir voir, discuta beaucoup avec lui, et finit par se composer un système théosophique à son usage particulier, dans lequel elle substituait à la Trinité une quaternité où le Fils procédait du Père, le Saint-Esprit du Fils, et [page 389] Melchisédech du Saint-Esprit. Mais elle était plus forte en théorie qu’en pratique. Sa principale occupation consistait à chasser le démon et à guérir ainsi des malades. Elle regardait en effet le diable comme la cause du plus grand nombre des maladies qui affligent l’espèce humaine ; ces maladies provenaient de quelque péché qui avait soumis la partie souffrante aux influences du mauvais esprit. C’est là une opinion qui ne laisse pas d’avoir un côté vrai, pourvu qu’on l’entende au figuré et cum grano salis. Elle opérait par la prière et par l’imposition de ses mains trempées dans de l’eau bénite et de l’huile consacrée. Mais son triomphe, c’était lorsqu’elle rencontrait un possédé du corps duquel elle pût expulser le démon. Elle établissait une différence entre les possédés qui ont conclu un pacte avec le diable, lequel s’est en conséquence mis en possession de leurs corps, et les individus qui n’ont été que saisis par le démon, lequel veut à toute force s’en emparer. Elle en avait bientôt fini avec ceux-ci, à tel point qu’elle était en mesure de faire voir le diable sous une forme quelconque et n’ayant rien d’effrayant, avant de le forcer à lâcher prise. C’est ainsi qu’au sujet d’un petit démon dont elle avait délivré un consul français, qui, d’ailleurs, appartenait à la coterie des encyclopédistes, elle raconta un jour ce qui suit au baron de Gleichen : « Une fois que le mauvais esprit eut quitté son corps, je lui ordonnai de nous apparaître sous la forme d’une petite Chinoise ; il eut la politesse de prendre une forme réellement charmante. Habillé couleur feu et or, il avait le visage fort avenant, remuait ses petites mains avec beaucoup de grâce, s’en alla se cacher derrière le rideau de taffetas vert, dont il s’enveloppa, [page 390] et d’où il se mit à faire toutes sortes de grimaces à l’individu qu’il habitait auparavant. Cependant, cet individu continua à rester sous sa puissance, vraisemblablement parce qu’il avait continué de pécher en secret ; en effet, en rentrant un soir chez lui, il trouva la petite Chinoise sur son bureau, et je dus me transporter à son domicile pour en chasser le démon. » Ce qu’il y a de plus étrange, c’est que madame de la Croix força le consul en question à affirmer la vérité de la chose en présence de Gleichen, qui le connaissait pour l’avoir, avant cela, vu dans de toutes autres sociétés.
D’ailleurs, Gleichen rencontra chez elle bien d’autres personnes qui racontaient, au sujet de démons dont madame de la Croix les aurait délivrées, des détails plus extraordinaires encore que ceux qu’on vient de lire au sujet de ce consul : par exemple le maréchal de Richelieu, le chevalier de Montbarrey, le marquis, la marquise et le chevalier de Cossé. Madame de la Croix prétendait qu’un grand nombre de personnes, même dans le cercle de ses connaissances, étaient visitées par le démon et avaient des apparitions, mais qu’elles n’osaient pas en parler, de crainte de paraître ridicules. Elle lui cita notamment le comte de Schomberg, qui jouait un rôle important parmi les incrédules et faisait partie de la société du baron d’Holbach. Gleichen trouva que cette assertion de madame de la Croix avait tous les caractères de l’invraisemblance ; mais un an après, la vérité lui en fut confirmée dans le salon de madame Necker. Cette dame montra en effet aux personnes qui se trouvaient un soir chez elle, un lettre que Buffon lui écrivait au sujet de quelques visions dont il était alors beaucoup [page 391] question en Bourgogne, et où figuraient toujours de vieilles femmes. Quelques gens de lettres, qui n’aimaient pas Buffon parce qu’à leurs yeux il était beaucoup trop religieux, se mirent à faire de mauvaises plaisanteries sur sa tendance à croire à l’incroyable. Le comte de Schomberg prit alors la parole en ces termes. « Vous me connaissez suffisamment, messieurs, pour être persuadés que je ne crois pas aux revenants : cela n’empêche pas que voilà bien longtemps déjà que moi qui vous parle je vois presque chaque semaine, et maintenant encore, les figures de trois vieilles femmes qui s'accroupissent au pied de mon lit et me font d’affreuses grimaces tout en me saluant. »
Un individu appelé Tieman, qui était aussi des connaissances du baron de Gleichen, et qui avait une véritable manie pour ce qu’on appelait alors les sciences occultes, d’ailleurs esprit vrai, ami de la vérité et se gardant autant que possible contre les illusions, disait apercevoir dans presque chaque endroit où il fixait ses yeux pendant quelques minutes, une tête dont les yeux et les traits étaient tellement expressifs, qu’ils lui semblaient vivants. A l’endroit de la salle du château d’Édimbourg où David Rizzio fut assassiné, et où l’on voit encore quelques traces de sang, il prétendait avoir aperçu une tête qui représentait d’une manière effrayante les crampes et les convulsions d’un mourant. Il passa à diverses reprises devant ce même endroit, et y revit toujours cette tête, dont l’expression devenait de plus en plus effrayante. C’est là un fait qui s’explique facilement par un caprice de l’imagination uni peut-être à une disposition particulière de l’œil ; il n’est pas plus difficile de [page 392] s’expliquer le retour de la même figure, une fois que le type en a été adopté.
Madame de la Croix avait été dans sa jeunesse le modèle le plus achevé de la beauté romaine. Pleine de grâce et d’expression, avec des yeux pénétrants, un nez aquilin, une tête bien dégagée sur de belles épaules, et une poitrine magnifiquement meublée, elle pouvait passer pour l’idéal d'une belle impératrice. De tant de charmes il lui restait encore dans son arrière-saison un visage spirituel et vif, une belle prestance, de jolis pieds, un grand air et beaucoup de facilité d’élocution. Ces restes imposants, et en définitive beaucoup plus rares qu’on ne pense, convenaient admirablement au rôle qu’elle jouait quand elle se mettait à conjurer le démon ; ses gestes menaçants et le ton de sa voix faisaient trembler ; il y avait tant de noblesse dans son maintien, tant d’élévation dans sa ferveur, une si haute expression de foi et de confiance dans toute sa personne, qu’on l’eût prise volontiers pour quelque sainte en train d’opérer un miracle. M. de Gleichen, quoiqu’il fût bien souvent venu chez elle dans l’espoir de voir le diable sortir en sa présence du corps d’un possédé, ne fut jamais assez heureux pour arriver au bon moment. En fait de guérisons, il ne fut témoin que de guérisons de maux de dents, de coliques et de rhumatismes.
Madame de la Croix racontait avec une naïveté et une grâce particulières, de même qu’avec les expressions les plus pittoresques, les visites que le mauvais Esprit lui rendait quand elle se trouvait seule. On croyait voir tout ce qu’elle disait, tant il y avait de naturel et de vivacité dans ses descriptions. Toutes [page 393] les fois que Gleichen venait lui rendre visite, elle avait quelque chose de nouveau à lui raconter au sujet de la société démoniaque. Tantôt, c’étaient d’amusantes farces qu’on lui avait jouées; tantôt elle avait été en proie aux plus effroyables persécutions.
Parfois, c’étaient des processions tout entières de pénitents, complètement habillés de rose, ou bien de capucins aussi laids que puants, ou encore d’autres individus ridiculement ou malproprement accoutrés, qui s’en venaient la nuit se promener sur son lit, les capucins lui envoyant des baisers, et les pénitents secouant ses couvertures. Quelquefois ils lui donnaient le divertissement d’un bal où elle apercevait les costumes les plus bizarres et les modes les plus disparates de tous les siècles. Une autre fois, on lui faisait voir un magnifique feu d’artifice, des pyramides de diamants, d’éblouissantes illuminations ou des palais enchantés. Et elle débitait tout cela avec tant de goût, tant de vivacité et de facilité d’élocution, que ses récits paraissaient bien plus intéressants que la plupart de ceux qu’on fait dans le monde au sujet de grandes fêtes ou de brillantes assemblées.
Un jour, elle racontait une discussion théologique qu’elle avait eue avec un de ses esprits les plus familiers, qui, travesti en docteur de Sorbonne, l’avait traitée d’hérétique et s’était mis à défendre les doctrines de l’église de Rome de la manière la plus orthodoxe. « Mais, ajoutait-elle, ayant fini par mêler des blasphèmes à son argumentation, je lui fermai la bouche avec un cadenas, qu’il portera jusqu’au jour du jugement dernier. — Mais, demanda Gleichen, où donc avez-vous pris ce cadenas ? — Ah ! mon cher baron, répondit madame de la Croix, que vous con [page 394] naissez mal la différence qui existe entre la réalité spirituelle et la réalité matérielle ! C’est un véritable cadenas que je lui ai mis. Les nôtres ne sont que des apparences de cadenas ! »
Bien des gens, assez méchants pour s’amuser à ses dépens, l’invitaient à venir dans leurs maisons en prétendant qu’on y voyait des revenants. La plaisanterie était souvent poussée si loin, que madame de la Croix finissait par s’apercevoir qu'on se moquait d’elle. Mais elle mettait ces humiliations au pied de la croix, et , à ce propos, elle disait à Gleichen avec autant de bon sens que de franchise : « Vous qui m’avez connue si jalouse de ma réputation et de ma supériorité, qui savez que je me prive du moindre superflu pour le donner aux pauvres, qui voyez que le métier que je fais ne me rapporte que honte et mépris dans un pays où, par mon rang dans le monde et par mes relations de famille, je pourrais jouer un tout autre rôle, ne comprenez-vous donc pas que la tâche que j’accomplis m’a été imposée par une puissance supérieure ? Dites-moi franchement si vous trouvez que mon esprit a faibli, et que j’ai perdu la raison ? » Il fut d’autant plus difficile à Gleichen de répondre catégoriquement à ces questions, faites ainsi à brûle-pourpoint, que force lui était de s’avouer à lui-même que jamais il n’avait trouvé l’esprit de cette dame plus brillant. Il se retira d’embarras à l’aide de banales politesses, tout en pensant qu’une idée fixe peut parfaitement coexister avec une intelligence saine à tous autres égards, et que dans la cervelle humaine la mieux organisée, il se trouve toujours en réserve un petit coin pour la folie. Du reste, il déclare que madame de la Croix (qu’il eut pour la dernière fois occasion[page 395] de voir en 1791 à Pierry en Champagne chez Cazotte, lequel, après avoir été martiniste, était devenu un de ses plus fervents partisans) était animée d’un amour si actif pour l’humanité, d’une piété si édifiante, d’une bonté d’âme si touchante, de tant d’onction, de tant d’esprit et de tant de noblesse de caractère, qu’il était impossible de ne pas l’aimer et de ne pas l’estimer.
Elle regardait la révolution comme l’œuvre du démon, et se vantait, comme d’un trait tout particulier de bravoure, d’avoir détruit un talisman de lapis-lazuli que le duc d’Orléans avait reçu en Angleterre du célèbre grand rabbin Falck-Scheck. Elle assurait que « ce talisman, qui devait faire arriver le prince au trône, avait été brisé sur la poitrine de Philippe-Égalité par la seule puissance de ses prières, au moment où il lui était arrivé de tomber sans connaissance en pleine assemblée nationale. »
M. de Gleichen termine ses relations sur cette femme singulière par le récit d’une scène qu’il n’a jamais pu oublier, dit-il, et qu’il lui a aussi été toujours impossible de s’expliquer. Il venait de temps à autre chez madame de la Croix un possédé auquel un de ses voisins, meunier de son état, avait fait conclure, sans le savoir, un pacte avec le diable. Dès lors, notre possédé était encore guérissable. Toutes les fois qu’il venait la voir, il se jetait à genoux et lui racontait, en sanglotant, les horribles souffrances auxquelles il était constamment en proie. Madame de la Croix le faisait s’étendre sur un canapé, le déshabillait, et lui promenait sur le corps des reliques trempées dans de l’eau bénite. On entendait alors d’horribles gargouillements dans son corps, et le [page 396] patient poussait des cris épouvantables ; mais le diable tenait bon, et les espérances de le voir déloger étaient constamment trompées: Un jour, cet homme devint furieux, sauta en bas du canapé, et parut prêt à se précipiter sur l’assistance. Madame de la Croix se plaça alors entre lui et sa société, et le remit en place d’un air impérieux et menaçant. Sur ce, notre individu se prit à grincer des dents d’une telle force, que les passants auraient pu l’entendre dans la rue, puis à vomir de si horribles imprécations, que chacun dans l’assistance sentait ses cheveux se hérisser d’effroi sur sa tête ; ensuite, il s’emporta en violentes invectives contre madame de la Croix elle-même, et termina cette scène par l’énumération des plus abominables péchés que la pauvre femme eût pu commettre, en entrant à ce sujet dans des détails de nature à la faire mourir de honte. Elle écouta tout cela les yeux tranquillement levés vers le ciel, les mains croisées sur sa poitrine, et en versant des larmes amères. Sauf la jeunesse, on eût dit la Madeleine repentante. Quand le patient eut fini, elle s’agenouilla et dit à l'assistance : « Messieurs, vous venez d’être témoins de la juste punition de mes péchés que Dieu a accordée à mon repentir. Je mérite les humiliations que je viens d’éprouver en votre présence, et je m’y soumettrais de grand cœur en présence de tout Paris, si cela pouvait me faire pardonner tous mes péchés (1. Mémoires du baron de Gleichen, p. 149 et suiv). »



