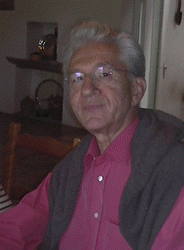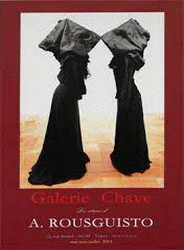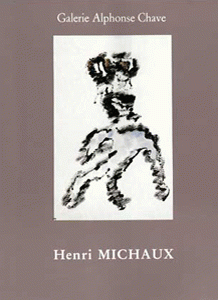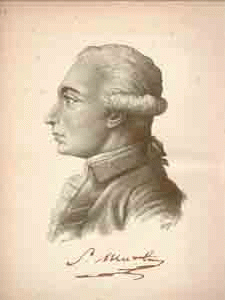Biographie de Jacques-François Denis
Jacques-François DENIS est né le 11 février 1821 à Corbigny (58800) [1] de Pierre Denis et Claudine Languillet. Son père, menuisier, est trop pauvre, Jacques François est placé en tutelle chez un de ses oncles.
 Il fait ses études classiques à Paris, au collège Bourbon (aujourd’hui Condorcet) et entre à l’École normale supérieure à 20 ans « dans la même promotion que Paul Alexandre Janet (1823-1899), Émile-Louis Burnouf (1821-1907), Hippolyte Ange Rigault (1821-1858) […]. Esprit solide et pénétrant, toujours préoccupé d'approfondir sa pensée, il était plus habile à manier la plume que la parole, et toute sa carrière s'en est ressentie ».
Il fait ses études classiques à Paris, au collège Bourbon (aujourd’hui Condorcet) et entre à l’École normale supérieure à 20 ans « dans la même promotion que Paul Alexandre Janet (1823-1899), Émile-Louis Burnouf (1821-1907), Hippolyte Ange Rigault (1821-1858) […]. Esprit solide et pénétrant, toujours préoccupé d'approfondir sa pensée, il était plus habile à manier la plume que la parole, et toute sa carrière s'en est ressentie ».
En 1842, il passe sa licence de lettres et tente une première fois l’agrégation, mais n’est pas admissible. Il est nommé en 1844 au collège royal d’Avignon où il est professeur suppléant, chargé de la philosophie ; puis, en 1845 à Angoulême.
 Il retente le concours de l’agrégation de philosophie en 1846 et obtient le 4e rang.
Il retente le concours de l’agrégation de philosophie en 1846 et obtient le 4e rang.
Il obtient son doctorat ès lettres en 1847 avec ce sujet : Du rationalisme d'Aristote, rôle de la raison dans les connaissances humaines d'après Aristote. Et celui de latin la même année avec De sermonis origine.
Il est nommé professeur de philosophie à Avignon en 1848, puis l’année suivante au lycée d’Alger. En 1850, il est envoyé à Tournon où il reste trois années. Va se succéder différentes nominations : professeur de logique au lycée de Grenoble (1853), puis à Strasbourg (1854).
Un de ses amis et collègue à Strasbourg se demande naturellement
« la raison de cette anomalie (postes successifs) d’un professeur sans cesse disgracié et du même professeur affirmant de plus en plus sa valeur par ses succès et travaux » (M. Chauvet).
En 1852, il soumet à l'Académie des sciences morales et politiques un mémoire sur le sujet Histoire des théories et des idées morales dans l’antiquité. Ce mémoire, couronné par l’Académie en 1853, est publié en deux tomes : tome 1 – tome 2 (1856). Dans la préface il déclare ne pas se sentir dans une position assez libre pour toucher à de pareils sujets » [il s’agit de l’influence des anciennes philosophies sur la formation de la morale chrétienne] et il ajouté :
« Quoique je n’espère rien, et je craigne peu de choses ».
 Cette publication paraît suspecte du fait de ces « additions » et fait l’objet d’un rapport (1er octobre 1856) par Laurent Delcasso (1797-1887), recteur de l’Académie de Strasbourg. Denis est alors envoyé à Pau, et ressent cela comme une disgrâce dont il se plaint. Par compensation, il est nommé au lycée de Dijon en 1857, poste qu’il refuse et demande sa mise en disponibilité, qu’il obtient.
Cette publication paraît suspecte du fait de ces « additions » et fait l’objet d’un rapport (1er octobre 1856) par Laurent Delcasso (1797-1887), recteur de l’Académie de Strasbourg. Denis est alors envoyé à Pau, et ressent cela comme une disgrâce dont il se plaint. Par compensation, il est nommé au lycée de Dijon en 1857, poste qu’il refuse et demande sa mise en disponibilité, qu’il obtient.
Il reste trois années à Paris pour préparer divers travaux et en 1860, il est appelé « par le comte de Cavour et par son collègue à l'instruction publique, le philosophe [Terenzio] Mamiani [1799-1885], à enseigner la littérature française à l’Université de Turin. Soutenu et encouragé par la faveur qui s’attachait alors en Italie au nom français, il occupa cette chaire avec succès jusqu’en 1863 »
Il intègre le 22 novembre 1863, la faculté de Caen où il est chargé de l’enseignement de la littérature ancienne. En 1866, il est enfin nommé professeur de faculté, responsable de l’enseignement de la littérature ancienne et est élu correspondant de l’Académie des sciences morales et politiques, dans la section de morale. C’est en 1876 qu’il reçoit la chaire de littérature et institution grecques.
 En 1881, l’Académie des sciences morales et politiques propose comme sujet pour le prix Victor Cousin : La philosophie d’Origène dont le « programme détaillé indique aux concurrents la nature et l’étendue de la question » (A. Franck) proposée :
En 1881, l’Académie des sciences morales et politiques propose comme sujet pour le prix Victor Cousin : La philosophie d’Origène dont le « programme détaillé indique aux concurrents la nature et l’étendue de la question » (A. Franck) proposée :
« Exposer la doctrine philosophique d’Origène. Recueillir les idées philosophiques répandues dans les commentaires sur toute l’Écriture et dans l’Apologie du christianisme contre Celse. Examiner s’il y a lieu d’attribuer les Philosophoumena à Origène. Remonter aux différentes sources de la philosophie d’Origène, particulièrement à Philon et à Clément d’Alexandrie. Signaler l’influence que la philosophie d’Origène a exercée sur les doctrines philosophiques et religieuses de la seconde moitié du IIIe siècle et celles des siècles suivants. Apprécier la valeur de cette philosophie au point de vue métaphysique et moral ». (Rapport de la section de philosophie sur les mémoires présentés pour concourir au prix Victor Cousin, p.80).
Denis sera lauréat de ce concours et son ouvrage sera publié par l’Académie. C’est dans cet ouvrage que nous trouvons une étude sur la pensée de Louis-Claude de Saint-Martin comparée à celle d’Origène, que nous publions ici.
Cette même année il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur.
En 1884, il est élu doyen de la faculté en remplacement de Joly, et le restera jusqu’en 1891, année où il prend sa retraite. En 1886, il est élu membre correspondant de l’Institut.
Il meurt le 8 février 1897 à Caen (Calvados) [voir État civil du Calvados, État civil du Calvados, acte n° 124, p. 413]. Un de ses collègues clama sur sa tombe :
« Il mourut en stoïcien, après avoir vécu en sage ».
Et M. Chauvet de conclure :
« Ce solitaire, ce silencieux, cet ami de l’ombre, qui n’avait rien fait pour être connu, il parut qu’il l’était universellement. Tout ce qu’il y avait d’excellent en lui avait transpiré, rayonné, et ceux-là mêmes qui ne l’avaient jamais lu ni entendu avaient le sentiment qu’une noble et belle intelligence venait de quitter la terre. Puisse-t-il, là où il est, revivre dans l’intimité des grandes Âmes qu’il a tant pratiquées dans ses études et tant célébrées dans ses livres ».
[1] Et non le 4 comme le note la notice de l’Académie des sciences morales et politiques ou le 11 juillet comme l’écrit Ch. Waddington dans sa Notice sur Jacques-François Denis. Voir l’acte de naissance n°7 sur l’État civil de Corbigny.
Sources
- Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains. Paris, Hachette, 1893, volume I, p. 447.
- M. Chauvet, « Jacques Denis », in Mémoires de l'Académie nationale des sciences, arts et belles lettres de Caen, 1897, p. 322-340.
- Ch. Waddington, « Notice sur Jacques-François Denis, correspondant de l’Académie » in Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 1898, p. 32-39.
- Notice : « DENIS Jacques François », in Les professeurs des facultés des lettres et des sciences en France au XIXe siècleLes professeurs des facultés des lettres et des sciences en France au XIXe siècle (1808-1880).
- Gabriel Vauthier, « Le professeur Jacques-François DENIS disgracié ». In : La Révolution de 1848 et les révolutions du XIXe siècleeLa Révolution de 1848 et les révolutions du XIXe siècle, Tome 27, Numéro 133, Juin-juillet-août 1930. pp. 106-114.
- A. Franck, « Rapport de la section de philosophie sur les mémoires présentés pour concourir au prix Victor Cousin ». Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques (Institut de France), p.80-110.