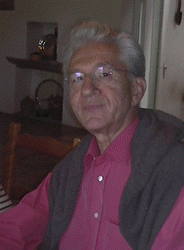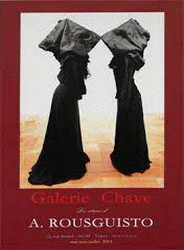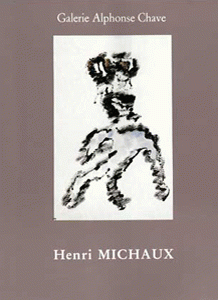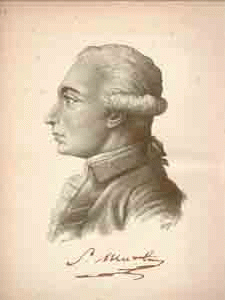Robinson
 Voici la citation de Louis-Claude de Saint-Martin dans l’Introduction du Ministère de l’Homme-Esprit, 1802, p.XIV
Voici la citation de Louis-Claude de Saint-Martin dans l’Introduction du Ministère de l’Homme-Esprit, 1802, p.XIV
« Descartes a rendu un service essentiel aux sciences naturelles en appliquant l’algèbre à la géométrie matérielle. Je ne sais si j’aurai rendu un aussi grand service à la pensée, en appliquant l’homme, comme je l’ai fait dans tous mes écrits, à cette espèce de géométrie vive et divine qui embrasse tout, et dont je regarde l’Homme-Esprit comme étant la véritable algèbre, et l’universel instrument analytique ; ce serait pour moi une satisfaction que je n'oserais pas espérer, quand même je me permettrais de la désirer. Mais un semblable rapprochement avec ce célèbre géomètre, dans l’emploi de nos facultés, serait une conformité de plus à joindre à celles que nous avons déjà lui et moi, dans un ordre moins important, et parmi lesquelles je n’en citerai qu’une seule, qui est d’avoir reçu le jour l’un et l’autre dans la belle contrée connue sous le nom du jardin de la France. »
 En fait, Saint-Martin se voyait plutôt comme le Robinson de la spiritualité, tel qu’il l’explique dans sa lettre à Kirchberger, baron de Liebistorf, (Lettre LI - Amboise, 5 messidor (23 juin 1794), p.138) :
En fait, Saint-Martin se voyait plutôt comme le Robinson de la spiritualité, tel qu’il l’explique dans sa lettre à Kirchberger, baron de Liebistorf, (Lettre LI - Amboise, 5 messidor (23 juin 1794), p.138) :
« Je vous avoue qu’après de semblables richesses qui vous sont ouvertes (les œuvres de Jacob Bœhm), et dont vous pouvez jouir à votre aise à cause de votre langue et de tous les avantages terrestres que la paix politique vous procure, je souffre quelquefois de vous voir me consulter sur des loges et sur d’autres bagatelles de ce genre ; moi qui, dans les situations pénibles en tous sens où je me trouve aurais besoin qu’on me portât sans cesse vers ce pays natal où tous mes désirs et mes besoins me rappellent, mais où mes forces rassemblées tout entières sont à peine suffisantes pour me fixer par intervalle, vu l’isolement absolu où je vis ici sur ces objets. Je me regarde comme le Robinson Crusoé de la spiritualité, et, quand je vous vois me faire des questions dans ces circonstances, il me semble voir un fermier général de notre ancien régime, bien gros et bien gras, allant consulter l’autre Robinson sur le chapitre des subsistances ; je dois vous dire ce qu’il lui répondrait : « Monsieur, vous êtes dans l’abondance et moi dans la misère ; faites-moi plutôt part de votre opulence. »
Voici l'explication qu’A. Vinet donne dans la Revue suisse (1844 - 7e année - Tome 7, p.25-27) des différents Robinson dans son analyse du livre de Daniel de Foe, Robinson Crusoé
 « Tout porte le même caractère. Lorsque, dans le second volume, Vendredi meurt percé d'une flèche, Robinson le regrette, Robinson le venge, mais vous ne trouvez ni réflexion, ni épanchement sur la mort de ce fidèle domestique, comme il l'appelle, et son nom ne reparaît plus.
« Tout porte le même caractère. Lorsque, dans le second volume, Vendredi meurt percé d'une flèche, Robinson le regrette, Robinson le venge, mais vous ne trouvez ni réflexion, ni épanchement sur la mort de ce fidèle domestique, comme il l'appelle, et son nom ne reparaît plus.
« Après tout, ces nuances délicates, au moyen desquelles nous avons multiplié les couleurs primitives de la vie morale, ont-elles tout le prix que nous leur attribuons ? dépouillées de cette richesse, les âmes en étaient-elles beaucoup plus pauvres ? En raffinant sur nos émotions, en sommes-nous devenus meilleurs ? Je veux croire que nous n’en sommes pas devenus pires ; mais enfin ce Robinson chez qui l’imagination joue un si petit rôle, ce Robinson dont la vie est si poétique et qui l’est si peu lui-même, il se montre capable des plus hautes pensées, s’il est vrai que les plus hautes soient celles dont Dieu est l’objet. Cet homme quelconque, ainsi que nous l’avons appelé, s’élevant bien au-dessus de la sentimentalité, arrive d’un premier élan à la plus haute des philosophies, à la religion ; et c’est ce que nous voyons tous les jours. Ceux qui ne peuvent pas le moins peuvent le plus, ceux qui ne peuvent pas marcher volent, et l’on dirait que le sublime est, bien plus que le médiocre, à la portée de l’humanité. On le dirait, et l’on aurait raison ; mais il faudrait ajouter que le médiocre n’est pas sur le chemin du sublime, qu’on ne passe point par l’on pour arriver à l’autre : ils sont sur deux lignes différentes, car le faux ne saurait être le premier degré du vrai, et en morale le sublime est le seul vrai. En résumé, tout le monde n’est pas capable d’être sentimental, et tout le monde est capable d’être chrétien ; une communion intelligente et sentie avec Dieu, le discernement religieux, le choix d’une croyance, sont du ressort de tout le monde ; la compétence, du moins, n’est pas proportionnée à la culture et au savoir; tout le monde a assez d’esprit pour se sauver; dans cette carrière, les ignorants eux-mêmes peuvent servir de guide aux savants, et c’est là que s’accomplit celle parole du Maître : « Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. » [Matthieu, 20:16]
« Il faut apprendre ici à ceux qui n’ont lu Robinson que dans [page 26] des éditions tronquées, que le véritable Robinson contient l’histoire d’une conversion. La conversion a été, durant un temps, une manière de conclure assez admise en littérature. Don Quichotte finit ainsi, et l’on peut affirmer que la conversion de Robinson, bien que placée au milieu du récit, est la véritable conclusion du livre. Quoi qu’il en soit, conclusion ou épisode, la conversion de Robinson n’a rien de commun. Elle a même quelque chose de particulier et de frappant. Je serais trop long si je voulais transcrire cet épisode ou même l’extraire. En voici l’idée. Robinson, dans une très grande maladie, où, privé de tout secours étranger, et ne pouvant se secourir lui-même, il se voit tout près de la mort, a rencontré dans l’Écriture cette parole divine : Invoque-moi au jour de la détresse ; je t’en délivrerai et tu m’en glorifieras [Ps 50:15]. Il cherche quel sens elle a pu, elle pourrait avoir pour lui. Il pense à différentes délivrances temporelles, mais surtout à celle de sa captivité, et se demande si ce n’est point là ce qui lui est promis ; mais à mesure que, par supposition, il fait correspondre quelque grâce temporelle à la promesse qu’il vient de lire, il sent le vide grandir au lieu de diminuer, il se dit qu’après toutes ces délivrances, il serait encore captif, et qu’un Dieu n’a pas pu lui promettre si peu. Son ingratitude pour tant d’autres bienfaits n’est-elle pas d’ailleurs une preuve qu’il est enchaîné dans les liens du péché ? et n’est-ce pas de ces liens que Dieu, qui ne fait rien d’imparfait, et dont les grâces temporelles sont le symbole et le gage de grâces meilleures, lui promet aujourd’hui de le délivrer ? On prévoit le reste. Ce drame spirituel est aussi bien conduit qu’il est bien conçu, et ces quelques pages, qui sont d’une simplicité touchante, donnent beaucoup à penser.
« Notre siècle a inventé un autre Robinson : c’est l’homme perdu dans la foule, « ce vaste désert d’hommes. » [Chateaubriand, René, in Œuvres complètes, Tome 4, p.669]
« L’idée est juste et féconde. L’isolement involontaire est la plus profonde comme la plus amère des solitudes. C’est dans ce sens que le théosophe St-Martin s’intitulait « le Robinson de la spiritualité. » Nous avons eu en littérature une foule de Robinsons » on en rencontre aussi, dans le monde, de plus ou moins authentiques, [page 27] qui ne portent pas un bonnet de poil de chèvre, ni un parasol de peau de bouc, mais qui ne manquent pas de perroquets. Quelques-uns sont à plaindre, quelques-uns sont plaisants. Il en est aussi d’odieux, aussi anciens dans le monde que le monde lui-même : ce sont les égoïstes. L’égoïsme est la solitude absolue. L’homme qui n’aime ni Dieu ni son prochain est un banni, un prisonnier volontaire ; mais s’il ne peut échapper au mépris, il échappe à la poésie : elle n’ira point, pour le peindre, s’enfermer avec lui dans son cachot : elle le marque du doigt, et passe1. »
1.Voir, dans les fables d’Arnault, le Colimaçon.