1847 - Le Correspondant – T 19
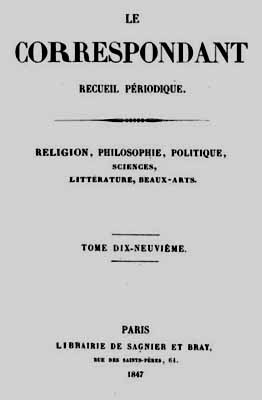 Le Correspondant, Recueil périodique
Le Correspondant, Recueil périodique
Religion, philosophie, politique, sciences, littérature, beaux-arts.
Tome dix-neuvième
Paris. Librairie de Sagnier et Bray, rue des Saint Pères, 64
1847 - Le Correspondant – T 19
Examen des doctrines du Philosophe inconnu, Louis-Claude de Saint-Martin, Louis Moreau
3e article – Exposition de la théorie sociale – Pages 74-95
Cet article comprend également les chapitres VII, Exposition du système métaphysique de Saint-Martin, et VIII, Vue de la nature. Esprit des choses, du livre de Moreau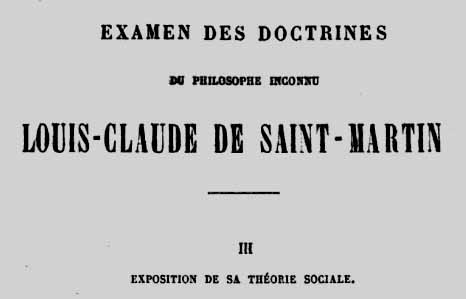
Une même épigraphe pourrait convenir à l'ensemble des divers travaux que le dernier siècle vit éclore ; cette épigraphe serait le mot célèbre de Bacon : Ars instauranda ab imis. Ce mot désespérant, s'il n'était profondément insensé, usurpe alors la puissance d'un axiome. Philosophes, savants et publicistes, tous partent de ce principe, que l'œuvre des devanciers est à peu près nulle et que l'édifice des connaissances humaines est à reprendre par la base. La tradition est proscrite, comme complice des superstitions. Témoin suspect, on récuse les faits qu'elle seule peut fournir, et qui seuls peuvent servir de fondement à la science, surtout à la science de l'homme. Par une contradiction remarquable, bien que peut-être elle ne soit qu'apparente, c'est de l'avènement de l'empirisme que date l'ère des romans les plus libres que puisse inventer l'imagination appliquée aux origines du monde, de l'homme et des sociétés. On refait donc la science, on refait l'esprit humain, on refait la société en théorie, et pour refaire tout cela, on répudie le passé et on le refait. Il faut voir avec quelle hardiesse ce préjugé étroit et injurieux à l'humanité substitue partout les plus étranges hypothèses à la voix de l'antiquité et aux premiers monuments de l'histoire. L'idéologie nous le montre à [p.75] l'œuvre dans l'analyse de l'entendement humain; et aucune de ses spéculations dans l'ordre physique ou dans l'ordre moral ne le trouverait inférieur à lui-même. L'expérience est acquise de tout ce qu'un siècle peut porter de paradoxes, et de quelles fictions l'homme est capable de se satisfaire afin d'échapper à des faits dont il décline le conséquences.
Pour trouver en quelques pages un modèle accompli de la méthode historique que les penseurs du XVIIIe siècle accommodent généralement aux divagations métaphysiques d'Helvétius et de Rousseau, il faut jeter les yeux sur les premières lignes de l'Esquisse d’un tableau des progrès de l'esprit humain, ce long et dernier blasphème que Condorcet proscrit exhale contre la religion et contre toute religion. C'est là que l'on peut admirer avec quelle audace et quel sang-froid, avec quel cynisme d'affirmation quand les faits manquent ou contredisent, un philosophe sait restituer le passé au gré de ses opinions. Ces hommes, contrôleurs si difficiles des titres du Christianisme, prennent une voie plus courte pour substituer leurs préjugés à ses dogmes et à ses preuves : ils érigent leurs opinions en dogmes dispensés de preuve.
Ainsi, veut-on connaître l'état primitif des associations humaines : rien n'est plus simple. Condorcet répond avec assurance : « Le premier état de civilisation où l'on ait observé l'espèce humaine est celui d'une société peu nombreuse subsistant de la chasse et de la pêche, etc. » Donc le premier état social n'est pas différent de l'état de civilisation que l'on observe aujourd'hui chez les sauvages. Mais le mot observer, qu'en dites-vous ? Ce fait que l'on peut observer dans certaines parties du monde, qui donc l'a observé à l'origine du monde ? Quelle est la date de cette précieuse observation ? Quel est le nom du premier observateur ? Condorcet et Rousseau ont-ils préexisté au temps pour observer par eux-mêmes ce phénomène originel ? Mais Condorcet prétend donner à l'hypothèse qui veut que l'homme débute par l'état sauvage, l'autorité d'un fait ; et voici à peu près à quoi se réduit son raisonnement. Le fait de l'état sauvage est observé dans plusieurs contrées du globe : donc il a été observé dès le principe. Ce fait se produit aujourd'hui, rare et avec tous les caractères d'une monstrueuse exception : donc il a dû se produire, et il s'est produit, aux plus anciens jours, comme un fait normal et nécessaire. Condorcet conclut donc du particulier au général, et place [p.76] arbitrairement dans le lointain des temps un fait qui se rencontre dans le lointain des lieux.
Cette méthode indépendante, ou plutôt cette indépendance de toute méthode permet au philosophe de poursuivre avec une rare facilité l'histoire de l'homme.
L'homme commence donc par tirer sa subsistance de la chasse et de la pêche, ou des fruits offerts spontanément par la terre (heureuse périphrase pour désigner sans doute le gland) ; mais la loi de perfectibilité indéfinie qui est inhérente à sa nature fait succéder à ces premiers aliments une nourriture plus certaine, la chair des animaux réduits en domesticité ; à ces moyens se joint bientôt une agriculture grossière ; il forme des provisions, qu'il sème, qu'il plante, et dont il favorise la reproduction par le travail de la culture.
Mais si cette loi innée à l'homme a guidé d'une main sûre ses premiers pas sur la terre, suivant l'induction nouvelle qui de l'exception dans le présent fait la règle du passé, pourquoi ne s'est-elle pas développée chez les peuplades sauvages auxquelles la chasse et la pêche n'offrent encore aujourd'hui qu'une ressource précaire ? Pourquoi l'enseignement du missionnaire ne trouve-t-il pas dans cette faculté du progrès un puissant levier pour les élever jusqu'à la prévoyance, qui est l'âme du travail et la première condition de la perfectibilité ? Pourquoi, au contraire, dans ces races dégradées, la nature oppose-t-elle une résistance si obstinée à sa régénération spirituelle et morale ? La vie des insulaires de l'Océanie est un démenti renouvelé à ces vaines théories qui font de la civilisation une conséquence naturelle et nécessaire de l'organisation humaine. L'anthropophage de Tonga se laisse mourir de faim sur un sol fertile qu'il ne sait ni veut cultiver (Annal. de la propag, de la foi, missions de l'Océanie centrale; septembre 1846).
Veut-on connaître l'histoire de la propriété : rien n'est encore plus simple. Ce n'est d'abord que quelques armes, quelques filets, quelques ustensiles de ménage. Cette propriété devient ensuite celle du troupeau, puis celle de la terre; et à la mort du chef elle se transmet naturellement à la famille.
Quoi de plus court et de plus naturel que cet exposé? Il est vrai qu'il débute par une hypothèse fondée sur un raisonnement ridicule ; [p.77] il est vrai qu'il faut en outre dévorer deux autres hypothèses. Car cette assertion qui fait succéder à l'état sauvage celui des peuples pasteurs, et à l'état des peuples pasteurs celui des peuples agriculteurs, est gratuite. C'est la philosophie qui trouve bon qu'il en soit ainsi ; c'est la philosophie qui imagine une histoire de la propriété en correspondance exacte avec l'histoire imaginaire de l'humanité ; c'est la philosophie qui contredit la Genèse et ne daigne plus même lui faire l'honneur de la nommer.
L'hypothèse en effet de l'état sauvage est démentie par cette seule parole : « Faisons l'homme à notre image et ressemblance, et que les hommes dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux domestiques, etc. »
L'hypothèse de la transition des peuples pasteurs aux peuples agriculteurs disparait devant ce simple récit :
« Eve mit au monde Abel, frère de Cain ; or Abel fut berger, et Caïn laboureur. » (Genèse, I, 26, IV, 2).
La Genèse, c'est-à-dire l'un des premiers monuments du monde, atteste donc que, dès le principe, l'homme fut à la fois pasteur, agriculteur, roi, investi par Dieu même du droit de souveraineté sur toute la nature, et le récit de Moïse n’exclut pas moins la supposition d'un état primitif d'ignorance et de brutalité que celle d'une lente série de progrès qui élèveraient à grand peine l'intelligence de l'homme au niveau de l'instinct animal.
Je n'exige pas d'un libre penseur qu'il attelle son indépendance au joug de l'Écriture ; mais j'ai le droit d'exiger qu'il substitue autre chose que des rêves métaphysiques aux dépositions de ce témoin antique de toutes les origines. Il est loisible à Voltaire de se moquer de la Bible, mais il n'est pas permis à Condorcet de la passer sous silence.
Quoi de plus impudent, en effet, que ces essais de restitution des temps anté-historiques, fondés sur le bon plaisir de l'esprit particulier ? Condorcet nous dit encore avec le même sang-froid : « L'invention de l'arc avait été l'ouvrage d'un homme de génie ; la formation d'une langue fut celui de la société entière ... » (Esquisses d'un tabl. hist. des progrès de l'esprit humain. In-18, p. 20, p.8). Il disait un peu plus [p.78] haut: « Des hommes de génie, des bienfaiteurs éternels de l'humanité, dont le nom, dont la patrie même, sont pour jamais ensevelis dans l'oubli, observèrent que tous les mots d'une langue n'étaient que les combinaisons d'une quantité très limitée d'articulations premières ... Ils imaginèrent de désigner par des signes visibles non les idées ou les mots qui y répondent, mais ces éléments simples dont les mots sont composés. »
A merveille. Mais d'abord comment peut-il rendre un compte si précis des procédés logiques employés par ces hommes de génie dont il ne sait ni le nom, ni la patrie, ni le siècle où ils ont vécu ? Et puis, s'il fait honneur de l'invention du langage à la société entière, où est la raison de ne pas accorder aussi à la société entière l'invention de l'écriture ? Ou bien, pourquoi ne pas attribuer la découverte de l'écriture à tous, et celle du langage à quelques-uns ? L'une de ces suppositions n'est ni plus ni moins aventureuse que l'autre. Mais ce que je ne puis assez admirer, c'est qu'en posant toujours comme point de départ l'état sauvage, l'on rattache aux temps voisins de ce triste berceau de l'humanité d'incomparables inventions et telles que les civilisations les plus florissantes n'en ont jamais su produire de semblable : l'invention de l'écriture, celle du langage et l'institution de la société civile. Car, selon la philosophie du dernier siècle, la société elle-même repose de temps immémorial sur une convention qui impliquerait dans les hommes grossiers, jouets de leurs passions et de leurs appétits, une singulière prévoyance et une métaphysique politique fort déliée, puisque, aux termes de l'hypothèse, cette convention aurait stipulé l'aliénation d'une certaine portion de la force et de l'indépendance personnelle au profit d'un pouvoir public et d'une liberté générale. La contradiction est évidente. Et toutefois les meilleurs esprits y sont tombés ; le penseur comme le déclamateur ; Montesquieu comme Rousseau. Car Montesquieu lui-même va chercher aussi dans les forêts l'homme naturel, l'homme antérieur à l'établissement des sociétés. C'est qu'en définitive il s'agissait moins de donner au problème des origines une solution véritable que d'en exclure les solutions admises ; il s'agissait moins d'établir solidement l'éducation progressive de l'homme par lui-même que d'interdire à Dieu le souci des choses humaines.
La fièvre antireligieuse peut seule expliquer cette manie de refaire à priori l'histoire primitive de l'homme. Comment, en effet, concevoir [p.79] que, obstinément engagés dans une voie de spéculations vaines, des esprits supérieurs s'amusent à tracer du commencement du monde ces étranges tableaux qui ne présentent ni une preuve, ni une date, ni un nom ? Comment concevoir que, négligeant Dieu dès le principe comme un terme inutile, et dédaignant le milieu social et traditionnel dont on ne saurait se dégager sans sortir des conditions qui sont faites à l'intelligence pour atteindre le vrai, l'observateur prenne l'homme comme une abstraction, le retire de la sphère vivante des faits humains, pour ériger en faits les développements hypothétiques qu'il lui prête ; à peu près comme on étudierait les chimériques évolutions d'un germe inconnu, en commençant par le soustraire à l'action des éléments sans lesquels il ne se peut qu'il devienne ce qu'il doit être ? Il fallait donc, je le répète, qu'il y eût à cette intempérance de rêveries manifestes un motif et un dédommagement : de puissants esprits ne sont jamais assez dupes de l'erreur pour affronter naïvement l'absurde et l'impossible.
En abordant l'examen contradictoire de ces questions redoutables, Saint-Martin prend pour point de départ l'homme même, et c'est par l'observation intérieure qu'il prétend arriver à l'explication de l'homme et des choses. « On a voulu, dit-il, expliquer l'homme par les choses et non les choses par l'homme, » et cependant l'homme est la clef des choses. L'âme de l'homme est le miroir universel; miroir terni et brisé, mais qui, par ses brisures mêmes et ses ténèbres, témoigne de toutes les lumières qu'il devrait concentrer et réfléchir. « Les vérités fondamentales, dit encore Saint-Martin, cesseraient de nous paraître inaccessibles si nous savions saisir le fil qui nous est sans cesse présenté ; parce que ce fil, correspondant de la lumière à nous, remplirait alors le principal objet qu'elle se propose, qui est sans doute de nous rapprocher d'elle et de réunir les deux extrêmes. » (Tableau naturel, 2. Édimbourg, 1782).
La méthode psychologique, l'étude de l'homme, si elle est indépendante et désintéressée, est une base solide ; car il est difficile que le sentiment vrai des misères humaines et la conscience de la situation maladive de l'âme ne confirment point de leur douloureux témoignage la tradition de la chute originelle, c'est-à-dire de l'alliance rompue entre l'homme et Dieu. Ce sentiment d'une grande infortune [p80] avec le soupçon d'une grande faute ne manquait pas aux sages de l'ancien monde : monde qui, comme le nôtre, a retenti des plaintes et des aveux de l'humanité déchue. Et toutefois l'unanimité de ce sentiment était loin d'emporter une conclusion unanime dès qu'il s'agissait de poser les prémisses de la destinée humaine. L'antique tradition n'était pas éteinte, et elle trouvait un écho dans les souffrances de l'âme ; ses traces étaient obscures, et de là son impuissance à réunir les opinions. Mais aujourd'hui que la main divine, la main de Celui en qui Saint-Martin croyait, a déchiré les voiles qui jadis couvraient en partie les origines humaines, n'est-il pas étrange qu'on se plaise à rabaisser la voie lumineuse de la tradition au profit de l'observation psychologique, et que l'on affecte de se borner à la simple inspection de l'homme, comme si la lumière de cette tradition n'avait pas une souveraine influence sur la manière même d'inspecter l'homme ? Évidemment l'on peut observer et conclure à merveille lorsqu'on néglige par hypothèse le fait primitif qui éclaire l'observateur, quoique celui-ci, de propos délibéré, ferme les yeux ; mais il est beaucoup moins évident que l'observation dût être aussi juste et la conclusion aussi légitime, si ce fait, dont on tient à se passer, était réellement anéanti dans la mémoire des hommes ; et cette remarque serait encore fondée, lors même qu'elle n'aurait point égard à la solution chrétienne. L'homme, en effet (non pas l'homme naturel, selon le XVIIIe siècle, mais l'homme social, l'homme vrai) naît au milieu d'une civilisation quelconque, c'est-à-dire au milieu d'un dogme et d'une croyance; et comme cet homme ne se fait ni son siècle, ni sa patrie, ni sa religion, ni sa langue, et que sa liberté ne s'exerce que par et sur ce qui lui est donné, il est impossible que plus tard il fasse un juste et fidèle départ de ce qu'il doit à la révélation dont il est saisi dès le berceau et de ce qu'il devrait à la solitude hypothétique de ces facultés individuelles, qui ne possèdent en aucun cas l'instrument de leur activité même, séparé des enseignements que cet instrument enveloppe et communique. Au début de son livre des Erreurs et de la Vérité, Saint-Martin prétend que « des vérités qui ne reposeraient que sur des témoignages ne seraient plus des vérités. » Mais il y a là plus de dédain que de sens, si toutefois il y a là le moindre sens. Je ne vois pas, en effet, comment le Témoignage pourrait destituer la Vérité de ses droits et de sa nature ; comment une vérité attestée cesserait d'être vérité, si le témoignage est [p.81] vrai. Je vais plus loin, et j'affirme au contraire qu'il n'est point de vérité qui se puisse passer du témoignage. Une vérité sans témoignage serait une vérité sans commerce avec notre intelligence, vérité infiniment plus inaccessible que le mystère lui-même, puisqu'elle tiendrait ses propres manifestations repliées en soi. Il n'est point de vérité qui ne s'atteste et ne soit attestée. Les vérités psychologiques elles-mêmes ont pour témoin cette parole intérieure qui les saisit au fond de la conscience, les dévoile et les produit; et l'identité entre la vérité et le témoignage, qui ne saurait être que dans Celui qui est, laisse néanmoins subsister une distinction personnelle entre l'une et l'autre, puisque le Fils, ou le Verbe de Dieu, rend témoignage du Père. Le Témoignage se retrouve ainsi jusque dans les profondeurs de la Vérité même ; il est donc impossible que la vérité s'en sépare, quand elle sort de son secret.
Ces réserves faites sur l'illégitimité des dédains du Philosophe Inconnu pour la voie traditionnelle, qu'on ne saurait sans erreur annuler au bénéfice exclusif de la méthode d'observation, j'entre volontiers dans la pensée de Saint-Martin et reconnais avec lui la vérité de cet adage : MENS HOMINIS RERUM UNIVERSALITATIS SPECULUM EST. J'admire ces nobles paroles au début de l'un de ses principaux écrits contre les erreurs sociales : « Ce sera toujours l'âme humaine, dit-il, qui me servira de flambeau; et cette lampe à la main, j'oserai marcher devant l'homme dans ces obscurs souterrains où tant de guides, soit trompés, soit trompeurs, l'ont égaré, en l'éblouissant par des lueurs fantastiques, et en le berçant jusqu'à ses derniers instants avec des récits mensongers, mille fois plus pernicieux pour lui que l'ignorance de son premier âge. Les publicistes n'ont écrit qu'avec des idées dans une matière où ils auraient dû n'écrire qu'avec des sanglots. Sans s'inquiéter de savoir si l'homme sommeillait ou non dans un abime, ils ont pris les agitations convulsives de sa situation douloureuse pour les mouvements naturels d'un corps sain et jouissant librement de tous les principes de sa vie ; et c'est avec ces éléments caducs et tarés qu'ils ont voulu former l'association humaine et composer l'ordre politique... Je suis le premier, dit-il encore, qui ait porté la charrue dans ce terrain, à la fois antique et neuf, dont la culture est si pénible, vu les ronces qui le couvrent et les racines qui se sont entrelacées dans ses profondeurs. » (Eclair sur l'Association humaine. Paris, an V (1797).). [p.82]
Saint-Martin pose au début le fait de la déchéance humaine, fait qu'il conclut de l'observation des souffrances et des afflictions de notre nature, et l'un des premiers principes qu'il établit pour éclairer la question de l'ordre social est celui-ci :
LE BUT VÉRITABLE DE L'ASSOCIATION HUMAINE NE PEUT ÊTRE AUTRE CHOSE QUE LE POINT MÊME D'OÙ ELLE EST DESCENDUE PAR UNE ALTÉRATION QUELCONQUE.
Si l'homme est un être spirituel, s'il est esprit, comme l'on n'en saurait douter, tout ce qui émane de lui doit avoir eu primitivement le caractère de l'esprit ; car c'est une loi incontestable que tout être, quel qu'il soit, doit offrir des résultats et des productions de sa nature. Or, tout ce qui émane de l'homme doit avoir eu dans le principe, non seulement le caractère de l'esprit, mais encore le caractère d'un esprit régulier ; car l'agent suprême, dont il ne peut émaner que des êtres qui soient esprits, n'en peut laisser sortir de lui aucun qui n'ait en soi ces sages et éminentes propriétés.
Mais quand on voit la pensée de l'homme produire des conceptions et des œuvres puisées tantôt dans un ordre inférieur à celui de l'esprit, tantôt dans des irrégularités de ce même esprit, on peut assurer que ces œuvres et ces conceptions désordonnées tiennent à une altération quelconque, et ne sont point le produit pur de ses facultés primitives. Ces résultats irréguliers n'excluent pas toutefois en lui le désir, souvent efficace, d'en produire de plus parfaits, en vertu de ce penchant radical qui rappelle tout être à sa vraie nature et à sa manière d'être originelle. Le malade, jusque dans ses délires, prouve qu'il tend à la santé; et dans les désordres mêmes de sa pensée, l'homme est un être qui aspire à remonter à un point d'où il est descendu.
N'est-ce pas, en effet, ce mobile secret et antérieur à l'orgueil même qui pousse les hommes aux travaux de l'esprit, à la poursuite de l'autorité et de la gloire ? Ils s'attachent à la conquête de tous ces objets comme à une sorte de restauration, comme s'ils cherchaient à recouvrer ce dont ils ont été dépouillés, c'est-à-dire la jouissance de tous les droits de la pensée pure et divine.
Cette tendance universelle de l'homme à sa réintégration dans ses vraies mesures serait au besoin vérifiée par les lois mêmes de la nature physique.
« Ne voyons-nous pas que le degré où l'eau peut monter est [p.83] toujours égal à celui d'où elle est partie, et qu'ainsi pour elle le point de tendance et le point de départ ne sont absolument que le même point quant à l'élévation ?
« Ne voyons-nous pas que, dans la végétation, le grain quelconque que l'on sème en terre arrive par sa loi ascendante jusqu'à la hauteur ou à la région où il avait pris naissance, en sorte que le terme de sa fructification ou de sa perfection est le même que le terme de son origine ?
« Enfin ne voyons-nous pas que, dans la géométrie, l'angle de réflexion est toujours égal à l'angle d'incidence ? Toutes vérités exactes et profondes qui paraissent comme la traduction sensible du livre des lois des êtres libres, et comme les modulations relatives et harmoniques de leur ton primitif et fondamental.» (Ibid, p. 23-24).
L'homme dans l'état primitif, en communion avec la source suprême de l'ordre et de la puissance, développant en liberté les germes de ses plus douces vertus, n'aurait pas eu besoin d'y faire usage ni de ses facultés délibérantes et judiciaires, puisqu'il n'y aurait eu pour lui que du bien à recueillir, ni de ses facultés coercitives et répressives, puisqu'il n'y aurait pas eu de méchants à contenir. Ces facultés néanmoins eussent toujours résidé en lui, comme en puissance, comme enveloppées et en repos.
Mais l'altération originelle, altération évidente « et mille fois plus démontrée par une seule des inquiétudes de l'âme humaine, que le contraire ne peut l'être par tous les balbutiements des philosophes, » a fait déchoir l'homme de ce haut rang. La pensée divine, qui eût dû perpétuellement servir de centre et de noyau à l'association primitive, s'est éloignée de lui; mais en se retirant elle ne lui a retranché que ses jouissances et lui en a laissé le souvenir.
« A l'instar des grands de la terre, que l'on exile quand ils sont coupables, le premier ancêtre des humains n'a point été précipité, enfant ni ignorant, dans la région ténébreuse où nous errons ; il y a été précipité homme fait, et dans cette chute on ne lui [a] ôté que l'usage de ses forces. [idem, p.28] » Il en a gardé le sentiment, afin de connaître la peine et le remords. Précipité enfant et dans cet état d'imbécillité aussi étrangère au remords qu'à la prévoyance, il eût expiré de misère et de faim longtemps avant l'âge où cette prévoyance eût pu naître en lui. C'est donc en vain que les publicistes vont chercher dans cette [p.84] prévoyance, nulle ou tardive, la racine de l'association humaine.
Si, dans l'ordre social actuel, les illustres disgraciés, plus sensibles au souvenir de leur grandeur éclipsée qu'au sentiment de leurs besoins présents, cherchent néanmoins à diminuer pour leurs descendants le poids de l'épreuve et de la honte ; si le père retrace à ses enfants le glorieux tableau du passé, leur suggérant à la fois le désir et les moyens de le reconquérir ; si le gouvernement lui-même, dans l'intérêt de sa propre gloire, désire encore plus la restauration de ces nobles exilés qu'il n'a désiré leur punition, il n'est pas moins vrai à coup sûr que le premier père du genre humain aura transmis à ses descendants et les souvenirs de son ancienne gloire et les puissantes espérances de retour qui lui étaient accordées. Et ce sont ces notions divines et ces principes consolateurs qui ont dû servir de noyau ou de centre aux anciennes associations terrestres. C'est à cette source commune que remontent les religions, « qui ne sont réellement dans leur origine que de véritables associations restauratrices dans l'ordre divin. »
D'où Saint-Martin conclut que l'ordre social ne repose que sur l'ordre spirituel, et que « le vrai gouvernement est le gouvernement théocratique. »
C'est en l'an III, peu de temps après la Terreur, à l'époque où le nom de Dieu était effacé de toutes les institutions et de tous les actes politiques, c'est alors qu'il développait ces idées si étrangères à l'esprit du temps : « Dieu, dit-il dans sa Lettre sur la Révolution française, Dieu est le seul monarque et le seul souverain des êtres; il veut être le seul qui règne sur les peuples dans toutes les associations et dans tous les gouvernements. Les hommes qui se trouvent à la tête des nations ne devraient être que ses représentants... Et l'on voit comment cette idée est en eux-mêmes par la confiance qu'ils ont en leur autorité et par les soins qu'ils prennent à la montrer comme émanant de la justice même. Or, comme ces représentants de la Providence, quoiqu'égaux par nature aux autres hommes, seraient distincts et supérieurs par leurs dons et par leurs lumières au reste de la nation, il ne serait pas difficile de voir là d'où les hommes qui abusent de tout ont tiré leurs monarchies humaines et leurs aristocraties terrestres, et d'où dérive ce respect, ou réel ou factice, que chacun a communément pour les autorités qui le gouvernent......
« On nous a dit que le peuple était souverain ; je me fais gloire de [p.85] le penser et d'en convenir hautement. Mais si l'existence de l'homme n'a qu'un seul objet, celui de la culture des éternels domaines de la vérité, le peuple ne peut être souverain que pour ce même but et dans le même sens où nous avons entrevu que l'homme eût dû autrefois être propriétaire. Ainsi, tout en reconnaissant les peuples souverains de droit, selon le plan original, nous ne pouvons nous empêcher de dire que, dans le fait, ils ne sont pas moins descendus que l'homme au-dessous de leur destination primitive.... Aussi cette souveraineté se réduit-elle réellement pour les peuples à éprouver le sentiment de toutes leurs misères, à jeter les yeux sur ceux d'entre eux qu'ils croient les moins incapables de leur servir de libérateurs.... La principale propriété actuelle de l'homme est son indigence, et le premier degré de la souveraineté des peuples, c'est leur impuissance et leur servitude..... Ainsi, disons donc hautement ce qui n'a peut-être encore été jamais entendu des hommes : Quand est-ce que les peuples sont souverains dans toute l'étendue que ce terme comporte ? C'est quand ils sont mis à l'œuvre pour l'accomplissement des décrets de la Providence; c'est quand ils ont reçu à cet effet leur sanction; c'est quand ils sont élevés par là jusqu'à une puissance qui soit au-dessus d'eux, et qui les lie, non plus à l'empire de leur volonté, mais à l'empire de la sienne, comme étant plus fixe et plus clairvoyante que la leur. » [Lette à un ami sur la Révolution française. Paris An III, p.60, 61, 62, 63]
Si l'on donnait, en effet, pour la sanction des peuples cette mutuelle adhésion, ce commerce des volontés rêvé par les publicistes, il n'y aurait là qu'un commerce d'égal à égal, commerce précaire et pouvant cesser à la volonté des parties, qui dès lors n'offriraient que des puissances conventionnelles et des sanctions figuratives.
Il n'en pourrait même jamais sortir une loi obligatoire, « puisque toute loi doit porter sa mulcte [Jurisprudence (Encyclopédie de Diderot), se dit au palais pour amende ; et mulcter, pour condamner ou imposer à une amende] avec soi-même, et que dans tous les individus qui seraient censés avoir fait le contrat, s'il en est beaucoup qui veuillent de la loi, il y en a sûrement fort peu qui veuillent de la mulcte pour leur propre compte.... Enfin le dernier terme où sache s'étendre la loi des hommes, c'est de tuer, punition qui n'effraie que l'homme de matière et amende rarement l'homme moral. Elle m'en imposerait davantage, cette loi, si, au lieu de tuer, elle savait ressusciter et environner les coupables de la lumière de leurs crimes.... » [Idem, p.63, 64]
C'est donc de la région supérieure que découle la souveraineté des peuples, « souveraineté qui, dès lors, n'est plus arbitraire et fragile ; [p.86] souveraineté qui s'appuie sur une base vive, et qui place les nations sous la dépendance des choses et non pas sous la dépendance de l'homme ; parce que s'il arrive que des peuples soient appelés à l'œuvre et sanctionnés de cette manière, il doit alors reposer sur eux une puissance appropriée au plan de la main qui les a choisis, et dont ils ne sont plus que les organes ; et ainsi cette puissance ne se calcule plus selon les conseils de la sagesse de l'homme, et selon la force des peuples et la grandeur de leurs armées, parce que, étant liée à l'ordre vif, il ne serait pas étonnant que, par cette union, elle eût le droit d'étendre à son gré la perspicacité des peuples choisis, de même que l'ardeur et le courage de leurs guerriers, de laisser naitre dans l'esprit des uns et des autres des découvertes et des inventions inattendues, et qu'on les vit par là opposer d'un côté une résistance à l'épreuve de tous les obstacles, et de l'autre imprimer une faiblesse à l'épreuve de tous les moyens....
« L'histoire des nations est une sorte de tissu vivant et mobile où se tamise sans interruption l'irréfragable et éternelle justice. » (Lettre à un ami sur la Révolution française, an III, Paris) [p.64-65]
« Les associations humaines ne peuvent être régulières et solides qu'autant qu'elles sont théocratiques, et le véritable contrat social n'est que l'adhésion de tous les membres du corps politique à cette antique volonté générale qui est avant lui, et qu'il ne pourra jamais créer avec toutes ses opinions et toutes ses volontés particulières. » (Eclair sur l'association humaine, an V, Paris) [p.55].
Loin de reconnaître la volonté générale humaine comme base de l'association et comme lien du contrat social, Saint-Martin ne la reconnaît même pas comme base et principe de la forme de gouvernement, ni de tous les modes d'administration que les hommes inventent et varient chaque jour en aveugles.
Les sanglantes vicissitudes du pouvoir dans la crise révolutionnaire où chaque forme de gouvernement s'est toujours donnée comme l'expression de la volonté commune, détruiraient au besoin l'hypothèse qui fonde sur cette volonté les associations politiques.
Mais il n'est pas jusqu'à cet abus de mots qui ne mette les principes en relief. Plus les hommes, au milieu de tant de méprises, parlent de la volonté générale, plus ils annoncent qu'il devrait y en [p.86] avoir une qui le fût ; et quoiqu'ils tendent à faux et à sens inverse vers ce point du niveau dont ils auront besoin pour conserver leur équilibre, il n'est pas moins certain qu'ils y tendent, et constatent par leurs illusions mêmes l'existence de cette volonté supérieure et vraiment universelle.
Ce serait, en effet, le plus inconcevable prodige que tout ne fût pas renversé sans retour « si cette éternelle volonté ne laissait jamais percer au travers des nuages épais qui nous environnent quelque lueur de son inaltérable clarté; et la plus grande preuve que, à notre insu.... elle ne cesse de jeter quelques regards sur l'ordre des choses, c'est que ces choses existent. » [Eclair..., p.66]
De ces principes, Saint-Martin conclut à la soumission aux Puissances. Fussent-elles injustes, ce n'est point à l'homme seul à les redresser ; il ignore toujours « la main cachée qui peut agir sous ces mains visibles. » [Idem, p.67]
Les fausses voies où la science politique s'est engagée ont amené cette absurdité évidente, savoir : « que selon le plan naturel des choses, il y ait dans les mêmes espèces des souverains du même ordre, des chefs du même genre, et que ce soient les individus qui les choisissent. » [Idem, p.68] Ce principe électif peut à la rigueur s'admettre dans des circonstances urgentes, dans le cas d'une altération évidente du corps social et du mobile régulier qui devrait lui servir de boussole ; mais il n'est tolérable qu'autant que l'état social ne s'élève pas au-dessus de l'ordre inférieur et matériel. Dès qu'il monte, « les élections humaines ne sont plus qu'illusoires, parce qu'il aborde des régions dont l'homme n'a plus ni la clef ni la carte, et c'est en voulant agir comme les ayant encore l'une et l'autre, qu'il ravage l'ordre inférieur social au lieu de le restaurer. » [Idem, p.70]
Étrange prétention de ceux qui, demandant à de simples élections humaines une autorité impérieuse, non contents des affaires du ménage, veulent dominer souverainement dans toute la maison ! Mais « n'est-ce pas le père de famille qui choisit les gouvernantes et les instituteurs de ses enfants, ainsi que les fermiers et les laboureurs de ses terres ? Et sont-ce jamais les gouvernantes, les instituteurs, les fermiers et les laboureurs qui choisissent le père de famille ? » [Idem, p.71]
Rousseau a dit que la souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu'elle ne peut être aliénée ; il dit aussi qu'à l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre, il n'est [p.88] plus. Il dit enfin que les députés du peuple ne peuvent être que ses commissaires.
D'accord avec Rousseau, quant à l'idée d'un représentant qu'il regarde en effet comme un être de raison dans le sens ordinairement reçu, Saint-Martin s'éloigne de lui quant à l'idée de la souveraineté du peuple, qu'il place non dans la chimérique volonté générale du peuple, mais dans l'éternelle sagesse ou l'universelle pensée divine. (Voir l’encadré)
|
Encadré, note de L. Moreau, p.88. « Lorsqu'un élu, selon les voies humaines et inférieures, s'annonce pour être le représentant du peuple, il doit, s'il est juste et bon logicien, dire à ses concitoyens: Je ne suis représentant que d'une partie de votre volonté ; savoir : de celle qui a pour objet l'administration de vos affaires domestiques, parce que vous avez le pouvoir de me confier ces soins inférieurs ; mais je vous tromperais et je me mentirais à moi-même, si je me disais le représentant de votre volonté entière ou de celle qui embrasserait tous les degrés de votre existence, et toutes les bases ainsi que tous les ressorts de votre ordre social : car vous n'avez plus la jouissance de toutes les lumières et de toutes les pensées qu'il faudrait pour cela ; et par votre élection, il vous a été impossible de me les donner, et à moi de les recevoir. Ce n'est donc qu'en vous abaissant que je m'élève ; ce n'est qu'en vous ôtant l'usage de vos moyens que je parais en avoir plus que vous ; ce n'est qu'en vous rapetissant journellement que je me fais passer pour grand à vos yeux. Que serait-ce donc si je n'usais de mon ministère que pour vous ruiner, pour vous ôter la liberté ou la vie ! Il est clair que ce n'est point à ces actes-là que vous m'auriez appelé, puisque chaque citoyen peut dissiper ses biens, se tenir renfermé ou se couper le col quand il lui plaît, et qu'il n'a pas besoin d'un représentant pour se satisfaire sur tous ces points. » Éclair sur l'association humaine, p. 71-73. |
Or, comme cette pensée n'est plus la source où les législateurs humains puisent leurs inspirations, ils ne portent plus que des lois prohibitives, lois d'épouvante et d'angoisse. Ces codes humains semblent n'en être jamais qu'au régime de la terreur. « On dirait qu'il n'y a qu'un seul sentiment dans l'âme des législateurs, celui de l'état précaire et fragile de leur édifice politique et celui de la défiance envers les gouvernés, qu'ils regardent moins comme des pupilles que comme des adversaires. » [Idem, p.75-76]
Au lieu de ces lois fécondes et de ces codes productifs, dont la vérité retentirait dans le cœur de tous les hommes, « les législateurs [p.89] humains sont venus gouverner la terre avec des lois mortes qu'ils n'ont su montrer que comme un épouvantail, et qu'en les environnant de menacés et d'échafauds : supplices et menaces qui ne tiennent presque jamais à la nature du délit, tandis que, dans l'ordre réel, l'on nous ouvrirait les yeux sur nos véritables dangers, et nous verrions toujours la peine liée naturellement aux transgressions. » » [Idem, p.78]
Or, l'une des plus incontestables règles de la justice serait que, dans les peines afflictives, les législateurs humains n'ôtassent jamais au criminel que ce qu'ils pourraient lui rendre, s'il venait à s'amender. Qu'ils lui ôtent donc ses dignités, ses biens, sa liberté même ; mais où donc prennent-ils ce droit de mort sur leur semblable ?
Saint-Martin rattache l'origine de la peine à la délégation que souvent, dans les temps antiques, la souveraine puissance a faite de ce droit divin à la voix et à la main de l'homme, en éclairant alors le ministre de ses justices de lumières surhumaines. Or, c'est l'ordre exprès de cette souveraine puissance qui seul peut mettre l'exercice de ce droit à couvert de l'injustice et de l'atrocité, parce que, même en détruisant l'homme, elle peut lui rendre beaucoup plus qu'elle ne lui a ôté ; seule, elle peut apporter à ce droit une exacte compensation.
Mais les législateurs humains , « ne portant que les ombres de ces hautes vérités dans leur justice composite, » [Idem, p.82] se sont approprié un droit qui n'avait été que prêté exceptionnellement à quelques-uns, et ils décident encore, condamnent, tuent, comme s'ils avaient l'autorité divine.
C'est une injustice et c'est aussi une inconséquence ; car les hommes, en s'abrutissant de plus en plus, ont perdu à proportion ces puissantes facultés de mal qui attiraient les vengeances suprêmes. Ennemis moins intelligents et moins actifs de la source-esprit, « ils s'éloignent d'autant des vastes foyers de crimes qui appelaient la mort ; et cependant les lois humaines, sans chercher à se rallier à des lois antérieures à elles et à s'unir à la source vive d'où doivent dériver tous les pouvoirs, ne prononcent pas moins cette mort journellement... La justice prise dans son sens intégral doit être une guérison et une cure, et non pas une destruction ; car si c'est une belle chose que de savoir mettre de la mesure entre les délits et les peines, c'en est une plus belle encore d'en savoir mettre entre la justice et l'amour... et, sous ce rapport, l'homme-esprit pourra trouver, sans que je le lui nomme, quel a été à la fois le plus sage législateur et le meilleur administrateur de la terre » (Éclair sur l'association humaine, p.84).
Mais, dans leurs égarements et leurs ténèbres, les hommes appellent leurs erreurs par des noms de vérités, noms qui représentent les éléments constitutifs de toute association humaine. Or, détournés, pour la plupart, comme celui de la justice, de leur véritable sens, ces noms de liberté, de gloire, d'honneur, d'intérêt national, de religion, etc., deviennent autant d'idoles qui demandent et qui obtiennent en sacrifice le sang de l'homme lui-même.
« Et nous, dit Saint-Martin, qui nous croyons si fort au-dessus des autres peuples... voyons combien nous avons offert de victimes humaines dans la révolution aux mots de nation, de sûreté de l'Etat, etc. N'oublions pas, surtout, combien nous en avons offert au mot liberté, et cela devant une image matérielle qui en porte le nom, mais qui n'est qu'une image muette de cette pensée féroce dont les sacrificateurs ou les bourreaux étaient les ministres... C'est donc malheureusement une vérité trop certaine que toutes les nations de la terre couvrent de morts, soit leurs champs de bataille, soit les théâtres de leurs cruautés, et que sur ces lacs de sang vous entendez planer des voix qui répandent le bruit de leurs actions triomphales, et qui crient : Victoire, gloire, liberté... sans laisser à l’oreille le temps de démêler le sens de toutes ces impostures. Devons-nous avoir une plus grande idée de ce nom de paix qui succède à toutes ces boucheries, et que les peuplent célèbrent avec tant d'exaltation, comme s'ils avaient vaincu leur vrai ennemi, qui est l'ignorance et l'illusion, tandis qu'avec le beau nom de paix et toutes les fêtes qui l'accompagnent, ils ne font tout au plus que mettre des entr'actes à leurs délires ?» [Idem, p.89-91]
Mais cet abus des noms, issu de l'abus des choses, n'en rend pas moins hommage aux principes violés. Dans ce mélange de crimes et d'absurdités, nous découvrons toujours que comme c'est une pensée religieuse qui est le noyau et le principe des associations humaines, c'est cette même pensée qui se montre à faux et en sens inverse dans tous leurs mouvements et dans toutes leurs révolutions ; en d'autres termes, toutes les sociétés continuent de reposer sur des pensées restauratrices et religieuses, puisque ces noms, mobiles de tant de [p.91] faits politiques, ne sont que l'expression défigurée et contournée de ces mêmes pensées.
Dans la main de l'homme dépravé, la marche de la société naturelle est devenue destructive de la nature, parce qu'il n'a cherché qu'à s'y passer de la sagesse et de la vertu; la marche de la société civile est devenue destructive de la justice, parce qu'il n'a cherché qu'à s'y passer de l'esprit de la loi, qui est le bonheur de tous; enfin la marche de la société politique est devenue destructive de la base elle-même ou de la Providence, parce qu'il n'a cherché qu'à s'y passer de ce seul principe de la force réelle et de l'efficacité de toute vraie puissance. Quelle que soit, en effet, la forme des gouvernements, « la Providence ne peut les faire prospérer qu'autant qu'ils sont vivifiés par la sagesse et son invariable raison; en un mot, qu'autant qu'ils ont véritablement l'esprit théocratique, non pas théocratique humain, pour ne pas dire théocratique infernal, mais théocratique divin, spirituel et naturel, c'est-à-dire reposant sur les lois de l'immuable vérité et sur les droits de ce fatalisme sacré qui unit Dieu et l'homme par une alliance indissoluble. » [Lettre a un ami, p.59]
Cette distinction entre le théocratique divin et le théocratique humain ou infernal est une de ces pensées sinistres qui donneraient au besoin la date de l'ouvrage, si elle venait à se perdre. Ces grandes vues sur le principe des sociétés humaines, ces réflexions sur la Révolution française, si profondes et si vraies, ce magnifique exposé des vraies doctrines sociales, où M. de Maistre a évidemment puisé ses immortelles Considérations et son Principe générateur des constitutions politiques ; - tant d'éloquents témoignages rendus à la vérité, Saint-Martin sent, pour ainsi dire, le besoin de les expier. Il s'empresse d'altérer tout cela par un mélange d'idées fausses et de sentiments coupables. Pour se faire pardonner les vérités qu'il a osé dire, comme il est généreux à lui de rivaliser avec les impies d'invectives et de haine contre le clergé qui confesse ces mêmes vérités par son sang ! C'est au moment où le bras de la Révolution est étendu sur les prêtres dépouillés, proscrits, égorgés, c'est au moment où de toutes parts le sang des martyrs crie, que lui, avec la passion d'un sectaire et la lâcheté d'un sophiste, se retournant contre les victimes, il leur impute l'athéisme des bourreaux ! Où trouver en effet une phrase plus insensée, plus abjecte que celle-ci :
« Le dessein de la Providence a été de nettoyer son aire avant d'y [p.92] apporter le bon grain.... Elle saura bien faire naître une religion du cœur de l'homme..... qui ne sera plus susceptible d'être infectée par le trafic du prêtre et par l'haleine de l'imposture, comme celle que nous venons de voir s'éclipser avec les ministres qui l'avait déshonorée : ces ministres qui, tandis qu'aucun gouvernement ne devrait marcher que sous l'égide de la prière, ont forcé le nôtre, pour sa sûreté, à rompre toute espèce de rapport avec cette prière, à la retrancher de lui tout entière, comme étant devenue pestilentielle, et à être ainsi le seul gouvernement de l'univers qui ne la compte plus parmi ses éléments; phénomène trop remarquable pour échapper aux observateurs instruits dans les lois de l'équilibre de la justice et des compensations divines » (Lettre à un ami sur la Révolution française, p. 78. Paris, an III).
On doit plaindre un esprit de cet ordre quand il consent à descendre si bas. Ce penseur original et profond, le voilà qui demande au protestantisme ses calomnies les plus banales et au style révolutionnaire ses expressions les plus néfastes pour relever de quelque nouveauté ces coupables lieux communs. Que reproche-t-il au clergé ? De substituer son règne au règne de Dieu, de vouloir être lui-même la Providence des peuples, de couvrir la terre de temples matériels, dont il se fait partout la principale idole, et de peupler ces temples de « toutes les images que son industrieuse cupidité peut inventer, » [Idem, p.78] égarant ainsi et tourmentant la prière au lieu de lui tracer un libre cours.
Et il ajoute : « Ils n'ont fait partout de leurs livres sacrés qu'un tarif d'exaction sur la foi des âmes; et ce rôle à la main, escortés par la terreur, ils venaient chez le simple, le timide ou l'ignorant, à qui ils ne laissaient pas même la faculté de lire sur le rôle sa quote de contribution de croyance en leur personne, de peur qu'il n'y vit la fraude. » [Idem, p.15] Il s'arrête, parce que ces tableaux répugnent trop à son cœur, et il lui suffit de montrer les prêtres comme les accapareurs des subsistances de l'âme. Voilà le dernier trait, et il ne songe pas un instant que ces tableaux, qui répugnent à son cœur, pourraient bien 'n'être qu'un mauvais rêve de sa raison.
C'est avec une surprenante facilité qu'il se paie d'un mot, d'une image, d'un pur jeu d'esprit pour conclure à un fait qui ne tarde pas à lui donner un principe. Il se souvient, par exemple, que quelquefois [p.93] il a comparé l'état politique de l'homme sur la terre à un édifice composé d'un souterrain, d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage. « J'ai vu, ajoute-t-il, que les gouvernements humains, soit sacerdotaux, soit séculiers, sous quelque forme qu'ils fussent, avaient précipité presque tous les peuples dans le souterrain. Or les Français, par l'effet naturel de leur révolution, sont sortis de ce souterrain et sont montés au rez-de-chaussée ; mais tant qu'ils n'auront pas monté jusqu'au premier, ils n'auront pas consolidé leur œuvre. » [Idem, p.74]
S'imagine-t-on que la mémoire d'un penseur garde cette longue fidélité à une comparaison si banale et si vague pour en tirer une vue si complétement insignifiante ? Il déclare d'un ton de voyant que presque tous les peuples ont été précipités dans le souterrain. Mais si quelques-uns plus heureux ont échappé à cette servitude et à ces ténèbres, que ne nous fait-il connaître le nom de ces rares privilégiés ? Que dis-je ? Ces gouvernants qui précipitent les gouvernés au fond du souterrain habitent-ils donc eux-mêmes, soit le rez-de-chaussée, soit le premier étage, s'il faut entendre par ces deux degrés divers une situation supérieure dans l'ordre intellectuel et moral ? Or, il est évident que montés à ce rez-de-chaussée ou à ce premier étage, selon le sens que Saint-Martin attache à ces expressions, ils n'auraient qu'une pensée et qu'un désir, la pensée et le désir d'élever les peuples jusqu'à leur bonheur, jusqu'à leurs lumières. S'il en est autrement, il faut donc reconnaître que les gouvernants mêmes sont beaucoup moins tyrans qu'esclaves, tendant les mains, comme les autres hommes, aux communes chaînes de l'ignorance et de l'erreur. Cette conséquence me semble rigoureuse ; elle ôte à la pensée de Saint-Martin le sérieux et la portée qu'elle affecte ; elle la réduit aux proportions d'un certain lieu commun qui traine volontiers dans les manuels de philosophie, où l'on ne cesse de mettre aux prises deux fantômes que l'on appelle l'autorité et la liberté, l'un aspirant à une éternelle tyrannie, l'autre s'agitant dans une éternelle révolte. Mais comme, en définitive, c'est à l'esprit humain qu'il faut s'en prendre et de cette tyrannie et de cet esclavage, comme c'est lui qui professe l'autorité, lui qui proclame la liberté, tout revient à dire que l'esprit humain opprime l'esprit humain, que l'esprit humain s'affranchit de l'esprit humain ; en d'autres termes, que l'esprit humain s'opprime lui-même et qu'il s'affranchit de lui-même. Tout se réduit donc à un non-sens. [p.94]
Que dire de ce rez-de-chaussée, que dire de ce premier étage qui permet, suivant Saint-Martin, de distinguer un plus grand espace et de mieux surveiller l'ennemi, c'est-à-dire l'auteur du mal ? N'est-ce pas se faire une étrange illusion que d'accorder aux révolutions politiques, et d'une manière si absolue, ces pieuses et mystiques conséquences ? N'est-ce pas excéder les limites permises de l'optimisme que de prêter aux faits purement temporels le pouvoir d'accroître les richesses spirituelles de l'homme ? Il est incontestable que les dogmes nécessaires à l'ordre de ce monde sont établis, et il n'est pas de raison suffisante pour concevoir l'introduction d'un dogme ou d'un principe nouveau. Toutes les vérités religieuses et morales que l'homme peut porter ont, surtout depuis dix-huit siècles, le degré d'évidence dont elles sont susceptibles sur la terre. Ces crises sanglantes où la justice divine éclate, tempérée par la clémence, les révolutions sont chargées d'appliquer à la propagation de ces vérités les crimes mêmes et les erreurs des hommes ; mais aucun événement humain ne saurait répandre un jour nouveau sur une vérité immuable, encore moins inaugurer une vérité supérieure ; aucun événement humain ne saurait communiquer aux âmes une impulsion de foi et d'amour qu'elle ne vienne de celui qui a réconcilié les pécheurs à son père. La nature du progrès qui nous a mis en possession du rez-de-chaussée me laisse de grands doutes sur la nouveauté des lumières et des vertus que nous offrira le premier étage.
Malheureusement, ces vues si hasardées, ces illusions du théosophe ne sont pas de simples caprices d'imagination ; elles tiennent à une erreur systématique. N'admettant pas que la vérité ait institué sur la terre une société dépositaire infaillible de ses enseignements et de son autorité, il regarde comme un progrès tout ce qui tend à supprimer entre l'homme et Dieu l'intermédiaire humain. Il applaudit donc à la dispersion du clergé, et ce grand désastre des âmes, il le salue comme un décret manifeste de la Providence qui prononce sans retour la déchéance du sacerdoce. C'est le rêve éternel des humanitaires, qui attendent toujours pour prier que la prière se passe de prêtre, d'autel et de paroles. L'homme égaré ne veut pas voir qu'il ne saurait faire l'ange sans se condamner à faire la bête.
Mais, par une contradiction inévitable, en excluant l'homme de l'administration des choses spirituelles, le principe d'indépendance y ramène l'individu. Ainsi, quand Saint-Martin proteste contre la [p.95] théocratie infernale, c'est-à-dire l'Eglise et son immuable autorité, et qu'il appelle de ses vœux et de ses espérances l'avènement de la théocratie divine, qu'est-ce à dire ? Pense-t-il que des anges vont se charger de réaliser sur la terre son utopie mystique ? Il faut après tout en venir à des hommes. Or, à défaut d'une société spirituelle visible, divinement instituée, divinement assistée jusqu'à la fin des temps, régulatrice infaillible et suprême des mouvements de l'humanité, faudra-t-il embrasser l'hypothèse de l'inspiration particulière, et croire à une délégation spéciale de toute puissance divine et humaine aux mains d'un visionnaire ou d'un hypocrite qui s'érige en juge ou en prophète de l'ancienne loi ? Saint-Martin ne détrônerait donc l'Eglise que pour s'incliner devant quelques hommes, ministres ou fléaux de la Providence, qu'il lui plaira d'investir de tous les droits qu'il refuse à l'Epouse de Jésus-Christ ? Mais ne voit-il pas qu'il aspire à la ruine d'une autorité certaine, définie, perpétuelle, pour n'élever à sa place qu'une autorité vague, capricieuse, intermittente ?
Etrange autorité qui, dans l'hypothèse la plus favorable, ne vivrait que sur la crédulité des gouvernés, dupes des gouvernants, et sur l'illusion des gouvernants, dupes d'eux-mêmes !



