1846 - Le Correspondant – T 14
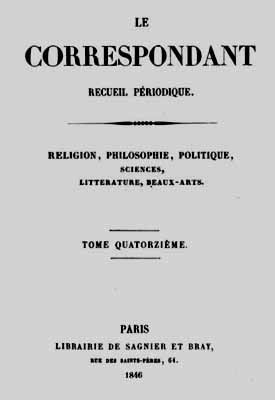 Le Correspondant, Recueil périodique
Le Correspondant, Recueil périodique
Religion, philosophie, politique, sciences, littérature, beaux-arts.
Tome quatorzième
Paris. Librairie de Sagnier et Bray, rue des Saint Pères, 64
1846 - Examen des doctrines du Philosophe inconnu
Examen des doctrines du Philosophe inconnu, Louis-Claude de Saint-Martin, Louis Moreau
1er article - [Sur la vie et les écrits de Saint-Martin]
Pages 495-512
À l'avènement du Christianisme, la seule religion qui survécût à toutes les autres dans le monde romain, c'était la religion du plaisir ou la foi à la débauche. La famille et le foyer domestique n'avaient plus leur culte; les grands dieux, relégués au loin dans leur béatitude et leur indifférence, laissaient à leur place régner Epicure, c'est-à-dire l'homme lui-même avec ses passions. De nobles âmes protestaient vainement contre la doctrine facile qui place dans la jouissance le souverain bien ou la vertu, et les derniers sages du paganisme s'élevèrent d'un effort désespéré contre cette incrédulité grossière et cynique. Mais entre les débris de ces croyances inanimées et les clartés nouvelles voilées à leurs yeux, les philosophes du Portique eurent beau glorifier la liberté morale ; ils exaltèrent l'homme quand il fallait l'humilier ; ils négligèrent la raison du devoir et méconnurent l'instinct de l'espérance. Les néo-platoniciens eurent une notion plus profonde et plus vraie des besoins de l'âme, mais ils livrèrent la philosophie à toutes les puériles superstitions du mysticisme et de la thaumaturgie. Une immoralité effrénée avait envahi la conscience humaine.
Quelque chose de semblable se passe en France dans le cours du XVIIIe siècle. Les hautes classes de la société professent l'épicuréisme pratique de la philosophie voltairienne, et, à leur exemple, le peuple et la bourgeoisie poursuivent ce divorce avec la vérité, qui doit avoir dans la révolution française sa consommation dernière et son expiation. [p.496] On renaît de toutes parts au paganisme, à ses mœurs, à sa sagesse. En présence de ces orgies et de ces molles opinions, quelques-uns reprennent le pallium stoïque; l'Eloge de Marc-Aurèle obtient un succès presque populaire. Sous le nom de tolérance, le scepticisme (mais un scepticisme avide de ruines) détruit la foi dans les âmes, où règne l'égoïsme sous le nom d'amour de l'humanité.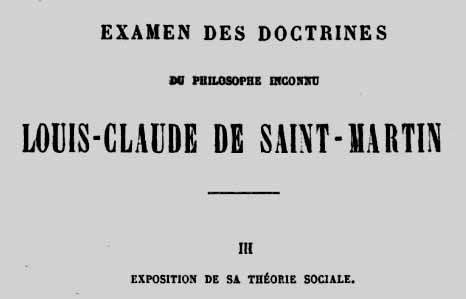
La philanthropie est la charité du déisme. Le dogme de l'indifférence de Dieu pour les hommes implique en morale l'indifférence de l'homme pour ses frères : c'est le moi qui s'affranchit également de Dieu et des hommes. Cependant l'homme ne saurait demeurer dans cette fausse indépendance ; il ne tient pas dans cet égoïsme étroit et sauvage. L'une répugne à son intelligence, qui a besoin de croire ; l'autre à son cœur, qui a besoin d'aimer. Son intelligence est trop vraie pour ne croire qu'en soi-même, et son cœur est trop grand pour n'aimer que soi-même. Si une heureuse inspiration ne le ramène aux pieds de la vérité, il ira plutôt demander aux conceptions les plus monstrueuses, ou aux fantaisies les plus vaines, de quoi remplir ce vide que Dieu laisse en lui par son absence. Aussi voyons-nous à la fin de ce siècle beaucoup d'esprits, fatigués du doute ou blasés, incapables par eux-mêmes de revenir aux croyances saines et durables, chercher un réveil funeste dans les pratiques de rites abominables ou honteux. Mesmer et Cagliostro exploitent la crédulité d'une époque incrédule. Les uns poursuivent la satisfaction d'une infatigable curiosité dans la recherche du grand œuvre ; d'autres se flattent de pénétrer au plus intime de notre nature pour y surprendre le mystère de l'âme et dominer la volonté : ils empruntent à un sommeil néfaste des révélations étrangères à la science. D'autres enfin, combinant le néo-platonisme alexandrin avec les spéculations de la kabbale et de la gnose, et accommodant le Christianisme à cet informe mélange de doctrines, prétendent s'élever à Dieu, non plus par la foi, mais par la connaissance ; non plus par l'abaissement volontaire de l'esprit et du cœur, mais par l'intuition particulière ou la notion vive ; non plus par l'humble acceptation des mystères, mais par le raffinement d'une science ténébreuse, par les rites occultes de la magie et de la théurgie renfermés dans l'enceinte des loges maçonniques.
Un juif portugais conduit par la kabbale au Christianisme (Je ne sais trop quel Christianisme), Martinez Pasqualis, avait fondé un système de théosophie et de magie qui se rattachait, même par une sorte de filiation historique, à la kabbale et au néo-platonisme. Dès 1754, il avait introduit un rite kabbalistique d’élus, appelés COHENS ou PRÊTRES, dans plusieurs loges de France, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux. Il ralliait à sa doctrine ces intelligences égarées, flottantes entre la philosophie d’alors et la religion, [p.497] également incapables de douter et de croire : âmes malades que le sourire de Voltaire avait blessées, et à qui le pain des forts, qui est aussi celui des humbles, ne pouvait plus suffire. Au nombre des disciples de Martinez était un jeune officier au régiment de Foix, qui cependant n'accordait à cet enseignement qu'une adhésion imparfaite. Il avait vingt-trois ans, et toutefois il ne se laissait guère séduire par ces voies extérieures qu'il ne regardait que comme les préludes de notre œuvre. Il préférait déjà la voie intérieure et secrète, et, comme lui-même le raconte, au milieu de ces choses si attrayantes, au milieu des moyens, des formules et des préparatifs de tous genres auxquels on le livrait, il lui arriva plusieurs fois de dire au maître : « Comment, maître, il faut tout cela pour prier le bon Dieu ? » Et le maître répondait : « Il faut bien se contenter de ce que l'on a. » [Correspondance inédite, lettre IV, p.15]
Le philosophe inconnu ne s'est pas assez souvenu de cette question simple et profonde du jeune officier.
Louis-Claude de Saint-Martin (car c'est de lui dont il s'agit) était né d'une famille noble, le 18 janvier 1743, à Amboise, en Touraine, à quelques lieues de la patrie de Descartes, qui n'a pas été sans influence sur lui, et non loin du berceau de Rabelais, qu'il semble vouloir rappeler dans le poème bizarre du Crocodile.
Quoiqu'il ait beaucoup parlé de lui, on n'a presque aucun détail sur sa famille, sur les circonstances privées de son enfance et de sa jeunesse. C'est moins sa vie dans le temps et avec les hommes que sa vie intérieure et avec lui-même dont il aime à s'entretenir.
Il a écrit ces belles paroles :
« Le respect filial a été, dans mon enfance, un sentiment sacré pour moi. J'ai approfondi ce sentiment dans mon âge avancé, et il n'a fait que se fortifier par là. Aussi, je le dis hautement, quelque souffrance que nous éprouvions de la part de nos père et mère, songeons que sans eux nous n'aurions pas le pouvoir de les subir et de les souffrir, et alors nous verrons s'anéantir pour nous le droit de nous en plaindre ; songeons enfin que sans eux nous n'aurions pas le bonheur d'être admis à discerner le juste de l'injuste, et, si nous avons occasion d'exercer à leur égard ce discernement, demeurons toujours dans le respect avec eux pour le beau présent que nous avons reçu par leur organe et qui nous a rendu leur juge. Si même nous savons que leur être essentiel est dans la disette et dans le danger, prions instamment le souverain Maître de leur donner la vie spirituelle en récompense de la vie temporelle qu'ils nous ont donnée. » [Œuvres posthumes, « Mon portrait », n°67].
Il gardait de sa belle-mère un tendre souvenir ; mais le témoignage qu’il lui rend, dicté par une vive reconnaissance, nous laisse entrevoir, sous le voile un peu mystique du langage, que cette affection n’était pas sans inquiétude et sans contrainte. [p.498]
« J'ai une belle-mère, disait-il, à qui je dois peut-être tout mon bonheur, puisque c'est elle qui m'a donné les premiers éléments de cette éducation douce, attentive et pieuse, qui m'a fait aimer de Dieu et des hommes. Je me rappelle d'avoir senti en sa présence une grande circoncision intérieure qui m'a été fort instructive et fort salutaire. Ma pensée était libre auprès d'elle et l'eût toujours été, si nous n'avions eu que nous pour témoins ; mais il y en avait dont nous étions obligés de nous cacher comme si nous avions voulu faire du mal. » [idem, n°111]
Au collège de Pont-Levoy, où il fut envoyé vers l'âge de dix ans, il lut le beau livre d'Abbadie : l'Art de se connaître soi-même, et cette lecture parait avoir décidé de sa vocation pour les choses spirituelles. Cependant, ses études terminées, il lui fallut suivre un cours de droit, et, cédant au désir de son père, il se fit recevoir avocat du roi au siège présidial de Tours. Mais les fonctions assidues de la magistrature ne pouvaient retenir cette intelligence méditative et profonde, plus capable de remonter aux sources mêmes du droit que de s'astreindre à la lettre de la jurisprudence. Il renonça bientôt à la magistrature pour embrasser la profession des armes, et ce ne fut pas l'instinct militaire qui lui fit prendre l'épée ; car « il abhorrait la guerre, » quoiqu'il « adorât la mort » (« J’abohrre la guerre, j’adore la mort », Œuvr. post., Pensées, 952) ; mais il trouvait dans les loisirs d'une garnison cette espèce d'indépendance que le barreau ne laisse ordinairement ni à l'esprit ni aux habitudes.
Ce fut à Bordeaux que, affilié avec plusieurs officiers du régiment de Foix à l'une des sociétés fondées par Martinez Pasqualis, il suivit les leçons de ce maître, en qui il reconnaissait « des vertus très actives, » mais dont il s'éloigna depuis pour se donner tout entier au fameux cordonnier de Görlitz, Jacob Böhm, le prince des théosophes allemands. « Excepté mon premier éducateur Martinez Pasqualis, disait-il, et mon second éducateur Jacob Böhme, mort il y a cent cinquante ans, je n'ai vu sur la terre que des gens qui voulaient être maîtres et qui n'étaient pas même en état d'être disciples. » [Portrait, n°73].
Martinez, selon le témoignage de Saint-Martin, avait la clef active des spéculations théosophiques de Bœhm. Il professait l'erreur d'Origène sur la résipiscence de l'être pervers à laquelle le premier homme aurait été chargé de travailler. Cette idée paraît à Saint-Martin digne du plan universel, mais il prétend n'avoir à cet égard aucune démonstration positive, excepté par l'intelligence. « Quant à Sophie et au Roi du Monde, dit-il encore, Martinez Pasqualis ne nous a rien dévoilé sur cela, et nous a laissé dans les notions ordinaires de Marie et du démon. Mais je n'assurerai pas pour cela qu'il n'en eût pas la connaissance. » [Correspondance, Lettre XCII, p.272] On voit reparaître dans ces obscurs et téméraires enseignements cette [p.499] distinction entre la doctrine livrée au vulgaire et celle dont le sanctuaire ne s'ouvre que pour un petit nombre d'initiés, cette doctrine ésotérique qui n'est que le système des castes intellectuelles, et dont le Christianisme a horreur.
Martinez Pasqualis était venu à Paris en 1768, et, pendant les dix années de son séjour en cette ville, il se fit de nombreux prosélytes, qui, vers 1775, formèrent une secte connue sous le nom de Martinistes, et très répandue dans l'Allemagne et dans le Nord. Saint-Martin venait de publier à Lyon son livre des Erreurs et de la Vérité, et cette circonstance a pu concourir avec la similitude du nom à faire passer le disciple pour le fondateur même de l'école. Après le départ de Martinez, mort en 1779 [sic, pour 1774] au Port-au-Prince, l'école se fondit à Paris dans la Société des Grands-Profès ou dans celle des Philalèthes. Invité en 1784 à cette dernière réunion, Saint-Martin refusa de s'y rendre. Il dédaignait la recherche du grand œuvre et les opérations de la franc-maçonnerie.
(Il écrivait plus tard, touchant ces premières initiations théurgiques et cabalistique» : « Dans l'école où j'ai passé, les communications de tout genre étaient fréquentes. J'en ai eu ma part comme beaucoup d'autres. Les manifestations ou signes du réparateur étaient visibles; j'y avais été préparé par des initiations... Mais le danger de ces initiations est de livrer l'homme à des esprits violents, et je ne puis répondre que les formes qui se communiquaient à moi ne fussent pas des formes d'emprunt. » — Satan se transfigure en ange de lumière, dit l'Apôtre). [Correspondance, lettre XIX, p.62].
Les manifestations sensibles lui révélaient, dans la doctrine de Martinez, une science des esprits, dans la doctrine de Swedenborg une science des âmes ; les phénomènes du magnétisme somnambulique appartenaient, suivant lui, à un ordre inférieur, mais il y croyait. Cherchant dans une conférence avec Bailly à convaincre ce savant de l'existence d'un pouvoir magnétique où l'on ne pouvait soupçonner la complicité du malade, il signale plusieurs opérations faites sur des chevaux que l'on traitait par le magnétisme. « Que savez-vous, dit Bailly, si les chevaux ne pensent pas ? — Monsieur, lui répondit Saint-Martin, vous êtes bien avancé pour votre âge. » [Portrait, n°122]
Dans cette même année 1784, il rédigea un mémoire sur cette question proposée par l'Académie de Berlin : « Quelle est la meilleure manière de rappeler à la raison les nations, tant sauvages que policées, qui sont livrées aux erreurs et aux superstitions de tout genre ? » L'intention de cette niaiserie philosophique est évidente. C'était le temps où les Nicolaïtes ou illuminants, Aufklœrer, précurseurs immédiats des rationalistes, comparaient hautement le divin Maître au célèbre imposteur tartare, le dalaï-lama. Saint-Martin entreprit de démontrer que la solution demandée était impossible par les seuls moyens humains : ce n'était pas la réponse que voulait l'Académie, et la question ayant été [p.500] remise au concours pour l'année suivante, un pasteur de l'Eglise française, nommé Avrillon, obtint le prix en donnant au problème une solution platonicienne. La thèse qu'il avait soutenue en face de l'Académie de Berlin, Saint-Martin la développa quatorze ans plus tard dans ses «Réflexions d'un observateur sur la question proposée par l'Institut (de France) : Quelles sont les institutions les plus propres à fonder la morale d'un peuple ? » (An VI, 1798.)
Je reviendrai sur ce sujet.
C'est à peu près vers cette époque de sa vie que, pendant un séjour qu'il fit à Strasbourg, il dut à l'une de ses amies, Mme Bœcklin, de connaître les écrits du célèbre illuminé Jacob Bœhm. Il avait déjà dépassé les dernières limites de la jeunesse, et cependant il se mit avec ardeur à l'étude de la langue allemande, afin d'entendre les ouvrages de ce théosophe qu'il regarda toujours depuis « comme la plus grande lumière humaine qui eût paru. » Cette admiration exaltée jusqu'au fanatisme lui inspirait ces paroles bizarres :
« Ce ne sont pas mes ouvrages qui me font le plus gémir sur cette insouciance générale ; ce sont ceux d'un homme dont je ne suis pas digne de dénouer les cordons de ses souliers (sic), mon charissime Bœhm. Il faut que l'homme soit entièrement devenu roc ou démon pour n'avoir pas profité plus qu'il n'a fait de ce trésor envoyé au monde il y a cent quatre-vingts ans. » [Œuvres Posthumes, pensée 334].
Dans un voyage qu'il fit en Angleterre en 1787, il se lia avec l'ambassadeur Barthélémy et connut William Law, éditeur d'une version anglaise et d'un précis des livres de Jacob Bœhm. En 1788, il alla visiter Rome et l'Italie avec le prince Alexis Galitzin, qui disait à M. de Fortia d'Urban : « Je ne suis véritablement un homme que depuis que j'ai connu M. de Saint-Martin.» Il vit l'Allemagne et la Suisse. [Ndw : Saint-Martin n’est jamais allé en Allemagne ni en Suisse !]. Il voyageait plutôt en sage qu'en artiste ou en poète. « Je n'ai jamais goûté bien longtemps, disait-il, les beautés que la terre offre à nos yeux, le spectacle des champs, les paysages. Mon esprit s'élevait bientôt au modèle dont ces objets nous peignent les richesses ou les perfections. » [Portrait, n°1051]
A son retour, quoique retiré du service, il fut fait chevalier de Saint-Louis. [Saint-Martin n’a jamais reçu cette distinction, il s’en est expliqué dans son Portrait, n°153].
Ses recherches sur la science des nombres amenèrent entre Lalande et lui une liaison passagère. Le théosophe qui voyait Dieu partout pouvait-il s'accorder longtemps avec le géomètre qui éliminait Dieu de partout ?
Le maréchal de Richelieu voulait le mettre en rapport avec Voltaire qui mourut dans la quinzaine (Pensées, 129). Il aurait eu plus d'agrément, il le [p.501] croyait du moins, et plus de succès auprès de Rousseau ; mais il ne le vit jamais.
« Rousseau, dit-il, était meilleur que moi Il tendait au bien par le cœur ; j'y tendais par l'esprit, les lumières et les connaissances. Je laisse cependant aux hommes de l'intelligence à discerner ce que j'appelle les vraies lumières et les vraies connaissances, et à ne pas les confondre avec les sciences humaines, qui ne font que des ignorants et des orgueilleux. » (Pensées, 423. Il dit encore: « A la lecture des Confessions de J.-J. Rousseau, j'ai été frappé de toutes les ressemblances que je me suis trouvées avec lui, tant dans nos manières empruntées avec les femmes que dans notre goût tenant à la fois de la raison et de l'enfance, et dans la facilité avec laquelle on nous a jugés stupides dans le monde, quand nous n'avions pas une entière liberté de nous développer. Notre temporel a eu quelque similitude, vu nos positions sociales dans le monde ; mais sûrement, s'il s'était trouvé à ma place, avec ses moyens et mon temporel, il serait devenu un autre homme que moi ». Pensées, 60).
Les charmes de la bonne compagnie, suivant un de ses biographes, lui faisaient imaginer ce que pouvait valoir une réunion plus parfaite dans ses rapports intimes avec son principe. C'est à cet ordre de pensées qu'il ramenait ses liaisons habituelles avec les personnes du rang le plus élevé, telles que le duc d'Orléans, le maréchal de Richelieu, la duchesse de Bourbon, la marquise de Lusignan, etc. Ce fut en partie chez cette dernière, au Luxembourg, qu'il écrivit le Tableau naturel.
Il dicta son Ecce Homo à l'intention de la duchesse de Bourbon, cette princesse si malheureuse, femme séparée du dernier prince de Condé et mère du dernier duc d'Enghien, persécutée, chassée par la Révolution qu'elle avait acceptée, et dans les ennuis de l'exil réduite à conjurer le meurtrier de son fils de lui permettre de revoir la France.
Revenue depuis de ses erreurs mystiques à la pratique simple de la religion, elle se laissait alors entraîner au merveilleux de l'ordre inférieur, comme le somnambulisme et les prophéties d'une visionnaire, Suzanne Labrousse, dont l'ex-Chartreux Dom Gerle et l'évêque constitutionnel Pontard étaient les ardents prosélytes.
« A moins que la Clef divine n'ouvre elle-même l'âme de l'homme, dit Saint-Martin dans cet ouvrage, dès l'instant qu'elle sera ouverte par une autre clef, elle va se trouver au milieu de quelques-unes de ces régions (d'illusion ou de lumière douteuse), et elle peut involontairement nous en transmettre le langage. Alors, quelque extraordinaire que nous paraisse ce langage, il se peut qu'il n'en soit pas moins un langage faux et trompeur ; bien plus, il peut être un langage vrai sans que ce soit la vérité qui le prononce, et, par conséquent, sans que les fruits en soient véritablement profitables. » (Ecce Homo, p. 124.) [p.502]
Saint-Martin pensait sans doute à son illustre amie, quand il laissait échapper de son cœur ces paroles touchantes :
« J'ai par le monde une amie comme il n'y en a point. Je ne connais qu'elle avec qui mon âme puisse s'épancher tout à son aise et s'entretenir sur les grands objets qui m'occupent... Nous sommes séparés par les circonstances. Mon Dieu, qui connaissez le besoin que j'ai d'elle, faites-lui parvenir mes pensées et faites-moi parvenir les siennes, et abrégez, s'il est possible, le temps de notre séparation ». (Pensées, 103).
Il disait encore :
« Il y a eu deux êtres dans ce monde en présence desquels Dieu m'a aimé. Aussi, quoique l'un d'eux fût une femme [ma B.], j'ai pu les aimer tous deux aussi purement que j'aime Dieu, et, par conséquent, les aimer en présence de Dieu, et il n'y a que de cette manière que l'on doive s'aimer si l'on veut que les amitiés soient durables. » (Pensées, 7).
Le saint pénitent de Thagaste, s'accusant de la trop vive douleur qu'il a ressentie de la perte d'un ami, s'écrie d'un accent plus pieux et plus sûr : « Heureux qui vous aime, ô Dieu ! et son ami en vous, et son ennemi pour vous ! Celui-là seul ne perd aucun être cher, à qui tous sont chers en celui qui ne se perd jamais. » (Beatus qui amat te, et amicum in te, et inimicum propter te. Solus enim nullam charum amittit, cui omnes in illo chari sunt qui non amittitur. (Confessions I. VI, 9, 2)).
La Révolution française survint. Saint-Martin fut du petit nombre d'hommes éminents qui eurent l'intelligence de ce grand événement. Supérieur aux passions politiques, il l'accepta avec cette religieuse épouvante que répand dans les âmes recueillies la vue des justices divines. Il fit plus peut-être que de maudire ce terrible passage de notre histoire ; le premier il le jugea. Vers le temps où il publia sa Lettre à un ami sur la Révolution, publication antérieure aux célèbres Considérations du comte de Maistre, il écrivait ces paroles remarquables :
« La France a été visitée la première, et elle l'a été très sévèrement, parce qu'elle a été très coupable. Ceux des pays qui ne valent pas mieux qu'elle ne seront pas épargnés quand le temps de leur visite sera arrivé. Je crois plus que jamais que Babel sera poursuivie et renversée progressivement dans tout le globe ; ce qui n'empêchera pas qu'elle ne pousse ensuite de nouveaux rejetons qui seront déracinés au jugement final ». (Correspondance inédite de Saint-Martin et de Kirchberger, baron de Liebisdorf. J'ai dû la communication d'un manuscrit de cette précieuse correspondance à l'obligeance toute aimable de M. Alexandre de Tourgueneff, ancien ministre de l'instruction publique en Russie, sous l'empereur Alexandre. Ce savant et excellent homme est mort à Moscou, le 15 décembre dernier. Avant son départ, j'avais eu une conversation avec lui sur Saint-Martin, fort instructive pour moi. Quoiqu'il eût déjà comme un pressentiment de sa fin prochaine, j'étais loin de penser que notre entretien sur les théosophes serait le dernier de nos entretiens). [p.503]
Ma mémoire ne me rappelle rien dans ses écrits imprimés qui fasse une allusion précise aux mémorables événements de cette époque, si ce n'est peut-être cette pensée que je lis dans ses Œuvres posthumes :
« Une des choses qui m'a le plus frappé dans les récits qui m'ont été faits de la conduite de Louis XVI lors de son procès a été de ce qu'il aurait été tenté, comme roi, de ne pas répondre à ses juges, qu'il ne reconnaissait pas pour tels, mais de ce qu'il oublia sa propre gloire, disant que l'on ne pourrait pas savoir ce que ses réponses pourraient produire, et qu'il ne fallait pas refuser à son peuple la moindre des occasions qui pourraient l'empêcher de commettre un grand crime. J'ai trouvé beaucoup de vertu dans cette réponse. (Pensées 751).
Au moment même où le torrent de la Révolution roulait en flots de sang, à la lueur des incendies, au bruit de la guerre ([Maximin] Isnard [de l’Immortalité de l’âme, 1802]), Saint-Martin, retiré à Amboise pour rendre à son vieux père les derniers soins et les derniers devoirs, entretenait une correspondance suivie sur les plus hautes questions de la métaphysique et de la théosophie avec le baron suisse Kirchberger de Liebisdorf, membre du conseil souverain de la république de Berne.
Singulier contraste entre le bruit épouvantable que fait tout ce siècle qui croule et ce paisible dialogue sur les mystères de l'âme, sur les mystères des nombres, sur toutes les questions relatives à l'infini et à l'ordre futur ! Ce contraste est surtout remarquable dans une lettre datée du 25 août 1792, où, racontant en quelques mots la sanglante journée du 10 :
« Les rues, dit-il, qui bordent l'hôtel où je loge étaient un champ de bataille; l'hôtel lui-même était un hôpital où l'on apportait les blessés, et en outre il était menacé à tout moment d'invasion et de pillage (l'hôtel de la duchesse de Bourbon). Au milieu de tout cela, il me fallait, au péril de ma vie, aller voir et soigner ma sœur (Bathilde de Bourbon, sœur en initiation) à demi-lieue de chez moi... » [L’auteur ici se trompe, il s’agit bien de la sœur de Saint-Martin]
Il ajoute presque aussitôt :
« Je suis dans une maison où Mme Guyon est très en vogue. On vient de m'en faire lire quelque chose. J'ai éprouvé à cette lecture combien l'inspiration féminine est faible et vague en comparaison de l'inspiration masculine. Dans Bœhme je trouve un aplomb d'une solidité inébranlable ; j'y trouve une profondeur, une élévation, une nourriture si pleine et si soutenue que je vous avoue que je croirais perdre mon temps que de chercher ailleurs ; aussi j'ai laissé là les autres lectures. » [Correspondance, lettre VIII, p.29]
Ces paroles étaient en même temps une petite leçon adressée à [p.504] Kirchberger, qui, lui, cherchait ailleurs, qui cherchait partout, et dont la curiosité s'étendait à des objets dont Saint-Martin faisait fort peu de cas.
« La maçonnerie dont vous me parlez, lui écrivait-il en 1794, je ne la connais point et ne puis vous en rendre aucun compte. Vous savez mon goût pour les choses simples et combien ce goût se fortifie en moi par mes lectures favorites. Ainsi tout ce qui tient encore à ce que je dois appeler la chapelle s'éloigne chaque jour de ma pensée Quant aux ouvrages de Swedenborg, mon opinion est imprimée dans l'Homme de désir..... Je vous avoue qu'après de semblables richesses qui vous sont ouvertes (les œuvres de Jacob Bœhm), et dont vous pouvez jouir à votre aise à cause de votre langue et de tous les avantages terrestres que la paix politique vous procure, je souffre quelquefois de vous voir me consulter sur des loges et sur d'autres bagatelles de ce genre ; moi qui, dans les situations pénibles en tous sens où je me trouve aurais besoin qu'on me portât sans cesse vers ce pays natal où tous mes désirs et mes besoins me rappellent, mais où mes forces rassemblées tout entières sont à peine suffisantes pour me fixer par intervalle, vu l'isolement absolu où je vis ici sur ces objets. Je me regarde comme le Robinson Crusoé de la spiritualité, et, quand je vous vois me faire des questions dans ces circonstances, il me semble voir un fermier général de notre ancien régime, bien gros et bien gras, allant consulter l'autre Robinson sur le chapitre des subsistances ; je dois vous dire ce qu'il lui répondrait : « Monsieur, vous êtes dans l'abondance et moi dans la misère ; faites-moi plutôt part de votre opulence. » [idem, lettre LI, p.138]
Le moment d'ailleurs n'était pas favorable aux idées mystiques. La théosophie même devenait suspecte. La prétendue conjuration de Catherine Théos, la mère de Dieu, et les folles prédications auxquelles l'ex-Chartreux Dom Gerle se livrait dans l'hôtel même de la duchesse de Bourbon, appelèrent l'attention du gouvernement révolutionnaire sur l'innocente correspondance du philosophe inconnu avec le baron de Liebisdorf. Dans la lettre que je viens de citer Saint-Martin invoque à l'appui de ses réflexions des avertissements d'une autre nature.
« Dans ce moment-ci, ajoute-t-il, il est peu prudent de s'étendre sur ces matières. Les papiers publics auront pu vous instruire des extravagances spirituelles que des fous et des imbéciles viennent d'exposer aux yeux de notre justice révolutionnaire. Ces imprudentes ignorances gâtent le métier, et les hommes les plus posés dans cette affaire-ci doivent eux-mêmes s'attendre à tout: c'est ce que je fais, parce que je ne doute pas que tout n'ait la même couleur pour ceux qui sont préposés pour juger de ces choses et qui n'ont pas les notions essentielles pour en faire le départ Mais en même temps que je prévois tout, je suis bien loin de me plaindre de rien. Le cercle de ma vie est tellement rempli et d'une manière si délicieuse que, s'il plaisait à la Providence de le fermer dans ce moment, de quelque façon que ce fût, je n'aurais encore qu'à la remercier, Néanmoins, comme on est comptable de ses actions, faisons-en le moins que nous pourrons et ne parlons de tout ceci dans nos lettres que succinctement (Correspondance inédite et manuscrite de Saint-Martin, 5 messidor, 23 juin 1794.). [p.505]
Dès le 21 mai de l'année précédente, il écrivait à son ami :
« Celle de vos lettres qui a été accidentellement retardée est du 5 avril. Votre dernière, du 14 mai, a été aussi retenue au Comité de sûreté générale à Paris, d'où elle m'a été renvoyée avec un cachet rouge par-dessus votre cachet noir. Vous voyez combien il est important de ne nous occuper que des choses qui ne sont pas de ce monde. »
Mais l'autre monde n'était plus même un asile sûr pour les méditations de la pensée suspecte. La police révolutionnaire ne comprenait pas que l'on pût se réfugier là de bonne foi et sans nourrir des projets de contre-révolution. Saint-Martin avait cependant donné des preuves suffisantes de son désintéressement politique. Quoique noble, il n'avait pas émigré ; chevalier de Saint-Louis [SM n’a pas obtenu cette distinction], il avait fait son service dans la milice bourgeoise et monté la garde au Temple, prison et tombeau de Louis XVII ; trois ans auparavant, son nom était inscrit sur la liste des candidats proposés par l'Assemblée nationale pour le choix d'un gouverneur de ce jeune prince. Ces gages de soumission donnés à la République ne purent le mettre à l'abri d'un mandat d'arrêt, sous la prévention de complicité dans l'affaire de Catherine Théos. Fort heureusement le 9 thermidor vint le soustraire au jugement du sanguinaire tribunal. Car il faut bien reconnaître à ce régime sauvage le mérite d'une activité rare ; il n'a laissé passer aucune tête éminente sans la persécuter, l'outrager ou l'abattre !
En méditant sur ces faits étranges et si pleins d'enseignements, Saint-Martin disait encore :
« Je crois voir l'Evangile se prêcher aujourd'hui par la force et l'autorité de l'esprit, puisque les hommes ne l'ont pas voulu écouter lorsqu'il le leur a prêché dans la douceur, et que les prêtres ne nous l'avaient prêché que dans leur hypocrisie. Or, si l'esprit prêche, il le fait dans la vérité, et ramènera sans doute l'homme égaré à ce terme évangélique où nous ne sommes plus absolument rien et où Dieu est tout. Mais le passage de nos ignorances, de nos souillures et de nos impunités à ce terme ne peut être doux. Ainsi je tache de me tenir prêt à tout. C'est ce que nous devrions faire, même quand les hommes nous laisseraient la paix; à plus forte raison quand ils joignent leurs mouvements à ceux qui agitent naturellement tout l'univers depuis le crime de l'homme. Notre royaume n'est pas de ce monde ; voilà ce que nous devrions nous dire à tous les moments et exclusivement à toute autre chose sans exception, et voilà cependant ce que nous ne nous disons jamais, excepté du bout des lèvres. Or, la vérité qui a annoncé cette parole ne peut permettre que ce soit une parole vaine, et elle rompt elle-même les entraves qui nous lient de toutes parts à cette illusion apparente, afin de nous rendre à la liberté et au sentiment de notre vie réelle. Notre révolution actuelle, que je considère sous ce rapport, me paraît un des sermons les plus expressifs qui aient été prêchés en ce monde. Prions pour que les hommes en profitent. [p.506] Je ne prie point pour n'être pas compris au nombre de ceux qui doivent y servir de signe à la justice; je prie pour ne jamais oublier l'Evangile, tel que l'esprit veut le faire concevoir à nos cœurs, et, quelque part où je sois, je serai heureux, puisque j'y serai avec l'esprit de vérité » (25 fructidor, septembre 1794).
Vers la fin de l'année 1794, il dut revenir à Paris dont il était expulsé comme noble par le décret du 27 germinal an II. Voici quelles circonstances le rappelaient.
L'échafaud de Robespierre venait de rendre la liberté à la France. La Terreur, fatiguée de crimes, commençait à défaillir. Mais sur ce sol si profondément remué tout n'était plus que sang et décombres. La dispersion du clergé, l'abolition des Ordres religieux et des corporations enseignantes, enveloppés dans la ruine de l'ancien gouvernement, laissaient la France à ses profondes ténèbres. L'impiété elle-même en fut épouvantée : Impia æternam timuerunt sæcula noctem. Elle eut peur de la nuit qu'elle avait faite et de l'état sauvage dans lequel grandissaient les générations nouvelles. Il s'agissait donc de ranimer « le flambeau des sciences prêt à s'éteindre ; » il s'agissait de « garantir la génération suivante des funestes effets du vandalisme. » « A la vue des ruines sur lesquelles l'ignorance et la barbarie établissaient leur empire, » il fallait bien reconnaître que l'instruction était le premier mobile de la félicité publique (Introduction aux cours de l'Ecole normale, 1808). Mais il ne s'agissait pas seulement de répandre l'instruction, il fallait former des instituteurs ; tel était le but des écoles normales.
« Dans ces écoles, disait le rapporteur du projet, Lakanal, ce n'est pas les sciences que l'on enseignera, mais l'art de les enseigner. Au sortir de ces écoles les disciples ne devront pas être seulement des hommes instruits, mais des hommes capables d'instruire. Pour la première fois sur la terre, la nature, la vérité, la raison et la philosophie vont donc avoir aussi un séminaire (voir l’encadré). [p.507]
|
Encadré, note de L. Moreau Rapport à la Convention, séance du 3 brumaire an III. Ce rapport contient, sur le désarroi moral des hommes influents de cette époque et leur impuissance à conduire les faits dans la Révolution les aveux les plus instructifs et les plus involontaires. Nous citerons les lignes suivantes : « Lorsque du milieu de tant de causes, de tant d'expériences morales si nouvelles il sortait tous les jours de nouvelles vérités, comment songer à poser par l'instruction les principes immuables ? Les hommes de l'âge le plus mûr, les législateurs eux-mêmes, devenus les disciples de cette foule d'événements qui éclataient à chaque instant comme des phénomènes, et qui avec toutes les choses changeaient toutes les idées, les législateurs ne pouvaient pas se détourner de l'enseignement qu'ils recevaient pour en donner un à l'enfance et à la jeunesse : ils auraient ressemblé à des astronomes qui, à l'instant où des comètes secouent leur chevelure étincelante sur la terre, se renfermeraient dans leur cabinet pour écrire la théorie des comètes... Le temps, qu'on a appelé le grand maître de l'homme, le temps, devenu si fécond en leçons plus terribles et mieux écoutées, devait être en quelque sorte le professeur unique et universel de la République. » |
Puis il ajoute :
« Aussitôt que seront terminés, à Paris, ces cours de l'art d'enseigner les connaissances humaines, la jeunesse savante et philosophe qui aura reçu ces grandes leçons ira les répéter à son tour dans toutes les parties de la république d'où elle aura été appelée.... Cette source de lumière si pure, si abondante, puisqu'elle partira des premiers hommes de la République en tout genre, épanchée de réservoir en réservoir, se répandra d'espace en espace dans toute la France, sans rien perdre de sa pureté dans son cours. Aux Pyrénées et aux Alpes l'art d'enseigner sera le même qu'à Paris, et cet art sera celui de la nature et du génie La raison humaine, cultivée partout avec une industrie également éclairée, produira partout les mêmes résultats, et ces résultats seront la recréation de l'entendement humain chez un peuple qui va devenir l'exemple et le modèle du mande. »
Ainsi, pour que la nation française devînt incontinent l'exemple et le modèle du monde, il ne fallait rien moins que recréer l'entendement humain. Telle était la manie de ce siècle ; détruire, que dis-je, détruire ? anéantir les ruines mêmes, afin de créer ex nihilo, afin de créer comme Dieu, sans Dieu ! Aussi les hommes de ce temps n'ont-ils été puissants qu'à l'œuvre de destruction. Pour détruire, l'homme suffit ; mais pour rétablir et fonder, Dieu ne permet pas qu'on se passe de lui.
Saint-Martin fut choisi comme élève à l'Ecole normale par le district d'Amboise, mais obligé de remplir certaines formalités, vu sa tache nobiliaire qui lui interdisait le séjour de Paris jusqu'à la paix. Voici comme il envisageait d'abord cette mission inattendue.
« Elle peut, disait-il, me contrarier sous certains rapports ; elle va me courber l'esprit sur les simples instructions du premier âge. Elle va aussi me jeter dans la parole externe, moi qui n'en voudrais plus entendre ni proférer d'autre que la parole interne. Mais elle me présente aussi un aspect moins repoussant : c'est celui de croire que tout est lié dans notre grande révolution, où je suis payé pour voir la main de la Providence. Alors, il n'y a plus rien de petit pour moi, et ne serais-je qu'un grain de sable dans l'édifice que Dieu prépare aux nations, je ne dois pas résister quand on m'appelle, car je ne suis que passif dans tout cela... Le principal motif de mon acceptation est de penser qu'avec l'aide de Dieu je puis espérer, par ma présence et mes prières, d'arrêter une partie des obstacles que l'ennemi de tout bien ne manquera pas de semer dans cette grande carrière qui va s'ouvrir et d'où peut dépendre le bonheur de tant de générations... Et, quand je ne détournerais qu'une goutte du poison que cet ennemi cherchera à jeter sur la racine même de cet arbre qui doit couvrir de son ombre tout mon pays, je me croirais coupable de reculer » (Correspondance manuscrite, 15 nivôse an III (4 janvier 1795).
Il arriva à Paris dans les premiers jours de janvier 1795 ; mais [p.508] l’ouverture des conférences fut retardée. Le projet n'était pas mûr ; il s'éloignait déjà du but simple de son institution.
« Je gèle ici faute de bois, écrivait-il à Kirchberger, au lieu que dans ma petite campagne je ne manquais de rien. Mais il ne faut pas regarder à ces choses-là ; faisons-nous esprit, il ne nous manquera rien ; car il n'y a point d'esprit sans parole, et point de parole sans puissance. »
Les conférences ne tardèrent pas à justifier toutes ses prévisions, et quelles difficultés les principes spiritualistes trouveraient à se faire entendre en présence de ces chaires et de cet auditoire incrédules.
« Quant à nos écoles normales, écrit-il encore, ce n'est encore que le spiritus mundi tout pur, et je vois bien qui est celui qui se cache sous ce manteau. Je ferai tout ce que les circonstances me permettront pour remplir le seul objet que j'aie eu en acceptant ; mais ces circonstances sont vaines et peu favorables. C'est beaucoup si, dans un mois, je puis parler cinq ou six minutes, et cela devant deux mille personnes à qui il faudrait auparavant refaire les oreilles » (ibidem, 5 ventôse, 25 février 1795).
Il trouva cependant une occasion éclatante de rompre en visière à l'esprit du siècle et de proclamer hardiment ses propres principes. « J'ai jeté une pierre dans le front d'un des Goliath de notre Ecole normale ; les rieurs n'ont pas été pour lui, tout professeur qu'il est. » Mais il n'eut pas le loisir de poursuivre à son gré cette piquante controverse avec le professeur Garat. Les écoles normales furent dissoutes le 30 floréal de cette même année, mesure qu'il regarda dès lors comme un événement heureux. Ces écoles n'avaient d'autre but que de continuer l'œuvre des philosophes et de perpétuer le système d'impiété qu'ils avaient, disait-il, « assez provigné en France depuis soixante ans.» Et il ajoutait :
« Je regarde comme un effet de la Providence que ces écoles-là soient détruites... Ne croyez pas que notre révolution française soit une chose indifférente sur la terre : je la regarde comme la révolution du genre humain... C'est une miniature du jugement dernier, mais qui doit en offrir toutes les traces, à cela près que les choses ne doivent s'y passer que successivement, au lieu qu'à la fin tout s'opérera instantanément » (30 prairial, juin 1795).
De retour dans son département, Saint-Martin fut membre des premières réunions électorales; mais sa vie publique devait se borner à son passage à l'Ecole normale et à son démêlé avec le professeur d'analyse de l'entendement humain : il ne fit jamais partie d'aucune assemblée politique. Il poursuivit son active correspondance avec le baron de Liebisdorf. Les deux amis, qui ne devaient point se voir en ce monde, s'envoyèrent mutuellement leur portrait. Le discrédit des assignats [p.509] ayant réduit Saint-Martin à une extrême détresse, Kirchberger lui fit passer dix louis d'or. Le premier mouvement de Saint-Martin fut de les renvoyer sur-le-champ ; un second le retint. La fierté de Rousseau lui eût paru plus dans la mesure, si elle eût été fondée sur la haute foi évangélique qui donne et crée les moyens de ne connaître aucun besoin. « Mais, dit-il, quoique sa ferme philosophie me paraisse toujours très estimable sans s'élever à ce point, elle ne m'a pas paru assez conséquente ; car s'il prêche tant l'exercice des vertus et de la bienfaisance, il faut donc aussi leur laisser un libre cours quand elles se présentent » (Correspond, manuscrite, 8 nivôse an IV). Saint-Martin reçut les dix louis, et, à son tour, il put offrir plus tard à Kirchberger, dont la maison de Moral fut pillée par les Français, plusieurs pièces d'argenterie qui lui restaient.
Les dernières années de sa vie s'écoulèrent en silence dans des relations studieuses avec des amis. Il tenait un journal de ses liaisons, et regardait comme des acquisitions précieuses celles qu'il ajoutait aux précédentes.
« Il y a plusieurs probabilités, disait-il, que ma destinée a été de me faire des rentes en âmes. Si Dieu permet que cette destinée-là s'accomplisse, je ne me plaindrai pas de ma fortune, car cette richesse-là en vaut bien d'autres (Pensées, 202).
Il était homme de bien et charitable. On lit dans les Archives littéraires de l'année 1804 une conversation sur les spectacles entre M. de Gérando et le philosophe inconnu. De Gérando lui demandait un jour pourquoi il n'allait plus au théâtre : était-ce rigidité de principes, ou défaut de loisir ? Après un peu d'hésitation, Saint-Martin lui répondit :
« Rien n'est plus simple. Je suis souvent parti de chez moi pour aller au théâtre. Chemin faisant, je doublais le pas, j'éprouvais une vive agitation par une jouissance anticipée du plaisir que j'allais goûter. Bientôt, cependant, je m'interrogeais moi-même sur la nature des impressions dont je me sentais si puissamment dominé ; je puis vous le dire : je ne trouvais en moi que l'attente de ce transport enivrant qui m'avait saisi autrefois lorsque les plus sublimes sentiments de la vertu, exprimés dans la langue de Corneille et de Racine, excitaient les applaudissements universels. Alors une réflexion me venait incontinent. Je vais payer, me disais-je, le plaisir d'admirer une simple image ou plutôt une ombre de la vertu !... Eh bien, avec la même somme, je puis atteindre à la réalité de cette image ; je peux faire une bonne action au lieu de la voir retracée dans une représentation fugitive. Je n'ai jamais résisté à cette idée ; je suis monté chez quelques malheureux que je connaissais, j'y ai laissé la valeur de mon billet de parterre ; j'ai goûté tout ce que je me promettais au spectacle, bien plus encore, et je suis rentré chez moi sans regrets. »
D'une constitution frêle et n'ayant reçu de corps qu'un projet, à peine [p.510] sur le seuil de la vieillesse il eut l'avertissement de l'ennemi qui avait enlevé son père. Il pressentit sa fin et il la vit s'approcher avec une vive espérance. La mort, qui attriste la nature, n'était à ses yeux que le signal du départ ardemment désiré.
« La mort ! disait-il, est-ce qu'il y en a encore ? Est-ce qu'elle n'a pas été détruite ?.... La mort ! Est-ce la mort corporelle que le sage compterait pour quelque chose ? Cette mort n'est qu'un acte du temps. Quel rapport cet acte du temps pourrait-il avoir avec l'homme de l'éternité ? —Il disait encore : L'espérance de la mort fait la consolation de mes jours ; aussi voudrais-je qu'on ne dit jamais l'autre vie, car il n'y en a qu'une » (Pensées, 109).
Quelques mois avant de mourir il écrivait :
« Le 18 janvier 1803, qui complète ma soixantaine, m'a ouvert un nouveau monde ; mes expériences spirituelles ne vont qu'en s'accroissant. J'avance, grâce à Dieu, vers les grandes jouissances qui me sont annoncées depuis longtemps et qui doivent mettre le comble aux joies dont mon existence a été constamment accompagnée dans ce monde. »
Dans l'été de 1803, il fit un dernier voyage à Amboise, visita quelques vieux amis et revit encore une fois la maison où il était né.
Au commencement de l'automne de la même année, après un entretien avec un savant géomètre sur le sens mystérieux des nombres : « Je sens que je m'en vais, dit-il: la Providence peut m'appeler; je suis prêt. Les germes que j'ai tâché de semer fructifieront. Je pars demain pour la campagne d'un de mes amis. Je rends grâces au Ciel de m'avoir accordé la faveur que je demandais. »
Le lendemain, il se rendit à Aulnay, dans la maison de campagne du sénateur Lenoir-Laroche. Le soir, après un léger repas, il se retira dans sa chambre, et bientôt il se sentit frappé d'apoplexie. Il put cependant dire quelques mots à ses amis accourus auprès de lui, les exhortant à mettre leur confiance dans la Providence et à vivre entre eux en frères dans les sentiments évangéliques. Puis il pria en silence et expira vers onze heures du soir, sans agonie et sans douleurs, le 13 octobre 1803 (22 vendémiaire an XII).
Je lis dans les Soirées de Saint-Pétersbourg qu'il mourut sans avoir voulu recevoir un prêtre. Aucune biographie ne fait mention de ce refus. Mais il est clair que, Saint-Martin ne croyant ni à l'Eglise, ni à la légitimité du sacerdoce catholique, le ministère du prêtre devait être indifférent à sa mort comme à sa vie. Ne disait-il pas : « Ma secte est la Providence; mes prosélytes, c'est moi; mon culte, c'est la justice ? » Et n'osait-il pas dire aussi: « Oui, Dieu, j'espère que malgré mes fautes tu trouveras encore en moi de quoi te consoler ! » Quand on est [p.511] parvenu dès ici-bas à cette intimité familière avec Dieu, il est évident que son Eglise et ses sacrements deviennent inutiles.
Tant de confiance étonne de la part d'un homme si éclairé sur les misères du cœur de l'homme, et qui devait l'être sur les misères de son propre cœur ! Mais il est des temps malheureux où les intelligences, même les plus élevées, semblent chanceler dans leurs propres lumières. Détourné de la voie simple par l'influence de ces erreurs qu'il combattait chez les philosophes, sa religion et sa vertu mêmes lui sont devenues un piège, et il n'a pas su s'en préserver. Il a cru à la mission du Réparateur, mais il n'est pas entré dans le sens pratique de ses enseignements ; il a accueilli avec amour la parole de la Sagesse incarnée et le sacrifice du Calvaire, mais il n'a pas compris la perpétuité sur la terre de cette parole et de ce sacrifice ; il a cru en la divinité de Jésus-Christ, mais il n'est pas entré dans l'humilité de Jésus-Christ, et, après une vie de méditation, de prière et de culte intérieur, il n'a pas laissé que de mourir hors de la voie du salut ; il est mort en philosophe, à la manière de Porphyre ou de Plotin.
Il n'avait jamais été marié. Lui-même raconte ce qui arriva quand une occasion vint à s'offrir.
« Je priai, dit-il, un peu de suite pour cet objet, et il me fut dit intellectuellement, mais très clairement : Depuis que le Verbe s'est fait chair, nulle chair ne doit disposer d'elle-même sans qu'il en donne la permission. Ces paroles me pénétrèrent profondément, et, quoiqu'elles ne fussent pas une défense formelle, je me refusai à toute négociation ultérieure » (Correspondance inédite et manuscrite).
Toujours communications intimes avec Dieu! toujours cette illusion d'être l'objet de la prédilection divine ! On ne saurait après cela s'étonner de l'immense et naïf orgueil qui perce à chaque ligne des Pensées où il a voulu se peindre.
« J'ai été gai, dit-il, mais la gaieté n'a été qu'une nuance secondaire de mon caractère ; ma couleur réelle a été la douleur et la tristesse, à cause de l'énormité du mal... »
Il s'applique la parole du prophète. Il semble gémir du mal qui se fait chaque jour sur la terre, comme si lui-même n'y avait aucune part : c'est la plainte de l'ange ou le gémissement de l'Agneau qui porte les péchés du monde !
Ne dit-il pas :
« Je n'ai rien avec ceux qui n'ont rien ; j'ai quelque chose avec ceux qui ont quelque chose ; j'ai tout avec ceux qui ont tout. Voilà pourquoi j'ai été jugé si diversement dans le monde et la plupart du temps si désavantageusement ; car, dans le monde, où sont ceux qui ont tout ? où sont même ceux qui ont quelque chose ? » [p.512]
Ne dit-il pas encore : « Dieu sait si je les aime, ces malheureux mortels ! »
Jamais un apôtre n'a parlé ainsi !
Dans la sphère restreinte et timide de son action, il finit par se prendre sérieusement pour un voyant, pour un consolateur donné à la terre ; c'est partout le ton d'un être inspiré, d'un homme dépositaire de plus de vérités qu'il n'en saurait communiquer aux mortels, d'un homme supérieur à l'homme ! « Pour prouver que l'on est régénéré, dit-il, il faut régénérer tout ce qui est autour de nous ». (Portrait historique et philosophique de Saint-Martin, Pensées, I, 614-795. — Il dit encore de lui (Pensées, 760) : « Une personne dont je fais grand cas me disait quelquefois que mes yeux étaient doublés d'âme. Je lui disais, moi, que son âme était doublée de bon Dieu, et que c'est là ce qui faisait mon charme et mon entraînement auprès d'elle. » Les saints ne s'amusent guère à chercher dans d'autres yeux le miroir de leurs yeux. Ces petites galanteries mystiques devaient un peu distraire l'homme de désir et retarder le développement du nouvel homme »).
Cela est vrai ; mais quel mort spirituel Saint-Martin a-t-il donc ressuscité ? A-t-il jamais pu dire au fils de la veuve : « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ! » Son œuvre est loin de répondre à l'ambition de sa parole. Cependant il n'a pas été sans influence sur son temps, et, quoique ses livres soient généralement peu connus, un grand nombre de ces pensées ont été mises en circulation par des écrivains supérieurs, M. de Maistre, entre autres, qui l'avait lu attentivement, et qui l'appelait le plus instruit, le plus sage et le plus élégant des théosophes modernes. Malgré l'énormité de ses erreurs, cet homme a servi la cause de la vérité, et l'on ne saurait oublier que le premier, au milieu des saturnales révolutionnaires, il a donné le signal de la réaction spiritualiste contre les doctrines sceptiques et athées du XVIIIe siècle. Il est peut-être le seul laïc qui ait osé dire alors une parole pieuse et touchante comme celle-ci : « A force de répéter mon Père, espérons qu'à la fin nous entendrons dire mon fils. »



