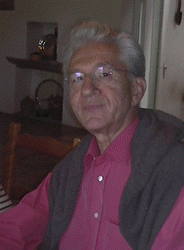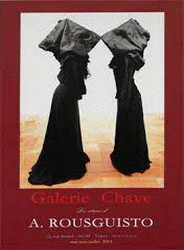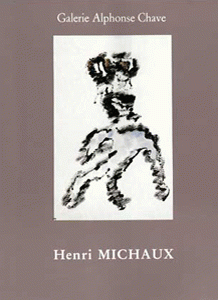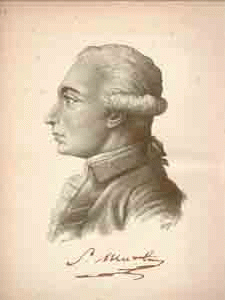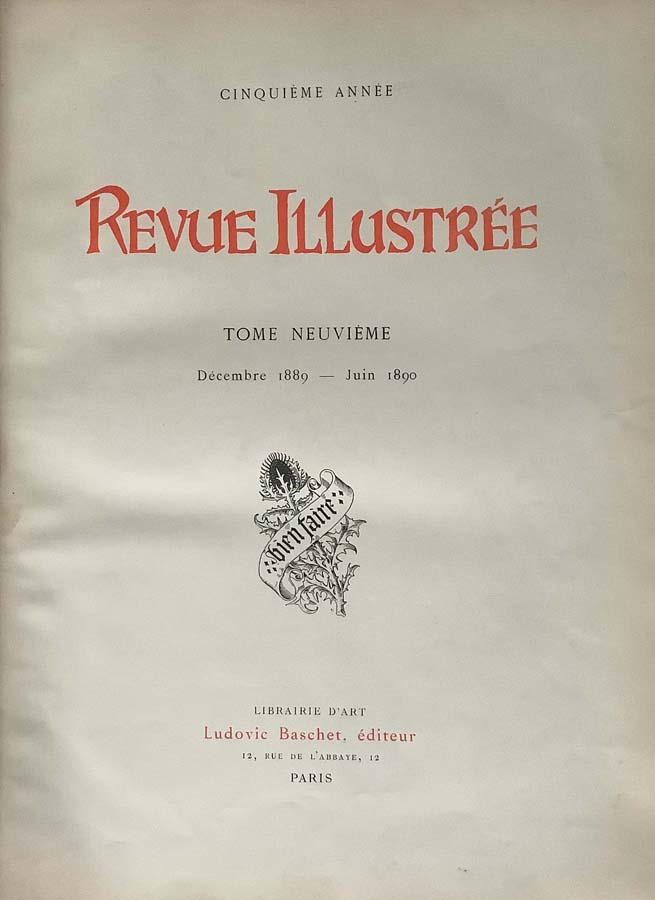 1890 - Papus et Anatole France
1890 - Papus et Anatole France
Le texte que nous présentons ci-dessous est extrait de la Revue Illustrée, cinquième année, tome neuvième (décembre 1889-juin 1890), du 15 février 1890 (pages 182-185). Librairie d’Art. Ludovic Bascher, éditeur, 12, rue de L’Abbaye, Paris.
À l’occasion de la sortie du livre de Philippe Encausse, Papus, sa vie ses œuvres (éditions Pythagore, 1932), Albert-Camille-Jean Cahuet, dit « Albéric Cahuet » (1877-1942), publie dans La Petite Illustration (28 janvier 1933) en dernière page, dans la rubrique « La vie littéraire », un article intitulé Un curieux homme qui n’est autre qu’un compte-rendu du livre de Ph. Encausse. Dans cet article, il cite une partie de l’article d’Anatole France.
Dans Sciences occultes ou 25 années d’occultisme occidental. Papus, sa vie, son œuvre, Philippe Encausse reproduit l’article d’Anatole France et l’introduit ainsi : « Parmi les relations de Papus dont je n’ai pas encore eu l’occasion de faire état dans cette biographie, il en est une qui mérite une citation particulière. Il s’agit d’Anatole France lui-même ». Puis il poursuit en donnant un éclairage sur les rapports entre Papus et l’auteur de l’article, et en conclusion l’extrait d’un article de Myriam Harry en 1932 dans Candide : « Souvenirs sur Anatole France ».
Ce texte a été publié dans la revue L’Initiation, n°5, septembre – octobre 1953 (pages 238-245) et repris à l’identique, sans l’image du mage, dans L’Initiation, n°1, janvier – février - mars 1960, p.7-14. Cet article a été publié partiellement dans L'Initiation, n° 4 de 2006, p. 308.
C'est cet ensemble que nous publions ici. Nous remercions la revue L'Initiation et son Rédacteur, Bruno Le Chaux de nous avoir autorisé à reproduire le texte paru dans la revue.
 L'Initiation n°5, septembre-octobre 1953
L'Initiation n°5, septembre-octobre 1953
Titre : Papus et Anatole France, par Philippe Encausse
Parmi les nombreuses relations de. Papus (1865-1916), il en est une qui mérite une citation particulière. Il s’agit d’Anatole France (1844-1924) lui-même.
À une certaine période de son existence, Anatole France s’intéressa, en effet, sur le conseil de Papus, au spiritisme en particulier, et à l’occultisme en général. Dans les Aventuriers du Mystère [1927], Frédéric Boutet a relaté une importante séance spirite qui eut lieu, vers la fin du siècle dernier, rue de Trévise, en présence d’un certain nombre de personnalités connues du monde des lettres et des arts, dont Anatole France lui-même. Le médium fut lié sur une chaise avec une corde dont les extrémités furent fixées au plancher, avec de la cire sur laquelle Anatole France apposa le cachet qui pendait en breloque à sa montre.
 Parmi les propagandistes que Papus cherchait à persuader (en dehors de personnalités comme Sarah Bernhard [1844-1923], Emma Calvé [1858-1942], Augusta Holmès [1847-1903] et bien d’autres représentants éminents du journalisme, des lettres, des arts et du théâtre qui parurent intéressées par ses exposés), il y avait Anatole France. Ce fut par l’intermédiaire de V.-E. Michelet [1861-1938] que Papus fit la connaissance directe du grand écrivain qui, devenu directeur d’une luxueuse revue, avait aussitôt choisi Maurice Barrès [1862-1923] et V.-E. Michelet, jeunes débutants, pour en faire ses collaborateurs. Michelet parla de Papus à France et ménagea une entrevue. « Papus, écrit-il, qui était alors à l’hôpital de la Charité l’externe du Dr Luys [1828-1897], exhiba à Anatole France toutes les expériences d’hypnose pratiquées dans le service. Puis, entraîné par Papus, France promena son infatigable curiosité vers les abords du domaine d’Hermès. Il n’alla pas bien loin, mais il en rapporta quelque chose. C’est alors que la lecture du Comte de Cabalis [Le Comte de Gabalis, dans son titre complet Le Comte de Gabalis ou Entretiens sur les sciences secrètes, est une satire sociale publiée anonymement en 1670. Son auteur, presque aussitôt connu, est Henri de Montfaucon, dit abbé de Villars (vers 1638-1673). Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Comte_de_Gabalis] lui suggéra la Rôtisserie de la Reine Pédauque [1893]. Mais si cet agréable roman est d’une jolie littérature, il n’a pas la portée de celui de l'abbé de Villars.
Parmi les propagandistes que Papus cherchait à persuader (en dehors de personnalités comme Sarah Bernhard [1844-1923], Emma Calvé [1858-1942], Augusta Holmès [1847-1903] et bien d’autres représentants éminents du journalisme, des lettres, des arts et du théâtre qui parurent intéressées par ses exposés), il y avait Anatole France. Ce fut par l’intermédiaire de V.-E. Michelet [1861-1938] que Papus fit la connaissance directe du grand écrivain qui, devenu directeur d’une luxueuse revue, avait aussitôt choisi Maurice Barrès [1862-1923] et V.-E. Michelet, jeunes débutants, pour en faire ses collaborateurs. Michelet parla de Papus à France et ménagea une entrevue. « Papus, écrit-il, qui était alors à l’hôpital de la Charité l’externe du Dr Luys [1828-1897], exhiba à Anatole France toutes les expériences d’hypnose pratiquées dans le service. Puis, entraîné par Papus, France promena son infatigable curiosité vers les abords du domaine d’Hermès. Il n’alla pas bien loin, mais il en rapporta quelque chose. C’est alors que la lecture du Comte de Cabalis [Le Comte de Gabalis, dans son titre complet Le Comte de Gabalis ou Entretiens sur les sciences secrètes, est une satire sociale publiée anonymement en 1670. Son auteur, presque aussitôt connu, est Henri de Montfaucon, dit abbé de Villars (vers 1638-1673). Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Comte_de_Gabalis] lui suggéra la Rôtisserie de la Reine Pédauque [1893]. Mais si cet agréable roman est d’une jolie littérature, il n’a pas la portée de celui de l'abbé de Villars.
« Dans Le Temps du 1er juin 1890, Anatole France écrivait : Cette antique maison (le Collège de France) a cela d’aimable qu’elle est ouverte à toutes les nouveautés. On y enseigne tout. Je voudrais qu’on y enseignât le reste. Je voudrais qu’on y créât une chaire de magie pour M. Papus [Le Temps, 1er juin 1890, La Vie littéraire, James Darmesteter, p. 2] (« Les Compagnons de la Hiérophanie ».)
Enfin, j'ai trouvé, dans le numéro du 15 février 1890 de la Revue illustrée, une longue chronique d’Anatole France consacrée à Papus et à son Traité élémentaire de science occulte [P. Encausse cite la dernière édition de l’époque : « Nouvelle édition, H. Dangles, Paris, 1932. » Depuis d’autres « nouvelles » éditions ont vu le jour. Citons l’édition de 1888, chez Georges Carré, Paris, Traité élémentaire de science occulte] chronique qui intéressera certainement nombre de lecteurs.
 Études et portraits
Études et portraits
PAPUS. - Traité élémentaire de science occulte
C’est un mage. Il se nomme Papus. Sur la foi de son nom et de ses travaux, je l’imaginais vieux et chenu, coiffé du serre-tête de velours noir du docteur Faust, et
« les années,
Pendant comme une barbe à ses tempes veinées. »
[Extrait de : Auguste Barbier (1805-1882), Poésies : Iambes et poèmes. « Le Campo Santo », Paul Masgana, libraire-éditeur, 1841].
Bref un Mathieu Laensberg ou un Thomas Nostradamus. C’était là une bien fausse image. Je l'ai vu : il est très jeune, l’œil vif, le teint frais, la joue ronde, la barbe fine. Il a plutôt l’air d’un carabin que d’un mage. Aussi bien a-t-il fait récemment d’excellentes études médicales. Et notre sorcier est un physiologiste. Il a bien voulu me donner un exemplaire de son Traité élémentaire de Magie, que j’ai lu avec curiosité et dont je vous dirai volontiers quelques mots. M. Berthelot, qui est chimiste, a publié les textes grecs des vieux alchimistes, et il ne nous conviendrait pas d'être plus dédaigneux que lui. Il va sans dire qu’au sentiment de notre jeune occultiste, la magie est la science des sciences, ou, pour mieux dire d’un mot : La Science. Il ne se nommerait pas Papus, s’il parlait autrement. Il enseigne, dans son Traité, que La Science est ancienne, qu’elle remonte à la fabuleuse antiquité de l’Égypte et de la Chaldée, et que le secret en était gardé dans les temples. Papus procède sur ce point par de simples affirmations qu’il nous laisse la lourde charge de vérifier ; car il ne les a pas vérifiées lui-même. Il s’en rapporte à Dutens [Louis Dutens (1730-1812). Anatole France fait ici allusion à son ouvrage en 2 vol., Recherches sur l’origine des découvertes attribuées aux modernes : où l’on démontre que nos plus célèbres philosophes ont puisé la plupart de leurs connaissances dans les ouvrages des anciens et que plusieurs vérités importantes sur la religion ont été connues des sages du paganisme. Vve Duchesne, Paris Tome premier, 1766 ; Tome second, 1766] et à Fabre d’Olivet [1767-1825]. Mais Dutens, qui mourut à Londres en 1812, et Fabre d’Olivet, qui lui survécut d’une quinzaine d’années, écrivaient à une époque où l’on ne connaissait guère l’Orient que par les contes aimables d’Hérodote et de Diodore. On ne lisait encore ni les hiéroglyphes, ni les cunéiformes. Fabre d’Olivet crut, il est vrai, avoir trouvé la clé des hiéroglyphes ; on sait aujourd’hui que sa clé n’ouvrait rien, et que son égyptologie était aussi imaginaire que ses opéras. Car il était poète et il écrivait pour le théâtre. Dutens avait plus d’érudition que de critique, et ce sont là en somme des autorités contestables. Il est vrai que Papus fait aussi quelques emprunts au livre récent de M. Saint-Yves d’Alveydre [1842-1909] sur la Mission des Juifs [1884]. J’avoue ne connaître ni M. d’Alveydre, ni son ouvrage. Mais ce serait un grand hasard qu’on y trouvât la preuve de tout ce qu’avance Papus, savoir : que les anciens connaissaient les lois de la gravitation, le mouvement de la terre autour du soleil, le télescope, le microscope, la réfraction de la lumière, l’isochronisme des vibrations du pendule, les armes à feu, la traction par la vapeur, le paratonnerre, le télégraphe électrique, la photographie et la circulation du sang. C’est là une chose difficile à croire. Sans disputer de la photographie, ni du reste, puisque Papus est médecin, je le prierai de se rappeler qu’on enseignait à Alexandrie que les artères sont remplies d’air. D’ailleurs la géographie de Strabon et le système de Ptolémée précisent la limite des connaissances scientifiques des anciens.
À quoi Papus me répond :
— Je parle de la Science et non des sciences. Et LA SCIENCE fut de tout temps [page 183] cachée, du caché, et cachant, SCIENTIA OCCULTA, OCCULTATI, OCCULTANS. Ptolémée et Strabon étaient des savants ; ils n’étaient pas des mages.
— Si votre science a jamais existé, ô Papus, ce dont j'ai mille raisons de douter, comment s’est-elle conservée ?
— Il ne s’en est conservé que des débris informes et d’obscurs monuments.
— Comment la connaissez-vous donc ?
— Nous la restituons sur quelques vestiges épars, comme Cuvier a restitué le dinothérium.
— Quels sont ces vestiges ?
— La table de Porphyre et généralement les textes hermétiques.
— Ils sont apocryphes.
— Ils sont anciens.
— Médiocrement anciens et non médiocrement apocryphes.
— Apocryphes tant qu’il vous plaira. J’admire, en vérité, le dédain de la science moderne pour les apocryphes !
— Vous avez raison, ô Papus ; mais les textes dont vous parlez sont d’hier. Ils ne remontent pas plus haut que le néo-platonisme et que la gnose.
— La gnose était une partie de LA SCIENCE ! Dans le peu qui nous reste des écrits des gnostiques, nous faisons de précieuses découvertes. D’ailleurs, la tradition n’est pas si bien rompue qu’il n’en reste quelques chaînons dans les sociétés secrètes. J’ai été assez heureux pour interpréter certains signes, certaines pratiques, conservés de nos jours par les rose-croix et par les francs-maçons, mais dont les initiés eux-mêmes avaient complètement perdu le sens.
Dans ce petit dialogue, j’ai laissé le dernier mot à mon contradicteur. C’est courtoisie pure et je déclare qu’il ne m’a pas convaincu.
Je crois que l’occultisme, tel que le conçoit Papus, est très moderne, et qu’il n’a pas pris la forme et les caractères qu’il revêt aujourd’hui qu’à la fin du dernier siècle. C’est là sans doute une opinion extrême ; mais celle de Papus aussi était extrême. C’est une loi de l’esprit que les contraires s’appellent. Un troisième terme en naît et c’est ce qu’en science occulte on appelle le ternaire. Exemple
Homme, femme, enfant.
Solide, fluide, gaz.
Un quatrième terme ramène le ternaire à l’Unité. Exemple :
Je ne puis me défendre de trouver à votre ternaire quelque air de famille avec certain vieillard anguleux et sec, que j’ai connu sur les bancs du collège, un certain maître Férulus qui n’avait que trois cheveux et trois dents, crochu du bec, le crâne pointu comme un œuf, béquillard et tortillard qui, de son vrai nom, s’appelait le Syllogisme. Dieu me pardonne ! et veuillent en faire autant Hermès et Zoroastre ! Mais il me semble que le ternaire et le syllogisme se ressemblent comme deux frères, et qu'on les croirait échappés ensemble des genoux de saint Thomas d'Aquin.
D’ailleurs la magie est d’un large syncrétisme. La scolastique y reconnaîtrait ses méthodes de raisonnement, Hegel sa thèse de l'identité de l’idée et de l’être, Kant son impératif catégorique, Schopenhauer sa théorie de la volonté, mais retournée et dirigée [page 184] vers un optimisme absolu. Je ne parle pas de Platon, puisque la magie est une sorte de néo-platonisme qui pousse la doctrine de la réalité des idées jusqu’à soutenir qu’une idée peut se promener sur les boulevards la canne à la main, en fumant une cigarette, ou venir, la nuit, pendant que vous dormez, vous enlever délicatement le cœur et le remplacer par une éponge. Notre Papus, pour sa part, est platonicien comme l’était Apulée, c’est-à-dire avec beaucoup de diablèmes [sic]. Et puisque nous nommons Apulée, j’avoue avoir souvent conversé avec cet Africain mystique et sensuel. Eh ! bien, après une conversation avec Papus, je me suis écrié involontairement : — C’est Apulée !
Mêmes contrastes de santé forte et de complexion spiritualiste ; même ardeur de parole (Apulée était grand conférencier) ; même imagination brûlée ; même goût de science un peu pédante et de mysticisme bizarre, enfin le même homme. Pour peu qu’on croie à la métempsycose [Note de Philippe Encausse : « Anatole France commet là une petite erreur. Il confond, en effet, métempsychose et réincarnation »] on se persuadera certainement qu’Apulée et Papus font un seul être, à cela près qu’Apulée écrivait dans un latin d’Afrique aromatisé et pimenté, d’un goût plus mordant que le style, très convenable d’ailleurs, du Traité élémentaire de Science occulte.
Ce traité nous enseigne que la magie tout entière est fondée sur l’analogie, c’est-à-dire sur la considération des similitudes qui relient entre elles les choses différentes. Je n’y vois pas d’inconvénient. C’est le procédé instinctif et naturel des poètes, qui sont, à tout prendre, les premiers philosophes du monde, quand ils ne sont pas les derniers des humains. Au reste, toutes les voies de l’esprit mènent à la vérité et à l’erreur.
![]() — Tout est analogie, disent les mages : la loi qui régit les mondes régit la vie de l’insecte. L’homme est un petit monde dans le monde, un microcosme dans le macrocosme.
— Tout est analogie, disent les mages : la loi qui régit les mondes régit la vie de l’insecte. L’homme est un petit monde dans le monde, un microcosme dans le macrocosme.
Et cela revient à l’idée de Hegel, que les lois de la pensée sont les lois du monde, et même, si l’on veut, à la doctrine de notre Renouvier qui subordonne l’univers à la loi morale.
Vraiment, il y a un peu de kantisme et beaucoup d’hégélianisme dans la philosophie de l’occulte. M. Vera, qui aimait tant la métaphysique, eût admis cette proposition de Papus : Les opposés ne sont que la conception à degrés différents d’une seule chose.
Sans vouloir entrer dans un exposé méthodique de la science magique, disons qu’elle aboutit à la divinisation de la volonté. « Le Thélème de tout le monde est la volonté », dit le mage. Ce Thélème commande à la nature physique et morale, et crée l’âme immortelle. Nous touchons ici au point le plus original de la doctrine. L’âme, y est-il dit, n’est pas congénitale à l’être humain. Elle est une résultante ; elle est le produit de la volonté bien dirigée, l’effet dont la cause est en nous. La vie est donnée à l’homme pour qu’il la transforme en une force plus haute : l’âme.
Victor Hugo avait coutume de dire que l’âme est facultative et qu’on est immortel seulement quand on le veut bien.
Et, s’exprimant en paraboles : « Un poète, disait-il, ayant écrit deux vers, quitta sa table de travail. En son absence, l’un, des vers dit à l’autre : « Je me sens immortel. » Et l’autre répondit : « Pour moi, je crains de ne point durer. » Le poète, rentré dans son cabinet, biffa le vers qui avait douté de son éternité glorieuse. » Cette fable est du magisme pur. Louis Lucas a dit expressément « L’âme est une création originale nous appartenant en propre. »
Il importe de vouloir. « De là l’emploi de certains objets, de certains caractères pour fixer la volonté dans les opérations magiques. »
Ces opérations auront-elles pour effet de produire des phénomènes contraires à l’ordre de la nature ? Non pas ! On ne sort jamais de la nature, et l’idée même du miracle [page 185] est absurde. Mais le mage, comme le Prospéro de Shakespeare, a le pouvoir de commander à la nature. C’est un physicien transcendant ; il agit sur le monde invisible qui double notre monde visible. Et il faut savoir que le monde invisible est peuplé d’Esprits élémentaires ou Élémentals, de Larves et d’Idées, agissant comme des êtres réels. Idées, Larves, Élémentals sont soumis à la volonté du mage. Quelle disgrâce de n’être point mage ! Ce doit être bien amusant. Mais ne l’est point qui veut. La plupart des êtres n’ont qu’une volonté faible et stérile : le Karma pèse sur eux. Ce Karma est une lourde nécessité faite de l’accumulation de nos actions passées. Nous portons un karma chargé du crime de nos existences antérieures. Telle faute, commise par nous dans une caverne préhistorique ou dans la case de roseaux d’une cité lacustre, nous pèse et nous opprime encore. C’est le karma. Nous ne serons mages que dans une existence ultérieure, si nous le sommes jamais ; mais tel de nous s’en ira lamentablement en larve ou en vampire. Et je n’ai pas vu que la magie enseigne la doctrine de la Rédemption finale des êtres [Dans l’Initiation, Philippe Encausse ajoute au texte cette note : « Anatole France ne fait pas mention, ici, de la théorie de la réincarnation qui permet à chacun de nous d’évoluer : « Naître, mourir, renaître et progresser sans cesse, telle est la loi », disent les Spirites. (Ph. E.) »].
Si nous avons ainsi causé de magie et interrogé Papus, c’est pour satisfaire une naturelle et perverse curiosité. Et puis une certaine connaissance des sciences occultes devient nécessaire à l’intelligence d’un grand nombre d’œuvres littéraires de ce temps. La magie occupe une large place dans l’imagination de nos poètes et de nos romanciers. Le vertige de l’invisible les saisit, l’idée de l’inconnu les hante et les temps sont revenus d’Apulée et de Phlégon de Tralles. M. Gilbert Augustin-Thierry [1840-1915], que les lecteurs de ce journal apprécient à sa haute valeur, a fondé, sur l’idée du monde magique, des drames d’une poésie neuve et d’un intérêt puissant, et il a noblement tenté de faire sortir de ces épouvantes et de ces mystères une morale et une philosophie nouvelles.
La bibliothèque magique s’accroît de jour en jour. Au Palimpseste et à la Tresse blonde, de M. G. A.-Thierry, s’ajoutent les Histoires incroyables et le Manuscrit à brûler, de M. Jules Lermina [1839-1915], le Horla, de M. Guy de Maupassant, Un Caractère, de M. Léon Hennique [1850-1935], les œuvres de deux poètes délicieux, Stanislas de Guaita [1861-1897] et Henri Jouny, et enfin les Éthopées du « sar » Joséphin Péladan.
Qu’est-ce que cela veut dire, sinon que l’esprit de l’homme est toujours tourmenté par la grande curiosité, que l’abîme l’attire et qu’il se penche avec une délicieuse horreur sur les bords brumeux de l’Inconnaissable ?
Anatole France.

Postface de l’Initiation par Philippe Encausse
Anatole France devait d’ailleurs donner ultérieurement une preuve de ce que les bords brumeux de l’Inconnaissable avaient également retenu son attention. En effet, il ressort de la lecture d’un article documenté publié par Myriam Harry, en 1932, dans Candide : « Souvenirs sur Anatole France. — La douce retraite » [Myriam Harry, Souvenirs sur Anatole France, « La douce retraite », dans Candide : grand hebdomadaire parisien et littéraire, n°422, avril 1932, p.3]., que le sceptique Anatole France qui avait prétendu n’avoir pas été convaincu par les démonstrations de Papus en 1890, fit plus tard... tourner les tables pour évoquer et apaiser l’âme de Mme de Caillavet [Anatole France partageait depuis une vingtaine d’années la vie de Mme Arman de Caillavet quand elle mourut en janvier 1910 (Ph. E.)] :
« ...Revenus à la maison (la Béchellerie), nous entrons dans l’ancienne salle de billard, écrit Myriam Harry à la fin de son article.
Mlle Laprevotte me montre une table ronde :
— C’est elle que nous avons tournée pour évoquer l’esprit de Madame.
— Anatole France a tourné les tables ?
— Oui, après la guerre. Oh vous ne sauriez croire combien nous étions malheureux, désemparés, abandonnés de tout le monde. M. France, sans amis, sans bibelots, sans livres, accusé de toutes sortes de forfaits, a sérieusement songé, je vous assure, au suicide. Et, naturellement, je serais morte avec lui. À cette époque, le fantôme de Mme de Caillavet, qui l’avait quitté à Versailles, est revenu le tourmenter. Il avait des cauchemars affreux. Elle lui apparaissait, non point impérieuse et volontaire, comme dans la vie, mais soumise et implorante, se traînant à genoux devant lui et portant sa tête entre ses mains. Et moi, j’étais au fond de la pièce et elle nous regardait avec les yeux de sa tête coupée et nous disait plaintivement : « Oh ! pourquoi m’avez-vous fait cela ? Je ne l’ai pas mérité. » M. France se réveillait ruisselant de sueur et gémissant. Et à force d’entendre raconter ces cauchemars, j’ai eu, moi aussi, la même vision. C’était horrible On n’osait plus se coucher. Un jour, Anatole France s’en plaignait à un libraire de Tours qui venait bavarder quelquefois avec lui. Il s'occupe de spiritisme ; il avait autrefois connu Huysmans et le docteur Encausse. Il nous a conseillé d’apaiser l’esprit de Mme de Caillavet en l’évoquant. Nous avons tourné la table avec lui. Madame a répondu. D’abord elle se lamentait, puis elle est devenue plus calme, elle a fini par dire qu’elle ne souffrait plus et qu’elle pardonnait à M. France. Alors les cauchemars ont cessé. »
Dans les Carnets intimes d’Anatole France publiés en 1946 par Léon Carias, on peut relever cette réflexion en date du samedi 27 août 1910 : En arriverai-je donc à croire que les morts ont une sorte de vie, qu’ils exercent sur nous une influence sourde et forte ? Il le faut bien, car, autrement, léger comme je le suis, avide de distractions, penserais-je à elle avec cette continuité ?
 La petite illustration - La vie littéraire - Un curieux homme
La petite illustration - La vie littéraire - Un curieux homme
Albert-Camille-Jean Cahuet, dit « Albéric Cahuet » (1877-1942), « Un curieux homme », La Petite Illustration n°611, 28 janvier 1933, Paris, Bibliothèques patrimoniales.
Comme il y a des siècles et des millénaires, on fait présentement appel au miracle pour tirer l’Europe et le monde d’un chaos où le génie politique apparaît déficient. Les prophètes ne manquent point, mais les bons prophètes sont rares. On nous annonce des maux aggravés alors que nous souhaiterions des prédictions optimistes, et ce recours au merveilleux souriant nous fait aimer le souvenir de tels maîtres de l’occultisme que leurs tendances mystiques, enrichies d’espoir, éloignaient des sombres magies : ainsi ce Dr Gérard Encausse disparu pendant la guerre, où il fit son devoir de bon Français, et qui, sous le nom de Papus, renouvela l’ « Esotérisme transcendantal ». Un intéressant petit livre [1.] de M. Philippe Encausse, fils de ce passionné des sciences hermétiques, remet au point bien des légendes qui se sont formées autour du personnage de Papus.
Né en 1865, en Espagne (à la Corogne), d’un père français et d’une mère originaire de Valladolid, Gérard Encausse vécut son enfance sur la Butte-Montmartre, où ses parents vinrent habiter vers 1869. Pendant ses études secondaires à Rollin, le jeune Encausse fonda son premier journal avec quelques camarades dont Xanrof. Étudiant en médecine, externe des hôpitaux, il devint chef de laboratoire du Dr Luys. Pourtant il ne prépara point l’internat comme ses camarades, car déjà il cherchait ses directions dans les vieux grimoires des alchimistes et des Rose-Croix. Dans quelques pages d’un curieux opuscule : Comment je devins mystique [Ce texte a été publié pour le première fois dans L’Initiation, numéro 29, 3 décembre 1895, p.195 et suiv., . Il a été réédité dans son Traité élémentaire de sciences occultes (5e édition,1898, p.439 et suiv.)]. Gérard Encausse nous a donné lui-même la suite des raisonnements qui du rationalisme le conduisirent au spiritisme avant qu’il n’inclinât au mysticisme sous l’influence d’un autre occultiste, Philippe, dont il fit le parrain de son fils. Sous le pseudonyme de Papus, Encausse commença la propagande de ses idées. Il se rapprocha, puis s’éloigna de la Société théosophique et fonda, en octobre 1888, avec la collaboration et les encouragements de Barlet, Stanislas de Guaita, Joséphin Péladan, Villiers de l'Isle-Adam, Catulle Mendès, Julien Lejay, Emile Goudeau, Jules Lermina, Victor-Emile Michelet, Rodolphe Darzens, Pâti, etc., sa revue l’Initiation qui devait paraître jusqu’à la veille de la guerre. En même temps paraissaient le Traité élémentaire de science occulte, l’Occultisme contemporain et, l’année suivante, le Tarot des Bohémiens que devaient suivre d’innombrables brochures.
Gérard Encausse soutint brillamment, en juillet 1894, sa thèse de doctorat. Il avait choisi comme sujet « l’Anatomie philosophique et ses divisions ». L'un de ses juges, le professeur Mathias-Duval, lui dit au cours de la soutenance : « Monsieur Encausse, vous n’êtes pas un étudiant ordinaire. Sur des sujets philosophiques et médicaux et surtout sur des matières troublantes que je n’ai pas à apprécier ici, sous votre nom ou sous un pseudonyme que vous avez rendu célèbre, vous avez écrit des livres de haute valeur et je suis fier d’être votre président de thèse. »
Reçu médecin, Papus voulut faire son tour d’Europe. Il parcourut l’Angleterre, la Hollande, la Belgique, la Russie, s’intéressant à toutes les médecines, à tous les procédés dans l’art de guérir et ne dédaignant pas de demander des secrets aux rebouteux, aux guérisseurs, même aux Bohémiens errants.
* * *
En Russie Papus fut très accueilli par les membres de la famille impériale. On le combla de cadeaux, on fit même éditer une traduction russe de son Traité de science occulte. M. Paléologue a raconté dans ses souvenirs d’ambassadeur qu’en octobre 1905, lors des désastres de Mandchourie, Papus aurait, à Tzarskoié Selo, évoqué devant les souverains le fantôme du tsar Alexandre III. Cette scène d’incantation, dont certains parlèrent avant M. Paléologue, a été niée, dès octobre 1922, par le Voile d’Isis, la plus ancienne revue s’occupant des études ésotériques : « De mage, dit l’article de cette revue, Papus n’eut que le nom... Son plaisir était de mystifier les faux occultistes pour éprouver leur savoir. Peut-être a-t-il dit à l’un d'eux que, d’un coup de son épée magique, il avait tranché la tête de l’hydre de la révolution russe et qu’il fallait du temps pour qu’elle pût repousser. »
Anatole Fiance a tracé de Papus ce portrait amusant : « Sur la foi de son nom et de ses travaux je l’imaginais vieux et chenu, coiffé du serre-tête de velours noir du Dr Faust, et
les années
Pendant comme une barbe à ses tempes veinées.
Bref, un Mathieu Laensberg ou un Thomas Nostradamus. C'était là une bien fausse image. Je l’ai vu : il est très jeune, l’œil vif, le teint frais, la joue ronde, la barbe fine. Il a plutôt l’air d’un carabin que d’un mage. Aussi bien a-t-il fait d’excellentes études médicales. Et notre sorcier est un physiologiste. Platonicien comme l’était Apulée, c’est-à-dire avec beaucoup de diablèmes. Et puisque nous nommons Apulée, j’avoue avoir souvent conversé avec cet Africain mystique et sensuel. Eh bien, après une conversation avec Papus, je me suis écrié involontairement : — C’est Apulée ! Mêmes contrastes de santé forte et de complexion spiritualiste ; même ardeur de parole (Apulée était un grand conférencier) ... même goût de mysticisme bizarre, enfin le même homme. Pour peu qu’on croie à la métempsychose, on se persuadera certainement qu’Apulée et Papas font un seul être, à cela près qu’Apulée écrivait dans un latin d’Afrique aromatisé et pimenté d’un goût plus mordant que le style, très convenable d'ailleurs, du Traité élémentaire de science occulte.
Médecin chef d’une ambulance pendant la guerre, le Dr Encausse-Papus se consacra, jusqu’à l'épuisement, à sa mission. Quand il mourut, le 15 octobre 1916, une foule considérable assistait à ses funérailles à Notre-Dame de Lorette, et le Temps, sous la signature de M. Abel Hermant, rappela que, si « Papus faisait sourire quelques-uns, le médecin chez lui était demeuré un excellent et dévoué praticien, un cœur généreux, jusqu’au bout se donnant aux pauvres avec un noble dévouement, et l’on n’a pas oublié non plus le savoir immense de cet alchimiste égaré parmi nous ».
Au Père-Lachaise, des amis et des disciples fleurissent fidèlement la tombe de ce très brave homme qui, parfaitement cultivé, optimiste et charitable pour les grands comme pour les humbles, tenta de rassurer les souverains russes au début de leur grande angoisse, mais ne saurait être confondu avec la tourbe de mages qui vinrent empoisonner l’atmosphère de Tzarskoié Selo.
ALBÉRIC CAHUET.