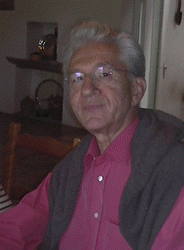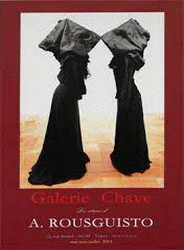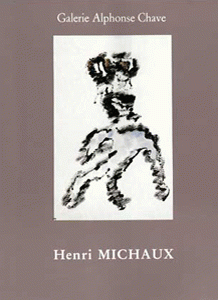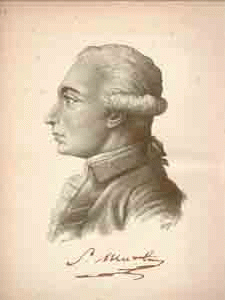Études et portraits
Études et portraits
PAPUS. - Traité élémentaire de science occulte
C’est un mage. Il se nomme Papus. Sur la foi de son nom et de ses travaux, je l’imaginais vieux et chenu, coiffé du serre-tête de velours noir du docteur Faust, et
« les années,
Pendant comme une barbe à ses tempes veinées. »
[Extrait de : Auguste Barbier (1805-1882), Poésies : Iambes et poèmes. « Le Campo Santo », Paul Masgana, libraire-éditeur, 1841].
Bref un Mathieu Laensberg ou un Thomas Nostradamus. C’était là une bien fausse image. Je l'ai vu : il est très jeune, l’œil vif, le teint frais, la joue ronde, la barbe fine. Il a plutôt l’air d’un carabin que d’un mage. Aussi bien a-t-il fait récemment d’excellentes études médicales. Et notre sorcier est un physiologiste. Il a bien voulu me donner un exemplaire de son Traité élémentaire de Magie, que j’ai lu avec curiosité et dont je vous dirai volontiers quelques mots. M. Berthelot, qui est chimiste, a publié les textes grecs des vieux alchimistes, et il ne nous conviendrait pas d'être plus dédaigneux que lui. Il va sans dire qu’au sentiment de notre jeune occultiste, la magie est la science des sciences, ou, pour mieux dire d’un mot : La Science. Il ne se nommerait pas Papus, s’il parlait autrement. Il enseigne, dans son Traité, que La Science est ancienne, qu’elle remonte à la fabuleuse antiquité de l’Égypte et de la Chaldée, et que le secret en était gardé dans les temples. Papus procède sur ce point par de simples affirmations qu’il nous laisse la lourde charge de vérifier ; car il ne les a pas vérifiées lui-même. Il s’en rapporte à Dutens [Louis Dutens (1730-1812). Anatole France fait ici allusion à son ouvrage en 2 vol., Recherches sur l’origine des découvertes attribuées aux modernes : où l’on démontre que nos plus célèbres philosophes ont puisé la plupart de leurs connaissances dans les ouvrages des anciens et que plusieurs vérités importantes sur la religion ont été connues des sages du paganisme. Vve Duchesne, Paris Tome premier, 1766 ; Tome second, 1766] et à Fabre d’Olivet [1767-1825]. Mais Dutens, qui mourut à Londres en 1812, et Fabre d’Olivet, qui lui survécut d’une quinzaine d’années, écrivaient à une époque où l’on ne connaissait guère l’Orient que par les contes aimables d’Hérodote et de Diodore. On ne lisait encore ni les hiéroglyphes, ni les cunéiformes. Fabre d’Olivet crut, il est vrai, avoir trouvé la clé des hiéroglyphes ; on sait aujourd’hui que sa clé n’ouvrait rien, et que son égyptologie était aussi imaginaire que ses opéras. Car il était poète et il écrivait pour le théâtre. Dutens avait plus d’érudition que de critique, et ce sont là en somme des autorités contestables. Il est vrai que Papus fait aussi quelques emprunts au livre récent de M. Saint-Yves d’Alveydre [1842-1909] sur la Mission des Juifs [1884]. J’avoue ne connaître ni M. d’Alveydre, ni son ouvrage. Mais ce serait un grand hasard qu’on y trouvât la preuve de tout ce qu’avance Papus, savoir : que les anciens connaissaient les lois de la gravitation, le mouvement de la terre autour du soleil, le télescope, le microscope, la réfraction de la lumière, l’isochronisme des vibrations du pendule, les armes à feu, la traction par la vapeur, le paratonnerre, le télégraphe électrique, la photographie et la circulation du sang. C’est là une chose difficile à croire. Sans disputer de la photographie, ni du reste, puisque Papus est médecin, je le prierai de se rappeler qu’on enseignait à Alexandrie que les artères sont remplies d’air. D’ailleurs la géographie de Strabon et le système de Ptolémée précisent la limite des connaissances scientifiques des anciens.
À quoi Papus me répond :
— Je parle de la Science et non des sciences. Et LA SCIENCE fut de tout temps [page 183] cachée, du caché, et cachant, SCIENTIA OCCULTA, OCCULTATI, OCCULTANS. Ptolémée et Strabon étaient des savants ; ils n’étaient pas des mages.
— Si votre science a jamais existé, ô Papus, ce dont j'ai mille raisons de douter, comment s’est-elle conservée ?
— Il ne s’en est conservé que des débris informes et d’obscurs monuments.
— Comment la connaissez-vous donc ?
— Nous la restituons sur quelques vestiges épars, comme Cuvier a restitué le dinothérium.
— Quels sont ces vestiges ?
— La table de Porphyre et généralement les textes hermétiques.
— Ils sont apocryphes.
— Ils sont anciens.
— Médiocrement anciens et non médiocrement apocryphes.
— Apocryphes tant qu’il vous plaira. J’admire, en vérité, le dédain de la science moderne pour les apocryphes !
— Vous avez raison, ô Papus ; mais les textes dont vous parlez sont d’hier. Ils ne remontent pas plus haut que le néo-platonisme et que la gnose.
— La gnose était une partie de LA SCIENCE ! Dans le peu qui nous reste des écrits des gnostiques, nous faisons de précieuses découvertes. D’ailleurs, la tradition n’est pas si bien rompue qu’il n’en reste quelques chaînons dans les sociétés secrètes. J’ai été assez heureux pour interpréter certains signes, certaines pratiques, conservés de nos jours par les rose-croix et par les francs-maçons, mais dont les initiés eux-mêmes avaient complètement perdu le sens.
Dans ce petit dialogue, j’ai laissé le dernier mot à mon contradicteur. C’est courtoisie pure et je déclare qu’il ne m’a pas convaincu.
Je crois que l’occultisme, tel que le conçoit Papus, est très moderne, et qu’il n’a pas pris la forme et les caractères qu’il revêt aujourd’hui qu’à la fin du dernier siècle. C’est là sans doute une opinion extrême ; mais celle de Papus aussi était extrême. C’est une loi de l’esprit que les contraires s’appellent. Un troisième terme en naît et c’est ce qu’en science occulte on appelle le ternaire. Exemple
Homme, femme, enfant.
Solide, fluide, gaz.
Un quatrième terme ramène le ternaire à l’Unité. Exemple :
Je ne puis me défendre de trouver à votre ternaire quelque air de famille avec certain vieillard anguleux et sec, que j’ai connu sur les bancs du collège, un certain maître Férulus qui n’avait que trois cheveux et trois dents, crochu du bec, le crâne pointu comme un œuf, béquillard et tortillard qui, de son vrai nom, s’appelait le Syllogisme. Dieu me pardonne ! et veuillent en faire autant Hermès et Zoroastre ! Mais il me semble que le ternaire et le syllogisme se ressemblent comme deux frères, et qu'on les croirait échappés ensemble des genoux de saint Thomas d'Aquin.
D’ailleurs la magie est d’un large syncrétisme. La scolastique y reconnaîtrait ses méthodes de raisonnement, Hegel sa thèse de l'identité de l’idée et de l’être, Kant son impératif catégorique, Schopenhauer sa théorie de la volonté, mais retournée et dirigée [page 184] vers un optimisme absolu. Je ne parle pas de Platon, puisque la magie est une sorte de néo-platonisme qui pousse la doctrine de la réalité des idées jusqu’à soutenir qu’une idée peut se promener sur les boulevards la canne à la main, en fumant une cigarette, ou venir, la nuit, pendant que vous dormez, vous enlever délicatement le cœur et le remplacer par une éponge. Notre Papus, pour sa part, est platonicien comme l’était Apulée, c’est-à-dire avec beaucoup de diablèmes [sic]. Et puisque nous nommons Apulée, j’avoue avoir souvent conversé avec cet Africain mystique et sensuel. Eh ! bien, après une conversation avec Papus, je me suis écrié involontairement : — C’est Apulée !
Mêmes contrastes de santé forte et de complexion spiritualiste ; même ardeur de parole (Apulée était grand conférencier) ; même imagination brûlée ; même goût de science un peu pédante et de mysticisme bizarre, enfin le même homme. Pour peu qu’on croie à la métempsycose [Note de Philippe Encausse : « Anatole France commet là une petite erreur. Il confond, en effet, métempsychose et réincarnation »] on se persuadera certainement qu’Apulée et Papus font un seul être, à cela près qu’Apulée écrivait dans un latin d’Afrique aromatisé et pimenté, d’un goût plus mordant que le style, très convenable d’ailleurs, du Traité élémentaire de Science occulte.
Ce traité nous enseigne que la magie tout entière est fondée sur l’analogie, c’est-à-dire sur la considération des similitudes qui relient entre elles les choses différentes. Je n’y vois pas d’inconvénient. C’est le procédé instinctif et naturel des poètes, qui sont, à tout prendre, les premiers philosophes du monde, quand ils ne sont pas les derniers des humains. Au reste, toutes les voies de l’esprit mènent à la vérité et à l’erreur.
![]() — Tout est analogie, disent les mages : la loi qui régit les mondes régit la vie de l’insecte. L’homme est un petit monde dans le monde, un microcosme dans le macrocosme.
— Tout est analogie, disent les mages : la loi qui régit les mondes régit la vie de l’insecte. L’homme est un petit monde dans le monde, un microcosme dans le macrocosme.
Et cela revient à l’idée de Hegel, que les lois de la pensée sont les lois du monde, et même, si l’on veut, à la doctrine de notre Renouvier qui subordonne l’univers à la loi morale.
Vraiment, il y a un peu de kantisme et beaucoup d’hégélianisme dans la philosophie de l’occulte. M. Vera, qui aimait tant la métaphysique, eût admis cette proposition de Papus : Les opposés ne sont que la conception à degrés différents d’une seule chose.
Sans vouloir entrer dans un exposé méthodique de la science magique, disons qu’elle aboutit à la divinisation de la volonté. « Le Thélème de tout le monde est la volonté », dit le mage. Ce Thélème commande à la nature physique et morale, et crée l’âme immortelle. Nous touchons ici au point le plus original de la doctrine. L’âme, y est-il dit, n’est pas congénitale à l’être humain. Elle est une résultante ; elle est le produit de la volonté bien dirigée, l’effet dont la cause est en nous. La vie est donnée à l’homme pour qu’il la transforme en une force plus haute : l’âme.
Victor Hugo avait coutume de dire que l’âme est facultative et qu’on est immortel seulement quand on le veut bien.
Et, s’exprimant en paraboles : « Un poète, disait-il, ayant écrit deux vers, quitta sa table de travail. En son absence, l’un, des vers dit à l’autre : « Je me sens immortel. » Et l’autre répondit : « Pour moi, je crains de ne point durer. » Le poète, rentré dans son cabinet, biffa le vers qui avait douté de son éternité glorieuse. » Cette fable est du magisme pur. Louis Lucas a dit expressément « L’âme est une création originale nous appartenant en propre. »
Il importe de vouloir. « De là l’emploi de certains objets, de certains caractères pour fixer la volonté dans les opérations magiques. »
Ces opérations auront-elles pour effet de produire des phénomènes contraires à l’ordre de la nature ? Non pas ! On ne sort jamais de la nature, et l’idée même du miracle [page 185] est absurde. Mais le mage, comme le Prospéro de Shakespeare, a le pouvoir de commander à la nature. C’est un physicien transcendant ; il agit sur le monde invisible qui double notre monde visible. Et il faut savoir que le monde invisible est peuplé d’Esprits élémentaires ou Élémentals, de Larves et d’Idées, agissant comme des êtres réels. Idées, Larves, Élémentals sont soumis à la volonté du mage. Quelle disgrâce de n’être point mage ! Ce doit être bien amusant. Mais ne l’est point qui veut. La plupart des êtres n’ont qu’une volonté faible et stérile : le Karma pèse sur eux. Ce Karma est une lourde nécessité faite de l’accumulation de nos actions passées. Nous portons un karma chargé du crime de nos existences antérieures. Telle faute, commise par nous dans une caverne préhistorique ou dans la case de roseaux d’une cité lacustre, nous pèse et nous opprime encore. C’est le karma. Nous ne serons mages que dans une existence ultérieure, si nous le sommes jamais ; mais tel de nous s’en ira lamentablement en larve ou en vampire. Et je n’ai pas vu que la magie enseigne la doctrine de la Rédemption finale des êtres [Dans l’Initiation, Philippe Encausse ajoute au texte cette note : « Anatole France ne fait pas mention, ici, de la théorie de la réincarnation qui permet à chacun de nous d’évoluer : « Naître, mourir, renaître et progresser sans cesse, telle est la loi », disent les Spirites. (Ph. E.) »].
Si nous avons ainsi causé de magie et interrogé Papus, c’est pour satisfaire une naturelle et perverse curiosité. Et puis une certaine connaissance des sciences occultes devient nécessaire à l’intelligence d’un grand nombre d’œuvres littéraires de ce temps. La magie occupe une large place dans l’imagination de nos poètes et de nos romanciers. Le vertige de l’invisible les saisit, l’idée de l’inconnu les hante et les temps sont revenus d’Apulée et de Phlégon de Tralles. M. Gilbert Augustin-Thierry [1840-1915], que les lecteurs de ce journal apprécient à sa haute valeur, a fondé, sur l’idée du monde magique, des drames d’une poésie neuve et d’un intérêt puissant, et il a noblement tenté de faire sortir de ces épouvantes et de ces mystères une morale et une philosophie nouvelles.
La bibliothèque magique s’accroît de jour en jour. Au Palimpseste et à la Tresse blonde, de M. G. A.-Thierry, s’ajoutent les Histoires incroyables et le Manuscrit à brûler, de M. Jules Lermina [1839-1915], le Horla, de M. Guy de Maupassant, Un Caractère, de M. Léon Hennique [1850-1935], les œuvres de deux poètes délicieux, Stanislas de Guaita [1861-1897] et Henri Jouny, et enfin les Éthopées du « sar » Joséphin Péladan.
Qu’est-ce que cela veut dire, sinon que l’esprit de l’homme est toujours tourmenté par la grande curiosité, que l’abîme l’attire et qu’il se penche avec une délicieuse horreur sur les bords brumeux de l’Inconnaissable ?
Anatole France.