 1834 - Examen de la doctrine de J. Bœhme et de Saint-Martin.
1834 - Examen de la doctrine de J. Bœhme et de Saint-Martin.
Philippe Hauger (1798-1838) - Philosophie religieuse.
Revue du progrès social
4e livraison - Avril 1834
Recueil mensuel politique, philosophique et littéraire publié par M. Jules Lechevalier
Année 1834 - I
Paris, au bureau du Journal, rue de Provence, 8, et chez Bachelier, libraire, quai des Augustins, 55.
Revue du progrès social, pages 408-437
L'article étant long, nous avons ajouté des sous titres entre crochets.
[Introduction]
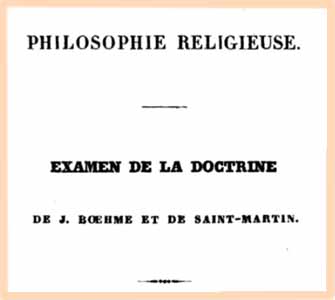 Le mouvement philosophique de notre âge a fait naître le besoin d'étudier les mystiques. La faim et la soif de la vérité devaient finir, en effet, par nous la faire chercher en dehors de toutes les méthodes scholastiques et de toutes les institutions régulières, formées en apparence dans l'unique dessein de la produire et de la propager, et ayant peut-être pour résultat de la voiler, de l'amoindrir, d'en retarder les développements, de l'exploiter en un mot, en la réduisant à la taille de ses interprètes officiels.
Le mouvement philosophique de notre âge a fait naître le besoin d'étudier les mystiques. La faim et la soif de la vérité devaient finir, en effet, par nous la faire chercher en dehors de toutes les méthodes scholastiques et de toutes les institutions régulières, formées en apparence dans l'unique dessein de la produire et de la propager, et ayant peut-être pour résultat de la voiler, de l'amoindrir, d'en retarder les développements, de l'exploiter en un mot, en la réduisant à la taille de ses interprètes officiels.
Quel penseur ne comprend aujourd'hui que si Charles Fourier, Hoëné Wronsky, Fabre d'Olivet, Ballanche, et quelques autres hommes de cette importance, sont aujourd'hui en dehors de la Sorbonne éclectique ; s'ils sont condamnés pour un temps à demeurer à peu près obscurs et méconnus, sous le coup de la perfide conspiration du silence, [page 409] ils ne sont pas pour cela en dehors du progrès humanitaire, qu'ils en sont peut-être les chefs, et que cette inique proscription, loin d'être un titre légitime au dédain et à l'oubli, pourrait être aussi bien une sorte de critérium de leur valeur philosophique et sociale ? Quel penseur ne s'est pas senti attiré, surtout dans les rêves de sa jeunesse pleine de sève et de vigueur, vers une science plus large que la science fragmentaire, aride et désenchantée des temps modernes ? Avant de se déterminer, par désespoir d'être compris, à suivre l'ornière tracée, c'est-à-dire a consumer ses heures à de niaises puérilités, pour obtenir l'inauguration de son nom, à propos de quelque mémoire à l'Institut, sur le nombre des mètres cubes d'eau passant, dans un temps donné, à travers un canal d'une dimension donnée, ou tout autre sujet d'égale importance, quel savant vraiment digne de ce nom n'a soupiré avec ardeur vers une époque où, dégagée des voies mesquines d'un terne individualisme, la culture intellectuelle, agrandie et fortifiée par l'association, dirigée par quelque haute pensée, rallierait à un foyer unitaire ses innombrables expériences de détail. D'ailleurs ces expériences ne peuvent recevoir que par là un sens et une valeur philosophique. Et, au moyen d'une synthèse nouvelle, l'on tenterait enfin de concilier et de satisfaire toutes les tendances de l'humanité, en rapprochant du triple flambeau de l'expérience, de l'observation et du calcul, le flambeau non moins imposant de l'imagination poétique, de l'érudition traditionnelle et de l'inspiration religieuse ?
Beaucoup d'hommes ont déjà sympathisé en France avec les puissants efforts de la philosophie allemande, pour légitimer ces nobles tendances de notre nature qui nous crient que nous ne sommes pas faits seulement pour nommer, analyser, mesurer, peser et décrire les productions de ce globe, mais bien plutôt pour nous en emparer comme de notre domaine, pour nous l'assimiler, le régir, et le pénétrer de toutes parts. La nature et l'homme n'ont-ils pas été [page 410] dans un rapport plus intime, et ce rapport ne pouvons-nous le reproduire ? Les admirables prévisions de de Maistre, opposant aux laborieuses et stériles investigations de la science moderne « affublée de l'habit étriqué du nord, le front sillonné d'algèbre, perdu dans les volutes d'une chevelure menteuse, (1) » la science intuitive des temps primitifs, fille radieuse de l'Orient, embrassant la nature dont elle comprend le symbolique langage, et agissant sur elle avec la sympathie et la puissance d'un amant, ces majestueuses paroles ne pourraient-elles pas servir de frontispice au siècle présent ? N'avons-nous pas besoin d'une immense restauration scientifique; et pouvons-nous nous attendre à trouver l’organon novum destiné à ce travail, dans les voies désormais épuisées de l'empirisme analytique de Descartes et de Bacon? Non, non sans doute. Et pour' me servir encore des paroles de ce saint Jean, précurseur de l'âge futur, qui, s'il n'a rien pu établir, a du moins tout pressenti : La Providence n'efface que pour écrire à nouveau.
Or, qu'a-t-elle effacé de notre temps ? Quel est le résultat de tout le mouvement philosophique et politique de notre époque ? Dans la science, l'annihilation de l'esprit scholastique qui procède par voie de syllogisme et d'analyse seulement, et dans l'ordre politique et religieux, l'annihilation du libéralisme et du protestantisme, en tant que doctrines critiques. Doctrines dominées par un esprit de défiance purement défensif, qui leur fait nier, à l'une, la nécessité d'une providence sociale, et à l'autre, celle d'une croyance unitaire imposée aux masses, pour s'absorber dans la préoccupation des intérêts individuels qu'elles réduisent à une désespérante nullité, et qu'elles tuent en les isolant (2). [page 411]
Cette importante prévision de de Maistre, que les grandes découvertes qui signaleront notre dix-neuvième siècle seront dues à l'emploi de la méthode hardie et aventureuse de l'hypothèse, et non pas à celle plus timide, plus défiante et plus laborieuse de l’analyse et de la démonstration scholastiques, est justifiée a la fois, et par la direction actuelle des travaux philosophiques de 1’Allemagne, et par l'application faite à l'industrie de la sublime hypothèse des destinées proportionnelles aux attractions.
Notre revue cherche à placer la société française à ce point de vue transcendental [sic] où l'on comprend,— comment d'une part l'appareil logique qui constitue l'entendement ne fournit à la philosophie que la forme de la connaissance, et sera éternellement impuissant à en légitimer didactiquement le fonds, donné à l'homme dans l'intuition de la raison pure ; — et comment, d'autre part, les passions, principe actif et recteur, se débattront contre tout pouvoir restrictif, aussi longtemps que la conscience n'aura pas obtenu la formule absolue du bien, à savoir l'équation du bonheur et de la vertu. Parvenu à ce terme, on est dans la meilleure disposition possible pour s'enquérir de la vérité en dehors de toutes les formes convenues, on ne connaît plus de grande route qu'elle soit tenue de prendre, d'uniforme obligé dont elle doive se revêtir, pour avoir droit à l'examen ; on peut alors, libre de tout préjugé, s'occuper avec fruit des écoles mystiques ou excentriques.
Ces écoles ont cru pouvoir s'emparer sans effort des sources du bien et du vrai, et y puiser toute connaissance, dans une intuition qui se pose, qui se sert de preuve à elle-même, et se légitime en coordonnant une multitude de faits par voie de ralliement au centre ou foyer qu'elles ont choisi. Ce foyer est toujours une hypothèse logiquement arbitraire, mais [page 412] d'autant plus voisine de la vérité qu'elle est moins laborieuse et plus attrayante, d'autant plus certaine qu'elle est moins démontrable au point de vue scholastique, d'autant plus puissante qu'elle satisfait davantage aux inspirations les plus compréhensives de l'âme. La base fixe donnée à la science par la philosophie mystique, que nous appellerions plus volontiers la théosophie, c'est l'utile et le beau, c'est-à-dire une vue téléologique, dont nous affirmons la vérité par cela seul que nous ne pouvons nous empêcher de la désirer, puisqu'étant donnée, cette vérité, elle satisferait à nos tendances instinctives, et expliquerait tout en reliant l'homme, l'univers et Dieu.
La synthèse du savoir et de l'être, de l'humanité et de la nature, tant cherchée dans les écoles philosophiques modernes, est le point de départ des mystiques ; elle est toujours supposée dans leurs écrits, elle doit être considérée comme l'idéal de la science et son critérium suprême. Les livres ouverts à la science humaine sont la langue de la nature, les traditions religieuses universelles, la conscience et la raison de l'homme isolé, l'histoire générale : tout principe en opposition avec quelqu'un de ces grands témoignages de la vérité universelle, est par là même frappé du caractère de l'erreur, puisqu'il répugne à quelqu'une des facultés qui nous constituent. Si tous ces témoins, au contraire, se contrôlant l'un par l'autre, déposent unanimement, quelle plus grande et plus solennelle sanction de la vérité pourrions-nous désirer ? Et pourtant il n'y aura pas la démonstration scholastique ; l'exigeance [sic] illégitime de ce genre de preuve serait, au contraire, le principal obstacle à l'acquisition du vaste ensemble de confirmations réciproques, qui peut seul engendrer le sentiment profond de la vérité absolue ou de la certitude. L'esprit humain n'arrivera jamais au sentiment de la certitude absolue que par la conciliation de toutes les tendances de notre nature. Il faut que la vérité morale, sociale, religieuse, nous arrive par toutes sortes de voies, afin que nous [page 413] obtenions cette intime et délicieuse satisfaction qui est un des plus grands besoins de notre être, de voir l'unité reproduisant dans l'immense variété des phénomènes sa glorieuse et ineffaçable empreinte.
La démonstration ne saurait jamais nous livrer le sens profond des origines, l'esprit des choses, leur synthèse et leur destination ; car la démonstration n'est que l'évolution de ce qui est renfermé dans une définition — de vérité conventionnelle, s'il s'agit de droit positif ou de problèmes linguistiques ; — de vérité absolue, mais bornée aux simples propriétés de l'étendue et du nombre, s'il s'agit de mathématiques.
C'est parce que nous sentons, avec Kant, que l'entendement n'étant que la faculté de coordonner en faisceaux, par l'application de ses diverses catégories, la matière de l'expérience sensible, ne peut nous conduire qu'à un ordre de vérités purement subjectives et relatives, profondément impuissant qu'il est à livrer autre chose à la raison pure, pour tout ce qui sort de ce domaine, que des antinomies insolubles ; c'est parce que nous répétons avec Fichte qu'une affirmation émanant des entrailles de l'homme, une croyance est nécessaire pour fournir à la science la base sur laquelle elle construira tout l'édifice dont elle sent invinciblement le besoin, croyance arbitraire au point de vue logique, mais à défaut de laquelle l'esprit flotterait éternellement sur un océan sans fond et sans rives ; c'est parce qu'avec Jacobi nous considérons les notions comme l'incarnation des sentiments ou leur schématisation, faisant ainsi dériver l'homme intellectuel de l'homme passionnel, que le vrai nous est apparu comme la manifestation du bien, n'ayant de valeur et de critérium réel qu'au point de vue téléologique ; c'est enfin parce qu'avec Schelling nous avons compris que le savoir intuitif était le seul organon suffisant à nous révéler la chaîne immense de toutes les transformations de l'être, toujours identique avec lui-même, dans la série de ses polarisations et neutralisations [page 414] successives, c'est, disons-nous, en considérant cette tendance unitaire si remarquable des écoles philosophiques les plus avancées, et frappés, comme nous ne pouvions manquer de l'être, de ses rapports avec la haute conception qui préside à la doctrine sociale de M. Fourier (3) , que nous avons été amenés à soupçonner la valeur des écrivains mystiques, eux qui, sans s'embarrasser des préventions et des prétentions de la raison spéculative, sans se laisser arrêter par ses méticuleuses fins de non recevoir se sont livrés avec abandon à quelque hypothèse favorite, et à son aide ont créé tout un monde.
Il résulte de tout le mouvement philosophique de notre temps, comme nous croyons l'avoir fait suffisamment pressentir, que ces sortes de tentatives n'étaient pas autant à dédaigner qu'elles ont dû le paraître aux époques où la manière de philosopher de Descartes, de Bacon et de Locke prévalait impérieusement. Nous pensons que l'esprit humain tend de toutes parts à se soustraire à leur joug, et qu'il est à la veille de se livrer à la systématisation synthétique avec autant d'obstination qu'il en a mis, pendant les trois siècles d'où nous sortons, à explorer, à l'aide de la méthode analytique, tous les filons de la connaissance expérimentale. Le second mouvement aura plus de grandeur, comme aussi de plus durables résultats : il correspond à la nécessité d'édifier, comme l'autre à celle de détruire ; il est organique, comme l'autre était critique ; il rétablira la paix et l'harmonie dans tous les domaines de la science, il conciliera les diverses branches également importantes de l'arbre encyclopédique, lesquelles ne pouvaient atteindre à leur perfection respective, par cela [page 415] seul qu'on les avait constituées en hostilité réciproque ; il légitimera par la science les pressentiments du poète ; il donnera un sens à l'histoire ; il fera de l'érudition une puissance philosophique et de la religion un flambeau.
[Bœhme et Saint-Martin]
Nous ne pouvons mieux entrer dans l'appréciation des écrits de Bœhme et de son disciple Saint-Martin qu'en montrant à quel point tous deux avaient pressenti, et avec quelle netteté et quelle éloquence ce dernier avait formulé, dès le commencement de ce siècle, l'importante distinction qu'on doit établir entre la raison critique, procédant par voie syllogistique et analytique, à l'aide des formes ou catégories fournies par l'entendement, et la raison pure ou intuitive spéculant sur une hypothèse ou croyance émanée d'un foyer supérieur. Quiconque se sera suffisamment pénétré de l'esprit actuel de la discussion philosophique en Allemagne, si bien résumé par M. Amédée Prévost à propos de F. Jacobi (4), sentira bien que c'est là le point capital, le levier destiné à soulever un nouveau monde intellectuel, et ne pourra s'empêcher d'être frappé de la singulière coïncidence des vues de l'école mystique avec celles des écoles le plus justement célèbres.
On lit au Ministère de l'Homme-Esprit, pages 407 à 410 (ouvrage de Saint-Martin) :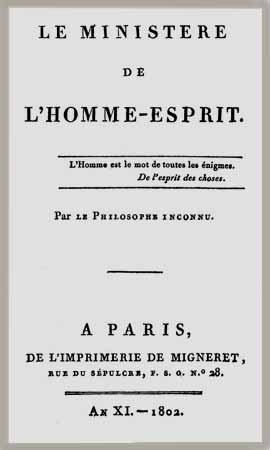
« Pourquoi les instituteurs religieux des peuples ont-ils souvent défendu que l'on marchât par la raison ? C'est qu'ils n'ont pas fait attention que s'il y a une raison humaine qui est contre la vérité, il y a aussi une raison humaine qui est pour elle. Ils sont sages et prudents lorsqu'ils nous défendent la première espèce de raison ; car, en effet, elle est l'ennemie de toute vérité, comme on le voit aisément aux outrages que font à cette vérité les docteurs dans les sciences externes qui sont l'objet et le résultat de la simple raison de ce monde naturel. La principale propriété de cette espèce de raison est de craindre l'erreur, et de ne se [page 416] livrer qu'avec défiance à ce qui est la vérité. Toujours occupée de scruter les preuves, elle ne laisse presque jamais à l'esprit le temps de goûter le charme des jouissances vives. Elle a une marche ombrageuse qui empêche que le goût du vrai ne pénètre jusqu'à elle. Voila ce qui entraîne à la fin les sociétés savantes dans l'incroyance, après les avoir retenues si longtemps dans le doute.
» Mais ils ne seraient plus ni sages ni prudents, s'ils nous défendaient l'usage de la seconde espèce de raison, parce que cette seconde espèce de raison est au contraire le défenseur de la vérité. C'est l'œil perçant qui la découvre continuellement et ne tend qu'à en faire apercevoir les trésors ; et, loin que sous ce rapport la raison soit condamnable, ce sera au contraire un crime pour nous de ne l'avoir pas suivie, puisque ce présent avait été fait à tous les hommes, dans le seul et unique but qu'ils s'en serviraient, et dans la persuasion où est l'agent suprême que ce flambeau, en se présentant humblement au foyer de la lumière universelle, eût suffi pour nous apprendre tout et nous conduire à tout.
» En effet, comment l'agent suprême aurait-il pu exiger que nous crûssions à lui et à toutes ses merveilles, si nous n'avions pas, par notre essence, tous les moyens nécessaires pour les découvrir ? Oui, la vérité serait injuste, si elle n'était pas clairement et ouvertement écrite partout aux yeux de la pensée de l'homme. Si cette éternelle vérité veut être crue, elle et tout ce qui dérive d'elle, c'est qu'il nous est donné, à tous les pas, de pouvoir nous assurer de son existence, et cela, non pas sur le témoignage de la simple assertion des hommes, ni des ministres même de la vérité, mais par des témoignages directs, positifs et irrésistibles.
» Car la croyance que vous faites naître quelquefois dans la pensée de vos prosélytes, quelque utile qu'elle soit, est bien loin de cette certitude qui doit s'appuyer sur de pareils témoignages. Ce n'est pas une chose rare que de rencontrer des hommes sur la croyance desquels on puisse exercer [page 417] quelque empire ; ce n'est pas même une chose rare que d'entendre dire dans le monde qu'il n'y a rien de plus aisé que de croire ; on y trouve même des gens qui prétendent qu'ils croient en effet tout ce qu'ils veulent.
» J'accorde cela pour la croyance aveugle, parce qu'elle ne consiste qu'a écarter l'universalité et à ne saisir qu'un seul point. Dès lors on est dispensé de toute comparaison ; et même par cette loi, plus on descendra dans les particularités, plus on sera disposé à croire, ce qui explique le fanatisme des superstitieux, qui est en raison directe de leur ignorance.
» Mais je le nie par rapport à la certitude, qui est l'opposé de la croyance aveugle, parce qu'on n'arrive à cette certitude qu'a mesure que l'on monte vers l'universalité ou vers l'ensemble des choses, attendu que lorsque l'on fait des confrontations dans cet ensemble des choses, et qu'on y découvre l'unité ou l'universalité de la loi, il est impossible que l'on n'ait pas la certitude. Et en effet, cette certitude est l'opposé de la croyance, parce qu'elle est en raison directe de l'élévation et des connaissances. »
[Foyer passionnel (moral) et foyer rationnel]
Quant à la supériorité et à l'antériorité du foyer passionnel par rapport au foyer rationnel, Saint-Martin, d'accord avec Jacobi et Fourier, s'exprime ainsi :
« Comme tout est amour, et comme la parole est l'hymne continuel et universel de l'amour, cette parole remplit toutes les voies de l'homme par des progressions douces, appropriées à tous les degrés de son existence. C'est pour cette raison que, pour l'âme humaine, tout commence par le sentiment et l'affection, et que c'est par là que tout se termine.
» Aussi notre intelligence ne se développe qu'après que notre être intérieur a éprouvé en soi-même les premiers sentiments de son existence. C'est ce qui se fait connaître dans l'âge où l'homme va commencer à penser. A cette époque de notre vie, nous sentons naître en nous un foyer neuf et une sensation morale que nous ne connaissions pas auparavant. L'intelligence ne tarde pas à donner aussitôt des signes de sa présence ; [page 418] mais cela n'arrive, à cet âge-là, qu'après que le foyer moral (passionnel) s'est développé.
» Dans un âge plus avancé, la sève monte à force vers la région de notre intelligence. Aussi, c'est alors que les savants mettent les idées avant le moral, puisque même ils l'en font dépendre, comme ils font dépendre les idées des sensations et des objets externes.
» Mais si ce foyer moral de sentiment et d'affection a l'initiative par droit de nature, il faudrait par conséquent que tout lui revînt en dernier résultat, comme nous voyons que les aliments que nous prenons ne nous sont utiles et ne remplissent leur objet qu'autant qu'ils portent leurs sucs et leurs propriétés jusque dans notre sang ou dans le foyer de notre vie.
» Aussi sera-t-on obligé de convenir que toutes les clartés que l'intelligence des hommes acquiert par le raisonnement ne leur servent qu'autant qu'elles pénètrent jusqu'au foyer moral, où elles apportent chacune l'espèce de propriété dont elle est dépositaire. C'est un tribut et un hommage qu'elles doivent rendre toutes à cette source, en venant témoigner par le fait le caractère de leur relation avec elle. » (Ministère de l'Homme-Esprit, pag. 421, 422.)
[Analogie du bien et du vrai]
Qu'il me soit permis d'insister encore sur cet important principe de l'analogie du bien et du vrai, que je voudrais pouvoir présenter dans cet article, sous tous ses aspects, au moyen des innombrables formules qu'il a revêtues, dans les écoles mystiques, dans celles de la philosophie allemande moderne, et dans celle de M. Fourier. Ce principe est la base de la philosophie, de la religion et de la science sociale. Nul ne peut le méconnaître dans la formule des destinées proportionnelles aux attractions, qui est la clé de voûte de la théorie sociétaire. Ce principe, en effet, ne fût-ce qu'à cause de sa fixité et de sa permanence, implique nécessairement l'aveu de la supériorité de l'être passionnel sur l'être intelligent. Si M. Fourier a tant déclamé contre la raison et les philosophes, c'est qu'il ignorait les deux espèces de raison et les deux [page 419] espèces de philosophie que les mystiques ont distinguées avec tant de netteté et de soin. Il ne s'est pas douté que cette méthode psychologique, pour laquelle il exprime en mille endroits de ses écrits une si juste et si profonde aversion, avait conduit pourtant des hommes tels que Kant, Fichte, Schelling, Jacobi, etc., à reconnaître que leur vie entière s'était épuisée en de vaines recherches ; il ne s'est pas douté que, selon l'éloquente expression de madame de Staël, la philosophie, magicienne irritée, après avoir tout détruit, avait incendié son propre palais, c'est-à-dire qu'examinant avec curiosité son propre instrument, l'appareil des formes de l'entendement, elle l'avait reconnu et déclaré inhabile à lui livrer autre chose que l'apparence, la vérité purement subjective et relative du phénomène, sans valeur dans les applications qu'on en pouvait tenter hors du domaine étroit de l'expérience sensible. Par conséquent force était à la philosophie de s'adresser à une faculté plus puissante, à une plus haute raison, prenant son point de départ, ou la première hypothèse nécessaire à toutes ses recherches, dans le principe attractionnel. Elle est donc enfin posée, comme inébranlable base à toutes les constructions scientifiques de l'avenir, cette affirmation arbitraire au point de vue logique, mais toutefois nécessaire et sublime, que la valeur de tous les faits sociaux, moraux, religieux, physiques et physiologiques même est déterminée, comme bonne ou mauvaise, par leur conformité ou leur opposition avec le génie de l’humanité, ses désirs, ses besoins, ses tendances natives, son attrait indestructible, et qu'il doit y avoir unité, plan général subordonné à l'homme, ainsi science synthétique de Dieu, de l'homme et de la nature.
Il faudrait faire une telle science, si elle n'était pas faite ; mais on en retrouvera partout les traces. Les illusions même en ce genre vaudraient mieux que les connaissances arides et fragmentaires qui nous sont données par la simple méthode analytique, parce que ces illusions correspondraient du moins a ce qu'il y a de plus vivace et de plus actif dans [page 420] l'homme ; elles satisferaient, par exemple, son génie poétique et religieux en vertu de quoi il veut impérieusement que tout lui soit subordonné, et la conscience de sa dignité, qui lui crie que le vrai ne pouvant être que la forme de son bien, le point de vue des causes efficientes, recherché en dehors du lien téléologique qui unit toutes choses, ne peut constituer qu'une science puérile et menteuse, sans valeur, parce qu'elle est sans grandeur, sans rapport avec nos plus immenses, nos plus pressants et nos plus impérissables besoins. L'humanité protesterait donc nécessairement, éternellement contre cette science brisée, ces disjecta membra, qui ne lui livrent le dernier mot de rien, si prétendant, comme elle l'a fait pendant trois siècles, constituer autre chose qu'une simple nomenclature, une pure description des phénomènes, une démonstration qui n'atteint que l'écorce des êtres, elle osait se produire comme le dernier terme de la connaissance permise et promise à l'homme ; laissant ainsi le roi de la création dans l'affreux désert de toutes ses espérances déçues, sous le coup d'un martyre incessant, dans l'attente continuellement trompée d'un bonheur qu'elle lui rendrait impossible, puisqu'elle ne lui fournit aucun idéal de ce bonheur, et aucun moyen d'y parvenir. Assez et trop longtemps nous nous sommes laissés diriger par l'idolâtrie de la raison logique, principe qui commence par anéantir l'être sublime qui, en nous, est la mesure et la clef de toutes choses ([texte en grec illisible]) principe funeste qui nous impose pour devoir la prétendue observation impossible des faits, comme si nous n'en étions pas nous-mêmes le sens et le lien ; comme si nous ne portions pas en nous cette vie qu'on nous dit d'aller puiser au dehors ; comme si nos opinions étaient jamais autre chose que le masque de nos affections ; comme si l'homme sans désir, ne serait point par là même sans intelligence ; comme si, pour tout homme, pour toute secte, pour toute époque, l'édifice scientifique n'avait pas toujours été la rigoureuse expression de ses tendances morales et passionnelles ; comme si la foi [page 421] et le désir de l'homme n'en étaient pas les prestigieux artistes, qui rendent vrai ce qu'ils veulent, qui le feraient être s'il n'était pas.
[Une philosophie plus compréhensive]
A l'instant où on le voudra, et bien que la pédantesque fatuité des historiens de la philosophie, des Brucke, des Tiedemann et des Tennemann, daigne à peine les honorer d'un regard, parce qu'ils sont en dehors de la grande route des bancs scholastiques, on trouvera dans les gnostiques, cabalistes et néoplatoniciens de l'école d'Alexandrie, et dans les écoles modernes Martinistes et Swedenborgistes, une philosophie plus compréhensive que ne l'ont pu faire les plus puissants efforts tentés de nos jours en Allemagne. Cette philosophie couronnera magnifiquement ces efforts, et légitimera toutes les tendances de la science nouvelle, tendances faibles encore et obscures, parce qu'elles sont inconscientes d'elles-mêmes, de leur vrai caractère et de leur destination. On verra avec admiration cet esprit philosophique agrandir et assurer le cercle de la connaissance ; l’agrandir par le principe de l'unité et de l'analogie, en ralliant toutes les sphères à l'histoire de l'homme, et en l'étudiant tout entier, c'est-à-dire autant dans son appareil passionnel que dans son appareil intellectuel ; l'assurer, en donnant à la science des critérium nouveaux, d'une importance infinie : 1° dans le point de vue téléologique, critérium pris de la nature même du vrai, qui n'est que la forme ou la manifestation du bien, toujours relatif à la réceptivité de l'être sentant et agissant ; 2° dans le principe de la vérité composée, qui fournit des contre-preuves, au moyen desquelles la certitude morale s'élève jusqu'au degré d'évidence qu'on ne croyait pouvoir atteindre que par le procédé mathématique. Lorsqu'une immense série de faits se coordonne en faisceaux se liant et se soutenant les uns les autres, et qu'on trouve en même temps l'empreinte de ces faits exprimés avec tous leurs détails, dans trois autres livres, tels que la Nature, l’Histoire et les Traditions, quand les rayons de la connaissance jusque-là en hostilité dans l'homme, [page 422] et qui faisaient de lui un royaume divisé avec lui-même, émanant majestueusement d'une même source, se rallient à un même foyer, l'homme en paix avec lui-même goûte le sublime repos qui résulte de l'harmonie active de toutes ses facultés, sorti pour jamais de la torpeur où le jetait le désespoir d'une connaissance incomplète et antinomique, il ne doute plus, il ne peut plus douter, il a reconnu qu'il portait à son doigt cet anneau e Gygès qu'il avait si vainement cherché partout. Suprême hiéroglyphe, auquel tous les autres se rapportent, ce que l'homme lit en lui, il le voit confirmé au dehors; clé universelle, sa parole ouvre tous les domaines ; ils lui apportent tous leur tribut ; ils viennent tous lui rendre hommage.
[La Voie de la Science divine]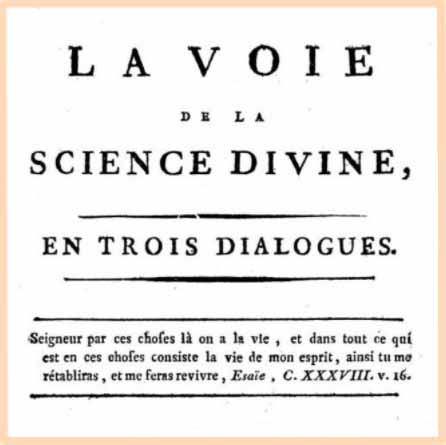
Par quelques citations de Saint-Martin, mises en rapport avec les débats actuels des écoles allemandes, et avec le principe attractionnel, base de la théorie sociétaire, j'ai cherché à faire voir que les mystiques avaient formulé nettement ce qui ne parait être encore, dans ces écoles, qu'à l'état d'obscur pressentiment, j'aurais pu mettre cette importante connexion dans tout son jour, en examinant Swedenborg, qui a été le plus didactique de tous les théosophes ; je me bornerai a faire une citation de Bœhme, dans le même sens. Elle est extraite d'un ouvrage que sa lucidité, son élégance toutes françaises, jointes à sa profondeur germanique, rendent infiniment précieux, bien qu'il soit presque inconnu, comme l'est aujourd'hui à peu près tout ce qui est vraiment remarquable. Je veux parler de La Voie de la Science divine, de Law, traducteur anglais du célèbre théosophe de Gœrlitz. Cet ouvrage me paraît contenir tout ce qu'on peut assimiler à l'état actuel de notre culture philosophique et religieuse, dans la doctrine de J. Bœhme, si prodigieusement excentrique, et, de plus, presque inintelligible dans l'original. Voici ce passage, 208 à 212.
« Je suppose que, guidé par votre raison incertaine, vous soyez parvenu à vous donner des doutes sur l'essence divine, [page 423] et sur les soins de la providence de Dieu à votre égard, en vain alors auriez-vous recours aux démonstrations des philosophes païens, ou à celles des théologiens, des déistes ou des athées, même quant ils conclueraient tous qu'il faut nécessairement qu'il existe une cause première éternelle de laquelle tout soit provenu. En effet, quel Dieu est celui-là, dont l'existence n'est prouvée que parce qu'il existe quelque chose, et que conséquemment il faut qu'il ait toujours existé quelque chose d'éternel et d'infini, qui ait eu le pouvoir de produire tout ce qui est venu en être ? Quel Dieu, dis-je, est celui-là que l'arien, le déiste et l'athée sont autant disposés à reconnaître que le chrétien, et qui sert également de base à l'édifice des uns et des autres ? car l'athée même admet une cause première, éternelle, toute-puissante, aussi bien que ceux qui disputent en faveur de l'existence d'un Dieu.
» Mais si, laissant de côté toutes ces vaines discussions et démonstrations de la raison humaine, vous rentrez au dedans de vous, à l'instant vous y trouverez une démonstration sensible et évidente par elle-même de l'existence du véritable Dieu de vie, de lumière, d'amour et de bonté, qui vous le rendra aussi manifeste que votre propre vie. En effet, l'existence réelle des sentiments de bonté, d'amour, de bienveillance, de douceur, de compassion, de sagesse, de paix, de joie, etc., ne vous est-elle pas démontrée d'une manière aussi certaine et aussi évidente que celle de votre propre vie ? Eh bien, l'être qui est la source, le principe et le centre de ces sentiments, c'est là le véritable Dieu évident par lui-même, et qui a voulu se révéler de telle manière que chaque homme le trouvât, le connût et le sentît aussi évidemment et aussi réellement qu'il sent et connaît ses propres pensées et sa propre vie ; c'est là ce Dieu dont l'être et la providence se font sentir en nous d'une manière si évidente, qui demande de notre part culte, amour, adoration et obéissance. Or, l'adorer, l'aimer, tâcher de devenir bon, comme lui, c'est véritablement croire en lui, d'après l'évidence qu'il nous donne de [page 424] la réalité de son existence. L'athée ne rejette point une cause première et toute-puissante, il ne fait que nier la bonté, la bienveillance, la douceur, etc., et tous les sentiments par lesquels la nature divine se rend évidente en nous, et s'y manifeste comme le véritable objet de notre culte, de notre amour et de notre adoration. Ce n'est donc qu'en ayant recours à cette démonstration d'évidence que nous trouvons en nous, que nous pouvons arriver à la seule vraie connaissance de Dieu et de la nature divine, et cette connaissance est à l'épreuve de toutes les objections de la raison, puisqu'elle est aussi évidente en nous que notre propre vie. Jamais on ne parviendra à connaître Dieu, en réalité, par aucune preuve extérieure, ni par autre chose que par Dieu lui-même, manifesté en évidence au dedans de nous. Ni le ciel, ni l'enfer, ni l'esprit pervers, ni le monde, ni la chair ne peuvent nous être connus, qu'autant qu'ils se manifestent en nous ; et la connaissance que nous en acquérons, indépendamment de cette évidence sensible qui résulte de leur naissance et de leur manifestation en nous, ressemble nécessairement à celle qu'un aveugle-né prétendrait avoir de la lumière qu'il n'a jamais vue.
» C'est ainsi que tout homme, par la nature de son être, naît, pour ainsi dire, à la certitude évidente et sensible de la réalité de toutes ces choses ; et si, à force de raisonner et de disputer, nous parvenons à en douter, c'est nous-mêmes qui créons notre incertitude, et elle ne vient point de Dieu ni de la nature. Dieu a ordonné toutes choses avec tant de sagesse, que les vérités qui sont pour nous de la plus grande importance, sont celles qui nous sont démontrées avec le plus de facilité et de certitude, puisque nous pouvons les connaître avec le même degré d'évidence, que nous connaissons, que nous souffrons, ou que nous avons du plaisir. Rien ne peut nous faire en réalité du bien ou du mal, que ce qui a pris naissance en nous. Aussi la religion n'est véritable pour nous, qu'autant qu'elle est devenue en nous principe de vie. Mais [page 425] dès que l'esprit et la vie de Dieu sont ainsi devenus vivants en nous, et qu'ils sont conséquemment évidents par eux-mêmes en nous, dès lors nous sommes dans la vérité ; cette vérité nous affranchit de tout doute, et nous n'avons pas plus d'égards à tout ce qu'une raison disputeuse peut opposer a notre croyance, qu'à ce qu'elle dirait contre l'évidence de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, et du sentiment que nous avons de notre propre vie. Mais délaisser cette démonstration d'évidence, pour se livrer aux doutes de la raison et à l'opinion, c'est vraiment abandonner l'arbre de vie, pour devenir le jouet de l'illusion. »
Un « magisme continu »
Après avoir essayé de faire compendre [sic] l'importance de ce grand principe de la philosophie mystique, ainsi formulée par Saint-Martin : chaque chose doit faire elle-même sa propre révélation, et par Bœhme : le développement de tout être est un magisme continu ; ce qui veut dire que rien n'est réellement assimilé à un être que par l'action de sa volonté, organe de son amour, et que rien de ce qui a été ainsi communiqué ne peut plus lui être enlevé par les doutes qui naissent de l'exercice de la raison spéculative agissant dans l'isolement ; après avoir montré que tous les efforts de la science étaient venus se résumer, pour les écoles allemandes, dans la négation des droits de cette raison critique isolée ; après avoir enfin mis en lumière l'identité de ce principe avec celui des destinées proportionnelles aux attractions, base de la théorie sociale proposée par M. Fourier, il me reste à soutenir ce parallèle par l'exposition rapide de quelques autres rapports, si essentiels et si frappants, qu'ils semblent faire de l'une de ces doctrines le simple développement des autres.
Nous avons déjà vu que l'école mystique considère l'homme comme pivot de la nature, mesure de toutes choses; elle subordonne toutes les connaissances fragmentaires fournies par l'analyse à la science foyère ou rectrice, synthèse de Dieu, de l'homme et du monde, révélée par la raison intuitive et confirmée par les traditions. Le savoir empirique n'a [page 426] de valeur pour elle qu'autant qu'il peut être employé dans la construction de l'édifice élevé par ce savoir de plus haute origine, dont le propre est de relier en systématisant. Elle s'occupe autant du pourquoi et du comment des choses, autant du rapport des moyens aux buts, que de celui des causes aux effets. Bien que l'école sociétaire n'ait pas encore complètement formulé sa philosophie, nous croyons qu'elle tend aussi à cet encyclopédisme unitaire et téléologique, que les écoles allemandes ont en vue dans leur célèbre formule de la synthèse du savoir et de l'être, et qui est l'esprit et la vie même de la théosophie.
Le système des correspondances ou analogies se retrouve dans les trois écoles. Pour Schelling et Kant, qui n'ont guères fait qu'énoncer le principe, sans lui donner les immenses développements qu'il comporte, c'est l'unité dans la variété, caractère suprême de l'ordre et du beau ; pour les mystiques, c'est la langue de la nature, le monde visible devenant le relief du monde invisible. M. Fourier, d'accord avec eux, n'en diffère qu'en ce qu'il applique ses analogies à l'ordre social, tandis que Bœhme, Saint-Martin et Swedenborg les appliquent surtout à l'ordre religieux, et s'en servent comme de principal flambeau pour interpréter les antiques et obscures traditions de l'humanité.
Le système optimiste de la Théodicée de Leibnitz, si justement qualifié dans ce recueil d'hypothèse malencontreuse, puisqu'elle tend à paralyser l'activité humaine, en lui enlevant tout espoir de voir jamais guérir ses maux les plus graves et lever des obstacles qu'elle considère comme nécessaires, a été flétri à la fois par l'âcre ironie de Voltaire et la tristesse imposante de Lamartine et de Byron, alliés comme à dessein pour appliquer l'indélébile stygmate de leur réprobation commune à la plus lourde et à la plus funeste méprise qui ait jamais pesé sur l'esprit humain. Les écrivains les plus célèbres de l'Allemagne moderne, tant poètes que philosophes, les théosophes mystiques et l'école sociétaire ont [page 427] repoussé avec une égale force la conception absurde et ridicule de l'optimisme quand même. Pour Bœhme et Saint-Martin, comme pour M. Fourier, le globe et l'humanité sont dans un état subversif, seulement la vue pessimiste de ces théosophes est plus étendue encore que celle du réformateur social ; ils n'ont pas cru, comme lui, que le mal fût fatalement attaché a l'évolution préparatoire qui signale les premières périodes de l'existence d'un globe et aux convulsions de sa décrépitude ; ils ont jugé que le mal social et le mal physique devaient avoir eu pour cause le mal moral, parce que d'une part les traditions de tous les peuples déposent avec unanimité en faveur du dogme de la déchéance, et que d'autre part ils ont compris avec une foule de penseurs illustres (5), que la raison et la conscience pouvaient se rallier a ce dogme, en tant qu'on ne le séparerait jamais de la doctrine consolatrice d'une réhabilitation, et que non seulement ils peuvent s'y rallier, mais qu'ils lui fournissent à leur tour la plus imposante sanction.
Je ne pense pas que l'école sociétaire attache une grande importance à la solution qu'a donnée son fondateur du problème de l'origine du mal ; il est évident qu'il n'a traité ce sujet qu'accessoirement, soit qu'il le jugeât en dehors de son but, ou que la direction habituelle de ses idées ne lui permît pas de s'en occuper avec le soin qu'il réclame à un autre point de vue. M. Fourier s'est borné à peu près à cette simple assertion, que le Créateur ne pouvait empêcher la prédominance du mal dans l'enfance et la décrépitude d'un globe. C'était trancher, au lieu de la résoudre, la plus grave de toutes les questions religieuses. Il n'est pas hors de propos de remarquer ici que cette solution ne se lie en aucune façon à tout le reste du système sociétaire, qu'elle semble même le contrarier visiblement. Une des plus belles idées de M. Fourier, [page 428] qu'il a eue en commun avec les mystiques, est celle de la régénération de la nature, comme conséquence directe de celle de l'humanité ! Il a dit dans le même sens et avec la même portée que saint Paul : toutes les créatures gémissent attendant de l’homme leur délivrance. Il a représenté cette nature, impatiente de procéder à de plus belles créations, enchaînée par le désordre dans lequel persistent les sociétés. Comment, dès lors, l'humanité, pivot du monde, élément libre destiné à régir l'élément fatal, a-t-elle pu être arrachée par celui-ci à l'état de bonheur dont il nous la montre en possession dans Éden. Il a bien fallu, dans l'ordre des idées de cet écrivain, que l'humanité engendrât elle-même le mal moral ou social dont elle a été la victime, et que, par suite, la nature, esclave docile, engendrât le mal physique, par une création subversive rigoureusement correspondante à la subversion qui avait eu lieu dans l'élément supérieur ; il l'a bien fallu, dis-je, puisque la restauration de l'humanité dans l'état primitif de bonheur, ou état sociétaire, par la pratique universelle de la justice et de la vérité, pourra seule opérer, par correspondance, la restauration de la nature. Le principe analogique dépose donc contre l'hypothèse de M. Fourier sur l'origine du mal. Le principe attractionnel et le principe téléologique lui sont formellement opposés. En vertu du premier, tout ce que l'homme n'aimera jamais, tout ce qu'il ne saurait désirer, est absolument mauvais et n'a qu'une existence factice. Le mal est le chisme de l'être, et à ce titre n'a pas d'existence per se. On doit donc supposer, si l'on se laisse diriger par le flambeau de l'attraction, que la décrépitude et la mort, cette mort qui sera toujours le roi des épouvantements, disparaîtront; car elles constituent la victoire de l'élément fatal sur l'élément libre. Aussi l'Écriture dit-elle que le dernier ennemi qui sera vaincu c'est la mort. En vertu du second principe, qui est celui des causes finales, l'âme et la vie de toute la théorie sociétaire, le but de la création, à savoir l'état heureux et glorieux de l'humanité et du globe, ce [page 429] but une fois atteint, pourquoi les ferait-on retomber dans l'incohérence et le malheur?
Il faudrait faire de cet article un volume, pour donner seulement une faible esquisse de la théosophie de Bœhme et de Saint-Martin. Nous avons dû nous borner à indiquer son point de départ et son caractère principal, son étroite connexion avec l'état présent de la culture intellectuelle, en France et en Allemagne. La citation de Saint-Martin, par laquelle nous allons terminer ce travail, nous paraît ne pouvoir manquer de frapper les hommes disposés à regarder comme chimérique, ou comme trop vague, le rapprochement de doctrines qui en est la principale pensée. Ils y remarqueront encore un point commun entre le christianisme mystique et l'école sociétaire, le désir d'arracher l'homme à la passivité fataliste avec laquelle il se résigne au mal, que les fausses religions lui font considérer comme une expiation utile, tandis qu'a titre d'administrateur de la terre, seul organe de la Providence divine, l'homme doit sentir qu'il n'est placé sur ce globe que pour en éliminer toutes les sortes de souffrances et de désordres, par sa gestion unitaire, radicalement médicatrice, et non pas dérisoirement palliative.
« Nous ne pouvons guère nous dispenser de croire qu'indépendamment des fruits terrestres que la terre nous prodigue tous les jours, elle a encore d'autres fruits à produire. Le premier des indices que nous en ayons est de voir la différence qui se trouve entre les fruits sauvages que la terre porte naturellement, et ceux que nous lui faisons produire par notre culture, ce qui pourrait annoncer à des yeux pénétrants que la terre n'attend que le secours de l'homme, pour faire sortir de son sein des merveilles encore plus intéressantes.
» Un second indice est qu'il y a eu peu de nations païennes qui n'aient rendu un culte religieux à la terre.
» Enfin la mythologie vient appuyer notre conjecture en nous offrant les pommiers d'or placés dans le jardin des [page 430] Hespérides, en faisant enseigner aux hommes par une déesse l'art de l'agriculture, et en nous apprenant, selon Hésiode, que la terre naquit immédiatement après le chaos, qu'elle épousa le ciel, et qu'elle fut mère des dieux et des géants, des biens et des maux, des vertus et des vices.
» Si, de ces observations naturelles et mythologiques, nous passons à des traditions d'un autre ordre, nous verrons dans la Genèse (4, 11 et 12) qu'après le meurtre d'Abel il fut dit a Caïn : Désormais tu seras maudit sur la terre qui a ouvert son sein, et qui a reçu de ta main le sang de ton frère. Lorsque tu la cultiveras, elle ne te rendra point ses fruits.
» Or, nous ne remarquons pas que la terre ne puisse être labourée que par la main d'un juste, sous peine de demeurer stérile. Nous ne remarquons pas non plus que ce soit le sang des hommes qui s'oppose à sa fécondité. Lors donc qu'il fut dit à Caïn, après son crime, que quand il travaillerait la terre elle ne lui rendrait point ses fruits, tout nous engage à penser qu'il était question dans ce travail d'une autre culture que de la culture commune et ordinaire ; or, cette autre culture, quelle idée pourrions-nous nous en former qui ne rentrât pas dans le véritable ministère de l'homme-esprit, ou dans cet éminent privilège qui lui est donné de pouvoir faire sabbatiser la terre ; privilège toutefois qui est incompatible avec le crime, et qui doit cesser et être suspendu dans ceux qui ne marchent pas selon la justice.
» Mais nous ne pouvons guère pénétrer dans le sens du mot sabbatiser sans recourir aux sept formes ou aux sept puissances que Bœhme établit pour base de la nature.
» Il nous faut en outre reconnaître avec lui que par une suite de la grande altération, ces sept formes, ou ces sept puissances sont ensevelies dans la terre comme dans les autres astres ; qu'elles y sont comme concentrées et en suspension ; et que c'est cette suspension qui tient la terre en privation et en souffrance, puisque ce n'est que par le développement [page 431] de ces puissances ou de ces formes, qu'elle pourrait produire elle-même toutes les propriétés dont elle est dépositaire et qu'elle désire manifester, observation que l'en peut appliquer à toute la nature.
» Enfin, il nous faudrait retracer le tableau de l'homme qui annonce universellement une tendance à tout améliorer sur la terre, et qui fut chargé par la sagesse suprême, selon Moïse, de cultiver le paradis de délices, et de veiller à sa conservation.
» Or, quelle pouvait être cette culture de la part de l'homme, sinon de maintenir en activité, selon les mesures et proportions convenables, le jeu de ces sept puissances ou de ces sept formes, dont le jardin de délices avait besoin, comme tous les autres lieux de la création.
» Il fallait donc, par conséquent, que l'homme fût dépositaire du mobile de ces sept puissances pour pouvoir les faire agir selon les plans qui lui étaient tracés, et pour maintenir ce lieu choisi dans son repos ou dans son sabbat, puisqu'il n'y a de repos ou de sabbat pour un être qu'autant qu'il peut librement développer toutes ses facultés.
» Aujourd'hui, quoique le mode de l'existence de l'homme ait prodigieusement changé par l'effet de la grande altération, l'objet de la création n'a pas changé pour cela, et l'homme-esprit est encore appelé à la même œuvre, qui est de faire sabbatiser la terre.
» Quant à ces sept puissances renfermées aujourd'hui dans la terre comme dans toute la nature, nous en voyons une image sensible dans le phénomène physique que notre atmosphère offre a nos yeux quand par la présence du soleil les nuages se fondent en eau.
» Cette substance aqueuse, qui, selon de profondes et justes observations, est dans toutes les classes le vrai conducteur ou le propagateur de la lumière, présente en remplissant l'espace un miroir naturel aux rayons solaires. [page 432]
» Ceux-ci, en pénétrant dans le sein de cet élément, marient leurs propres puissances avec celles dont il est lui-même dépositaire, et par cette féconde union le soleil et l'eau, c'est-à-dire la région supérieure et la région inférieure, manifestent aussitôt à notre vue le signe septénaire de leur alliance, qui est en même temps le signe septénaire de leurs propriétés, puisque les résultats sont analogues à la source qui les engendre.
» Ce fait sensible et physique nous offre, en nature, l'enseignement le plus instructif sur l'état de concentration et d'invisibilité où sont ces sept puissances dans la nature, sur la nécessité que leurs entraves se rompent pour qu'elles puissent rentrer dans leur liberté ; sur l'action constante du soleil, qui ne travaille qu'à faciliter leur délivrance, et à montrer ainsi à tout l'univers qu'il est ami de la paix, et qu'il n'existe que pour le bonheur des êtres.
» Lorsque cette pluie, ainsi fécondée par le soleil, descend sur la terre, elle vient opérer, en se mariant avec elle à son tour, les salutaires résultats de la végétation, que nous secondons par notre travail et dont nous recueillons les heureux fruits, et c'est ainsi que la vie, ou le sabbat matériel de la nature, se propage par des progressions douces, depuis le chef solaire jusqu'à nous.
» Mais ce phénomène physique et figuratif, et tout ce qui en est le résultat, s'opère sans le ministère spirituel de l'homme, et cependant c'est à l'homme à faire sabbatiser la terre ; aussi avons- nous reconnu ci-dessus qu'elle attendait de lui une autre culture.
» Je ne craindrai point de dire que ce glorieux sabbat que l'homme-esprit est chargé de rendre à la terre est de lui aider à célébrer les louanges de l'éternel principe, et cela d'une manière plus expressive qu'elle ne le peut faire par toutes les productions qu'elle laisse sortir de son sein.
» Car c'est là le terme réel où tendent tous les êtres de la [page 433] nature. Leurs noms, leurs propriétés, leurs sept puissances, leur langue enfin, tout est enseveli sous les décombres de l'univers primitif ; c'est à nous à les seconder dans leurs efforts pour qu'ils puissent redevenir des voix harmonieuses et capables de chanter chacun dans leur classe les cantiques de la souveraine sagesse.
» Mais comment chanteront-ils ces cantiques si cette souveraine sagesse n'employait un intermède pour pénétrer jusqu'à eux, puisqu'elle leur est si supérieure, et si par son représentant et une image d'elle-même elle ne leur faisait pas ainsi parvenir ses douceurs ?
» Nous ne cherchons plus à établir ici que l'homme est cet intermède ; tout ce qui a précédé n'a eu pour objet que de nous amener à cette persuasion, et malgré les nuages ténébreux qui enveloppent la famille humaine, malgré le poids énorme du fardeau qui l'accable depuis qu'elle a été plongée dans la région de la mort, je me plais à croire que parmi mes semblables il s'en trouvera encore qui dans cette sublime destination n'apercevront rien que leur véritable nature désavoue, et peut-être même, ne fût-ce qu'en perspective, ils n'en envisageront pas le charme sans tressaillir. Ne nous occupons donc ici que de chercher à quel prix l'homme peut parvenir à s'acquitter de cet important ministère.
» Ce ne peut être qu'en employant ces mêmes puissances, qui sont cachées dans son être corporel comme dans tous les autres êtres de la nature; car l'homme étant l'extrait de la région naturelle, de la région spirituelle et de la région divine, les sept puissances ou les sept formes qui servent de base à toutes choses doivent agir en lui, mais d'une manière diverse et graduée, selon son être naturel, selon son être spirituel, et selon son être divin ou divinisé.
» Mais, pour qu'elles puissent agir en lui dans quelques-unes de ces classes qui le constituent, il faut que ces puissances elles-mêmes soient ramenées en lui à leur état de liberté originelle. [page 434]
» Or, quand l'homme se contemple sous ce rapport, quand il considère à quel état de désordre, de désharmonie, de débilité et d'esclavage ces puissances sont réduites dans tout son être, la douleur, la honte et la tristesse s'emparent de lui au point que tout pleure en lui, et que toutes ses essences se transforment en autant de torrents de larmes.
» C'est sur ces torrents de larmes représentées matériellement par les pluies terrestres que le soleil de vie dirige ses rayons vivificateurs, et que par l'union de ses propres puissances avec le germe des nôtres, il manifeste à notre être intime le signe de l'alliance qu'il vient contracter avec nous.
» C'est alors, homme, que tu deviens susceptible de sentir les douleurs de la terre, ainsi que de tout ce qui constitue l'univers ; c'est alors qu'en vertu de l'énorme différence qui se trouve entre l'état infirme des sept puissances cachées dans la terre, et entre tes propres puissances revivifiées, tu peux apporter du soulagement à ses souffrances, parce que tu peux répéter à son égard ce qui vient de s'opérer sur toi. Enfin, ce n'est qu'en jouissant toi-même de ton propre sabbat et de ton propre repos que tu peux parvenir à la faire sabbatiser à son tour.
» Ce n'est que par là que tu deviens réellement le maître de la nature, et que tu peux l'aider à manifester tous les trésors qu'elle gémit de voir concentrés dans son sein, ainsi que tous ces prodiges et tous ces faits merveilleux dont les mythologies de tous les peuples et de toutes les traditions, soit sacrées, soit profanes, sont remplies, et qu'elles attribuent, les unes à des dieux imaginaires, les autres aux droits réels qui appartient à l'homme revivifié dans ses facultés par le principe même qui lui a donné l'être.
» C'est par là que tu peux en quelque sorte soumettre les éléments à ton empire, disposer à ton gré des propriétés de la nature, et contenir dans leurs bornes toutes les puissances qui la composent, afin qu'elles n'agissent que dans leur union [page 435] et leur harmonie ; car ce n'est qu'en agissant dans leur désordre et leur désharmonie qu'elles produisent ces formes et ces êtres monstrueux que l'on remarque dans les différents règnes de la nature. » (Ministère de l’Homme-Esprit, 135 à 142.)
[Détails biographiques]
Il nous reste a donner quelques détails biographiques sur ces deux grands théosophes.
Jacob Bœhme, connu en Allemagne sous le nom du philosophe teutonique, naquit en 1575, dans une petite ville de la Haute-Lusace, nommée l'ancien Seidenburg, à un demi- mille environ de Gœrlitz. Ses parents étaient de la dernière classe du peuple, pauvres, mais honnêtes. Ils l'occupèrent pendant ses premières années à garder les bestiaux. Il passa sa vie entière dans un état voisin de l'indigence, occupé des soins de sa profession de cordonnier concurremment avec les hautes spéculations religieuses qui l'ont rendu si célèbre. Il le fut beaucoup dans le dix-septième siècle ; il rencontra en Allemagne et en Angleterre surtout, un grand nombre de partisans, dont quelques-uns très distingués par leurs connaissances et d'autres par leur rang.
Au nombre de ces derniers, plaçons le roi Charles Ier, qui envoya à Gœrlitz Jean Sparrow, avocat, homme d'une vertu rare et d'un grand talent, pour étudier avec soin les profondeurs de la langue allemande, afin d'être en état de traduire parfaitement les œuvres de Bœhme en anglais. William Law est son autre traducteur dans cette langue. Saint-Martin nous a fait connaître ses principaux ouvrages, qui sont : l’Aurore naissante, les Quarante questions, et la Triple vie.
D'autres ont été traduits en latin. Ce sont .Mysterium magnum, et Signatura rerum. Bœhme mourut à Gœrlitz en 1620.
Claude-Louis de Saint-Martin naquit à Amboise en Touraine, d'une famille appartenant à la noblesse. Il manifesta, [page 436] dès sa jeunesse, la vocation la plus décidée pour les études religieuses et philosophiques, et spécialement pour la recherche des points de doctrine les plus obscurs : on peut dire de lui, avec plus de raison encore qu'on ne l'a dit de Kant, que, semblable à la colonne qui marchait en tête du peuple hébreu, dans son pèlerinage a travers le désert, nébuleuse pendant le jour et étincelante dans les ténèbres, il est embarrassé et diffus dans les choses faciles qu'on peut expliquer par des lieux communs, et admirablement lucide dans les choses difficiles et naturellement obscures.
Sa vie présente peu d'événements remarquables ; il avait été amené, par des circonstances complètement étrangères à ses goûts et à ses opinions, à embrasser la carrière militaire. Il sut féconder l'oisiveté des garnisons par de nombreux et importants travaux littéraires. La connaissance qu'il prit d'une mauvaise traduction d'un des ouvrages de Bœhme le remplit d'admiration pour le génie de ce théosophe, et lui fit sentir vivement l'assujétissement qui résultait des devoirs de sa profession. Il la quitta donc pour pouvoir visiter l'Allemagne, en apprendre la langue, peu répandue alors en France, dans le but unique de traduire lui-même les ouvrages de Bœhme, ce qu'il a fait pour les plus remarquables d'entre eux. Il n'émigra point à l'époque de la révolution. La considération qu'il avait acquise par sa vie studieuse et simple le fit même porter comme candidat sur la liste, présentée par l'Assemblée constituante, des noms parmi lesquels le pouvoir exécutif avait à choisir le gouverneur du dauphin. A l'exemple de Rousseau, qui refusa l'éducation du prince de Parme, Saint-Martin crut devoir se soustraire à une mission dont il n'attendait pas de bien possible. Il mourut en 1804, à la maison de campagne du sénateur Lenoir Laroche, son ami. Il avait blâmé le mode de conversion de La Harpe, et, fidèle à ses principes, il ne voulut à ses derniers moments le secours d'aucun ministre officiel de la religion. L'établissement d'une église externe, le métier de prêtre, la transmission d'un pou- [page 437] voir spirituel quelconque, à tout autre titre que celui de la sainteté, toutes ces choses résultant d'idées qu'il n'avait jamais pu admettre, lui apparaissaient comme la tentative d'une domination directement opposée à l'esprit chrétien.
Les ouvrages propres à Saint-Martin sont : l’Homme de désir, le Nouvel Homme, le Ministère de l'Homme-Esprit, le Crocodile, sorte de poème emblématique, dans la manière de Rabelais, écrivain dont Saint-Martin faisait le plus grand cas ; l'Esprit des choses, le Tableau naturel, et une brochure sur la révolution française.
Ph. Hauger
Notes
(1) J. de Maistre, Soirées de Saint-Pétersbourg.
(2) Il ne peut entrer dans notre intention de nier la haute valeur du protestantisme et du libéralisme comme protestations contre l'unité catholique et féodale, qui ne se relèvera jamais des coups qu'ils lui ont porté. Cette unité peu compréhensive, laissant hors de sa sphère un grand nombre d'intérêts, et d'ailleurs plus externe qu'interne, doit faire place à une unité plus large, plus intime et plus forte, que signalera sans doute notre siècle. Le protestantisme et le libéralisme seront jugés alors n'avoir été qu'une anarchie transitoire nécessaire entre ces deux systématisations.
(3) Le savoir intuitif ou immédiat correspond, par l'importance de ses résultats dans l’ordre scientifique, au travail attrayant dans l'industrie. M. Fourier a donné le plus bel exemple d'un immense développement intuitif dans son grand ouvrage, où rien n'est démontré scholastiquement, mais où tout est amené au plus haut degré de vraisemblance, par la seule coordination synthétique des idées.
(4) Voir notre livraison de février.
(5) Fabre d'Olivet, Ballanche, de Maistre, Hoëné Wronsky, etc.



